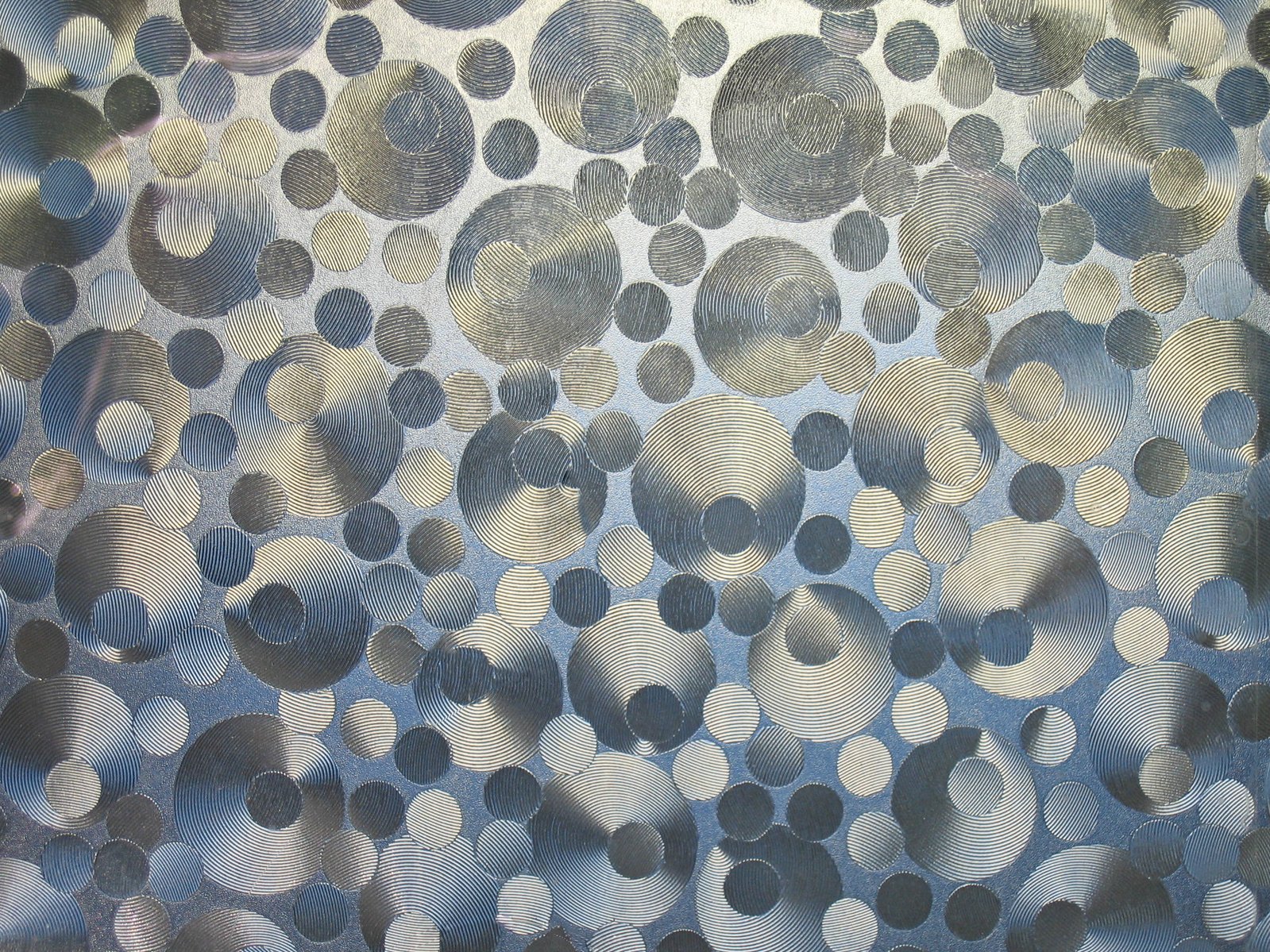Les passions selon Spinoza : un éclairage pertinent sur les mécanismes de l’addiction ?
Christine Leroy
[learn_more caption= »Résumé: »] Notre article se propose d’interroger le profit que pourrait tirer la psychanalyse d’une lecture spinoziste des passions, dans le cadre du traitement de l’addiction. Nous préciserons dans un premier temps la façon dont Spinoza définit la passion en lien avec le désir, et la manière dont il voit dans la passion quelque chose de positif. Nous nous attacherons dans un second temps à étudier le parallélisme entre spinozisme et quelques principes de la psychanalyse, afin de considérer dans quelle mesure il est ou non légitime de se revendiquer de Spinoza pour justifier une certaine approche thérapeutique de l’addiction. Nous postulerons enfin que la focalisation sur la « joie » plutôt que sur la « souffrance » est probablement ce en quoi Spinoza peut susciter un renouvellement de bon nombre d’approches psychothérapeutiques de l’addiction, lorsqu’elles sont confrontées à leur propre échec.
Introduction
 Notre étonnement naquit du constat que certains philosophes – « diplômés », du moins – semblent avoir pris un parti alternatif à celui de la transmission par l’enseignement : celui de la « philo-thérapie ». La plupart des « philo-thérapeutes » proposent des « consultations de philosophie », à la manière des maîtres de sagesse de l’Antiquité. Pourtant, ce n’est pas de stoïcisme dont il est question, mais explicitement, de « spinozisme ». Plus explicitement encore, de faire reposer leur « consultation » sur le livre III de l’Éthique du dit Spinoza.
Notre étonnement naquit du constat que certains philosophes – « diplômés », du moins – semblent avoir pris un parti alternatif à celui de la transmission par l’enseignement : celui de la « philo-thérapie ». La plupart des « philo-thérapeutes » proposent des « consultations de philosophie », à la manière des maîtres de sagesse de l’Antiquité. Pourtant, ce n’est pas de stoïcisme dont il est question, mais explicitement, de « spinozisme ». Plus explicitement encore, de faire reposer leur « consultation » sur le livre III de l’Éthique du dit Spinoza.
Au premier abord, on ne saurait manquer de s’étonner d’une telle proposition, et d’y voir une supercherie : a-t-on jamais fait reposer la guérison d’une souffrance psychique, peut-on raisonnablement faire reposer une démarche thérapeutique, sur un cinquième de livre, qui plus est destiné à d’autres fins qu’une thérapie ? Si l’on pouvait soigner l’âme par des lectures, cela se saurait ; mais hélas, les cabinets de psychanalystes sont plutôt fréquentés par des personnes cérébrales, dont aucune lecture n’a su panser les maux de l’âme.
Le pari des philo-thérapeutes d’obédience « spinoziste » est plus fou encore : les « passions », au sens de Spinoza, seraient l’ancien mot pour désigner les « addictions ». Du reste, Spinoza recourt fréquemment à la figure de l’alcolo-dépendant, preuve s’il en est qu’il a pour objet de résoudre le problème de la dépendance.
Si le pari est fou, il n’est donc pas sans fondement. Et si nous le tenions à notre tour, le temps d’une brève enquête ? Et si, pour reprendre le titre d’un ouvrage fameux de Damasio, « Spinoza avait raison[1] » ?
Notre cheminement partira d’un tel postulat. Nous nous demanderons dans quelle mesure il est possible de penser le concept de « passion » au sens de l’addiction, ce qui justifie son mépris au XVIIe siècle, et nous verrons par quelle subversion Spinoza réhabilite en partie la passion comme manifestation d’un certain conatus. Dès lors, nous considérerons la légitimité, avérée ou non, des thérapies de l’addiction par la médiation du spinozisme, et tracerons les linéaments d’une mise à profit d’un tel « pari » dans le domaine des psychothérapies plus « conventionnelles ».
Le XVIIe siècle est celui de la mainmise de la raison sur les passions, lesquelles sont traditionnellement associées à la déraison du corps. Le terme de « passion » en effet renvoie à la soumission, au fait de subir ce dont on n’est que l’acteur malgré soi : le verbe latin pateor est toujours employé au passif et renvoie au fait de subir quelque chose. L’individu passionné agit, mais il subit son agir. Il y a ainsi un paradoxe inhérent à la passion : j’en suis le jouet, tout en agissant ma passion. Au plaisir que je tire de cette activité se joint quelque chose de délétère, ce qui vaut de la haïr : lorsque Médée tue ses enfants, elle éprouve la jubilation de satisfaire sa furie, mais par son acte vengeur elle détruit sa propre progéniture.
Le théâtre de Racine et de Corneille reflète la préoccupation des penseurs du XVIIe pour la problématique des passions, et la manière dont il est possible ou non d’en triompher. Les passions semblent tout-à-fait déraisonnables ; or, la raison seule doit guider l’honnête homme.
Les « passions » chez Spinoza : une description de l’addiction ?
Dans un tel contexte opposant la raison et la spiritualité aux passions charnelles et terrestres, le discours tenu par Spinoza fait figure d’exception. Bien loin qu’il s’agisse chez lui d’une promotion d’un quelconque libertinage ou de la démesure, Spinoza prend acte du caractère délétère de la passion : la passion est bien une souffrance, comme l’indique son étymologie latine. À cet égard, elle est dangereuse. Plus exactement, la passion témoigne d’une ignorance, d’une erreur fondamentale, qui est, elle, cause potentielle de souffrance. Autrement dit, la passion est la conséquence potentiellement douloureuse de cette méconnaissance première : une « idée inadéquate ». Il y a certes des passions heureuses, lorsque quoique passifs et ignorants, nous recevons par hasard de quoi être en joie, mais les passions heureuses le seraient plus encore si elles ne résultaient pas d’une erreur. Car réciproquement, les passions, même heureuses un certain temps, suscitent méprise et idées inadéquates, de sorte qu’elles s’autoalimentent d’elles-mêmes dans le négatif ou finissent par devenir malheureuses :
Notre âme est active en certaines choses, passive en d’autres, savoir, en tant qu’elle a des idées adéquates, elle est nécessairement active en certaines choses ; en tant qu’elle a des idées inadéquates, elle est nécessairement passive en certaines choses[2].
(…) Il suit de là que l’Âme est soumise à d’autant plus de passions qu’elle a plus d’idées inadéquates (…)[3].
Mais ce que Spinoza affirme en même temps, c’est que la passion n’est pas en soi une nuisance : il s’agit seulement d’une force animatrice. En effet, le philosophe définit en Éthique III, proposition VI, le conatus ou « effort pour persévérer dans l’être » :
Chaque chose, autant qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans son être.
Or, s’il est naturel à toute chose de « persévérer dans son être », c’est-à-dire d’œuvrer à sa propre conservation, cette persévérance dans l’être se vit chez l’individu comme un « désir » ou « appétit » :
l’appétit […] est […] l’essence même de l’homme, de la nature de laquelle suit nécessairement ce qui sert à sa conservation ; et l’homme est ainsi déterminé à le faire. De plus, il n’y a nulle différence entre l’Appétit et le Désir, sinon que le Désir se rapporte généralement aux hommes, en tant qu’ils ont conscience de leurs appétits, et peut, pour cette raison, se définir ainsi : le Désir est l’Appétit avec conscience de lui-même[4].
Spinoza souligne ici l’inclusion d’une énergie vitale dans le désir. Le désir est une des formes prises par l’ « appétit » : si ce dernier est énergie, poussée, pulsion de vie, le désir se présente comme appétit conscient de lui-même. À l’énergie brute s’ajoute ainsi, dans le désir, la connaissance réflexive. Le désir est chose bonne chez Spinoza, qu’il faut satisfaire, car il est pulsion connaissant les causes qui la déterminent. Il ne s’agit pas seulement d’une conscience mais véritablement d’une connaissance causale. À l’opposé, la passion est un désir perverti, c’est-à-dire un appétit certes conscient mais ignorant des causes qui le déterminent – conscient de lui-même, mais non connaissant de ses causes. « Je sais que je souffre, mais je ne sais pas pourquoi » : voilà ce que dira un passionné.
Car si l’appétit est force motrice, que le désir s’applique à agir, elle est également force motrice subie dans le cas de la passion. La passion réside en effet seulement dans l’inadéquation de la connaissance que le sujet a des mécanismes causaux de son appétit. Autrement dit, si le sujet désirant connaît la causalité intime de l’appétit qui le meut, il est force active ; dans la passion au contraire, le sujet méconnaît la cause de son appétit, il méconnaît le fait qu’il est déterminé et ce qui le détermine. Il se croit à l’origine de son appétit, il le prend pour sa volonté propre, quand cet appétit est fallacieusement « happé » par une cause extérieure au sujet, sur laquelle il n’a pas prise. Réciproquement, si le sujet possède une connaissance adéquate de son appétit – s’il accepte de reconnaître et d’assumer ses pulsions en tant qu’elles lui sont propres – alors il est mû par son désir ; si en revanche il s’obstine à les déconsidérer, c’est-à-dire à en avoir une connaissance altérée – par exemple, il refuse de les considérer comme siennes –, alors il subit ces pulsions, sous la forme de la passion. La reconnaissance est donc une première étape : je reconnais être l’auteur de ma pulsion. Mais j’admets en même temps que je ne suis pas dépendant de l’objet que je vise à travers elle : si la pulsion m’est bien propre, alors elle n’est pas déterminée par l’objet qu’elle vise et je me libère du même coup de ma dépendance passionnelle.
Il est donc absurde de lutter contre la passion en soi : c’est lutter contre la force de vie qu’est le conatus. Lutter contre la passion, c’est lutter contre le sujet passionné, et donc diriger son combat pour la vie contre soi-même. Lutter contre le conatus revient dès lors à lutter contre la vie au nom de la vie même. La passion est adhérente au corps animé, et ne résulte que d’une méprise cognitive à l’égard de l’appétit. Lutter contre la passion, c’est donc récuser l’animation du corps, en supprimer l’appétit animateur même. Or,
Rien n’arrive dans la nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle[5].
Il n’y a pas de « faute » dans la nature à l’origine de la souffrance du passionné. Cette souffrance manifeste au contraire la prégnance d’une certaine vitalité en lui. La souffrance est la manière qu’a notre désir authentique de se rappeler à nous et de nous signifier combien l’objet de la passion ne le satisfait pas. La passion signe donc l’énergie de vie du sujet, en tant qu’il souffre. Il ne faut surtout pas supprimer cette force de vie.
Ce qui fait souffrir le passionné, c’est le fait d’être le jouet de cette animation, parce qu’il en méconnaît les mécanismes causaux, s’en croit à l’origine. Il s’y soumet parce qu’il la prend pour une nécessité : il est victime de l’illusion qui donne l’objet de la passion pour ce sans quoi il ne peut pas vivre. Il vit son appétit, cette pulsion de vie, sur le mode d’une soumission passive à un objet. Il en vient à se définir par cette soumission elle-même, il devient sa passion, parce qu’il méconnaît le caractère sien, et naturel, de l’appétit. C’est tout le propos de la préface à la troisième partie de l’Éthique :
Ceux qui ont écrit sur les Affections et la conduite de la vie humaine […]cherchent […] la cause de l’impuissance et de l’inconstance […] dans je ne sais quel vice de la nature humaine […]. Mais [rien] n’arrive dans la Nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle […]. Les Affections donc de la haine, de la colère, de l’envie, etc., […] suivent de la […] nécessité et de la […] vertu de la Nature.
Spinoza réprouve les moralisateurs ; quant à lui, il décide de ne pas attribuer de jugement de valeurs aux « affections ». Il les définit ainsi :
J’entends par Affections les affections du Corps par lesquelles la puissance d’agir de ce Corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même temps les idées de ces affections.
Quand nous pouvons être la cause adéquate de quelqu’une de ces affections, j’entends donc par affection une action ; dans les autres cas, une passion[6].
Qu’est-ce qu’être la « cause adéquate » d’une affection ? Est-ce la même chose que posséder une « connaissance adéquate » de l’appétit ? Si tel n’est pas le cas, quel est le lien entre ces deux logiques consécutives ?
Pour y répondre, il faut revenir très légèrement en arrière, aux deux premières définitions inaugurant la troisième partie de l’Ethique :
Définition 1 : J’appelle cause adéquate celle dont on peut percevoir clairement et distinctement l’effet par elle-même. J’appelle cause inadéquate ou partielle celle dont on ne peut connaître l’effet par elle seule.
La « cause adéquate » est ce qui signe son effet par elle-même : je vois la cause, et je peux en prévoir l’effet. La « cause inadéquate » en revanche est un fait qui ne nous laisse pas anticiper ses conséquences. Ainsi, la « cause adéquate » informe, elle donne une connaissance : celle de son effet. Je connais l’effet dès lors que je connais la cause adéquate. Il y a un rapport de nécessité entre la cause adéquate et l’effet de cette cause. À l’inverse, la « cause inadéquate » est une méprise quant aux mécanismes causaux, elle fonctionne souvent par métonymie ou déplacement. Elle est souvent « partielle » : il y a bien intuition d’un mécanisme de causalité, mais on ne le saisit qu’en partie et l’on prendra la partie pour le tout.
Aussi la « cause adéquate » est-elle une connaissance de la cause réelle, la « cause inadéquate » une illusion assignant à un fait ou une entité la cause d’un autre.
La passion consiste dès lors à se penser cause de ses affections, alors que leur cause est ailleurs.
Définition 2 : […] nous sommes actifs, quand, en nous ou hors de nous, il suit de notre nature quelque chose qui se peut par elle seule connaître clairement et distinctement. […] nous sommes passifs quand il se fait en nous quelque chose ou qu’il suit de notre nature quelque chose, dont nous ne sommes la cause que partiellement.
Ainsi, quand le sujet est lui-même la cause adéquate de ce qu’il produit, ou de ce qui se produit en lui (les affects), il est actif. À l’inverse, lorsqu’il est cause inadéquate, parce que ce qu’il ressent et ce qu’il fait dépend éminemment des choses extérieures, il est passif : il a une connaissance inadéquate de son propre désir et de ce qui le détermine. Il se trompe sur ce qui le meut. Il ne fait qu’agir une cause autre que lui-même. Aussi y a-t-il souffrance : l’individu s’éloigne de sa nature propre.
La passion est donc le contraire de l’action, mais elle se présente chez Spinoza sous les traits d’une réaction. Car il y va aussi de notre nature dans la passion : le sujet essaie de se réapproprier une certaine puissance sur lui-même. Mais plutôt que d’éliminer l’agent externe de son affect, ou de penser cet affect comme ne dépendant pas de lui, le sujet va s’imputer la causalité de cet affect. Autrement dit, plutôt que d’admettre qu’il n’est pas en cause, il va s’illusionner sur sa toute puissance. Il entre dès lors en conflit avec lui-même, puisqu’il agit un désir qui n’est pas le sien en se le donnant pour sien.
Ainsi, si le sujet a une connaissance inadéquate de son affect, c’est-à-dire s’il méconnaît la relativité de son affect à une cause extérieure à lui, sur laquelle il n’a pas prise, il sera tendu entre son conatus : le désir de persévérer dans son être et donc d’être moteur causal de soi, et une réalité de fait à laquelle il doit se soumettre, qu’il doit subir. Le conatus amène à s’illusionner sur la réelle cause de ses affects : je veux être cause, maître en ma maison. Je ne le suis pas. Deux solutions : soit je refuse ce qui m’est imposé, soit je m’y soumets en prétendant l’avoir décidé.
La « passion » n’apparaît donc pas vraiment comme une soumission, ce que devrait être, en toute logique, le contraire de l’action. La « passion » est un entre-deux entre action et soumission : dans la passion, le sujet est partiellement actif parce qu’il est partiellement connaissant. Il connaît quelque chose, quoique sur le plan de l’erreur : il connaît qu’il désire. Il se trompe en revanche sur la nature de son désir. Il devient le théâtre d’un conflit entre son désir de s’accomplir – le conatus – et la (mé)connaissance qu’il en a mais qu’il croit adéquate.
Il y a bien des passions heureuses : ce sont celles qui corroborent « heureusement », par hasard donc, le conatus. Par exemple, je crois œuvrer à mon bonheur en travaillant pour gagner de l’argent, alors que je suis mû par un système économique ; mais en travaillant, je contribue à augmenter la richesse nationale, qui m’assure de prendre en charge ma santé en cas de problème ; j’y gagne en sérénité et entretiens donc mon conatus en travaillant pour gagner de l’argent, quoique je me trompe sur la vraie cause de ma sérénité.
Dans les deux cas : activité ou passivité, la nature du sujet, et donc son conatus, restent inchangés ; son malheur provient seulement de sa méprise quant aux causes qui le meuvent. La solution consiste donc pour lui à ne plus se leurrer sur son désir, et en particulier à ne pas le discréditer car il est bon : il est cela même qui œuvre à la persévérance dans l’être. Ce qui est mauvais, c’est de lutter contre le désir au lieu de chercher le désir réprimé dans la passion. On se trouve ici très proches de la psychanalyse et en particulier du leitmotiv lacanien : « ne pas céder sur son désir ».
Spinoza récuse une lutte frontale contre les passions : ce serait en même temps lutter contre le conatus. La passion est d’ailleurs souvent liée à l’opprobre et au discrédit jeté sur le désir :
Plus on s’efforce à chercher ce qui est utile, c’est-à-dire à conserver son être, et plus on en a le pouvoir, plus on est doué de vertu ; et au contraire, dans la mesure où l’on omet de conserver ce qui est utile, c’est-à-dire son être, on est impuissant[7].
Ici s’accordent donc à la fois vertu morale et nécessité vitale : faire le bien, c’est œuvrer à sa propre survie : « Le désir de persévérer dans l’être est le seul fondement de la vertu[8] ». Ce que nous appelons « pulsions », que Spinoza qualifie d’ « appétits », est chose bonne en soi. La passion naît d’un jugement erroné sur ces appétits, par lequel on les juge mauvais alors qu’ils sont bons.
La passion résulte elle-même d’une lutte entre force vitale ou appétit, et jugement de valeur erroné ou connaissance inadéquate. Dans un tel contexte, la passion reste une manière de mettre en œuvre le conatus. Lutter contre la passion revient dès lors à lutter contre cette force qui anime le sujet ; plus il lutte, plus il amoindrit l’appétit… qui lui donne l’énergie de lutter. Aussitôt cette perte d’énergie du sujet passionné renforce l’appétit du sujet qui lutte contre sa passion. Mais comme il n’est qu’une seule et même personne, c’est sa nature de sujet passionné qu’il renforce lorsqu’il lutte contre sa passion… La tension paradoxale est à son comble : lutter contre la passion la renforce. Mais la passion n’est que le substitut du désir authentique, lorsque le sujet se trompe quant à la « cause » de son désir. En vérité, il ne désire pas vraiment l’objet de sa passion. Ce qu’il désire, c’est autre chose. Aussi lui serait-il profitable de réorienter son appétit vers l’objet de son désir véritable, ce qui suppose de le connaître et de l’admettre. Se dessine ici l’exact processus de l’addiction : plus l’individu lutte contre sa passion addictive, plus elle se fait possessive, moins elle peut être réprimée… le sujet devient sa propre victime.
L’enjeu est donc de récupérer l’autorité sur l’appétit, sans chercher à le dompter, mais en s’en faisant l’auteur véritable – la cause – et non simplement l’agent. Il n’y a pas de véritable dichotomie entre volonté du sujet et passion qui s’impose de l’extérieur : si cette dernière semble s’imposer au sujet, c’est seulement parce qu’il refuse de reconnaître l’appétit qui le meut pourtant et assure, bien malgré lui, sa survie. C’est de là que la connaissance adéquate (de l’appétit) génère l’harmonie et le bien-être : connaître adéquatement, c’est connaître son autorité sur l’appétit, s’en savoir la cause adéquate. Une telle connaissance, une reconnaissance véritable, permet d’accroître sa liberté, sa puissance d’agir, donc d’être heureux.
Aussi faut-il « superposer la vie raisonnable à la vie passionnelle[9] », et non les opposer :
Un sentiment qui est une passion cesse d’être une passion lorsque nous en formons une idée claire et distincte[10].
L’affranchissement des passions repose donc sur le fait de reconnaître et d’accepter ses appétits, c’est-à-dire d’admettre d’une part qu’ils sont bons car conformes à notre nature, et d’autre part de comprendre qu’on ne peut pas les maîtriser par quelque acte de la volonté : ils relèvent de notre nature. Le désir ne doit pas générer le moindre sentiment de culpabilité, car il est déterminé par la nature – c’est-à-dire Dieu. Ce qui est bon, conforme au bien, c’est ce qui permet à l’individu de persévérer dans son être. Les appétits sont de cet ordre.
Par perfection (…), j’entendrai (…) la réalité, c’est-à-dire l’essence d’une chose quelconque en tant qu’elle existe (…)[11].
La perfection d’un être humain consiste dans le fait d’être conforme à sa nature réelle, et non à un idéal ; ce qui ne signifie pas pour autant qu’il doit agir de manière pulsionnelle, mais plutôt de manière conforme à sa nature d’homme social.
Car agir conformément aux appétits n’est pas céder à la déraison : « Un désir tirant son origine de la raison ne peut avoir d’excès[12] ». Par « raison », il faut entendre une certaine rationalité à l’œuvre dans la nature et dans le sujet mu par son désir. Le désir est raisonnable. Ce qui ne l’est pas, c’est de refuser de connaître son désir (on n’est pas obligé pour autant de l’agir), et donc de lutter contre : la passion naît d’un tel déni, elle est la seule manière dont le désir puisse se réaliser. Le sujet reconnaît qu’il désire, mais se trompe sur son objet. Ce n’est alors plus raisonnable ; et chacun sait que la déraison mène plutôt à la démesure.
Il faut donc impérativement agir pour transformer une passion, et non se contenter de « lâcher prise », suivant un leitmotiv actuel : il faut en rechercher la cause adéquate en soi, c’est-à-dire trouver ce qui en soi, dans son être propre, motive cette affection. Il faut trouver dans la passion ce qui relève de l’énergie vitale, ce en quoi elle est lutte bonne pour la survie. L’erreur classique en effet consiste à lutter contre ce qui, de la passion, fait souffrir ; tout au contraire, il faut en trouver « la cause adéquate », c’est-à-dire en cerner la positivité et se l’approprier comme sienne. Quelle est la positivité de la passion, à quoi sert-elle ?
De là surgit la fécondité majeure de la réflexion de Spinoza dans le cadre d’un questionnement sur les addictions : le philosophe invite à comprendre la positivité de la passion, à la « prendre » comme « sienne », à en saisir la nécessité vitale. Le sujet reconnaît en elle la force qui le meut et le fait persévérer dans son être. De cette reconnaissance découle la nécessité d’acquérir une connaissance cette fois adéquate de son désir pour en devenir l’acteur. Il convient dès lors d’agir cette force positive, en œuvrant cette fois non plus de manière délétère, mais de manière constructive. Il s’agit en somme bien de « reprendre le pouvoir sur soi de manière raisonnable », en faisant de la passion un outil fécond qui guide vers le véritable objet du désir ; ce cheminement vers l’objet authentique du désir est celui qui mène au bonheur et à la liberté.
De la théorie spinoziste des passions à la psychologie de l’addiction
Le processus libérateur décrit par Spinoza n’est pas sans rappeler la démarche psychanalytique ; ce qui nous intéressera ici sera de préciser en quoi la théorie des passions chez Spinoza peut s’avérer un outil d’amélioration de la proposition psychanalytique face aux particularités de l’addiction.
En ce qui concerne l’analogie entre le raisonnement de Spinoza et la théorie de la psychanalyse, Freud lui-même reconnaissait le 28 juin 1931 : « J’admets tout à fait ma dépendance à l’égard de la doctrine de Spinoza ». Un colloque se tint ainsi au Centre Culturel de Cerisy du 30 août au 6 septembre 2016, intitulé « Les psychanalystes lisent Spinoza »[13], colloque dont l’argument majeur fut celui d’une évidente communauté de thèses entre Spinoza et Freud mais aussi Lacan. On sait que la psychanalyse consiste dans l’explicitation de nœuds conflictuels entre raison ou volonté consciente, et pulsions refoulées constituant « l’inconscient ». De manière analogue à la théorie spinoziste, la psychanalyse invite à reconnaître, c’est-à-dire d’abord et avant tout à admettre, les pulsions dont le caractère immoral a valu leur réprobation préconsciente. Il faudra alors les juger d’un œil neuf, celui de l’adulte. Elles seront soit assumées, soit réprouvées, selon les critères du bien et du mal dont l’adulte est en possession de manière consciente. Ainsi, la (re)connaissance rend impossible la perpétuation de la souffrance de l’individu, parce qu’il connaît cet « effort pour persévérer dans l’être » contre lequel il a lutté et avec lequel il était en désaccord.
Une première question se pose toutefois : la psychanalyse parie sur la guérison par l’entremise de la prise de conscience de l’affect refoulé. Chez Spinoza, il s’agit de « connaissance » adéquate ou non. Une connaissance inadéquate est-elle un défaut de conscience ? C’est ce qu’il faudra élucider.
En outre, la psychanalyse souffre aujourd’hui d’un certain discrédit dans le traitement des addictions. Le constat de la lenteur du processus, joint à l’échec fréquent face à de nombreux patients, valent à de nombreux addictologues comportementalistes d’en souligner l’inefficacité fréquente. Freud lui-même n’avait-il pas reconnu que la structure psychique des addicts et leur type de mécanismes de défense entravait le traitement par l’analyse ?
« L ’analyse est, du reste, peu appropriée au traitement des intoxications, car tout mouvement de résistance se termine en rechute. »
« La psychanalyse est contre-indiquée pour les toxicomanes, car chaque rechute ou difficulté dans le traitement les ramène à la drogue[14]. »
La question est ici de déterminer si les analogies de la doctrine de Spinoza avec la psychanalyse permettent d’en anticiper l’échec face aux addictions précisément, ou si les différences avec la psychanalyse portent avec elles peut-être l’espoir d’une amélioration de l’outil psychanalytique.
L’addiction partage avec les passions, au sens de ce mot dans le théâtre de Racine par exemple, la dépendance du sujet à l’égard de « l’objet » de la passion. Le sujet est tout entier « dans » l’objet, son identité se perd dans l’addiction elle-même. Il y a aliénation, et l’on sait à quel point par exemple la « dépendance affective » peut être nuisible au sujet dépendant, qui acceptera toute requête de la part de celui dont il se vit dépendant : Oreste amoureux d’Hermione est prêt à tuer Astyanax. En outre, l’addiction semble s’alimenter de la lutte contre l’objet de sa dépendance : plus je vais réfréner une envie de fumer, plus elle se fera sentir, à tel point que je cèderai à l’obsession plus rapidement que si je ne voulais pas me départir de cette habitude fâcheuse. De même, nous avons vu que Spinoza décourage la lutte frontale contre les passions, au motif que ce serait lutter contre le désir et donc aussi vain que nocif, la lutte contre le conatus renforçant sa perversion sous la forme de la passion. Quant au caractère délétère, il fait partie de la définition de l’addiction : si l’emploi du mot « passion » s’est aujourd’hui départi de son aspect négatif et destructeur, il désignait initialement « le fait de souffrir », c’est-à-dire conjointement le fait de subir une action – de la part d’un objet auquel on est subordonné –, et celui d’en éprouver une douleur. Le terme d’« addiction » en reprend le sens, tout en lui adjoignant pour caractéristique la récurrence : l’addiction est une conduite de répétition.
D’où vient dès lors que si la psychanalyse postule la reprise de pouvoir du sujet sur son désir par l’entremise de la parole, l’alcoolo-dépendance soit néanmoins rarement guérie par la psychanalyse, par exemple ? S’il ne s’agissait que d’une dépendance physiologique, comment expliquer l’échec des patients toxicomanes néanmoins sevrés après une hospitalisation, et qui « rechutent » ? Comment se fait-il que moult techniques psychothérapeutiques alternatives se révèlent plus efficaces face aux troubles du comportement alimentaire ?
Il ne faut pas oublier que la psychanalyse, en tant que technique, ne suppose pas l’usage du raisonnement logique. Si elle mobilise la parole, c’est pour y voir surgir de l’involontaire, de l’accidentel, dans le discours habituellement construit. L’une des difficultés majeures pour le patient consiste donc à ne vouloir absolument plus construire un raisonnement, ne pas chercher frontalement des causes rationnelles et logiques à son comportement irrationnel. L’écueil est justement que bien des patients conçoivent la psychanalyse comme une quête rationnelle de sens, quand la découverte du sens ne peut passer que par le surgissement de l’irrationnel, de l’inadmissible. Autrement dit, la psychanalyse n’est pas responsable de l’échec de certains analysants ; reste qu’elle y est confrontée, en particulier lorsque ces analysants sont « addicts ».
Or, nous l’avons souligné, le but de l’analyse n’est pas la « connaissance » mais la prise de conscience. En cela, elle se distingue du projet spinoziste. Le spinozisme serait-il une meilleure réponse que la psychanalyse face aux dépendances addictives, ou ne ferait-il qu’en renouveler l’échec fréquent ?
Quelques psychothérapeutes font le pari d’un profit plus grand du spinozisme : ils s’improvisent, parfois après des études plus ou moins solides, « philo-thérapeutes » ou « spichanalystes », renouvelant en cela une certaine tradition ancienne de la « consultation philosophique »[15].
La théorie spinoziste se distingue en partie de la théorie analytique, par la démarche à laquelle elle invite : la réflexion encouragée par Spinoza est une introspection guidée par la logique causale. Il s’agit bien de partir à la recherche des facteurs déclenchant une conduite irrationnelle, mais cette recherche repose sur l’éclaircissement d’une logique dont il est supposé qu’elle n’est pas évidente. Autrement dit, l’individu part à la recherche d’une erreur de raisonnement qui cause un conflit interne entre élan vital et raison et amène le sujet à se tromper sur l’objet de son désir. Jusqu’ici, si la méthodologie analytique repose sur les associations d’idées quand la méthodologie spinoziste ne laisse pas place au hasard, la finalité des deux démarches semble bien être la même : libérer le sujet d’une erreur, mais dans un cas par le lâcher prise, dans l’autre par le logos.
Une différence de fond plus importante apparaît lorsque l’on comprend que le patient en analyse cherche le plus souvent à résoudre son problème d’addiction. Soit il se focalise sur la souffrance sienne, et l’on comprend avec Spinoza qu’une telle focalisation ne fait que renforcer le conflit, puisqu’il s’agit de lutter contre soi avec soi. L’addiction se renforce d’une telle recherche : la psychanalyse parlera de mécanismes de défense. Soit l’individu lutte frontalement contre son addiction, la réprouve, ce qui revient à renforcer la « connaissance inadéquate », c’est-à-dire l’erreur de jugement qui cause l’addiction.
Il arrivera peut-être que l’analyste intervienne pour recadrer le discours, pour déculpabiliser l’individu face à son agissement déraisonnable. Mais il se produit aussi que l’analyste n’intervienne pas et laisse le patient tourner autour des symptômes addictifs au lieu de l’aider à y voir la force positive en acte. Car l’addiction est une solution, parmi plusieurs, à la réprobation d’un certain désir. Le plus souvent, les thérapeutes vont aider le patient à mettre en lumière les bénéfices secondaires de l’addiction. Elle permet de suppléer un manque, qu’il est question de révéler. Et c’est là, semble-t-il, que l’analyste tombe parfois avec l’addict dans le puits sans fond de l’addiction, en se focalisant avec lui sur le symptôme passionnel – ce qu’il dit – alors que cela même qu’il dit n’est en rien cause de la passion addictive.
L’addiction se donne en effet au patient sous la forme d’un manque, mais un manque insatiable. S’il est insatiable, c’est qu’en toute logique l’objet par lequel on comble ce manque est impropre à fournir la satiété, à suppléer le vide de l’addict, à combler son manque. De quoi l’addict manque-t-il ?
C’est souvent sur le corps que se cristallise l’addiction, car c’est lui qui supporte les obsessions de remplissage de l’addict. C’est lui également qui en pâtit : en cas d’addiction aux jeux vidéos, le corps tombe malade, et « le joueur d’échecs » de Stefan Zweig est physiquement altéré. Mais bien évidemment, il est des addictions qui s’inscrivent à même le corps qu’il s’agit de remplir : alcoolisme, boulimie, toxicomanie, potomanie[16], bigorexie[17] etc. L’anorexie est également considérée comme une addiction, si l’on conçoit qu’on peut être addict au vide même[18], par peur d’une passion ressentie pour le remplissage.
Or, le corps est aussi central chez Spinoza, et c’est par ce caractère central que le philosophe se démarque de ses contemporains. Spinoza réhabilite le corps là où les moralisateurs le réprouvent, précisément parce que dès les premiers temps de la philosophie, c’est bien au corps qu’on attribue les passions. Qu’elles soient valorisées par Calliclès chez Platon, ou récusées chez la majorité des philosophes, elles adhèrent au corps.
Spinoza ne conçoit pas les choses autrement, mais il refuse de dissocier le corps de l’âme : l’âme est l’idée du corps, signifie-t-il en Éthique II proposition XIII. Autrement dit, le corps n’est plus la cause des passions et des souffrances en lesquelles elles consistent. Certes la psychanalyse n’assigne pas davantage au corps l’origine exclusive, ni même partielle, des addictions : il ne s’en fait que le réceptacle passif. En réalité, nous l’avons soutenu, la psychanalyse coïncide avec la théorie de Spinoza et n’en diffère que par la méthodologie ; ce qui fait échouer l’analysant addict n’est donc pas la psychanalyse elle-même, mais l’attitude qu’il adopte en culpabilisant sa passion. Autrement dit, s’il va chez l’analyste pour lutter contre sa souffrance, il est condamné à l’alimenter. Aussi un psychanalyste influencé par la lecture de Spinoza aurait-il tout lieu d’orienter son patient non sur les bénéfices secondaires de son comportement d’addict, mais sur la méprise première qui a consisté pour le patient à dévaluer une pulsion, c’est-à-dire à créer un vide en lui-même qui est le vide du silence, de la répulsion de l’objet authentique de son désir vital. À l’inverse, alimenter le vide par la parole, c’est chercher à combler ce puits sans fonds, et c’est par là même alimenter la démarche passionnelle qui crée le vide.
Or, ce n’est pas en comblant le vide de l’addict qu’on peut espérer le voir guérir, quelque symbolique et oral que soit ce comblement. Il ne faut pas s’évertuer à remplacer ce qui manque. Il y a plutôt lieu de restituer au sujet la pleine possession de lui-même, son autorité pleine et entière sur ce qui le détermine. Il s’agit de « libérer » l’individu de sa servitude passionnelle, non en lui fournissant une béquille langagière et orale pour suppléer ce manque qui l’anime passionnellement, mais plutôt en l’amenant à connaître et reconnaître ce qui le meut vraiment – et qui le met en joie au-delà du simple plaisir.
En transformant son regard sur son propre vécu, en cherchant dans l’addiction la nature de la jubilation recherchée par le sujet, le thérapeute peut révéler au patient ce qu’il cherche vraiment. Il s’agira dès lors d’axer la thérapie sur la joie, qui « contente » au sens étymologique de « rendre contenant », c’est-à-dire entier. Guérir par ce qui procure à l’individu une joie authentique, par laquelle il « persévère dans son être ».
Ce remède spinoziste aux addictions par la joie peut paraître simpliste, et c’est l’impression que donnent en effet les « thérapeutes » qui se revendiquent de Spinoza pour prendre la responsabilité de soigner des patients. Il a le mérite de questionner un système soignant où le patient est nécessairement, par définition, souffrant – au point parfois de jouer sa souffrance et de jouer de sa souffrance pour en tirer un peu de joie.
[1] Antonio Damasio, Spinoza avait raison, Paris, Éditions Odile Jacob, 2005.
[2] Éthique, IIIe partie, définitions, proposition I.
[3] Ibid., corollaire.
[4] Éthique III, proposition IX, scolie.
[5] Éthique III, préface.
[6] Éthique III, définition III.
[7] Éthique IV, définition 8, proposition XX.
[8] Ibid.
[9] Alain, Spinoza, chap. 5 « De la Raison » édition électronique p.56.
[10] Éthique V, proposition III.
[11] Éthique IV, préface.
[12] Éthique IV, proposition LXI.
[13] http://www.ccic-cerisy.asso.fr/psyspinoza16.html
[14] Réponse à S. Ferenczi, le 1er juin 1916.
[15] Voir par exemple http://www.philotherapie.net/
[16] Addiction à la consommation d’eau ; un potomane peut boire des dizaines de litres d’eau par jour.
[17] Addiction à la pratique sportive.
[18] C’est du moins l’hypothèse de Vladimir Marinov dans l’ouvrage collectif Anorexie, addictions et fragilités narcissiques, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France, « Petite bibliothèque de psychanalyse », 2001, 190 pages. « L’anorexie est la plus paradoxale des addictions puisqu’elle se rattache à un vide, un manque. L’addiction est une dépendance et même selon l’étymologie latine un esclavage. Mais comment expliquer, dans le cas de l’anorexie, une dépendance à une absence, à un tel vide alimentaire ? L’addiction est-elle une nouvelle forme de la dette psychique ou engage-t-elle le corps tout entier ? »