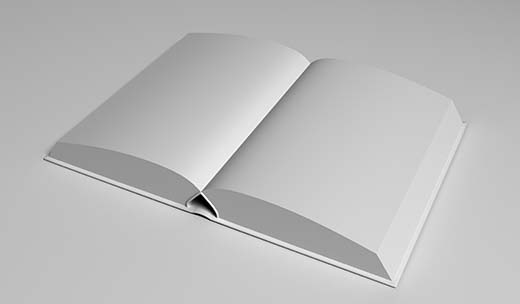Les nouvelles situations de recherches numériques
Compte-rendu de l’atelier culture numérique – Florian Forestier, Chloé Girard, Nolwenn Picoche, Thibaud Zuppinger
Introduction
L’outil numérique a changé les pratiques de la recherche et de l’enseignement. Le numérique devient de plus en plus présent. Toutefois cette omniprésence ne nous le rend pas plus familier. Il est hasardeux de chercher une unité pour un phénomène qui est multiple et lui-même en mutation. De plus il ne recouvre pas toujours les mêmes enjeux selon les disciplines et les objets étudiés. Dans le cadre de cette séance de l’atelier culture numérique, nous avons décidé de nous concentrer sur les mutations profondes qui commencent à se faire sentir dans le monde de la recherche.
La formation numérique regroupe deux grandes tendances, qui ne se recoupent pas, bien qu’elles entretiennent de forts liens entre elles. D’un côté il est possible de distinguer l’utilisation par le chercheur de documents numériques (dans son travail même de recherche ou dans la création de nouveaux documents numériques), et de l’autre l’émergence de recherches qui prennent spécifiquement les usages et les pratiques numériques pour objet.
1 – La maîtrise des usages numériques au sein de la recherche.
Par cette idée de maîtrise, nous renvoyons à un savoir-faire (ou un savoir utiliser) relatif à la fois aux contenus numériques et aux contenus numérisés. Bien sûr, la maîtrise des savoir-faire et des interfaces pour accéder au contenu est également un point important, que l’on réserve pour une prochaine séance.
Le développement d’internet et des ressources numériques ont influencé la manière dont on recherche, au quotidien, des informations. Pour le chercheur, dont les demandes sont plus spécifiques, il est d’autant plus important de maîtriser les outils numériques ainsi que les contenus (numériques et numérisés). Les contenus numérisés ne renvoient pas à du contenu primitivement numérique, mais recouvrent les contenus qui ont été numérisés, alors qu’ils étaient sous forme papier, microfilm, fiches, etc. Les contenus numérisés montrent d’une certaine façon que le contenu n’est pas dépendant de la forme, et que la disjonction fond/forme ne pose pas un problème insoluble. Pour le chercheur cette mutation se traduit souvent par l’emploi d’outil informatique là où il consultait du papier. On pense notamment à la localisation d’un ouvrage dans une bibliothèque, ou pour prendre connaissance de numéros numérisés de revues.
Quand on traite du travail de recherche il faudrait prendre le temps de comprendre les pratiques particulières, en fonction des disciplines et des problématiques. Le travail de recherche a évolué dans sa pratique, la recherche des mêmes informations a changé.
Mais à cette évolution il faut encore ajouter l’élargissement du champ de la recherche à des données spécifiquement numériques, qui n’ont pas de pendant physique. Ces objets là ont gagné une légitimité qui en font des éléments importants voire incontournables dans le cadre d’une recherche.
Toutefois leurs aspects novateurs impliquent une méthodologie et une épistémologie différentes. En effet, l’ontologie de ce type de contenu est particulièrement incertaine, fluctuante. Un article en ligne peut ainsi être modifié, sans que n’apparaisse un historique ou une balise de mise à jour. La stabilité des références et des citations est d’une nature autre que celle d’un livre. Enfin, concernant les contenus numériques, nous sommes confrontés à des technologies relativement nouvelles, du moins comparée à l’invention et la domination quasiment incontestée des supports papiers dans le cadre de la recherche. Les contenus immatériels demandent un nouveau type de recherche, un traitement de l’information différents et surtout une connaissance fine de ses moyens de productions et de diffusion.
2 – L’étude des pratiques numériques
Il est important de posséder une connaissance des procédées de fabrications. Cela permet de mieux savoir ce que l’on peut attendre de ce type de savoir, mais aussi d’interroger les choix faits et à faire. Ainsi, une question surgit : jusqu’à quel point les chercheurs doivent-ils s’investir dans l’élaboration des contenus et des outils numériques qu’ils seront amenés à utiliser ?
Métamorphose de la recherche et des chercheurs
IL existe une difficulté sérieuse à faire émerger des différences et de la hiérarchie devant une accumulation de données que l’on obtient d’un simple mot-clé et d’un clic. N’y a t-il pas un risque de donner un poids égal à tout, et que au travers du mythe de l’analyse en temps réel, on perde de vue la sélection et la hiérarchisation de l’information ?
De manière provocatrice, on peut même se demander si le numérique ne rend pas stupide. Si d’un côté, il est indéniable que les nouveaux outils obligent les chercheurs à développer de nouvelles compétences, à élargir le champ de leur recherche, à traiter plus de matériaux, avec des procédés nouveaux, cela ne signifie pas que de manière symétrique la capacité à produire des idées nouvelles soit nécessairement corrélée.
Le chercheur est devenu, ou est amené à devenir, un expert en demande : savoir poser la bonne question, avec les bons critères, dans la bonne base de donnée, mais une fois la masse d’information à disposition, le travail fondamental de la recherche n’a lui, en rien changé.
Pour autant, on peut se demander si la multiplication des outils et compétences à maîtriser ne risque pas à terme de s’interposer entre le chercheur et son activité première. Certes, la difficulté semble surtout liée à une génération de transition, qui doit s’approprier un environnement et un mode de fonctionnement qui n’est pas natif pour elle, mais il n’est pas impossible que la complexification de ces outils finisse non seulement par modifier, mais aussi par dénaturer l’activité de recherche. L’accélération de la temporalité du changement technique ne laisse plus toujours à ces outils le temps de s’adapter à la morphologie et à la cognition humaine. Le livre imprimé par exemple, s’est peu à peu calqué sur des dimensions et organisation le rendant le plus maniable possible. Ici, le débat fait rage entre ceux pour qui l’outil modèle la cognition, et pour qui l’évolution technique suscite de nouvelles habiletés cognitives, et ceux pour qui la plasticité de la cognition humaine a des limites, pour qui son temps d’assimilation ne suit pas forcément celui des mutations technologiques (cf. à l’appuis de l’importance de l’ergonomie, le succès d’Apple, et l’importance de plus en plus grande de l’internet des objets, des objets intelligents, l’interface générique ne semble plus nécessaire, le numérique se fond au contraire dans l’espace concret)
Une étude intéressante, menée au LUTIN (MédiaLab de Science Po) sous la direction de Thierry Baccino a montré que les mouvements des yeux n’étaient pas du tout les mêmes sur un livre et une page web. Certes, ces mouvements ne sont sans doute pas non plus les mêmes sur un magazine et un livre savant, sur un PDF ou un site de publicité. La question est de savoir s’il y a là seulement usage différencié de capacités cognitives, ou si cette absence de fixation n’a pas des conséquences plus graves. Pour Stiegler, le cerveau humain a besoin de s’exercer à l’attention et à la concentration : c’est par elle que le réel se donne sous la forme d’un monde (au sens heideggérien), qui nous dépasse et au sein duquel nous sommes, et pas d’une myriade de perceptions disparaissant les unes dans les autres. L’absence de fixation dès le jeune âge empêcherait l’entrée en fonctionnement correct des centres de l’attention.
Stiegler parle par exemple d’une prolétarisation généralisée touchant particulièrement les professions traditionnellement intellectuelles, et en particulier la recherche, l’art, la création. Cette prolétarisation est un phénomène de perte des savoirs : non seulement des savoir-faire, mais des savoir-vivre, de tout ce qui fait le grain, la différence propre de chaque existence individuelle. Celle-ci conduit à passer de l’adoption à l’adaptation comme modalité de rapport aux choses. L’infidélité constitutive du milieu technique, écrit Stiegler, a été accrue et ne permet plus la méta-stabilisation d’une normativité psycho-sociale et sa transmission. La technique s’autonomise, en ce sens qu’elle n’est plus d’abord utile mais addictive.
On peut se demander si ces nouvelles techniques, ces nouvelles compétences n’ont pas pour but premier de faciliter le travail du chercheur, de lui permettre de faire mieux ce qu’il faisait déjà, mais plutôt de flatter un goût pour la démesure bien humain, où le quantitatif remplace le qualitatif.
L’individu est sans cesse sommé – et motivé par des processus artificiellement entretenus – de s’adapter et de se réadapter à des environnements artificiels si la résistance du réel ne se phénoménalise plus, si donc la finitude ne s’inscrit plus nulle part, si le réel n’est plus donné que comme disponibilité à d’incessantes reconfigurations, note-t-il dans une perspective très heideggérienne, l’individu nie sa propre inscription dans le milieu transindividuel au sein duquel seulement il est ce qu’il est.
Il est intéressant de replacer cette idée avec les concepts de clôture. Un livre marque la fermeture d’une pensée. Il arrive un moment où l’auteur admet qu’il lui faut figer sa pensée, la sceller entre deux couvertures. Le numérique et internet ont véhiculé le mythe que cette clôture était une limite. Le numérique se devrait d’être une libération de l’œuvre enfermé dans un livre papier. Ainsi, les fantasmes autour du livre liquide, où l’ouvrage n’aurait pas besoin d’être sans cesse remis sur le métier, puisqu’il ne le quitterait plus.
L’idée à l’arrière-plan étant de combattre, une fois encore, la finitude humaine. Or si le livre s’est diffusé comme il l’a fait, pendant aussi longtemps, c’est sans doute qu’il correspondait à un besoin humain, à sa nature, qu’il y a bien une corrélation plus forte qu’on ne le soupçonne entre le livre et la nature humaine.
Une lisibilité adaptée à l’homme, qui tienne compte des limites physiologiques.
Pour Michel Melot par exemple , le livre est, par sa clôture, une forme à créer de la transcendance. Il est autant à distinguer du parchemin roulé que de la toile indéfinie. On peut s’interroger sur le sens que prend la plus ou moins grande solidarité du texte et de la page, la plus ou moins grande matérialité du texte. On ne peut désolidariser un texte d’une page imprimée, mais on peut refermer un document PDF : le texte est détachable de son support d’apparition.
Qu’aimons-nous dans le livre papier : sa sacralité, ou au contraire sa maniabilité, le fait qu’on puisse corner les pages, l’amener avec soi, le tâcher, boire son café par-dessus, le laisser tomber, bref, se l’approprier jusqu’à l’irrespect. Le livre électronique nous apparaît comme un objet technologique complexe ; dans le cas extrême de l’IPad, je vois dans mes mains une merveille technologique d’une valeur de 500 euros que j’admire en tant que telle, et que j’ai peur d’abimer, etc. L’objet s’approprie le fétichisme. Certes, le livre à l’origine est aussi le fruit d’une technologie (pour l’époque) de rupture. Mais sa diffusion, sa popularisation a su en faire oublier la valeur. Il faudrait que la technologie du support du texte numérique s’éclipse à son tour. On peut mettre un certain espoir dans le développement de technologies liées au papier et à l’encre électronique, à ce sujet.
C’est pourquoi combattre le manque de connaissance des processus de fabrication des contenus numériques est un enjeu majeur. Il importe de savoir comment l’on fait, car avec, vient la question du pourquoi. En effet, il y a aussi des choix qui sont opérés et il nous appartient de nous saisir de ces choix – de les considérer comme des alternatives et non comme des faits.
Cela passerait par l’élaboration de processus de fabrication qui n’obéirait pas à une logique du fantasme que ce soit l’omniscience ou le culte de la nouveauté. En effet, les acteurs du livre numérique, comme de nombreux terrains pionniers, connaissent la tentation de produire des normes et des processus sans finalité, grisés par l’innovation spectaculaire et oubliant de la sorte la véritable finalité de ces productions.
Seulement, le travail de pédagogie à faire en la matière est immense, et les finalités sont vagues, lointaines, diffuses. Peut-être que la constitution de ce que l’on pourrait nommer corps intermédiaire serait une option envisageable. Il s’agirait de déléguer la sélection, de reconstituer une chaîne du livre, qui emprunterait mais ne serait pas calqué sur le livre papier. Le rôle dévolu aux éditeurs pourrait être élargi aux bibliothécaires, qui travailleraient en collaboration avec les chercheurs. Au premier plan de leurs priorités, on pourrait placer l’inter-opérabilité entre les systèmes, la pérennité des ressources, veiller à l’extraction des savoirs des contenus numériques et d’une manière générale, à assurer une meilleure compréhension des différents rôles des acteurs dans la chaîne.
En guise d’ouverture
Le contenu numérique est évidemment une forme inédite de création, transmission et exploitation du savoir. À cet égard, il obéit à deux logiques de déploiement. Il y a une logique interne, celle qui pousse à créer et explorer : celle des opportunités spécifiques à ce type de contenu. Sur cela, rien n’est écrit, et l’imagination humaine est convoquée.
Mais nous souhaitons également rendre attentif à la dynamique externe. Il ne faut pas, au nom de la nouveauté, rejeter la logique externe de déploiement du livre numérique. Il n’y a de nouveauté que sur fond d’ancien. Le contenu numérique se comprend, aujourd’hui tout du moins, en rapport étroit avec le livre papier. Il ne s’agit pas de fétichiser ce dernier, mais de garder à l’esprit cette question : que peut-on transposer de l’un à l’autre ? Que doit-on abandonner ? Est-ce une perte ?