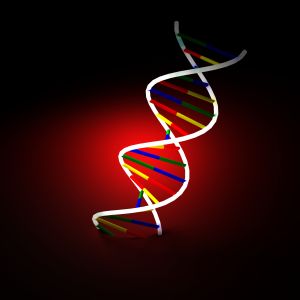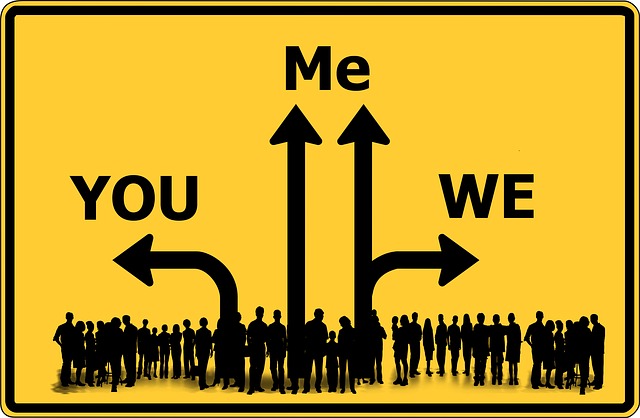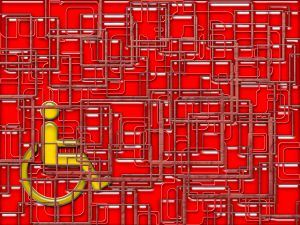Les neurosciences face à l’éthique : questions d’actualité
Hervé Chneiweiss- Directeur de recherche au CNRS – Président du comité d’Ethique de l’Inserm
Les Neurosciences sont à l’honneur en cette année 2013. En réponse au grand programme européen Blue Brain (1 milliards d’euros) les USA viennent de lancer le Human Brain Mapping project (3 milliards de dollars), deux grands programmes donc qui s’inscrivent comme les nouveaux défis de la science comme le furent en leur temps la conquête spatiale ou le programme de décryptage du génome humain. Le nouvel objectif est de décrypter le code neural[1]. Les enjeux sont majeurs. D’un côté des besoins immenses, par exemple lutter contre les maladies du système nerveux qui représentent aujourd’hui un tiers de nos dépenses de santé, c’est-à-dire une dépense annuelle d’environ 7% du PIB des pays développés et qui ne saurait que s’accroitre avec l’allongement de la durée de la vie et les problèmes de santé publique que deviennent les maladies neurodégénératives ou les affections psychiatriques liées au stress. De l’autre une question essentielle du mystère humain : comprendre cet organe qui nous permet de penser, qui nous communique le monde et nous permet de communiquer avec ce monde. Au-delà de toute maladie, acquérir peut-être de nouvelles facultés nous permettant d’être plus humain : apprendre mieux, communiquer mieux, comprendre et résoudre des questions aujourd’hui sans réponse. Les découvertes à venir pourraient également mettre les scientifiques et la société aux prises avec une longue liste de questions éthiques : l’utilisation responsable des méthodes d’amélioration cognitive, la protection des données neuronales personnelles, l’autonomie de l’individu et sa liberté de pensée, la prédiction des maladies neurodégénératives incurables, l’évaluation de la responsabilité pénale basée sur l’imagerie cérébrale, le risque de passer d’un modèle du cerveau à un cerveau modèle. Il est donc urgent d’identifier les zones de tension où ce merveilleux défi de la science peut ouvrir sur des dangers à reconnaître et prévenir. C’est l’objet d’un champ particulier de l’éthique aujourd’hui en expansion : la neuroéthique.
Neuroéthique et neurodroit
Les difficultés du dialogue entre neurosciences et droit illustrent bien la tension éthique majeure ouverte par les avancées des neurosciences, tension entre le nécessaire développement des analyses du fonctionnement du cerveau humain et la difficulté que nous avons à faire comprendre que la connaissance scientifique se nourrit de probabilités et non de certitudes. Nos hypothèses sont vérifiables sur un groupe d’individus tout en restant inapplicables à un individu particulier. Ceci est incompatible avec la demande de la preuve considérée en tant que vérité irréfutable telle que l’entend la justice. Mais le risque est bien là de voir une grandeur statistique, tel schéma d’activité cérébrale est le plus souvent observé lors de telle activité, en une norme.
Les neurosciences ont fait une entrée récente mais remarquée dans le champ du politique par plusieurs tentatives d’instrumentalisation de nos travaux aux fins de répondre à des attentes sociétales sécuritaires. Ce fut d’abord le très regrettable rapport d’expertise collective de l’Inserm portant sur « Les troubles des conduites chez le jeune enfant », suivie par la recherche de marqueurs, génétiques, biologiques ou d’imagerie cérébrale pour les délinquants sexuels, puis vint la discussion de l’imagerie cérébrale fonctionnelle comme instrument de preuve de la dangerosité d’un individu et se termina par la rédaction, très maladroitement calquée sur l’article concernant la protection des données génétiques personnelles, du nouvel article 16-14 de la loi du 7 juillet 2011, ajoutant l’expertise judiciaire au domaine d’application potentielle de l’imagerie fonctionnelle cérébrale[i].
Dans le même temps pourtant plusieurs avis éclairés étaient venus mettre en garde contre la confusion inacceptable entre recherche scientifique et application dans le domaine légale de résultats encore très partiels et non validés à l’échelle d’un individu hors du laboratoire. Ainsi l’avis 116 du CCNE était venu utilement compléter le travail du Conseil d’Analyse Stratégique[ii] et une série d’auditions et de rapports parlementaires encadrant la révision des lois de bioéthique[iii]. D’un côté l’histoire de l’exploration du cerveau est inhérente à l’histoire de l’humanité, mais de l’autre il est évident que depuis l’émergence de l’homme moderne, disons 30.000 ans, son cerveau a peu évolué tandis que les lois qu’il s’est donné ont changé très fréquemment. La question est aujourd’hui de savoir comment l’imagerie cérébrale, en donnant à voir certains fonctionnements d’un cerveau ouvre des perspectives nouvelles qui dépassent le cadre scientifique et médical et concernent la société toute entière, pratiques et usages mais aussi l’image de l’individu et le concept même de liberté de pensée par l’analyse des mécanismes neuraux sous-tendant la prise de décision et donc un renouvellement du questionnement sur la responsabilité individuelle.
La question centrale qui se pose à nous aujourd’hui est celle de la signification individuelle des données recueillies quelque soit la méthode scientifique utilisée. Une importante partie politique et économique de notre société voudrait y trouver les bases d’un déterminisme individuel des comportements. Il convient de reprendre ici la fameuse proposition de Hume « ce n’est pas parce que les choses sont telles que nous les voyons quelles n’auraient pu être autres » que je me permettrai ici de reformuler en « ce n’est pas parce qu’une image illustre l’activité cérébrale d’un individu lors d’un comportement réel ou simulé à un instant de sa vie que cet individu n’avait d’autre possibilité que d’avoir ce comportement, et de fait un autre comportement aurait été associé à une autre image cérébrale ». C’est l’erreur sans cesse renouvelée de confondre la compréhension d’un code et l’existence d’un programme déterminé. Cette confusion a déjà été faite en génétique en confondant l’ADN de nos chromosomes avec le « grand livre de la vie » qui révèlerait le destin de chacun d’entre-nous. Un gène code pour une protéine et non pour un destin. A cette « génomancie » succède aujourd’hui une « neuromancie » qui voudrait lire dans notre fonctionnement cérébral notre destin. Certes, notre ambition est bien de décrypter le code neural, mais ceci ne nous permettra ni de lire dans les pensées ni, et même encore moins, de deviner quelles seront les pensées futures d’un individu. Connaître une langue et savoir lire permet d’accéder à tous les livres d’une bibliothèque, mais non de les connaître avant de les avoir lu, ni de prédire le contenu de ceux qui rejoindront demain les nouveaux rayonnages. L’image cérébrale dit l’activité de l’individu au moment où il agit et ne dit rien de l’histoire qui l’a constitué en tant qu’individu ni des activités cérébrales ayant préludées au choix du comportement observé. Encore moins ce que sera son comportement dans quelques mois ou années dans un environnement inconnu de l’expérimentateur. Il faut admirer le travail de chercheurs comme l’équipe de Susumu Tonegawa qui montrent, chez des souris génétiquement modifiées pour l’expérience, qu’il est possible d’effacer une trace de mémoire ou d’induire un comportement de peur par la seule stimulation de neurones entrés dans un réseaux particulier en réponse à des chocs électriques sur les coussinets des pattes induisant un comportement de peur[iv]. Ceci nous apprend beaucoup sur les mécanismes de la mémoire mais en extrapoler la possibilité de manipuler un comportement humain reste un fantasme total.
Les risques d’un glissement d’une neurotechnologie médicale vers une neurocosmétologie
Un premier garde-fou technologique nous prévient de céder au fantasme, mais il est fragile car une barrière technologique ne peut-être une réponse à une question éthique, seulement un délai de grâce. En effet aujourd’hui la complexité du cerveau humain, 200 milliards de cellules entretenant chacune 50.000 connexions avec d’autres cellules, le rend hors de porté de nos moyens techniques à l’échelle d’un individu. La seule mesure de l’architecture du cerveau à un instant donné et qui serait analysé en microscopie électronique a été évaluée à 60 pétaoctets pour un cerveau de souris et pour un cerveau humain à environ 200 exaoctets, c’est à dire l’équivalent de tout le contenu numérique du monde d’aujourd’hui. Et ceci ne serait qu’une image statique. Il est en effet nécessaire d’envisager le fonctionnement du cerveau, or nos meilleures sondes actuelles sont capables d’enregistrer au maximum 2000 neurones à la fois, même si le passage à l’échèle nanométrique pourrait améliorer d’un facteur 10 ce nombre d’ici 3 ans nous sommes encore loin de compte, sans parler des puissance de calcul, et des logiciels, nécessaires au décryptage d’une telle quantité d’information.
Malgré ces faits, la tendance à l’ivresse du vertige technologique est là, en particulier dans le domaine des interfaces entre le cerveau et une machine, ordinateur ou robot. Ce vertige, que l’on pourrait résumer par la formule « tout ce qui peut être fait doit être fait », est alimenté par le désir de transformer des procédés de soins de plus en plus efficaces comme la stimulation cérébrale profonde (SCP) ou la stimulation magnétique transcranienne (SMT) en procédés d’amélioration cognitive. La SCP a été développée pour améliorer l’état de certains malades parkinsoniens devenus réfractaires aux traitements médicamenteux. Elle a été plus récemment étendue à certaines maladies psychiatriques comme les troubles obsessionnels compulsifs. La SMT a été utilisée pour traiter des troubles dépressifs graves et aider à la rééducation fonctionnelle après un accident vasculaire cérébral. Ces technologies alimentent le fantasme d’une possibilité élargie de contrôle direct de son environnement par sa « pensée ». Inversement elles alimentent la peur d’une prise de contrôle du comportement d’un individu qui serait « guidé » à distance. Mais outre la barrière technologique déjà évoqué il existe un autre garde-fou plus conceptuel : rien ne nous dit qu’un procédé capable de compenser un déficit serait également capable d’augmenter une capacité non altérée.
La question de l’amélioration cognitive
Le concept d’augmentation de la performance appliquée aux tâches effectuées par le cerveau est complexe à analyser. Il nécessite de préciser ce que l’on souhaite améliorer, pourquoi on le voudrait et qui le demande. Le concept d’augmentation repose sur la mesure et la capacité d’évaluer si le chiffre de cette mesure est plus élevé après un changement des conditions de la mesure. Une voiture est immobile, puis elle roule : sa vitesse a augmenté. Poursuivons la même métaphore et songeons maintenant à la performance. Avec un certain moteur votre véhicule peut atteindre une vitesse maximale, par exemple 150km/h. Vous optez pour un moteur plus puissant, vous augmentez la vitesse maximale, par exemple à 180km/h, vous avez augmenté la performance du véhicule. Tout le moins sa capacité à atteindre une certaine vitesse, ce qui vous en coûtera un risque également augmenté de retrait de permis de conduire pour vitesse excessive, sans parler de votre consommation et donc du prix du carburant. Une performance peut difficilement être analysée seule, sortie de son contexte. Et c’est ici que ce concept d’augmentation de la performance appliquée aux tâches effectuées par notre cerveau va devenir complexe à analyser : peut-on établir des mesures, peut-on évaluer leur variation, et finalement améliorer quoi, pour quoi et pour qui ?
L’être humain a cherché de tout temps le soutien des drogues pour éviter de souffrir, physiquement ou moralement, ce qui ne veut pas dire améliorer ses performances cérébrales. L’usage de l’alcool est commun à toutes les civilisations humaines et même plus puisque des grands singes ont été observés en conditions naturelles faisant macérer plusieurs jours des fruits dans des coques évidées avant de revenir y cueillir l’ivresse. Ulysse au cours de son Odyssée trouve dans la fleur de lotus le remède au désespoir de sa patrie perdue. La morphine est décrite dans les plus anciens codex de l’Egypte pharaonique, il y a plus de quarante siècles. La médecine indienne traditionnelle connaît la racine de Rauwolfia, dont fut extraite l’un des premiers médicaments modernes de lutte contre la dépression nerveuse. Ces différents psychotropes changent l’état du cerveau sans que l’on puisse vraiment parler d’amélioration de la performance. Reste alors à nous concentrer sur les molécules dont le but est effectivement d’améliorer la performance cognitive, c’est-à-dire la capacité et/ou la rapidité et/ou l’endurance de notre cerveau à manipuler des images mentales et développer sa pensée, son imagination, sa capacité de résolution de problème. Si nous analysons les molécules pour lesquelles il est réellement possible d’accéder à des études scientifiques mesurant et évaluant la performance, nous allons nous restreindre à des fonctions cérébrales en apparence plus simple : la capacité d’éveil, la capacité de concentration sur une tâche, la capacité de mémoire. Et finalement ces substances ne sont aujourd’hui que cinq groupes: la caféine, la nicotine, les amphétamines, le modafinil, et le methyl phenidate. La caféine est certainement la drogue d’éveil légale la plus utilisée au monde. La nicotine a un usage beaucoup plus encadré en raison de la présentation sous forme de tabac ou en médicament comme les patchs ou les gommes. Le modafinil est un médicament sur prescription dans des indications précises : la narcolepsie/cataplexie, maladie génétique rare. Les amphétamines sont interdites sauf deux molécules très utilisées aux USA, la dexamphetamine et le dexedril donnés sur prescription médical. Elles rejoignent dans leur usage le méthylphénidate médicament donné sur prescription chez l’enfant dans le cadre du très controversé trouble de déficit attentionnel avec hyperactivité (TDAHA). Résumons d’une phrase lapidaire les résultats scientifiquement démontrés de ces molécules en terme d’amélioration des performances cérébrales : elles augmentent le temps de vigilance, elles diminuent les temps de latence pour une réaction (donc augmentent la vitesse de réaction), mais n’améliorent en rien les résultats cognitifs escomptés comme la mémoire et les apprentissages, voire même détériorent la capacité de correction d’erreur à long terme[v].
Un cerveau humain n’existe pas
Pour développer des stratégies d’amélioration cognitive acceptables, il faudra des molécules ou des interfaces cerveau-machine non toxiques et efficaces, favorisant l’épanouissement de la personne concernée. Et la personne en question ne peut jamais être considérée hors de son contexte social. Un cerveau humain ne peut naître, se développer et exister sans interaction avec d’autres cerveaux humains. Notre activité cérébrale n’est pas seulement la synthèse de l’activité et de la coordination de nos réseaux de neurones. Nous existons avec et par les autres ; nous existons en tant qu’individu social, à l’intersection du déterminisme du cerveau-organe et du probabilisme du cerveau social. L’individu ne peut pas s’isoler des autres en absorbant des molécules ou s’équipant d’électrodes qui l’amélioreraient et l’assujettiraient à une norme sociale ou économique. Un des risques liés à l’amélioration cognitive serait de voir des individus de plus en plus performants au service de l’économie dominante, mais de plus en plus isolés socialement. Quel serait le sens de certaine augmentation de la performance inhumaine ? Finalement, comme le souligne Judy Illes[vi] dans un récent commentaire du livre de Robert Blank[vii] qui vient de paraître sur les relations entre politique et neurosciences, ne sommes-nous pas encore une fois dans les avatars de la vieille querelle entre le rôle de la culture et celui de la biologie dans les comportements humains. Ce débat n’a pas de sens puisqu’aucun cerveau biologique n’existe sans un contexte social et culturel, dès 4 mois de gestation et jusqu’au dernier souffle d’un individu. Cette place désormais majeure des neurosciences dans nos sociétés nous convie à réfléchir aux risques d’un lent glissement guidé par un consumérisme où des molécules aux effets non prouvées sont appelées « élégantes » ou « intelligentes » (smart drugs) et où le centre de notre intimité, notre cerveau, serait ouvert pour permettre un individu connecté. Peut-être serons-nous alors des acteurs économiques plus efficaces. Mais serons-nous des humains plus heureux ?
[1] Les neurosciences comme l’omique des omiques : on désigne aujourd’hui par « omics » en anglais ou « omiques » en français les techniques permettant des analyses à très haut débit de registres du vivant. Le premier domaine fut l’analyse du génome, le séquençage à haut débit et la bioinformatique dont le développement fut le corollaire devenant la génomique. Puis vinrent l’exploration des autres briques du vivant, les ARN, la transcriptomique, les protéines, protéomique, les lipides, lipidomiques, les modifications de l’expression du génome additionnelles aux variations de séquences de l’ADN, l’épigénétique et l’épigénomique l’analyse du métabolisme cellulaire, la métabolomique. Aujourd’hui les neurosciences explorent les réseaux de connexion en cellules de différentes régions du cerveau, le connectome et donc la connectomique.
[i] Loi de bioéthique du 7 juillet 2011. Art.16-14 : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment ».
[ii] Voir les notes et rapport d’analyse Le cerveau et la loi par Olivier Oullier et Sarah Sauneron sur www.strategie.gouv.fr › Les publications › Les notes d’analyse
[iii] Citons par exemple les auditions de l’OPECST organisées par les députés Alain Claeys et Jean-Sebastien Vialatte du 26 mars 2008 Exploration du cerveau, neurosciences : avancées scientifiques, enjeux éthiques. http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/CR_Neurosciences.pdf; puis les 29 juin et 30 novembre 2011 sur le thème Exploration et traitement du cerveau : enjeux éthiques et juridiques suivi du rapport à l’OPECST sur l’Impact et les enjeux des nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau du 13 mars 2012 http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-off/i4469-ti.pdf
[iv] Ramirez S, Liu X, Lin PA, Suh J, Pignatelli M, Redondo RL, Ryan TJ, Tonegawa S. « Creating a false memory in the hippocampus », , Science. 2013 Jul 26;341(6144):387-91.
[v] Augmenter les performances du cerveau : un leurre ? Hervé Chneiweiss, Pour la Science Décembre 2012 422 : 98-105
[vi] « Technological creep and technological vertigo », Judy Illes, Lancet Neurol. In press
[vii] Intervention in the Brain: Politics, Policy, and Ethics, Robert H. Blank, The MIT Press (2013)