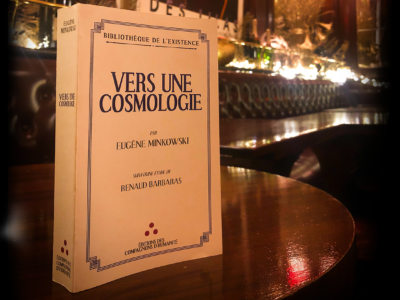Les mondes connectés. Entretien avec Isabelle Pariente-Butterlin
Les mondes connectés. Entretien avec Isabelle Pariente-Butterlin
Entretien avec Isabelle Pariente-Butterlin. Professeur de philosophie HDR, AMU, UR 3276 – IHP. Vous pouvez retrouver son ouvrage, Philosophie de l’espace connecté : la réalité d’internet, Le bord de l’eau, 2018, en suivant ce lien.
Résumé
L’internet n’est ni un « nouveau » monde, qui s’opposerait à l’ancien, ni un monde virtuel, différent de l’actuel. C’est plutôt un espace connecté au nôtre, qui étend manifestement le champ des possibles. Isabelle Pariente-Butterlin revient dans cet entretien sur la thèse principale de son ouvrage sur la philosophie des espaces connectés et la réalité d’internet, inspiré du réalisme modal de David Lewis. Après avoir rappelé ses motivations et ses positions, elle explique que la philosophie et son histoire fournissent les concepts qui permettent de mettre à l’épreuve cette innovation technique. Considérant qu’internet ne révolutionne ni l’ontologie ni la philosophie, elle nous invite à la prudence autant qu’à la parcimonie.
Mots-clefs : Internet, réalisme modal, causalité, monde virtuel, émotion.
Abstract
The Internet neither is a « new » world, opposed to the old one, nor a virtual world, different from the current one. Rather, it is a space connected to us, which clearly expands the field of possibilities. In this interview, Isabelle Pariente-Butterlin reexamines the main thesis of her work on the philosophy of connected spaces and the reality of the Internet, inspired by David Lewis’ modal realism. After reminding us of her motivations and her positions, she explains that philosophy and its history already provide the concepts needed to evaluate this technical innovation. Considering that the internet does not revolutionize ontology nor philosophy, she invites us to be cautious as well as parsimonious.
Keywords: Internet, modal realism, causality, virtual world, emotion.
Question : Vous publiez un ouvrage sur « internet », après en avoir écrit d’autres sur les normes et l’éthique. Pourquoi ce livre ?[1]
 J’ai écrit ce livre pour plusieurs raisons qui s’entremêlent les unes aux autres. Après avoir en effet travaillé sur les normes et sur l’éthique, j’avais d’abord envie de changer de sujet d’étude. C’est un choix autant qu’une exigence et une temporalité propre à la recherche, dont il faut toujours renouveler le champ. La raison qui m’a fait m’intéresser à ce type d’objet tient ensuite à ma formation. J’ai été formée par François Dagognet, qui apprenait à ses étudiants à s’intéresser aux formes concrètes de l’existence, dans un souci aussi pédagogique que philosophique. Or, le numérique est entré dans notre existence. Mais il est si proche et si concret que nous avons des difficultés à le penser. Internet est souvent critiqué comme porteur de pathologies, de conduites déviantes, et dévalorisé de ce fait alors que nous sommes tous connectés. Je me rendais, quant à moi, sur le web pour des expériences d’écriture participative en ligne ou pour lire des blogs littéraires. Je ne m’y suis pas intéressée pour ses pathologies, mais dans la perspective ouverte par l’ouvrage de François Dagognet sur les détritus où il interroge ce que nous apprend sur notre monde ce qu’il laisse derrière lui et qu’il rejette[2]. Notre société dit beaucoup sur elle-même à travers les emballages qu’elle jette par exemple, de sa manière d’être, de consommer, de désirer, de rejeter, de valoriser ou de dévaloriser. Le geste philosophique consistant à se saisir de ce qui est dévalorisé pour l’examiner, voir ce qu’il « est », m’intéresse toujours. C’est avec ce geste que nous a légué François Dagognet que j’ai voulu renouer dans ce livre.
J’ai écrit ce livre pour plusieurs raisons qui s’entremêlent les unes aux autres. Après avoir en effet travaillé sur les normes et sur l’éthique, j’avais d’abord envie de changer de sujet d’étude. C’est un choix autant qu’une exigence et une temporalité propre à la recherche, dont il faut toujours renouveler le champ. La raison qui m’a fait m’intéresser à ce type d’objet tient ensuite à ma formation. J’ai été formée par François Dagognet, qui apprenait à ses étudiants à s’intéresser aux formes concrètes de l’existence, dans un souci aussi pédagogique que philosophique. Or, le numérique est entré dans notre existence. Mais il est si proche et si concret que nous avons des difficultés à le penser. Internet est souvent critiqué comme porteur de pathologies, de conduites déviantes, et dévalorisé de ce fait alors que nous sommes tous connectés. Je me rendais, quant à moi, sur le web pour des expériences d’écriture participative en ligne ou pour lire des blogs littéraires. Je ne m’y suis pas intéressée pour ses pathologies, mais dans la perspective ouverte par l’ouvrage de François Dagognet sur les détritus où il interroge ce que nous apprend sur notre monde ce qu’il laisse derrière lui et qu’il rejette[2]. Notre société dit beaucoup sur elle-même à travers les emballages qu’elle jette par exemple, de sa manière d’être, de consommer, de désirer, de rejeter, de valoriser ou de dévaloriser. Le geste philosophique consistant à se saisir de ce qui est dévalorisé pour l’examiner, voir ce qu’il « est », m’intéresse toujours. C’est avec ce geste que nous a légué François Dagognet que j’ai voulu renouer dans ce livre.
Question : Peu d’universitaires français se sont interrogés sur « l’ontologie » de cet objet. Comment vos collègues ont-ils accueilli votre ouvrage ?
Les discussions que l’ouvrage a suscitées ont surtout porté sur la position réaliste que je défends. Mais nous pourrons en reparler. La publication a aussi provoqué un certain étonnement, mêlé de scepticisme. Le sujet de l’ouvrage, s’il ne paraissait pas très académique, s’est finalement imposé et les réflexions que l’on peut avoir sur ce type de réactions sont aussi instructives. Elles montrent que le web et l’internet qui n’étaient pas considérés comme des objets intéressants dans le champ de philosophie académique se sont peu à peu imposés. Je trouvais regrettable qu’ils n’y soient pas présents pour la raison que j’évoquais tout à l’heure : il n’y a pas d’objet qui ne soit philosophique ou dont on ne puisse traiter philosophiquement. C’est d’ailleurs ce qui m’intéresse dans cette activité, à savoir sa capacité à interroger toute notre existence. Elle nous devient entièrement consubstantielle parce qu’elle procède ainsi. Elle s’intrique profondément dans nos existences et l’on ne s’arrête pas de faire de la philosophie en fermant la porte de sa salle, quand on est professeur. Enseigner ou faire de la recherche en philosophie c’est finalement la même chose : réfléchir sur le monde dans lequel notre existence se déploie. Il n’y a pas même besoin d’un papier ou d’un crayon pour cela. C’est la spécificité du travail philosophique que de se continuer constamment. En ce sens, internet n’est l’objet de ce livre que parce qu’il est entré dans nos existences. C’est ce qui fait de lui un objet de philosophie, parmi d’autres. Il a sans doute une particularité, une étrangeté dont on peut discuter. Mais est-il vraiment nouveau ? Rompt-il avec tout ? A-t-il besoin d’une ontologie spécifique ? Je n’en suis pas persuadée.
Question : Vous défendez une approche « réaliste » de l’internet. Pouvez-vous redéfinir votre position, en rappelant à quelles autres approches elle s’oppose ?
On peut poser une thèse en l’opposant à d’autres et cela joue dans les deux sens. On peut penser que tout est modifié avec internet. Prétendre que ce qu’on appelle la « vérité » ou la « science » dans ce « nouveau » monde ne seraient pas ce qu’elles étaient dans l’ancien. Soutenir que faire la recherche ne demanderait, à la limite, que de la sérendipité, au hasard des clics. Ces positions forcées marquent à mon avis le moment dans la découverte de l’objet, où il s’est agi surtout de faire apparaître des différences radicales entre internet et notre monde pour faire apparaître son identité. Or, ce n’est justement pas ainsi que je l’ai abordé. Je pense qu’internet fait partie de notre monde et je me méfie de toutes les pensées de la rupture, de la radicalité ou de l’inouï. Toute affirmation du type « internet change radicalement les critères » pose problème. Car nous avons déjà une définition très dure et bien-fondé de la vérité des propositions. On sait ce qu’est une proposition « vraie » et je ne vois pas du tout en quoi internet peut changer cela. J’ai donc voulu défendre un certain nombre de positions philosophiques, sur la vérité et le réel notamment, contre l’idée qu’internet puisse tout « révolutionner » car à supposer que cette thèse soit vraie, elle ne pourrait être que le point d’aboutissement de la recherche et non pas son point de départ. Certains prétendent par exemple que ce qui est vrai sur internet est ce qui est dit être tel et que la réputation que l’on y a est essentielle. Ma réaction est intrinsèquement liée à ma vie de chercheur. L’impact factor, les citations ou un nombre de vues pouvaient nous rassurer sur la valeur de notre travail. Mais on peut faire une excellente recherche en étant lu par très peu de gens ou par personne, sans même publier. Ces réalités sont déconnectées. La dérive qui consiste à les indexer et à comptabiliser la recherche me paraît contre-productive. Si l’on peut publier plusieurs fois le même article sous plusieurs versions, on en publie rarement plusieurs excellents durant la même année. On a pu rendre internet responsable de la course en avant liée à cette comptabilité. Mais je ne crois même pas qu’il le soit : ce n’est qu’un outil, qui permet de savoir si nos travaux sont consultés et à quel moment. La responsabilité est plutôt du côté des formes d’organisation de nos sociétés, qui sont de plus en plus normatives et traversées par une course à la compétitivité, à la rentabilité, qui se faisait déjà sans internet. Il a sans doute accéléré ce mouvement mais il ne l’a pas instauré. Que l’on songe par exemple à l’enfermement de ceux qui ne sont plus compétitifs : on enferme les personnes âgées dans des EHPAD, avec les conséquences dramatiques que cette situation a eues pendant la crise actuelle du Coronavirus. Sans doute notre société procède-t-elle ainsi pour des raisons de sécurité, bien sûr, du moins peut-elle avancer ces raisons tout à fait nobles ; mais cet enfermement se produit aussi parce que les anciens ne répondent pas à ce que nous valorisons par-dessus tout, la productivité et la compétitivité. La productivité et la compétitivité sont devenues les deux seuls critères de valorisation sociale, partout, dans tous les domaines, y compris dans un domaine qui devrait leur être indifférent, celui de la recherche, qui devrait être collaboratif et serein. C’est un autre des sujets de recherche qui m’intéressent et c’est ce fonctionnement des forces en jeu dans le monde social qui m’intéresse plus profondément. Internet n’en est que le moyen. J’ai voulu montrer dans mon ouvrage à quel point il était réel, et contribuait au fonctionnement du réel, sans entrer dans des considérations techniques et contre toutes les interprétations qui le présentent comme « irréaliste », parce qu’il modifierait la définition de la science, celle du savoir, cliverait les personnalités et rendrait fou. Nous attribuerons toutes ces particularités à internet, alors que ce sont seulement celles du jeu social que nous jouons, dont il n’est que le moyen. C’est mon avis et c’est, très modestement, le rôle du professeur de philosophie de faire entendre une voix dissonante dans ce concert car elle ne consiste pas simplement à dramatiser les différences qu’internet peut mettre en place.
Ma thèse métaphysique est simple, ou du moins elle a pour ambition de simplifier nos représentations. Elle est liée à la dimension causale qu’internet exerce sur nos existences. Dans la mesure où il exerce une causalité sur elles, il est aussi réel que nos actions dans le monde actuel. C’est aussi simple que cela. Ce n’est pas un « autre » monde ni un « monde virtuel ». Les mondes virtuels n’existent pas. Ce qui existe, ce sont les mondes possibles et je me rattache ici à la théorie « réaliste » de David Lewis sur le sujet[3]. Je pense que c’est un bon modèle pour penser internet. David Lewis donne des raisons de penser qu’internet est le monde actuel, puisqu’il a causalement des effets dans notre monde. Deux mondes qui sont liés causalement ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Lorsque vous cliquez sur internet et que vous réservez un billet de train dans ce monde, ou que vous interagissez avec quelqu’un sur internet, par exemple en lui fixant un rendez-vous, vos actions ont des effets dans notre monde. Il y a en ce sens une présence immédiate d’internet dans notre monde et celui-ci en est l’actualité. Internet est de ce point de vue aussi réel que le reste de notre existence, ni plus ni moins. J’ai donc écrit cet ouvrage contre l’idée d’une frontière ou d’une rupture entre ces deux mondes, en m’intéressant finalement aux jeux ou aux interactions qui modifient nos procédures de décision. Je suis arrivée à la conclusion que le monde a pour ainsi dire deux « parties », dont l’une est immédiatement accessible par les sens et l’autre par l’entremise d’internet. C’est à mes yeux la principale différence. La façon dont nous prenons l’habitude d’échanger sur internet donne aussi plus d’aisance dans les relations sociales. Je ne vois donc pas pourquoi on parlerait de rupture. Cela fluidifie plutôt ces relations. Les adolescents qui partent en vacances, ou qui en reviennent, font l’expérience de cette fluidité en continuant d’échanger des nouvelles, au lieu de voir leurs liens rompus comme c’était le cas pour notre génération. Internet a, de ce point de vue, de profonds effets sur l’existence mais peut-être moins dans un sens de rupture que vers une fluidification des échanges. Certes, on ne peut pas ignorer que des drames se produisent par exemple avec des situations de harcèlement, mais ce n’est pas internet qui en est responsable, car s’il l’amplifie, ce comportement est néanmoins d’abord et avant tout celui des individus dans le monde immédiatement accessible. Mais penser internet par le seul biais comportemental, parfois pathologique, le déforme à mon avis. Ces modifications accompagnent en réalité le jeu social dont je parlais précédemment ; elles ne sont ni nouvelles ni propres à ce média. Les effets les plus profonds d’internet sont peut-être politiques. J’ai écrit mon livre avant le mouvement des gilets jaunes. Mais celui-ci a montré que leurs acteurs se donnaient rendez-vous sur Facebook et que les informations circulaient sur cette plateforme, non sur les médias traditionnels qui étaient court-circuités. Mais internet est-il aussi puissant que cela ? Je n’en suis pas convaincue, même dans le jeu politique. On voit que les mouvements populaires ont trouvé un outil de communication puissant avec internet et c’est finalement cette facilité de communication qui change la donne, sans changer fondamentalement notre monde. Internet est un moyen technique qui a provoqué un affolement autour de lui, on a voulu y voir une rupture radicale, comme c’est souvent le cas dans l’histoire : que l’on se souvienne par exemple des trains, dont Stendhal disait qu’ils ne devaient surtout pas aller au-delà 30 km/h, tandis qu’ils vont 10 fois plus vite maintenant ! Nous pensons aujourd’hui la technique comme Stendhal hier : nous sommes toujours persuadés que notre monde sera totalement bouleversé par son apparition, qu’il ne sera pas le même qu’avant, alors que ce n’est manifestement pas le cas. Notre monde utilise les moyens mis à sa disposition pour continuer à se développer à sa manière. Il en va malheureusement de même des rumeurs ou du harcèlement : internet ne produit pas ces phénomènes ; tout cela existait déjà auparavant. L’outil augmente seulement leur puissance. L’histoire nous dira si cette augmentation entraîne un changement de nature mais je ne suis pas convaincue de cette dramatisation dans laquelle on se complaît à propos de la nature de cet objet. On a par exemple espéré que l’arrivée de la télévision change notre rapport à la démocratie. Mais Pierre Bourdieu a souligné que ce moyen de communication est extrêmement conservateur et la façon dont les jeunes se tournent aujourd’hui vers internet le montre à nouveau[4]. Nous n’avons peut-être pas pour l’instant le recul suffisant pour évaluer la puissance du changement qu’internet fait subir notre monde. Le tremblement de terre émotionnel qu’il produit finira peut-être par se calmer et l’on reviendra à un usage plus modéré. L’anneau de Gygès supposé nous rendre invisibles faisait déjà l’objet d’expériences de pensée avant que nous nous interrogions sur l’anonymat et la circulation des rumeurs via internet, et l’impunité qu’il fournit. Nous sommes sans doute en train de digérer cette technologie, avec ce moment d’affolement qui consiste à croire qu’elle met fin à un « ancien » monde et que l’on ne parviendra plus à distinguer le vrai et le faux dans le « nouveau ». Mais pas d’affolement. Il faut raison garder. Je ne crois pas qu’internet fasse changer le monde en profondeur. On peut d’ailleurs regretter qu’il ne fasse que prolonger des fonctionnements qu’il faudrait interroger et remettre en question.
Question : Vous dirigez l’Institut d’histoire de la philosophie (IHP, UR 3276). Comment cette histoire peut-elle nous aider à penser le numérique, réputé « disruptif » ?
Je suis profondément attachée à l’histoire de la philosophie qui est le lieu où ressourcer notre réflexion et continuer d’apprendre au contact des grands textes. Revenir à eux est un geste qui ne cesse de nous former à la réflexion philosophique. J’avais envie d’interroger le point d’insertion d’internet dans nos existences et de l’interroger sous ce critère de richesse tel qu’il est défini par Gilles-Gaston Granger : il appelle « richesse » d’un texte philosophique sa capacité à nous parler d’un monde qui n’existait pas encore quand il a été écrit. Comment s’y manifeste-t-il au quotidien ? Vous connaissez la boutade « Tout iPhone est équipé d’un humain » : il y a quelque chose de vrai dans cette expression, au sens où les technologies numériques sont entrées dans nos vies et que nous ne nous souvenons plus tout à fait de la vie que nous menions auparavant. Internet ne révolutionne pas l’ontologie, mais intéresse néanmoins la philosophie. J’ai toujours été fascinée par la manière dont les textes philosophiques nous permettent d’interroger notre expérience quotidienne ou l’actualité à partir de concepts forgés en dehors de celles-ci et indépendamment d’elles. Ils montrent ainsi tout à la fois leur plasticité et leur richesse. Une formation classique en philosophie permet ainsi de penser le monde actuel en évitant les effets de mode, d’affolement ou de panique que suscite la nouveauté. J’ai ainsi mobilisé les concepts de causalité et de vérité dans mon ouvrage, pour critiquer l’interprétation de faits qui n’existaient pas lorsque ces concepts ont été construits. Le monde prétendument « nouveau » ou « virtuel » d’internet ne résiste pas à leur épreuve et nos concepts montrent ainsi une nouvelle fois leur richesse. Penser notre existence contemporaine avec les outils classiques de la philosophie montre leur puissance. Quelque chose leur résistera peut-être un jour et il faudra alors forger de nouveaux concepts. Mais je ne crois pas que ce soit le cas d’internet aujourd’hui. Le concept d’émergence a par exemple été forgé récemment et les discussions qu’il suscite sont extrêmement intéressantes. La philosophie n’a donc évidemment pas tout dit, il y a du nouveau à faire apparaître ; mais la nouveauté doit toujours être interrogée, examinée, mise à l’épreuve des concepts. Je ne crois pas, en particulier, que l’apparition de ce nouveau moyen technique qu’est Internet révolutionne nos concepts de vérité, de réalité ou de citoyenneté en nous imposant de repenser le monde. La philosophie rend plutôt « résistant » à ce type d’annonce. Il est possible qu’Internet modifie quelque chose en profondeur dans notre réalité ; mais il est encore trop tôt pour le dire, et je constate surtout les effets d’amplification qu’il produit. Or, ces effets d’amplification portent sur des phénomènes que nous connaissions déjà. Si modification fondamentale il y a, ce sera peut-être davantage dans notre rapport à la temporalité. Une nouveauté peut toujours émerger, ce n’est jamais exclu ; mais il ne semble pas que ce soit encore le cas. Après un moment d’affolement, nous parviendrons sans doute à intégrer cet outil dans nos existences quotidiennes, en discriminant ses bons et ses mauvais usages. Les moyens de transports ont modifié en profondeur notre rapport à l’espace et nous n’avons pas encore fini d’en prendre la mesure, tandis qu’Internet arrive à peine et sans doute modifie notre rapport à la temporalité. Ce ne sera donc pas la première fois qu’une technologie change nos existences, mais rien ne dit que ce soit le cas. L’histoire de la philosophie est si structurante pour nous, professeurs de philosophie, qu’elle nous demande d’abord d’examiner si les concepts qu’elle nous livre ne peuvent pas absorber notre actualité, avant de crier à la radicale nouveauté. C’est le premier effort à faire : il faut être parcimonieux et économe sur le plan conceptuel, sans se satisfaire d’effets d’annonce ni chercher du nouveau à tout prix pour faire un effet d’annonce. La philosophie ne doit pas céder au sensationnalisme. Le philosophe peut-être un empêcheur de penser en rond : le monde est plus vieux que la technique et l’affolement qu’elle suscite. La nouveauté n’est pas encore au rendez-vous, sinon pour l’écriture et les modifications qu’elle y connaît, peut-être.
Question : Vous réfutez l’approche « dualiste » du monde virtuel, en vous référant à Lewis. L’approche idéaliste de cet autre lieu, là-bas, est-elle aussi un contresens ?
La tradition, la transmission de la pensée des grands auteurs, déforme parfois leur pensée — le kantisme n’est pas exactement ce que Kant a dit, et cela est valable pour tout auteur et nous impose de revenir aux textes, aux sources vives de la pensée philosophique. L’idée par exemple selon laquelle internet serait comme une caverne, dont nous sortirions en revenant au monde réel, me semble être un contresens. Nous ne nous sortons pas du monde des ombres en fermant nos ordinateurs. Cette représentation me paraît tout à fait faussée ; le monde immédiatement accessible aux sens n’est d’ailleurs pas plus le monde réel. Les frontières que nous voulons désigner ne sont pas nettement tracées, et d’ailleurs elles ne peuvent pas l’être, elles ne reprennent aucune structure propre à la réalité. Lorsque nous sommes dans ce monde immédiatement accessible par les sens et que nous sommes aussi « dans nos pensées », parce que nous lisons par exemple un texte de philosophie, où sommes-nous réellement ? De même, lorsqu’un adolescent prend part sur le Web à groupe d’écriture participative, n’est-il pas d’abord et surtout dans l’écrit et cela fait-il une différence radicale que cette écriture se fasse sur internet ? C’est le point qui me semble devoir être interrogé pour éviter le contresens qui consiste à croire qu’internet serait une caverne dont il faudrait sortir pour revenir au monde réel, selon l’injonction éducative à la déconnexion — alors même que la connexion est devenue le relai de l’enseignement pendant la crise du Coronavirus et que nous venons de passer des semaines à inciter nos enfants à se connecter et à apprendre en ligne. Le monde immédiatement accessible aux sens est fait d’ombres tout autant que le web, et il est traversé par l’écrit tout autant que lui. La frontière ne passe pas entre ce dernier et la vie quotidienne ; tous les deux sont en réalité du même côté. Les ombres sont évanescentes et les pages du web changent selon nos parcours. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et les ontologies liquides ont pu tenter certains. Mais les phénomènes qui méritent d’être pointés ici sont moins les informations ou les objets sur lesquelles elles portent que des émotions qu’ils suscitent et dont le jeu social exige à présent qu’elles trouvent à s’exprimer à l’unisson. C’est particulièrement remarquable dans le cas de la communication politique. Nos responsables investissent les réseaux sociaux pour s’émouvoir de l’actualité et partager la joie des uns, l’indignation des autres ou la tristesse et le deuil du pays. Le monde des ombres me paraît être celui de toutes ces choses qui n’auraient pas d’existence si on ne les écrivait pas. Ce genre d’émotions, ces moment très fugitifs, n’existent que parce qu’on les écrit sur le web. Internet donne en ce sens de l’existence à ce qui est labile, fluide, ici nos émotions, parce qu’il donne la possibilité de les écrire — mais il ne suffit pas de les écrire pour les éprouver. En les fixant, il permet aussi de les rappeler, bien plus tard et contre nous parfois. On le voit en politique et dans les médias. Ce phénomène montre surtout à quel point l’écriture est au cœur de notre société et je rejoins sur ce point Maurizio Ferraris[5] qui a démontré que tout ce qui existe dans nos sociétés n’existe que parce que c’est écrit — on a une existence parce que notre naissance est enregistrée dans les registres d’état civil, on est professeur parce qu’on a des diplômes et un contrat de travail, on a cours que parce que notre emploi du temps est saisi dans un logiciel, etc., jusqu’à la mort qui fait elle aussi l’objet d’un acte d’écriture. Que voit-on sur internet ? Est-ce un monde d’ombres ou d’écriture ? Je penche bien sûr pour la seconde hypothèse. Si c’est un monde d’écriture, la philosophie nous a bien armés pour le penser. On pourrait alors se référer à la lettre VII de Platon se demander si ce monde de l’écriture n’est pas aussi celui la mort que l’écrit porte en lui. La dimension foncièrement écrite d’internet est quelque chose que nous savons penser. Pour ma part, je vois actuellement se déployer un monde qui n’a jamais été autant celui de l’écrit, qui d’ailleurs prend parfois des formes cachées : car les cours en ligne, les conférences enregistrées, me paraissent moins des formes de l’oralité que des formes cachées d’écriture.
Question : Le terme d’ « intelligence artificielle » est devenu aussi courant que celui de monde virtuel, que vous critiquez. Les machines peuvent-elles penser ?
Je ne suis pas spécialiste de la question de l’intelligence artificielle, mais je doute que la pensée soit épuisée par la forme du calcul, même si Hobbes a souligné la puissance de cette procédure. La pensée – je veux dire l’acquisition et le développement de la rationalité – me semble être une opération extrêmement complexe et proprement humaine, dont nous ne percevons d’ailleurs pas nous-mêmes toute la finesse. S’il y a évidemment un usage de la rationalité comme calcul, il y a aussi ce que l’on appelle les formes de deep rationality – qu’on pourrait traduire par « rationalité profonde » – auxquelles la philosophie s’intéresse actuellement, et qui est une façon de renouveler le très ancien concept de « sagesse ». Les machines en sont encore très loin, à mon avis. Il faut aussi se demander si l’on peut dissocier cette activité des émotions. Les machines peuvent-elles penser, si elles n’en éprouvent pas ? C’est un point qui m’intéresse. Converser avec un robot serait une expérience philosophiquement intéressante. Il est question d’introduire des robots dans les EHPAD. Ils manifesteraient des émotions, un peu comme des animaux de compagnie dont on sait les effets bénéfiques sur la psychologie et les schèmes cognitifs, sans transmettre de maladies ni mourir, contrairement à eux. Le type d’interaction que les résidents auraient avec eux est cependant sujet à discussion. Il est d’ailleurs surprenant de constater que, alors même que nous critiquons le monde des ombres qu’est internet, nous sommes prêts à introduire des robots dans nos existences, toujours sous couvert du souci de sécurité sanitaire (ils ne sont pas porteurs de maladie, ils n’introduisent pas de virus) et affective (ils ne meurent pas puisqu’on peut toujours les remplacer par un autre, identique). En revanche, nous ne nous pas encore aperçus, ou plutôt nous avons oublié, que les anciens sont sans doute plus performants – s’il s’agit de performance ! – ou du moins maîtrisent mieux cette rationalité profonde qui n’est pas seulement des connaissances ponctuelles et des procédures mais exige plus pour se déployer. Cette forme de rationalité ne saurait pas être un calcul, il ne faut pas l’oublier. Je trouve satisfaisant que la philosophie recommence à l’interroger et la reconnaisse.
Question : Vous êtes professeure HDR au Département de philosophie d’Aix-Marseille-Université (AMU). Le « numérique » peut-il servir l’enseignement de la philosophie ?
Être professeur demande de prendre en charge le geste de la transmission, celui-là même qu’ont fait pour nous ceux qui nous ont formés. Il faut sans doute réfléchir aux technologies numériques qui sont actuellement mises à disposition des enseignants, les intégrer dans notre pratique parce que les étudiants se les sont appropriées. Je suis avant tout convaincue que la présence physique des professeurs devant leur classe est évidement indispensable, parce qu’elle est beaucoup plus riche que les MOOC, qui sont des pis-aller peut-être plus économiques, qui peuvent relayer les connaissances mais qui n’ont pas la puissance de transmission d’un cours où le professeur et sa classe interagissent et pensent ensemble un objet commun que le professeur propose à la réflexion que les élèves ou les étudiants s’attachent à saisir. L’interaction entre le professeur et les élèves est plus puissante parce qu’elle est constamment renouvelée et surprenante. Les conférences et tous les autres outils d’enregistrement ou de diffusion du savoir ne font pas forcément concurrence au livre. Ce sont plutôt des compléments, qui n’en diffèrent fondamentalement pas d’ailleurs. Je considère que l’enregistrement de la parole est en effet de l’ordre de l’écrit, plutôt que de la parole proprement dite. Car une parole enregistrée, accompagnée d’images comme dans les conférences en ligne, est plus proche de l’écriture que de la parole. Or tout ce qui est en ligne est de cet ordre. Un cours est en revanche une parole vivante, en acte, interactive, et non une production écrite des difficultés qui surgissent et des solutions de dépassement que l’on n’avait pas forcément envisagées avant d’entrer en cours et de se trouver devant sa classe. Il y a là quelque chose qui est intact de l’emprise d’internet. Une leçon enregistrée n’est qu’un document, c’est-à-dire un ensemble d’informations que l’on peut mettre à disposition des étudiants, puis utiliser en cours. Produire de telles ressources est peut-être capital ; mais ce n’est pas un cours à « proprement parler ». Autoriser les étudiants à y accéder durant une séance ou pour la préparer peut sans doute fluidifier les interactions et faire gagner du temps ; mais rien ne saurait remplacer la puissance d’une présence du professeur et de l’élève. Je ne suis pas convaincue de la puissance d’internet dans ce contexte car la relation de l’élève et du professeur ne s’épuise pas dans la transmission d’un contenu qu’internet rend possible. Ce qui se joue de fondamental dans la transmission se surajoute à cette transmission d’un contenu de connaissance et ne s’épuise pas en lui. On ne fait pas forcément la philosophie de la technique qu’on utilise ; internet est peut-être neutre, au sens où il est seulement ce que l’on en fait. Cette approche pragmatique lui convient aussi bien : même s’il n’est pas neutre économiquement, mais orienté par les GAFAM, l’intelligence et la rationalité peuvent résister à ces géants et s’emparer de l’outil. Je crois qu’il y aura toujours des îlots de rationalité à faire exister et à protéger dans le monde ; c’est cela aussi l’acte de transmission philosophique. Ce que nous transmettons à nos élèves nous vient de Platon et d’Aristote ; à mon avis, la transition numérique ne fait pas trembler ce geste. C’est finalement parce que j’ai confiance en lui, que je ne suis pas inquiète d’internet, et que je n’en attends pas trop non plus.
[1] Isabelle Pariente-Butterlin : Philosophie de l’espace connecté : la réalité d’internet, Le bord de l’eau, 2018.
[2] François Dagognet : Des détritus, des déchets, de l’abject : une philosophie écologique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1998.
[3] David Lewis : De la pluralité des mondes, Éditions de l’éclat, Paris, 2007
[4] Pierre Bourdieu : Sur la télévision, Liber-Raisons d’agir, Paris, 1996
[5] Maurizio Ferraris : T’es où ? Ontologie du téléphone mobile, Albin Michel, 2013.