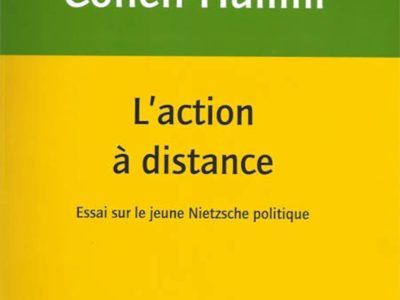L’égalité fait-elle pencher le fléau de la balance ? (1/2)
Sylvie Taussig, chargée de recherche CNRS centre Jean Pépin.
L’égalité à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines sont attachées comme à l’un de leurs piliers fondateurs est cependant soumise à de puissantes critiques, dont certaines vont jusqu’à la remise en question du régime démocratique en tant que tel. Ces critiques passent par la mise en évidence des origines sanglantes de l’égalité, de son caractère ethnocentrique, ou bien s’attachent à souligner les promesses non tenues d’une égalité réelle, à l’heure où les discriminations et injustices sociales se renforcent. Cet article, qui rappelle comment, par la métaphore de la balance, la pensée politique classique, issue de la philosophie morale, articulait liberté et égalité, et cela dans un contexte de réalisation d’un nouveau type de pouvoir souverain, avant sa mutation absolutiste, veut relancer la possibilité d’une action politique dans les régimes politiques sortis historiquement triomphants mais philosophiquement affaiblis de la chute du Mur de Berlin, autrement dit de l’évanouissement de l’antagonisme entre une société d’égaux, communiste, et une société d’individus libres, le système capitaliste. La métaphore de la balance et sa logique dynamique comme passage de l’équilibre à sa rupture permet non seulement de revisiter et de questionner les interprétations canoniques que la philosophie politique a données de cette notion à travers son histoire, mais surtout veut démontrer la nécessité de maintenir comme un couple indissoluble liberté et égalité afin de tenir tête aux critiques qui s’attaquent à la démocratie mais plus profondément à son anthropologie et à ses valeurs fondamentales.
Selon Castoriadis[1], à chaque fois que des universels, tels le concept d’égalité, ont été établis, ils ont perdu leur fondement en transformant leur histoire. Benjamin va plus loin encore, s’agissant de la démocratie, qu’il juge nécessairement fondée sur un « oubli actif[2] », présent de façon inhérente dans la loi. Selon leur analyse, alors que l’égalité nous fonde comme Européens, en ce que l’exigence d’égalité est une création de notre histoire et trouve son expression normative dans les Déclarations successives des droits de l’homme, cette auto-institution aurait été soumise à une inévitable auto-occultation, ou bien oubli de la source.
Les universels à l’épreuve de l’histoire
De fait, l’origine de l’égalité, située dans une histoire, ne présente pas la totalité du concept : l’égalité fut accordée dans des limites que tous dénoncent aujourd’hui, sur la question des femmes notamment ou celle des esclaves. Ainsi donc le concept implique une occultation de son origine dans la violence, par ceux-là mêmes qui l’ont formulée ou par la tradition de philosophie politique qui s’en réclame, pour pouvoir réellement accéder à sa valeur universelle de telle sorte que la réalité, par corrections et réformes successives, puisse accéder à une plus grande réalisation du concept, s’il est vrai universellement. La violence qui fait surgir la loi est oubliée dès que cette dernière est promulguée ; et ainsi des universels, dont il est nécessaire d’oublier qu’ils furent au départ énoncés en faveur de l’homme blanc, de façon à ne pas se laisser prendre dans les pièges d’une culpabilité stérile et à s’engager dans des luttes pour défendre leur signification et expansion, jusqu’au moment où ils n’excluent plus aucun groupe humain. L’action politique se sépare ici subtilement de la science historique, et deux différentes vérités sont mises à jour, une vérité historique, factuelle, susceptible de recouvrement mémoriel, et une vérité philosophique, conceptuelle, dont se réclament cependant les « historiens », soucieux de juger l’histoire, tandis que les « politiques » ont tendance à manipuler les faits. Vérité normative et vérité factuelle doivent donc nécessairement marcher de conserve, pierre de touche respective et réciproque chacune l’une de l’autre, pour le fonctionnement humanisant de la démocratie. Si notre époque s’est difficilement extraite des grands totalitarismes idéologiques dont le déni historique était le fonctionnement quotidien, il n’en reste pas moins vrai que chercher des fondements historiques particuliers aux universels revient à les relativiser, présentant un danger d’absolutisme total : les théories les plus totalitaires ne sont-elles pas celles qui cherchent des faits empiriques objectifs, et non pas celles qui évoquent des principes abstraits ? La pensée de l’égalité, aujourd’hui, mérite d’être pensée non pas à nouveaux frais, mais de façon à la désincarcérer de l’emprisonnement de l’irréductible antinomie de l’histoire et de la pensée.
La psychanalyse, dans sa réflexion sur l’origine des sociétés, nous présente une alternative : suivant Freud on pourrait dire que l’égalité des frères est née du meurtre du père, meurtre oblitéré dans les consciences. Dans ce cas, l’égalité naît de l’inégalité, c’est-à-dire de l’atteinte à un homme, et d’un choix, celui de sortir soudain de l’indifférence pour engager une action : telle est la définition classique de la liberté. Le présent article se veut une tentative de réflexion sur l’égalité à partir de la formulation classique du concept de liberté pour pouvoir dépasser la critique tocquevillienne bien connue, exprimant une certaine amertume sur l’égalité[3] :
Je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart est comme étranger à la destinée de tous les autres ; ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul.
Dans la conception classique développée par les philosophes politiques du xviie siècle, le terme de liberté renvoie, par recours transparent à l’étymologie, à libra la balance. « C’est pourquoi on peut se le représenter comme une balance, puisque, comme une balance est indifférente de telle sorte qu’elle penche vers l’un ou l’autre des deux plateaux et penche vers celui sur lequel on a posé un poids, de telle sorte que si l’on en pose un plus lourd sur l’autre elle se portera vers celui-là, de même l’intellect est-il indifférent de telle sorte qu’il peut s’infléchir vers l’un ou l’autre de deux jugements opposés et s’infléchit vers celui à qui est attachée une apparence de vérité, tel un poids, de telle sorte que si une vraisemblance supérieure est ajoutée dans l’autre parti, il s’infléchira vers lui aussitôt[4]. »
L’égalité comme système de la balance
L’idée de balance éveille pour nous une image évidente : les choses égales étant celles qui s’équilibrent dans la balance, dans une démocratie un citoyen ramené au concept d’égalité a, par sa voix, le même poids que chacun de ses concitoyens. Cette première étape s’appelle, dans le premier temps de l’analyse de Gassendi, liberté en tant qu’indifférence, c’est-à-dire condition de possibilité de la liberté qui aussitôt l’annule, par la liberté comme préférence déterminée par le jugement rationnel, symbolisé, dans une métaphore scientiste, par le poids de la balance. Notre concept d’égalité a trop souvent tendance à se limiter à celui d’indifférence, ou d’équivalence, ou d’équilibre, alors que les classiques incluaient dans leur comparaison l’ensemble de la balance, c’est-à-dire y compris sa faculté de mesurer et de différencier, et non pas l’égalité originelle des éléments pesés qui précisément rend la pesée inutile.
Le concept d’égalité réduit à une équivalence pondérale ne vaut du reste pas même pour le citoyen dans un pays où est édicté le principe d’égalité, c’est-à-dire où il s’exerce dans le vote et devant l’impôt, ainsi que dans la justice, elle-même représentée sur les édifices de nos tribunaux sous la figure d’une porteuse de balance les yeux bandés[5], constituant une certaine égalité ? Pour le dire autrement, comment évaluer la distorsion entre le principe d’égalité sur le modèle de la balance (poids égal) et celui des principes juridico-politiques ? L’égalité de ces derniers, avec les institutions qui en découlent et qui l’administrent, suppose que l’on pèse dans la balance des choses qui sont comparables, en particulier (et peut-être seulement) la voix, c’est-à-dire la capacité à se porter sur un nom ou une liste, en débarrassant cette instance dotée de l’égalité de tout ce qui la particularise : sa fortune, son âge, son niveau d’éducation etc. Nous trouvons ici cette abstraction de la personne si souvent décriée comme déshumanisante. Le principe d’égalité ici compare non pas des poires et des pommes, mais c’est lui-même qui crée les objets qu’il énonce égaux, et cela à partir de la diversité empirique des êtres humains, et sans considérer cette diversité, non pas pour l’étouffer, ni pour la contraindre, mais parce qu’elle est secondaire au regard de la nation. Le processus de l’égalité est dans un sens parfaitement tautologique, car la « voix » comme suffrage n’est que l’hypostase de cette égalité, un fruit étrange qui du reste se caractérise par le silence total de l’individu au moment où il s’identifie de part en part à sa voix, c’est-à-dire au moment où il se dépouille de tout ce qu’il est, s’abstractisant en quelque sorte, pour la donner, soit en levant la main comme dans les formes plus anciennes du suffrage, soit que tout se passe, comme aujourd’hui, sous la forme écrite, sans que du reste le sujet écrive lui-même, puisqu’il plie un papier imprimé, préécrit ; et il en va de même dans les procédures informatiques déjà conçues pour le futur. La voix est le silence de l’individu, qui consent à se taire pour mieux s’exprimer, pour mieux laisser passer ce qui est capable en lui de penser l’intérêt général ou le bien commun, selon la tradition dans laquelle on se situe. L’égalité impliquée par le silence de l’individu laissant parler en lui le citoyen est aussi une nudité que représente symboliquement le tablier des écoliers et qui exige la sanctuarisation de certains espaces où sa connaissance s’acquiert, dont par excellence l’école. C’est du reste dans les écoles que se déroule le plus souvent le vote ; et cette égalité, fiction d’une cire vierge où pourrait se déposer un savoir neutre, s’y célèbre et s’y actualise. Ce dépouillement pourrait bien aussi exprimer en filigrane un mouvement d’expiation face à ce qui aurait été, dans la rhétorique antidémocratique invoquant l’histoire, l’impureté originelle de l’égalité, inégale autant que possible dans la période révolutionnaire de son instauration politique, puisqu’elle s’occupa de décapiter l’ordre hiérarchique de l’Ancien Régime.
Ainsi le principe d’égalité décide-t-il de l’égalité entre des gens dotés d’une certaine dignité reconnue par une instance, politique, et non pas de nature ; la dignité qui confère le droit de vote dépend de la constitution, maîtresse, selon certaines garanties, de ce qui fait la citoyenneté et de ce qui en réalise la déchéance. Le processus semble nécessairement abstrait, ne relevant cependant ni des idées platoniciennes ni de l’élaboration aristotélicienne de l’idée, car l’égalité fait naître des figures qui n’existent pas, des voix, détachées des corps et dépouillées de leur existence comme Dasein, au sens heideggérien du terme.
De fait, si le présent article ne remet pas en cause l’égalité de l’être pour la mort, il considère cependant insuffisante cette égalité subie comme un destin, dans le registre de l’historial, et non pas comme une responsabilité à porter historiquement par des êtres situés. L’égalité comme système de la balance affirmant la liberté est bien aux antipodes, en un jeu baroque de courbes et de contre-courbes, de la peinture des vanités contemporaine plaçant l’homme sur un plan d’égalité devant la mort tout en écrasant tout ce après quoi il court, honneurs, richesse, savoir, beauté… C’est peut-être dans cette peinture que se figure au mieux l’égalité métaphysique et sa déclinaison religieuse dans la vision paulinienne des talents, mais elle ne sert point au plan philosophique, où elle est décidément incohérente et contradictoire, invitant à lui substituer la dynamique féconde de la liberté gassendienne, passant de l’indifférence à son contraire radical. De fait l’égalité du vote produit une inégalité, dès lors qu’un nombre de voix supérieur qui se porte par exemple sur un candidat fait que les voix qui se sont portées dans ce sens sont plus égales que les autres, indiquant une préférence et entraînant une fin provisoire de la liberté.
L’exercice autodestructeur de la liberté et de l’égalité
Le citoyen égal ne l’est jamais que dans le geste sanctuarisé du vote, mais là encore il ne l’est pas parfaitement : s’il fallait se contenter d’une vision de la pesée égale, alors il pourrait exercer son droit de vote dans des conditions strictes d’égalité qu’à la condition de déposer un bulletin blanc, sans désignation de préférence, ce qui serait absurde. Le choix d’un candidat particulier subvertit de l’intérieur l’égalité, et l’addition de ces préférences que l’on peut analyser comme des déséquilibres rationnels, issus de la délibération comme perte de la liberté dans sa forme originelle et fondamentale d’indifférence, produit de l’inégal, faisant pencher le plateau de la balance politique, dans le sens d’une majorité qui se dégage, crée des minorités politiques et détruit l’égalité[6]. Telle personne, tel groupe, ne verra pas ses intérêts, fussent-ils seulement intellectuels, défendus au même titre que les autres, si celui qui a été élu gouverne raisonnablement, c’est-à-dire en appliquant le mieux possible le programme pour lequel la majorité l’a élu. Mais même dans le cas du vote le plus démocratique, il faut, pour assurer un mandat paisible, assumer une certaine part d’oubli de la relative violence du vote majoritaire, qui semble rappeler le moment de la décapitation pour à nouveau se choisir un chef et une tête.
L’égalité manifestée dans les conditions de la démocratie paradoxalement détruit donc l’égalité, se montrant en cela conforme à la définition classique de la liberté, qui à un moment annule la liberté, c’est-à-dire l’indétermination ou l’indifférence par rapport à des objets de choix. À peine ai-je choisi que j’ai renoncé à ma liberté de choisir. Par là on voit que ni l’égalité ni la liberté n’ont de sens métaphysique que si elles sont d’abord des instances de la philosophie pratique : que dois-je faire ? Contrastant avec les assemblées censitaires instaurées par la monarchie de Louis Philippe, où les citoyens aisés considérés à ce titre comme suffisamment responsables pour influer sur les destinées de la nation passaient des journées et des journées en délibérations inachevées, selon la critique cinglante que Schmitt leur adresse dans ses analyses sévères du mécanisme démocratique, Gassendi exprime parfaitement cette perte de liberté qui procède de la délibération achevée[7] :
C’est donc apparemment dans ce sens que Démocrite semble avoir été tenté de dire qu’il y avait des choses en notre pouvoir, quand nous faisons l’expérience de la délibération et que nous préférons une chose à une autre non pas sous la contrainte, mais selon notre bon plaisir et en toute liberté. Mais en réalité ce n’est là rien d’autre que le fait que la situation de la délibération ou manifestation [exhibitio] d’une pluralité de choses qui nous touchent presque à part égale et maintiennent donc notre esprit dans le doute à cause de l’égalité de leurs poids respectifs ne peut pas ne pas avoir lieu pour nous à cause de l’enchaînement des choses et que la délibération elle-même ne peut pas ne peut pas advenir parce que deux choses se présentent à l’esprit de telle sorte que, alors que l’une entraîne notre esprit déjà à cause de son utilité bien repérée, l’autre montre une utilité plus grande, qui l’entraîne à son tour ; et cependant, alors que cette seconde l’entraîne déjà, la première à nouveau s’impose et l’ébranle du fait de sa plus grande utilité, puis c’est à nouveau la seconde qui revient à la charge, puis la première, etc. au point que l’esprit, selon ce qui a été dit plus haut, se retrouve dans une sorte de point d’équilibre, comme s’il était flottant ou qu’il restât suspendu, et qu’il se demande, en proie à l’incertitude, quand l’utilité de l’un paraîtra dépasser l’utilité de l’autre de telle sorte que l’utilité de l’autre ne s’imposera plus à nouveau, en rétablissant l’équilibre entre les deux, et qu’ainsi celle-là sera celle qui l’entraîne complètement, c’est-à-dire lui arrache son consentement, et qui est jugée comme devant être préférée à toutes les autres. Car la préférence n’est rien d’autre que la poursuite de la chose la meilleure – ou qui paraît telle – sans résistance, parce que nous aimons spontanément le bien et le poursuivons volontiers [libenter]. C’est pourquoi Démocrite, pour la même raison que Chrysippe, peut être considéré comme ayant renoncé à la liberté, qui est bon vouloir [libentia].
Dans cette réflexion, deux formes de libertés qui sembleraient s’opposer, soit une liberté d’indifférence et une liberté de préférence, s’articulent en fait en ce moment de la délibération entendue comme mouvement, perte d’équilibre, autrement dit renoncement libre et volontaire à la liberté totale et inerte où il s’agit de faire perdre à l’objet sur lequel le choix s’est arrêté[8] sa dimension d’équivalence pour lui faire accéder à celle de valeur. Cependant, ce qui compte d’abord, ce n’est pas le moment de la décision comme instant dramatique voire sublime de la crise, selon la description schmittienne de l’état d’urgence, en une conception qui donne plus d’importance à la valeur vécue, dans son intensité pathétique et existentielle, qu’à la valeur morale et/ou intellectuelle de l’objet plus chèrement évalué, mais l’articulation permanente des deux libertés. Cette articulation, impliquant un jugement moral, noue la liberté comme aliénation de la liberté à la capacité de discernement des valeurs possibles. La liberté, dans ce moment de déséquilibre, fait acception de personnes, c’est-à-dire qu’elle prend en considération, dans le partage entre des objets supposés égaux par le premier stade de liberté comme indifférence, leurs détails et particularités, qui justifient et justifieront si l’on m’en demande raison, ma préférence et ma rupture de l’égalité. Celle-ci n’est point dictée par une soif d’intensité existentielle, mais se détache en quelque sorte, au moment même où elle s’unit à elle, de ma subjectivité. Ainsi pourrai-je en rendre compte par la suite à chaque instant, en une élaboration de la quête de vérité comme retour à l’indifférence, qui n’est pas retour à un chaos informe primitif, mais porte la trace de l’histoire de toutes ces pesées. L’objectivité n’est plus opposée à la subjectivité, dès lors que la liberté ainsi entendue n’exige pas une élimination du sujet, comme on le conclut parfois de la critique sceptique des sensations, relatives. Au contraire, elle attend de lui une certaine humeur égale, autre nom de l’indifférence, et cette équanimité, que l’on peut appeler également équité bienveillante ou égalité d’âme et patience, trouve sa place dans le registre moral d’éducation des passions, et donc d’éducation politique où les passions sont le plus exaspéré et où il convient que l’homme puisse « aequum ferre », supporter sans se laisser emporter d’un côté ou de l’autre, ou encore aequo animo, avec un cœur égal. L’égalité postulée par le sujet politique serait donc sa capacité à effectuer ce retour à l’équilibre, seule preuve de l’effort de discernement qu’il a consenti au moment de basculer en préférant tel parti.
La liberté et l’égalité se déployant dans le temps
Cette façon de considérer l’égalité abstraite comme fondatrice, non pas qu’elle serait chronologiquement première, mais parce qu’elle est la condition minimale de ma liberté au moment de dire ma préférence et de rompre l’égalité et un critère ultime de l’exercice du discernement, permet aussi d’envisager l’erreur du sujet par rapport à ses choix, non pas de l’effacer mais de revenir comme en arrière dans le temps pour déclarer à nouveau l’égalité entre les objets, et déclarer à nouveau ma liberté, y compris par rapport à ce que j’ai choisi, en me permettant de re-regarder les objets dans leur état d’égalité stricte, c’est-à-dire avant que je n’aie discerné tel détail qui les a valorisés. Cette dimension de la liberté mutée au terme de la délibération, donc de l’égalité comme condition de la valeur à la sortie de l’équivalence, laquelle ne serait ni morale ni politique[9], permet d’envisager la liberté et l’égalité comme se déployant essentiellement dans le temps, et non pas figées dans des absolus métaphysiques. Elle permet également d’éviter la problématique du droit naturel et de la postulation que la seule égalité qui vaille serait celle de la faucheuse ou celle d’un Dieu juste, par où l’on sort des questionnements politiques, en même temps qu’elle protège utilement d’une conception contractualiste de la politique, où l’égalité serait le produit du pacte, et non pas sa condition de possibilité.
Cette conception permet enfin, très concrètement, de récuser différentes pratiques expérimentées dans l’histoire et parfois proposées, contre les dérives de la démocratie représentative : par exemple le vote censitaire, qui pose d’emblée une inégalité entre les nationaux et attache le citoyen à sa territorialité plus encore qu’à sa propriété en tant que qualité propre, dès lors que le propre du citoyen c’est sa capacité à posséder. Ainsi l’être et l’avoir sont-ils en quelque sorte confondus, rapprochant cette réalisation politique louis-philipparde de la conception de celui qui en fut un des critiques les plus vigoureux, au titre de sa paralysie, à savoir Carl Schmitt avec son idée de nomos considérée comme une réalité prophétique, par opposition à cette réalité eschatologique qu’est le kathekon.
Pour autant, l’interprétation schmittienne de ce type de vote, qu’il dévalue au respect de sa vision qualifiée de décisionniste en tant qu’elle confère la légitimité à la vertu seule de la décision (autre nom de la violence) permettant de sortir du marécage de la crise, tétanie des volontés incapables de renoncer à l’égalité comme équivalence, de peur de brader leur liberté comme indifférence et préférant la décadence à l’interruption d’une délibération qui idéalement serait infinie, ne rend compte que d’un de ses aspects ; il en limite la genèse à une réflexion sur le meilleur gouvernement possible (c’est-à-dire capable de remettre à plus tard la grande catastrophe décrite exemplairement par Heidegger dans Pauvreté[10]), en dévoyant la pensée de Hobbes, comme si le vote dit « démocratique » ne décrétait pas l’égalité positivement, comme cela est le cas chaque fois que l’application de ce principe ne se fonde pas sur la considération anthropologique ou philosophique de l’égalité, mais instaurait une égalité par soustraction, c’est-à-dire par l’étêtement du souverain, valant promulgation, par le seul acte de décapitation, qu’aucun homme n’est inégal par rapport aux autres. Dans la reconstruction schmittienne telle qu’elle s’est répandue dans un grand nombre de courants de philosophie politique[11], mobilisant la vision propre au juriste allemand (mais non fondée historiquement, et dans les textes) de l’absolutisme, c’est cet acte même qui serait effacé, alors que sa présence initiale désigne la fondation même de la loi.
De là la description fréquente, souvent sous la forme d’une dénonciation, d’un des paradoxes de la démocratie, qui est établie par un acte de violence, par un mouvement de sortie de crise, mais peut s’abolir par un acte non violent (telles les élections qui ont conduit Hitler au pouvoir). Mais cette conception, avec l’oubli du trauma qu’elle implique, paraît bien la sœur du décisionnisme, même si de prime abord elle ne justifie pas les coups d’État comme chemin légitimant de la prise de pouvoir. Nous avons vu, au contraire, que l’exigence de la liberté comme indifférence et de l’égalité comme équivalence, centre rééquilibrant du choix politique, doit rester au cœur du principe du vote comme annulation temporaire de la liberté et de l’égalité. Au contraire, le cadre tel qu’il découle de la vision des schmittiens, s’il n’émane pas du constat d’une égalité naturelle puisqu’il aurait plutôt tendance à souscrire à une esthétique du surhomme nietzschéen, affranchi des procédures tatillonnes et culpabilisantes, la postule pour la restreindre aussitôt, par l’effet de la loi qui décide qui est citoyen et ce qu’est la citoyenneté, excluant le cosmopolitisme, donc excluant l’égalité « réelle », naturelle, par une forclusion. Dans ce cas, le vote, qui est l’exercice par excellence de l’égalité, le seul lieu où, comme nous l’avons vu, le concept d’égalité soit appliqué de façon totale et sans scorie, ne serait plus cet espace politique où soudain le questionnement philosophique sur l’égalité entre les hommes fait silence, mais bien un retour du religieux, ou plus précisément la sécularisation des concepts théologiques.
En réalité, cette égalité des voix comme décision arbitraire, historiquement mal fondée (comme si l’égalité politique était née, non pas même de la Révolution française, fille des Lumières, mais du régicide) est philosophiquement insuffisante, car précisément dans la dynamique de crise qu’elle met en place il n’est nul besoin de balance pour décréter l’égalité, et donc aucune instance de liberté n’est requise, la liberté n’y étant pas considérée dans la totalité de ce que soutient le concept dans sa formulation classique autrement plus féconde, parce qu’elle découle d’une théorie de la connaissance et ne suppose aucune accointance originelle avec la violence, qui a par ailleurs entaché effectivement les actes des révolutionnaires. Si je résume la conception mise en place par Gassendi, selon laquelle l’égalité annule l’égalité, de même que la liberté annule la liberté, dans une relation d’étroite interdépendance entre égalité et liberté, puisque la délibération met fin à l’égalité, faisant incliner le plateau de la balance qui est l’intellect et débouchant sur l’agir, c’est-à-dire une perte d’équilibre ou le renoncement à une assise, la délibération comporte nécessairement un discernement, c’est-à-dire la capacité à distinguer le vrai du faux, reposant sur des critères de vérité. C’est un système articulé des critères du vrai, que Gassendi appelle d’abord « canonique » à la suite d’Épicure, que le philosophe de Digne tâche de mettre en place ; et l’on ne s’étonnera pas de le voir choisir, dans l’énoncé des critères, le terme de suffragatio[12], et ses dérivés, pour traduire le « marturomenai » et ses dérivés, qu’avait utilisé Épicure, contenant l’idée de vote : « Sont vraies les opinions qui reçoivent le vote favorable de l’évidence [des sens], ou du moins qui n’en reçoivent pas un vote défavorable. » Les différents « canons » ou critères de sa « canonique » (qu’il préférera par la suite, pour des raisons évidentes d’inscription dans une tradition philosophique et de lisibilité, appeler simplement logique sans rien y changer sur le fond) décline ainsi les discriminations universelles du vrai et du faux, dans une anthropologie platonicienne selon laquelle nul n’est méchant volontairement : on croit toujours aller vers le vrai, même si parfois c’est seulement apparence du vrai, anthropologie sans doute insuffisante pour ce qui est d’une psychologie individuelle (que l’on appelle péché ou inconscient ce qui fait que l’on ne fait pas ce que l’on voudrait faire délibérément), mais nécessaire dans la politique, comme instrument contre le lien entre l’être et la puissance exemplairement mis en évidence par Pierre Caye, nœud de la pensée heideggérienne[13].
Mais pourquoi le mythe d’une société d’égaux devait-il nécessairement faire long feu et à quelles conditions la hiérarchie n’est-elle pas nécessairement contraire à l’égalité ?
[1] Cornelius Castoriadis, Philosophy, Politics, Autonomy (Oxford University Press, 1991), p. 133 sqq. Ses remarques s’appliquent également à la notion de droits de l’homme indissolublement liée.
[2] Walter Benjamin, « Critique de la violence », tr. fr. M.De Gandillac, in Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000, p. 224.
[3] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835). Paris, Gallimard, 1968, p. 347.
[4] Pierre Gassendi, De la liberté, de la fortune, du destin et de la divination. Syntagma Philosophicum, Éthique, Livre III, Turnhout, Brepols, 2008. [824b]
[5] Il y aurait du reste long à dire sur une comparaison entre cette figuration de la justice aux yeux bandés et la représentation traditionnelle péjorative de la Synagogue, yeux bandés elle aussi, face à l’Église et à ses yeux grands ouverts, alors que le Christ ne fait pas acception de personnes.
[6] Il y aurait cependant matière ici à débattre : l’argument peut paraître valoir vaut en théorie, mais être en pratique impossible. De fait si tout le monde votait blanc, l’égalité serait parfaite, mais parfaitement formelle et sans objet. Pour autant ce serait une égalité tout aussi contradictoire avec son concept en tant que lié à la liberté. Il faut donc exclure l’idée d’un vote blanc généralisé, et c’est peut-être un moyen de justifier ici la non reconnaissance du vote blanc dans le décompte des voix.
[7] Pierre Gassendi, De la liberté, op. cit. [834b].
[8] Il paraît cependant que le langage, qui parle du choix comme d’un arrêt, restitue mal ce mouvement de bascule qu’il est fondamentalement, en une dynamique du sujet qui y sacrifie sa liberté de choix pour s’engager dans une action.
[9] Et tout simplement contradictoire, s’il est vrai que dans les situations politiques extrêmes en particulier ne pas choisir c’est se ranger du côté d’une adhésion tacite, voire d’une complicité.
[10] Martin Heidegger, La Pauvreté ; trad. et présentation de Philippe Lacoue-Labarthe, Presses Universitaires de Strasbourg 2004, écrit en 1945, dans les circonstances que l’on sait, méditant sur un vers d’Hölderlin, « chez nous [les Allemands], tout se concentre sur le spirituel, nous sommes devenus pauvres pour devenir riches ».
[11] Et dans la psychanalyse lacanienne, avec la figure du Grand autre, jusque dans son « inexistence ».
[12] Terme qu’il préfère à suffragium comme il le précise lui-même : « je traduis par suffragatio plutôt que par suffragium, puisqu’à ce mot s’oppose trop durement rejet pour pouvoir dire attestation, confirmation, ou autre ; mais il manque un terme à opposer précisément ». Voir Pierre Gassendi, La Logique de Carpentras ; Texte, introduction et traduction par Sylvie Taussig, Turnhout, Brepols, 2012.
[13] Pierre Caye, Morale et chaos. Principes d’un agir sans fondement, Paris, Le Cerf, 2008.