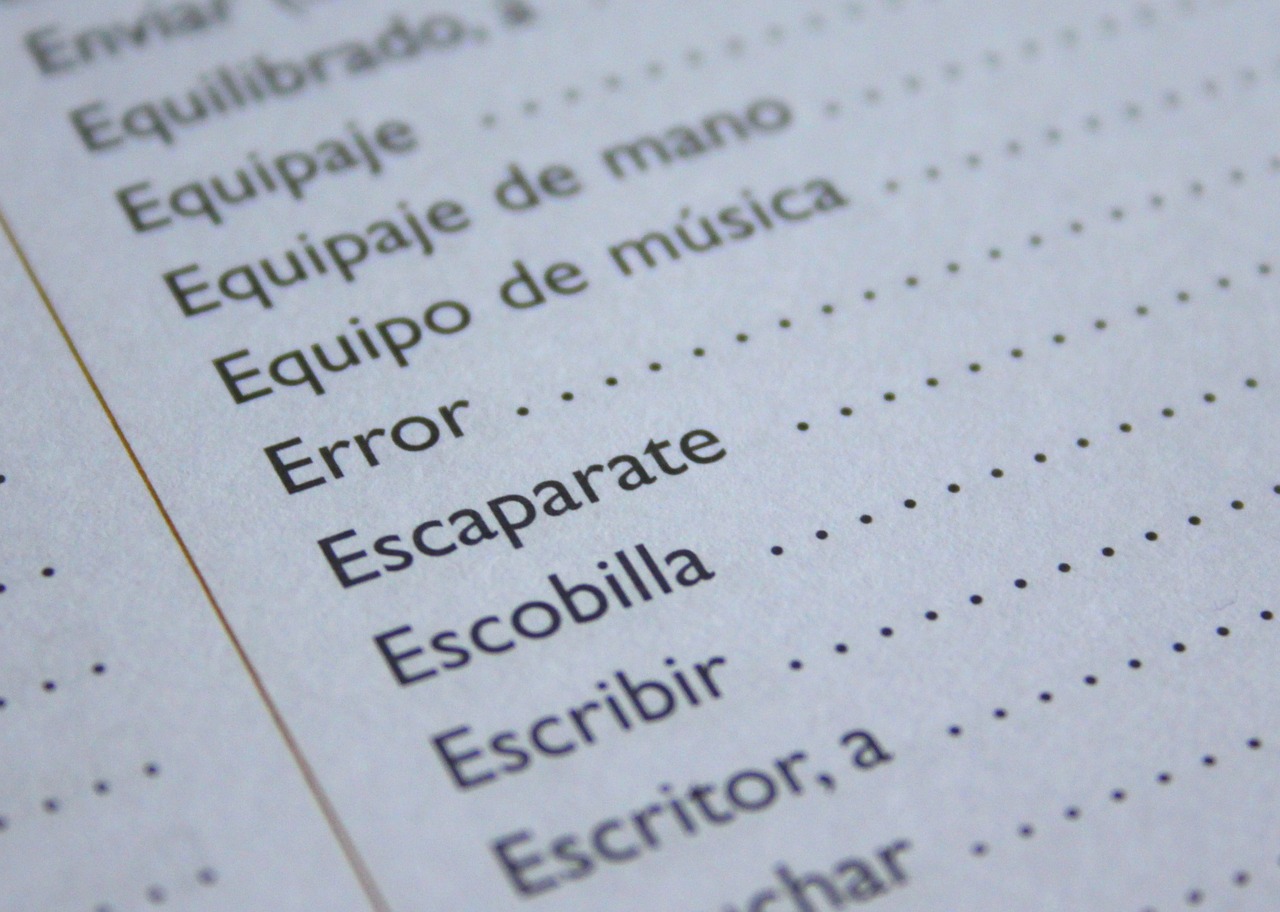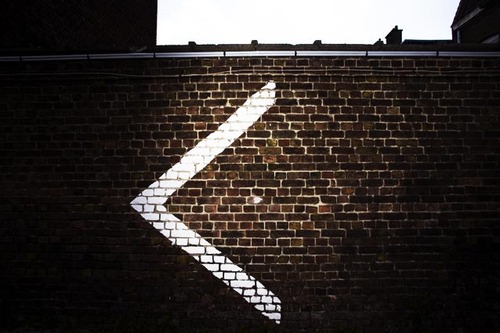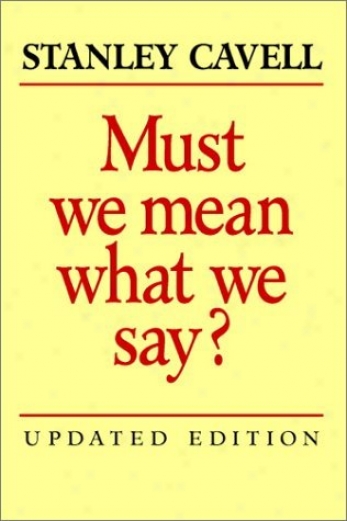Le type d’affirmation produite par la philosophie de l’ordinaire.
Dire et vouloir dire (Partie 3)
Autour de « Must we mean what we say ? » de S. Cavell
Le deuxième type d’énoncé, dont traite Cavell dans « MWM », pose le problème du rapport entre ce que nous disons (explicitement) et ce que nous sous-entendons par là, c’est-à-dire ce que nous « impliquons » (imply) par ce que nous disons. Pour une démarche philosophique comme celle de Mates, interroger de la sorte ce rapport (d’implication) constituerait une erreur logique. Autrement dit cela serait opérer une confusion entre sémantique (le rapport aux mots/phrases) et pragmatique (le rapport de ces phrases au monde, son usage). Dans ces conditions, les rapports d’implications ne concernent que la sémantique (imply=entail). Pour autant que cette distinction recèle des avantages[1], on a vu avec Austin, à quel point elle est aussi inopérante pour rendre compte du concept d’action (et d’acte de langage). « On ne s’y retrouve pas », c’est pourquoi Cavell nous demande d’oublier l’impossibilité logique (formelle) de la relation d’implication ordinaire pour « éprouver à quel point il est invraisemblable de dire qu’elle n’est pas logique. (…) C’est invraisemblable parce que nous n’acceptons pas une question comme “Avez-vous fait cela involontairement ?” comme étant de mise pour toute action quelle qu’elle soit »[2].

Roman Bonnery - http://www.romanbonnery.com/
La « nécessité ordinaire »
Pour comprendre cela, et expliciter cette notion « d’implication ordinaire » (qui a un air de ressemblance avec le concept d’ « entailement » de Grice[3]), reprenons l’analyse de Cavell :
Si une personne vous demande si vous vous habillez ainsi volontairement, vous ne comprendrez pas cette personne comme manifestant simplement de la curiosité pour votre fonctionnement psychologique; vous comprendrez cette personne comme étant en train d’impliquer, ou de suggérer, que votre tenue vestimentaire a quelque chose de particulier. Si l’on répond à cela que “volontaire” ne signifie pas “particulier” (ou “spécial” ou “douteux”) et donc que l’implication ou la suggestion font simplement partie de la pragmatique de l’expression, et non pas de sa signification (de sa sémantique), voici ce que j’objecterai : cette réponse vaudrait contre une thèse [claim] différente de celle que j’avance ici ; elle ne vaut d’être dite ici que si vous pouvez rendre compte du rapport entre la pragmatique et la sémantique de cette expression. En l’absence de ce compte-rendu, la réponse est vide. Car réfléchissez : si nous utilisons la formule de Mates pour calculer la valeur pragmatique d’une expression – “Il ne dirait pas cela à moins de…” – alors, dans la situation qui a été décrite, nous la complèterons par quelque chose du genre “… à moins de penser que ma tenue vestimentaire est particulière”. Dites que cette implication de l’énoncé est “pragmatique” ; il n’en reste pas moins qu’il ne dirait pas (qu’il ne pourrait pas dire) ce qu’il a dit sans impliquer ce qu’il a impliqué : il doit vouloir dire que mes vêtements ont quelque chose de particulier. Au moment où je parle, je m’intéresse moins à “vouloir dire” qu’à “doit”. (Après tout, il y a forcément une raison qui fait qu’un certain nombre de philosophes ont la tentation de qualifier une relation de logique ; et “doit” est logique.) Mais la formule “pragmatique” ne jette pas la moindre lumière sur ce sujet.
Pour montrer l’inopérance de la distinction sémantique-pragmatique, Cavell la renverse dans son cadre propre, c’est-à-dire en l’envisageant dans son mode interne de compréhension. Une approche pragmatique échoue à rendre compte de l’élément de nécessité contenu dans cette implication. Dire « volontairement » ici, c’est bien nous indiquer nécessairement quelque chose (et tout ce que cet énoncé dit, c’est qu’il l’indique). On pourrait même dire que cette approche « pèche » doublement, car elle ne nous apprend à la fois rien sur les implications que nous comprenons, mais elle ne nous dit rien de plus sur les implications d’énoncés dont nous ne saisissons pas l’usage. Soit nous savons déjà quels sont la signification et l’usage de l’énoncé (dire que « volontaire », qui veut dire ici « particulier », fait partie de l’usage que l’on fait du sens présuppose que nous connaissons déjà cet usage), soit nous ne le comprenons pas, et la qualification de « pragmatique » ne nous apprend rien de plus sur cet usage. En ce sens les effets de cette distinction n’ont pas la vertu austinienne de nous faire comprendre (faire prendre conscience) de ce qui se fait d’ordinaire par l’examen de ce qui a échoué, de mettre au jour le normal par l’anormal.
Dire que l’implication de l’énoncé est « pragmatique » ne met nullement en cause son caractère nécessaire et il ne l’explique pas. Par « volontaire », on laisse entendre nécessairement que j’ai quelque chose de particulier dans ma manière de me vêtir. La personne qui me dit cet énoncé m’indique son intention de signifier cela. Elle me le fait savoir. On retrouve ici la conception non-naturelle du sens de Grice. Il nous l’indique, mais pas comme la fumée nous indique un feu. Il existe – un « mode non-naturel»[4] du sens, qui ne nous conduit pas à envisager la signification comme cognitive ou émotive. Ce qui nous permet de conclure cela est que nous savons naturellement[5] (ou nous ne le savons pas et de ce fait, nous ne comprenons pas ce qu’il dit ou a voulu dire) ce qu’il a laissé entendre ; nous avons reconnu son intention. Naturellement, parce que « Apprendre ce que sont ces implications fait partie de l’apprentissage du langage ; et ce n’est pas une partie moins importante que l’apprentissage de sa syntaxe, ou de ce à quoi s’appliquent les termes : elles constituent une partie essentielle de ce que nous communiquons quand nous parlons ».
Il y a toujours du « non-dit » dans ce que nous disons. Faute de voir qu’il existe « une logique de l’ordinaire », on rate la diversité de ce langage et de ses usages et l’on se contraint au « silence » quant à tout ce qui ne rentre pas dans la logique. Dans une communication normale, on ne peut pas tout dire explicitement (et pas seulement pour des « raisons d’économie »), « autrement la seule menace à la communication serait de nature acoustique » (p.12). Dans une conversation normale, nous présupposons et impliquons (laissons entendre) des choses, choses qui ne rentrent pas dans le contenu de ce que nous disons, mais dans sa « signification au sens large ». Cette conception élargie du sens, nous ouvre un domaine nettement plus large et complexe que celui sticto sensu de la vérité, celui de la morale ou de l’éthique. « Pour cette raison [on ne peut pas tout dire explicitement], nous sommes exactement aussi responsables des implications spécifiques de nos énonciations que de leurs thèses factuelles explicites »[6]. Mais avant de questionner cette « dimension éthique » du langage, nous devons voir à quel type de logique nous avons affaire. « Volontaire » = (ici) « particulier ». Est-ce à dire que ce type d’énoncé est analytique (c’est-à-dire un certain type d’analycité tout à fait particulière[7]) ? À quel type de « logique » nous mène cette nécessité éprouvée ?
Il semble que nous ayons le choix entre deux solutions : Ou bien (1) nous nions qu’il existe aucune contrainte rationnelle (logique, grammaticale) sur les «implications pragmatiques» de ce que nous disons – ou peut-être qu’il existe la moindre implication, en nous fondant sur le fait que le rapport en question n’est pas déductif – si bien qu’à moins que ce que je dis soit carrément faux, ou à moins de me contredire explicitement, il ne sert à rien de suggérer que ce que je dis est erroné ou que je dois vouloir dire autre chose que ce que je dis ; ou bien (2) nous admettons la contrainte et nous disons ou bien (a) que, puisque toute nécessité est logique, les «implications pragmatiques» de notre formulation sont des implications (quasi-) logiques ; en ajoutant, ou sans ajouter, (b) que, puisque les «implications pragmatiques» ne sauraient être interprétées en termes de logique déductive (ou inductive), il doit y avoir une «troisième sorte» de logique ; ou bien nous disons (c) qu’il y a de la nécessité non logique. Aucune de ces solutions n’est dépourvue d’obscurité, mais elles sont suffisamment claires pour que nous faire voir que Mates a choisi la solution (1), tandis que le philosophe qui part du langage ordinaire éprouvera probablement le besoin d’adopter la solution (2), sous une forme ou sous une autre. La solution (2a) met en relief la raison pour laquelle le philosophe oxfordien maintient que c’est bien de logique qu’il parle, tandis que (2b) explicite la raison pour laquelle cette affirmation rend perplexes les autres philosophes (pp.10-11).
On pourrait dire que la solution (A) recèle quelque chose de bancal dans son énonciation même… On n’accepte pas la qualification de « logique », mais on concède tout de même (« il existe ») une sorte d’implication (non logique au sens de non déductive), « si bien qu’à moins que ce que je dis soit carrément faux, ou à moins de me contredire explicitement, il ne sert à rien de suggérer que ce que je dis est erroné ou que je dois vouloir dire autre chose que ce que je dis ». Nier totalement la possibilité « d’implications pragmatiques » et dire que je ne peux pas vouloir dire autre chose que ce que je dis revient au même : c’est envisager les énoncés par l’entremise de la distinction sémantique-pragmatique, ou plutôt c’est n’accepter que l’analyse du sens en termes cognitivistes[8]. Les conditions pour accepter l’existence de l’implication sont révélatrices de ce type d’analyse. C’est seulement à la condition que le contenu de mon dire ne soit pas faux, c’est-à-dire non contradictoire (sémantique), et que je ne me contredise pas, c’est-à-dire à la condition de ne pas être en contradiction avec moi-même (se contredire a rapport avec la vérité non plus du contenu de ce que je dis, mais sur ma position (sa cohérence) à prétendre pouvoir dire ce que je dis), qu’on peut parler « d’implications pragmatiques »[9]. Or interpréter la pragmatique de la sorte, c’est se méprendre sur l’usage que nous faisons du langage. « Nous utilisons un modèle de travail qui ne concorde pas avec les faits dont nous voulons vraiment parler »[10].
Toute la différence entre les deux types de solutions réside en fait dans le mode d’appréhension du langage. Et ce que revendique Cavell ici, c’est la rationalité de l’appréhension du langage ordinaire : il y a bien une logique de l’ordinaire qui nous autorise à ne pas avoir recours à une vérification empirique, il existe quelque chose comme la connaissance des formes de notre discours, connaissance qui distingue ce qui se dit (peut se dire) et ce qui ne se dit pas (ne peut pas se dire, c’est-à-dire est inapproprié et/ou ne pas être en position de dire…) dans certaines situations, qui estime la pertinence du dire. Et cette « logique » est a-scientifique (et non pas pré-scientifique) c’est-à-dire que l’analyse en termes de vrai ou de faux n’est pas son mode exclusif d’appréhension[11]. Il nous faut l’envisager au contraire en termes « d’autorité » (et de pertinence). C’est pourquoi il nous faut admettre la « contrainte » éprouvée comme rationnelle et dire que « puisque toute nécessité est logique, les «implications pragmatiques» de notre formulation sont des implications (quasi-) logiques ». « Quasi-logique », car nous n’avons pas affaire à une relation logique déductive, ni même inductive[12], mais à un « autre type de logique », affirmation qui rend les autres philosophes perplexes[13].
Interrogeons de plus près cette « logique ordinaire » en faisant appel à Austin et à sa réponse au « paradoxe de Moore »[14]. La logique veut que, soit la proposition p implique une autre proposition r, soit p n’implique pas r, c’est-à-dire est compatible avec non-r. Or le paradoxe de Moore nous montre l’inefficience de ce type d’implication pour les énoncés relevant de la croyance. Austin propose en guise de réponse une doctrine où « ce n’est pas p, mais asserter p, qui implique « je (assertant p) crois que p ». Il nous faut donner ici un sens particulier à « implique ». Bien entendu, ce n’est pas que « j’asserte p » implique (au sens ordinaire) « je crois que p », car je peux mentir. Il s’agit du sens où, posant une question, j’ « implique » que je ne connais pas la réponse. En assertant p, je laisse entendre que je crois que p »[15]. Par ce « je » (le sujet énonciateur) qui « laisse entendre » (dont l’activité linguistique a des effets non contenu dans ce qui a simplement été énoncé), Austin rejoint l’implicature gricéenne et la présupposition strawsonienne[16]. Cette « implication » n’est pas logique au sens classique car elle n’implique pas la réciprocité (la symétrie) de toute relation logique, mais elle porte sur le sujet (qui asserte). Par exemple, quand je dis que « je ne crois pas que faire ceci est bien », cela n’implique pas que « faire ceci » n’est pas bien. Cet exemple n’est sans doute pas le meilleur à choisir ici – même si le débat autour de l’implicature prend source dans ce genre d’énoncés – parce que justement, Cavell n’use pas du terme de la croyance pour montrer à quel type d’implication nous avons affaire ici. On peut prendre un autre exemple, celui de la différence entre faire un dépôt d’argent et le remettre à quelqu’un, où l’on peut voir que « la nécessité ordinaire» est « logique ».
Considérons un énoncé portant sur un dépôt d’argent. Si je fais un dépôt d’argent, cela implique que mon interlocuteur comprenne bien que c’est un « dépôt » (je demande à ce que l’on me garde cet argent) et non pas une simple remise d’argent (je prête de l’argent à un ami dans le besoin par exemple). Une contradiction de « type logique » apparaît si je m’approprie cet argent que l’on m’avait déposé (dont j’avais accepté, reconnu le dépôt). Je me suis contre-dit (je n’ai pas tenu ma parole au sens où je n’ai pas respecté mon engagement). La contradiction ne porte pas sur l’usage de l’énoncé, mais sur ce que j’ai fait. De même, un enfant qui dit qu’il sait, alors que nous savons qu’il ne peut pas savoir ce qu’il prétend savoir, ne fait pas un usage erroné de « je sais », il n’est juste pas en position de savoir, il n’en a pas le droit, il n’a pas l’autorité pour l’affirmer.
Cavell nous dit : « Ce qu’il faut soutenir à présent, c’est que le fait qu’un terme est employé de sa manière habituelle implique bien quelque chose : cela vous autorise (ou, en employant le terme, vous autorisez les autres) à faire certaines inférences, à tirer certaines conclusions » (p. 11). L’usage de « volontairement » dans « Est-ce que vous vous habillez ainsi volontairement ? » nous autorise à dire (à penser) que cette personne sous-entend, ou laisse entendre que la manière dont je suis habillé doit avoir quelque chose de particulier. Mais pour affirmer que nous sommes bien autorisés à faire cela, nous devons voir à quel type d’affirmation nous avons affaire, c’est-à-dire montrer quand on doit énoncer de telles affirmations et qui doit les énoncer, et ce qu’on doit vouloir dire en les produisant.
Le type d’affirmations et le « droit à »
Traditionnellement, se poser ce genre de question, c’est se demander si l’énoncé (par exemple (S) : « Quand nous demandons si une action est volontaire, nous sous-entendons que l’action est douteuse ») est un jugement « analytique ou synthétique ». Or, « Quand nous considérons ce dont nous voulons vraiment parler, et non le modèle, que peut-on bien entendre par jugement « analytique » ou jugement « synthétique » ? Nous n’en savons tout simplement rien »[17]. (S) ne peut pas être analytique : à « volontaire » ne correspond pas « douteux », même si on aimerait les dire a priori[18]; mais il n’est pas non plus synthétique[19], puisque – nous l’avons vu – il recèle une nécessité qui lui est propre (« volontaire » ne peux pas vouloir dire autre chose que « douteux » ici, dans ce cas-là, tel que nous l’avons énoncé).
L’intention de la démarche de Cavell est spécifique, c’est-à-dire qu’il veut soutenir que «
les “deux méthodes” de Mates pour recueillir des preuves à l’appui d’“énoncés sur le langage ordinaire” comme S n’ont aucune pertinence quant à ce qui autorise une personne à dire S, et puisque cette thèse repose évidemment sur l’affirmation que le concept de preuve est en général absolument sans pertinence pour ces énoncés, je dirai simplement ceci : pour comprendre quelle sorte d’énoncé constitue S, il faut tenir compte du fait que “nous”, tout en étant un pluriel, est de la première personne (p.14).
Pourquoi ne savons-nous pas (ne pouvons-nous savoir) à quel type d’affirmation nous avons affaire ? Parce que tout énoncé envisagé par les philosophes du langage ordinaire ne l’est que dans sa situation particulière (son occasion). Et nous ne nous accordons non sur des « significations », mais sur des usages. Or il n’y a pas de critère autre que le « nous » – le « je » – pour les déterminer (qui les détermine). De ce fait, les « caractérisations » générales (telles que la distinction analytique-synthétique) sont vouées à l’échec[20]. Et ce qui m’autorise à dire ce que je dis que nous disons d’ordinaire est le fait que ce langage m’est naturel, que c’est ma langue maternelle. Comme il le dira postérieurement « De telles révélations, qui sortent du banal, sont le cœur vivant de la manière de philosopher propre aux procédures du langage ordinaire »[21].
Et de ce fait, on ne peut pas de systématique récuser ce que nous disons. « La thèse selon laquelle nous n’avons en général pas besoin de preuves pour les énoncés à la première personne du pluriel ne repose pas sur l’affirmation que nous ne saurions nous tromper sur ce que nous faisons ou sur ce que nous disons, mais seulement qu’il serait extraordinaire que nous nous trompions (souvent). Donc ce que je veux indiquer à propos de ces énoncés, c’est qu’ils ne sont mis en cause de manière sensée que lorsqu’il y a une raison particulière de supposer que ce que je dis sur ce que je dis (ou sur ce que nous disons) est faux : c’est seulement là que l’exigence d’une preuve s’applique » (p. 14). Il me semble que la clarté du propos se suffit à lui-même, et d’une manière analogue on a pu voir que « volontaire » ne peut pas s’appliquer à toute action ; c’est pourquoi on peut en conclure, avec Cavell, que nous sommes bien fondés à dire ce que nous disons, quand nous disons que « nous disons que… ».
Mais on peut aller plus loin, en disant que nous avons aussi le droit de dire des énoncés tels «Nous pouvons dire…» et «Nous ne pouvons pas dire…», c’est-à-dire passer d’énoncés portant sur le langage, à des énoncés portant sur le monde. Appréhender le langage de la manière que revendiquent les philosophes du langage ordinaire n’est pas « se payer de mots », mais appréhender des phénomènes (réels, mondains). « On a parfois l’impression que les différences chez Austin pénètrent les phénomènes qu’elles relatent »[22]. C’est pourquoi nous apprenons (découvrons) quelque chose sur le monde, l’action, etc., quand nous faisons des recherches sur notre langage.
« Pourquoi postule-t-on que nous découvrons ce que sont des actions volontaires et involontaires (et également, bien sûr, ce que sont des actions faites par inadvertance, machinales, pieuses, etc.) en demandant quand nous devrions dire d’une action qu’elle est volontaire, ou faite par inadvertance ou pieuse, etc. ? Mais qu’y a-t-il là dedans de dérangeant ? Si vous avez l’impression que, pour découvrir ce qu’est une chose, il faut absolument une enquête sur le monde plutôt que sur le langage, peut-être êtes-vous en train d’imaginer une situation où il s’agit par exemple de trouver quels sont le nom et l’adresse de quelqu’un, ou quel est le contenu d’un testament ou d’une bouteille, ou si les grenouilles mangent les papillons » (p. 19);
c’est-à-dire des cas où il est possible concrètement de faire cette enquête, mais dire cela serait nous inciter à la confusion, car nous n’avons, dans tous les cas, nullement besoin « d’enquête mondaine » à proprement parler. Tous les éléments (à savoir) sont déjà dans le langage lui-même (le discours), car « nous apprenons le langage et nous apprenons le monde ensemble, ils se compliquent et se distordent progressivement ensemble, et aux mêmes endroits » (Ibid). Ce qu’il faut entendre par là, c’est que comme notre langage est notre forme de vie[23], l’apprendre, c’est apprendre une forme de vie, (c’est-à-dire pas seulement ce qu’elle est, mais aussi comment l’utiliser).
Rechercher un mot
Rechercher un mot dans le dictionnaire devient affaire de recognition (de réminiscence) de quelque chose que nous connaissons déjà. Car, en fin de compte, que fait-on quand on cherche la signification d’un mot dans un dictionnaire ? « Tout ce qu’un dictionnaire peut faire quand nous y “regardons la signification d’un mot”, c’est (de) nous aider à comprendre ces phrases. Il semble donc juste de dire que ce qui “ a une signification”, au sens premier, c’est la phrase »[24]. Qu’est-ce que comprendre une phrase ? « En gros : comprendre une phrase veut dire comprendre un langage. En tant qu’elle est une partie du système langagier, pourrait-on dire, la phrase est vivante »[25]. Et dans ce dictionnaire, suis-je en train de chercher à savoir ce que veut dire «un terme» (« umiak » par exemple) ou (de chercher à savoir) ce qu’est ce « terme » ? Ce que l’on trouve dans un dictionnaire, ce n’est pas vraiment la « définition » d’un mot, mais des éléments (déjà connus) pour me le faire comprendre.
Deux situations se profilent : soit je ne connais pas du tout ce mot, je ne l’ai jamais rencontré, appris ; soit je ne le connais pas sous ce mode-là, je ne comprends pas ce qu’il veut dire dans cette phrase-là. Comme le souligne justement Cavell « Ce que vous avez besoin d’apprendre dépendra de ce que vous voulez savoir en particulier ; et la manière dont vous pouvez le découvrir dépendra particulièrement de ce que vous maîtrisez déjà » (p. 20). Par conséquent, on voit bien que ce que nous faisons quand nous cherchons un mot dans un dictionnaire, c’est amener « le monde au dictionnaire ». Parce que chercher ce que « nous dirions quand » ne se trouve pas là. Et il nous faut souligner avec Cavell que
La clarté qu’Austin recherche dans la philosophie est à atteindre par l’établissement de la carte des champs de conscience qu’éclairent les occasions d’un mot, et non pas par l’analyse ou la substitution d’autres mots à un mot donné ( MWM, p. 100).
Néanmoins, on peut remarquer que parfois, dans la deuxième situation – celle où on recherche ce que le terme « veut dire »– nous savons déjà ce que le dictionnaire peut vous apprendre et nous sommes alors « forcés de philosopher » :
« Il arrive parfois que nous sachions tout ce qu’il y a à savoir d’une situation – ce que veulent dire tous les mots en cause, en quoi consistent tous les faits pertinents ; nous avons tout sous les yeux. Et pourtant nous avons l’impression qu’il y a quelque chose que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas. (…) Socrate dit que dans une telle situation nous avons besoin de nous souvenir d’une chose. Le philosophe qui part du langage ordinaire dit la même chose : nous avons besoin de nous souvenir de ce que nous devrions dire et quand ».
C’est ainsi que nous pouvons dire que nous trouvons ce que « veut-vraiment-dire-un-mot ». Car que nous montre la démarche de Socrate (que Mates raille), qui nous invite à nous remémorer non les seuls « mots », mais les situations où nous les utilisons et en même temps nous implore de nous connaître nous-mêmes ? En nous demandant d’être attentifs à ce que nous disons dans certaines situations, en invoquant nos souvenirs (réminiscence),
Socrate parvient à ce que ses antagonistes retirent leurs définitions non pas parce qu’ils ne savent pas ce que leurs mots veulent dire, mais parce qu’ils savent ce qu’ils (leurs mots) veulent dire, et qu’ils savent donc que Socrate les a menés à un paradoxe. (Comment pourrais-je être mené à un paradoxe si je pouvais signifier ce que je désirais par mes mots ? Parce que je dois être conséquent ? Mais comment pourrais-je être inconséquent si les mots voulaient bien signifier ce que je voulais qu’ils signifient ?) Ce dont ils ne s’étaient pas rendu compte, c’est de ce qu’ils étaient en train de dire, ou de ce qu’ils étaient vraiment en train de dire, ainsi ils n’avaient pas su ce qu’ils voulaient dire. En ce sens, ils ne s’étaient pas connus eux-mêmes, et n’avaient pas connu le monde. Je veux dire, bien sûr, le monde ordinaire. (…) Il ne fait pas de doute qu’une part des mathématiques et de la science ne lui appartient pas (p. 39).
Cette conclusion a quelque chose de terrible et de terrifiant, elle nous montre combien il est important de savoir ce que disent mes mots (ce que je veux dire). Et pour ce faire, il faudrait envisager ce qu’ils ont de normatif, et tenter de circonscrire ce qu’est le normatif.
Delphine Dubs
[1] Il lui trouve une utilité : celle d’empêcher de postuler de nouveaux types particuliers de signification (il vise ici la distinction non-cognitive/émotive) car la pragmatique d’un énoncé (ses conditions d’énonciation et les effets produits à ce niveau) n’implique rien quant à sa sémantique.
[2] Cavell, [MWM], p.9. (Toutes les références dans le texte renvoient à la pagination de la version originale de l’article)
[3] Cette notion deviendra la notion « d’implicature » autrement dit une « implication » dans un sens non logique. Elle prend source dans le débat sur le(s) paradoxe(s) de Moore, dont il est question dans « g. e. moore and Philosopher’s paradoxes »(1953) et « Meaning » (1957) in Studies in the Ways of Words, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1989. Austin (« La signification d’un mot », Écrits philosophiques, op. cit.) et Strawson (« De l’acte à la référence », 1950, Études de logique et de linguistique, trad. J. Milner, Paris, Seuil, 1977.) participent aussi à sa formation. Nous reviendrons plus en détail sur Grice un peu plus loin, quand nous envisagerons la question de « l’intention », et la tendance de Grice à se rabattre sur une version causaliste de l’intention.
43 Cf. la distinction entre signification naturelle et non-naturelle de Grice, « Meaning », op. cit.
[5] On joue sur les mots… Rappelons que « naturellement » ici doit s’entendre comme quelque chose que nous savons parce que nous l’avons appris, nous avons déjà été confrontés à de telles situations, ou nous les avons observées. Le langage est notre « forme de vie ».
[6] Par exemple, pour reprendre un exemple d’Austin dans « Autrui », dire « je sais que p est q » autorise autrui à dire que « p est q ».
[7] Une analycité qui n’en est pas une… « Volontaire » veut dire particulier ici, et pas à chaque fois. On ne trouve pas « particulier » comme terme définissant « volontaire » dans un dictionnaire. Autrement dit, c’est bien une « implication » mais pas au sens logique (classique).
[8] Dans le sens où toute analyse est rabattue sur la distinction vrai-faux.
[9] Position classique depuis Frege.
[10] Austin, « La signification d’un mot », op. cit., p.30.
[11] «Il faut être deux pour faire une vérité » (traduction modifiée :« it takes two to make a truth »), Austin, « Vérité », Écrits philosophiques, op.cit., note 14, p. 100. « Vrai » désigne une dimension générale de convenance, de ce qui est approprié dans ces circonstances-là : « La vérité ou fausseté d’un énoncé ne dépend pas de la seule signification des mots, mais de l’acte précis et des circonstances précises où il est effectué », Quand dire c’est faire, op. cit., p. 148.
[12] Si cette « quasi logique » relève de la déduction ou de l’induction, on rabat le pragmatique sous la contrainte logique au sens classique du terme, et donc en fait une extension du sémantique (quand on le formalise, quand on permet de l’évaluer tel un calcul).
[13] « Pour qu’il y ait communication au moyen du langage, il doit y avoir accord non seulement dans les définitions, mais aussi dans les jugements. Cela semble abolir la logique, mais ce n’est pas le cas », wittgenstein, §242 des Recherches philosophiques, 1958, trad. F. Dastur, M. Elie, J-L . Gautero et al., Paris, Gallimard, 2005.
[14] Austin, « La signification d’un mot », op. cit., p.29-37.
[15] Ibid.p. 31.
[16] Austin traite implicature et présupposition de manière indifférenciée ; ce qui compte c’est la validité de « je crois que p » lorsque j’asserte (dis que) p. Lorsqu’il propose le modèle de la question, il se réfère en particulier à Frege (« Recherches logiques 1.la pensée », Écrits logiques et philosophiques), qu’il connaît bien pour l’avoir traduit en anglais. À défaut d’entrer plus en profondeur dans ce débat entre Frege-Austin-Stawson-Gric, précisons ici que pour la présupposition, il faut une présupposition commune pour envisager la question de la contradiction, alors que l’implication pragmatique aurait pour « vice » un mensonge ou une insincérité et ne peut pas être « faux » au sens « n’existe pas ».
[17] Austin, « La signification d’un mot », op. cit., p.30.
[18] Les liens entre nécessité et a priori (pour ne pas dire analytique puisque cela serait un type d’analycité vraiment très particulier…) sont tels, que je cèderai bien à la tentation, initiée par Cavell, de les qualifier d’a priori… Même si « Nous ne savons pas non plus s’il faut dire qu’il s’agit d’énoncés a priori, ou s’il faut expliquer leur air de nécessité comme une illusion dialectique, due davantage au mouvement de notre argumentation qu’à leur propre nature». p.16. Pourtant, on pourrait dire que ce type d’énoncé, dont la nécessité nous frappe, pourrait être dit catégoriels, c’est-à-dire qu’il porte sur l’action (dans ce qu’elle a de général ou, dirais-je, de normal). On aurait alors affaire à une logique transcendantale et non pas formelle.
[19] En revanche, un énoncé tel que (T) «“X est-il volontaire ?” implique que X est douteux» semble bien synthétique et donc le réquisit de preuves est sensé ici. Mais un énoncé de la même forme (T’) tel «On ne dit pas (d’ordinaire) : Je le sais, à moins que le locuteur n’ait une grande confiance sur ce point», ne peut pas – comme le montre Cavell – être synthétique.
[20] Austin soulignait cela dans « la signification d’un mot » (p.34) à propos de Moore, qui soutient qu’un énoncé tel « Ce qui est bon devrait exister » est synthétique, et le tient pour vrai, alors que dire qu’un énoncé est synthétique l’expose au genre de réfutation que propose, par exemple, Mates dans son article.
[21] Cavell, Un Ton pour la philosophie, op. cit., p.7. Nous estimerons à proprement parler toutes les implications d’une telle découverte dans la seconde partie de ce mémoire.
[22] Cavell, « Austin at criticism », MWM, p. 103.
[23] « Se représenter un langage veut dire se représenter une forme de vie ». Wittgenstein, §19 Recherches philosophiques.
[24] John Langshaw Austin, « La signification d’un mot », op. cit., p.23.
[25] Ludwig Wittgenstein, Le Cahier bleu et le cahier brun, 1958, trad. M. Goldberg & J. Sackur, Paris, Gallimard, 1969, p. 40, je souligne.