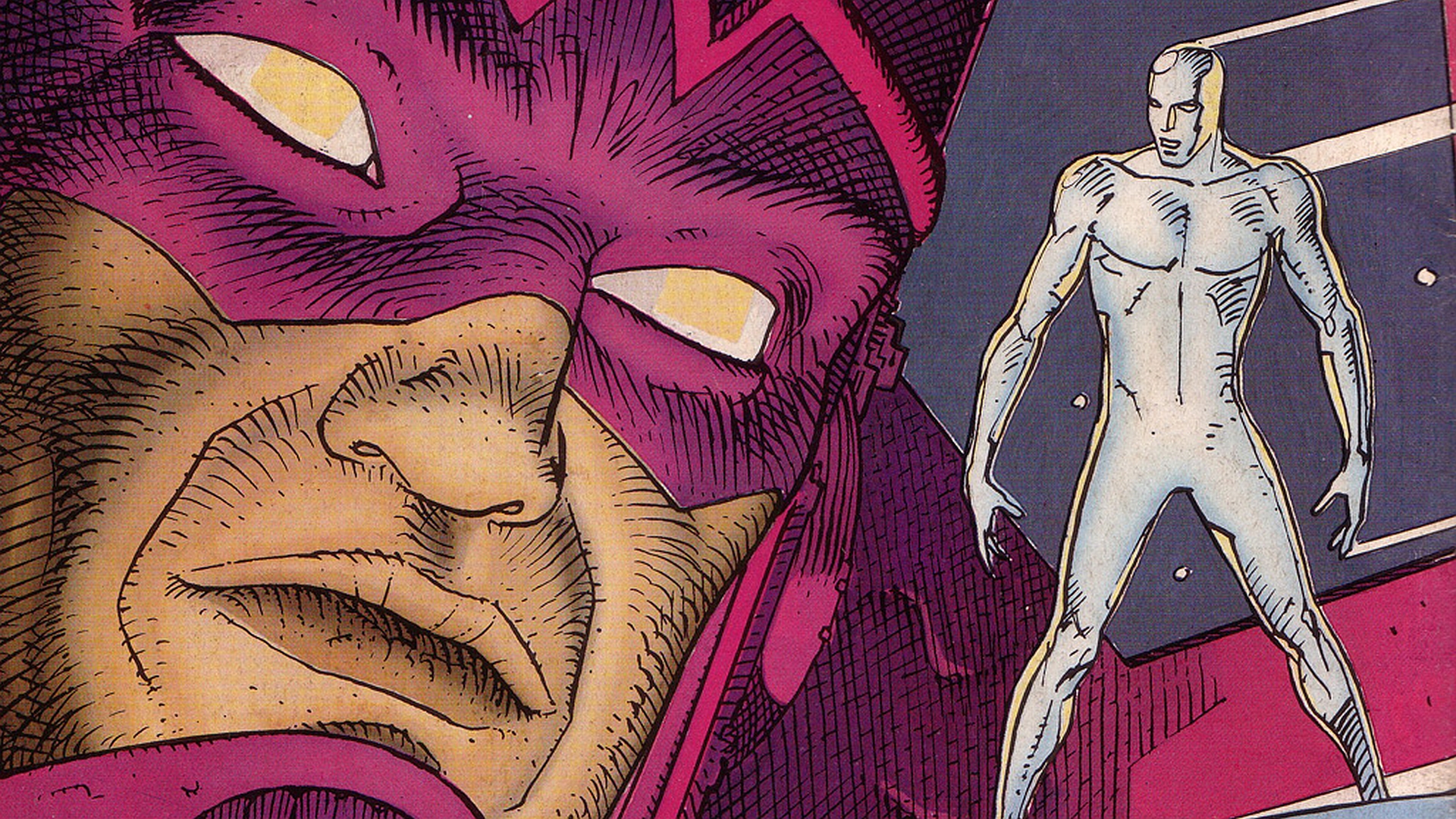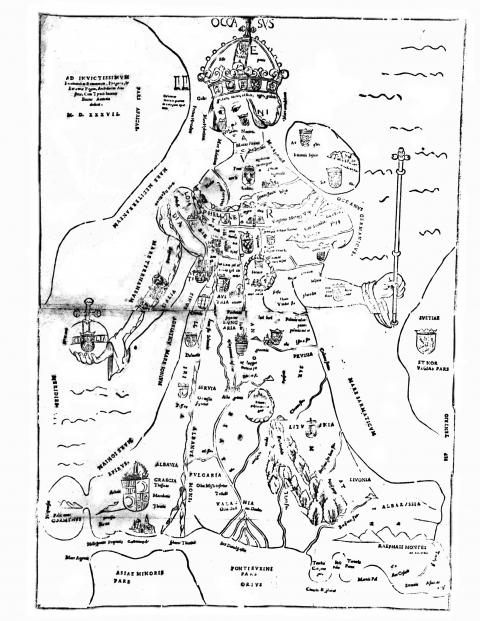Le roman, saint et bâtard
Sylvie Taussig – CNRS
Le présent article est tout à fait expérimental car je pose sur le roman et l’Église (mais que faut-il exactement entendre sous ce mot ?) un regard qui n’est pas celui du comparatiste (car quelle comparaison entre deux objets aussi hétérogènes) et qui ne sait guère où se poser. Je le fais également sans méthode particulière et sans discursivité identifiée. Cette liberté m’est donnée par le format de ce dossier ; mon papier vient aussi en conclusion pour ouvrir des pistes, fût-ce de manière un peu acrobatique.
Le roman, comme l’Église « romaine », vient, par une étymologie indirecte, de Rome ; est-il un chemin qui y retourne ? Ou bien est-il, à l’intérieur de Rome, la présence de Jérusalem, si ce n’est que Rome n’est pas Athènes et que donc l’opposition de Chestov ne fonctionne pas[1] ? Avec cette entrée en matière spirituelle et peu spirituelle (ou l’inverse), cet article propose un éclairage analogique, voire mythique et non point une étude historique poussée, du rejet ancestral, par l’Église, du genre romanesque. En fait, ce rejet n’est pas forcément général, il n’est pas un article de foi, et il caractérise même une certaine tension dans l’Église, car il y a naturellement des romans chrétiens, et aussi des interprétations chrétiennes de certains romans. Mon propos semble donc peu fondé et périlleux, pourtant il vient éclairer l’opposition que ce dossier tente de mettre en place entre sacré et saint.
Sans fournir un tableau historique complet du rapport complexe de l’Église (et quelle église) à ce genre très moderne qu’est le roman, je partirai du Roman de la rose, qui fut l’objet de la première querelle littéraire française, même si l’ouvrage serait aujourd’hui difficilement qualifié de roman. Le Traité contre le Roman de la Rose du chancelier de l’Église de Paris, le théologien Jean de Gerson, accuse le texte de manquer de respect envers les choses religieuses et envers la raison à laquelle il ferait tenir des propos « blasphémateurs » ; il lui reproche surtout de mêler le registre sacré et le registre profane, une critique surprenante puisque le Moyen Âge est coutumier de ce type de mélange : “Travesty, profanation, and sacrilege are essential to the continuity of the sacred in society[2].” Pourquoi le roman dérangeait-il donc ? Et pourquoi le genre romanesque a-t-il continué à déranger à travers les siècles ?
La méthode consiste à proposer plusieurs points de départ, plusieurs fils, que je tâcherai de réunir à la fin. Un des fils est le fait bien connu qu’on n’attaque que ce qui est proche de soi, pour s’en différencier, et jamais le complètement autre : il y aurait donc des éléments d’une troublante similarité entre roman et « génie du christianisme » et des différences fondamentales qui seraient telles que l’Église se sentirait attaquée.
Un autre fil est historique : le roman apparaît véritablement aux premières heures de l’époque moderne, plongeant ses racines dans le roman de chevalerie médiéval de Chrétien de Troyes et dans les nouvelles médiévales : Rabelais, Cervantès. Cette apparition est concomitante à la transformation de la royauté en absolutisme monarchique, c’est-à-dire que la sacralité se déplace de la fonction, sacrée au Moyen Âge (sacre, écrouelles, cf. les Deux corps du roi), à la personne physique. Le roi est donc à la limite comme une nouvelle incarnation du pouvoir de dieu et organise un culte autour de sa personne. Le sacré étant happé par le pouvoir séculier, le saint se promène en liberté, c’est-à-dire sans mécanisme d’intégration sociale. Mon hypothèse est qu’il investit le roman.
Le roman apparaît au moment de la Réforme[3], et on pourrait dire qu’il pourrait s’expliquer par un nouveau rapport à l’intériorité en une quête inquiète de l’authenticité, notion dont Charles Taylor fait le concept clef de la modernité spirituelle[4]. Le genre s’est même répandu dans les pays catholiques tout autant (sinon plus), au moment où le culte des saints prenait particulièrement d’ampleur, dans sa stratégie de la contre réforme. Avec le culte des saints, nous sommes aussi devant un phénomène de sacralisation et peut-être moins de sanctification ; en tout cas d’élévation de personnes ordinaires à une fonction de médiateurs susceptibles de recevoir des prières et une forme de culte. Les saints, dans ce sens, sont plutôt des personnes sacralisées, sinon élevées au rang de demi dieux, à l’image de la mère de Jésus elle-même, dite sainte, mais paraissant moins sanctifiante que susceptible de recevoir un culte et de figurer sur des images sacrés – et c’est bien cette sacralisation que la Réforme dénonce dans le culte marial. Il en va des « saints » donc comme des rois : comme si reconnaître l’importance de la personne, de cette personne, de l’individualité, c’était obligatoirement la rendre sacer, c’est-à-dire voué à un dieu ou sanctus (de sancire) c’est-à-dire rendu irrévocable. Ce sacer est un concept typiquement romain – il renvoie à la part païenne de la foi catholique, laquelle porte également une part juive, pour qui la notion de sacré n’existe pas, ou plutôt pour qui le sacré est ce qui renvoie forcément à l’idolâtrie et qu’il faut rejeter. Le saint chrétien porte ce double héritage, car il est à la fois une figure du sacré, nourrissant l’idolâtrie, et une figure du saint, permettant de se « séparer » d’elle (« Soyez saints comme je suis saint… Exode 19,1). D’un autre côté, les saints ne sont pas des saints au sens trivial du terme ; ils sont même le contraire, et en ce sens ils s’opposent totalement aux sages prônés par la philosophie dont les vies sont entièrement exemplaires et significatives, comme on le voit par exemple chez Diogène Laërce. Ce sont des vies humaines, dont l’Église après coup décide qu’elles auront été saintes ou plutôt qu’elles méritent de devenir sacrées. Et par là deviennent source d’aliénation, de même que ce n’est pas la technique qui nous asservit mais le sacré transféré à la technique ; ou que ce n’est pas l’État qui nous asservit, c’est sa transfiguration sacrale.
Reprenons quelques éléments de définition : le sacré est une puissance immobile, et il est ce qui sidère, paralyse, comme on le voit exemplairement chez Burke[5], où il s’identifie au sublime dans sa dimension d’écrasement plutôt que d’élévation (plus présente chez le pseudo-Longin), inspirant « fear and awe ». Face à cette puissance, qui atterre, paralyse, voire anéantit au moment où l’on en fait l’expérience, il y a cette autre puissance, la sainteté, qui n’existe pas chez Longin, et pour cause, mais semble plonger ses racines dans le judaïsme pour qui le sacré n’existe pas. Le saint à l’inverse représente un mouvement, la possibilité d’une sanctification. Le sacré existe dans les religions dominées par le sacrifice[6] ; il est le produit du sacrifie considéré comme essentiellement païen dans la tradition juive à commencer par la ligature d’Isaac ; il demeure dans le christianisme qui s’emploie en partie à résoudre les contradictions, comme l’exprime de façon inégalée Pascal dans les Écrits sur la grâce. Mon hypothèse est ici que le roman explore une piste singulière pour décrire la sainteté en refusant toute dimension sacrée, et y compris toute image, toujours susceptible de devenir un support pour l’idolâtrie.
Le roman serait donc haï de l’Église, elle qui s’invente comme corps du Christ – corps idolâtré, en tant qu’il la surprend en train de ne pas désamorcer le sacré, mais au contraire d’en faire un puissant outil, et qui se renforce encore à l’âge classique avec les propositions esthétiques de la Contre Réforme.
S’il est vrai que le sacré implique toujours une stylisation en reposant sur la préfiguration[7] – il est une dimension fondamentale dans le christianisme comme signe supplémentaire par rapport à ce qu’il appelle l’« ancien testament », dès lors que tous les signes messianiques ne sont pas là pour désigner Jésus, alors on ajoute des signes « païens », le roman fait échouer la préfiguration qui relève du mythe en proposant une autre histoire possible ; il désamorce le sacré en fournissant des possibles, en désignant la réalité comme une des réalités possibles. L’imagination serait donc le moyen de sortir de la réitération mythique.
Le roman serait une voie différente de la voie protestante, de retour au texte et donc d’un certain fondamentalisme, excluant[8] les interprétations historiques successives, que l’Église maintenant catholique appelle la « tradition » et qu’elle définit comme inspirée par l’« Esprit saint », la mettant donc sur le même plan que les Écritures – lesquelles sont cependant saintes et non sacrées[9]
Il s’agit en bref de comprendre en quel sens Oscar Wilde, romancier inclassable, dit de Jésus qu’« avec une imagination dont l’extraordinaire ampleur est presque terrifiante, il prit pour royaume tout l’univers de l’inarticulé, l’univers sans voix de la douleur, et s’en fit pour l’éternité le porte-parole[10] » et de démontrer que le roman n’est pas une sécularisation des Écritures, mais une élaboration critique. Wilde est ici génial, en ce qu’il ne parle pas du sacrifice de Jésus, mais d’une parole divine qui n’est déposée et fixée nulle part, rejoignant la Sagesse créatrice (Proverbes (Pr 8, 22-31).
Le roman d’une part mettrait en place une solution à la fameuse question de la vertu des païens ou de l’adage « hors de l’église pas de salut », anticipant le thème des « chrétiens anonymes » élaboré par le théologien Karl Rahner[11] : « Celui qui ne se trouve en aucune manière en lien historique concret avec la prédication expresse du christianisme peut néanmoins être un homme justifié, qui vit dans la grâce de Dieu. Il ne possède pas seulement alors cette autocommunication surnaturellement gracieuse de Dieu comme une offre, comme un existential de son existence ; mais il a également accueilli cette offre, possède ainsi proprement l’essentiel de ce que le christianisme veut lui transmettre : son salut dans la grâce qui objectivement est celle de Jésus Christ. Parce que l’autocommunication transcendantale de Dieu comme offre à la liberté de l’homme est, d’un côté un existential de tout homme, et, d’un autre côté, un moment de cette autocommunication de Dieu au monde qui en Jésus-Christ possède son terme et son point culminant l’on peut parler sans hésiter d’un “chrétien anonyme”[12]. »
Le héros romanesque ne mérite cependant pas ce nom de « héros », encore un terme hérité du monde « païen » dont la réalité mérite d’être mise en parallèle avec celle des saints, pour bien comprendre l’articulation du saint et du sacré. Le héros appartient au monde qui connaît le sacré. Le héros de roman intègre la dimension de sainteté chrétienne. Car, chez les grec hagios ne désigne jamais le héros individuel ; si bien que le saint est en quelque sorte la synthèse du héros et du hagios, dont l’héroïsme consiste à marcher vers l’état de hagios, ou plutôt de vie au repos. Gassendi fournit une clef pour comprendre comment on passe au héros de roman[13] : de fait, il utilise la périphrase de « héroïne » (principalement les femmes, de façon curieuse) pour désigner autrement que par leurs noms les individus pas forcément « héroïques » dont il commente un fait ou geste. Les mêmes, une fois morts, sont des makaritès – des bienheureux, translittéré du grec. Le terme de héros renvoie au mouvement de la vie, et donc à l’impossibilité d’être saint en tant que séparé du pur, alors que le bios comme vie est bien un bios (arc) qui est mort, suivant Héraclite (fr. 49) c’est-à-dire un mouvement ; déplaçant à cette lumière le proverbe bios abiotos commenté par Rabelais, une bios sans bios, non pas sans santé mais sans ce qui cause la mort, ne mérite pas d’être vécue ; l’existence au repos c’est bien la mort.
Les héros romanesques doivent donc s’appeler des saints, au-delà du bien et du mal, sanctifiés par leurs épreuves et leur existence romanesque ; ce n’est pas que le roman fait exister des personnes oubliées de l’histoire, oubliées des canonisations canoniques, invisibles comme le levain de la pâte ; le roman ne parle pas de « vaincus » de l’histoire, en fait il ne parle pas de l’histoire réelle, mais de toutes les possibilités et de l’histoire « réelle » comme une possibilité actualisée. Dans le visible il y a les saints « homologués, dans lesquels s’expose le passage de l’invisible au visible », selon Blumenberg, et les saints si invisibles que même leur nom n’existe pas. Que sont les noms des personnages de roman ?
En effet, c’est à l’occasion d’une réflexion sur le roman que Blumenberg ressent la nécessité de développer une typologie des concepts de réalité, afin de comprendre le sens de la prétention du roman à « réaliser un monde[14] », le roman étant le « genre le plus rempli de monde et le plus relié au monde, genre d’un contexte certes en soi fini, mais présupposant de l’infini et renvoyant à de l’infini[15] ». Et ce monde est bien nulle part, mais sa désignation n’est pas absurde : il est comme le chat de Schrödinger, si je peux utiliser ce lieu commun. Et le chat, c’est bien ce qu’est le monde, et c’est bien ce qu’est Jésus. Ni vivant ni mort, à la fois vivant et mort, selon le moment de l’année. Si l’artiste est celui pour lequel « l’expression est le seul mode sous lequel la vie lui soit concevable. Pour lui ce qui est muet est mort[16] », le roman comme genre présente une théologie « moliniste » ou apocatastatique, qui consiste à vider l’enfer de toutes les âmes modernes au nom de la miséricorde de dieu.
La condition pour être un « saint » c’est être ni vivant ni mort, et cependant exister. Être un qui met les autres en mouvement. De même Jésus n’est pas non plus un héros et il n’agit pas à coups d’efforts volontaires ; il se laisse vaincre, il meurt pour laisser naître et vivre en lui le second Adam, le Christ. En ce sens, tout effort humain est vain ; la sainteté ne veut pas seulement la sainteté, mais la metanoia, la conversion. Toute vie de saint est l’emprise progressive du saint sur le non saint, pour qu’il ne reste rien qui ne soit sanctifié, déifié, conforme aux mœurs de dieu : c’est une vie qui indique une dépossession de soi (comme être naturel) et une dépossession par dieu. Dieu a parlé et l’homme s’est retourné, comme en une collaboration entre les deux. Mais le problème du saint et peut-être de Christ si l’on recherche une sainteté dépourvue de sacré, c’est-à-dire dépourvue de pouvoir, une sainteté comme humilité, nécessaire à la relation de « soin », c’est bien sa publicité et donc sa sacralisation fatale, qui touche ses vêtements, ses instruments de supplice, sa tunique, et j’en passe. Il en va de même pour les saints.
Le saint comme « héros » romanesque sera donc à jamais caché en tant que tel ; il ne peut dévoiler sa sainteté qui ne peut non plus se dévoiler ou se canoniser, sans incarner le sacré. Dans le roman, l’action de dieu appelant à devenir « saint car il est saint » (Lévitique, 19,2) ne peut pas non plus se dire, de sorte que le meilleur précédent du roman pourrait bien être, dans la bible hébraïque, le livre d’Esther, avec la mise en exergue paradoxale d’un personnage féminin, une héroïne, dont le nom signifie, selon le Midrach, le « caché ». Le terme de « roman » pourrait traduire alors celui de « Meguilát », qui signifie révéler. Ce livre biblique, qui ne parle ni de sacrifice, ni de sacré, ni de dieu, mais bien de meurtres, est bien paradoxal, en tant que « roman » ; il a du reste eu bien du mal à s’imposer dans le canon de la bible hébraïque et donne cependant lieu à une fête, Pourim, fête du travestissement et du théâtre, une fête éminemment littéraire, la seule fête qui ne soit pas prescrite dans la Torah. Étant « dehors », elle désigne la diversité – et son articulation avec l’unité. Le problème principal du sacré, c’est son unité sans diversité possible – la non collaboration de l’homme, écrasé, sidéré. Logiquement, le judaïsme ne rejette pas le « roman » (la Aggadah entendue comme représentation de la diversité, est reconnue à côté de la Halakhah soit la Loi, l’unité) : il est le peuple « des livres » et non pas « du livre ».
Le travestissement, le caché, le double : on est loin de la recherche de « l’authenticité » et du sujet, qui pourrait bien recouvrir cette tension plus importante, mise en évidence par Bakhtine dans la « fête des fous », sur Rabelais[17].
Dire que le roman apparaît au XVIe siècle, c’est dire aussi que le genre n’existe pas auparavant et donc qu’il n’est pas théorisé dans la typologie littéraire d’Aristote. Le roman, genre opportuniste, qui agrège à sa composition tous les genres et registres possibles et se montre de la plus grande malléabilité, tout en demeurant « roman » (il n’a jamais été question de le débaptiser) se prête à une étonnante inculturation, et il ne suffit sans doute pas d’évoquer l’impérialisme et le colonialisme pour comprendre son succès mondial. Même s’il ne manque pas de détracteurs pour stigmatiser la bâtardisation, par son biais, des cultures traditionnelles et la mort de l’oralité. C’est à ce titre que Benjamin l’attaque[18]. En effet, pour Benjamin, l’apparition des romans signe la disparition de la transmission orale et de la transmission tout court : comme tout doit être chaque fois réinventé, la modernité est barbarie, et il n’y a pas de sens dès lors qu’il n’y a pas d’expérience. Le roman tue même l’idée de sens puisqu’à la fin tout est fini, achevé, sans dire un mot sur le monde « réel », que l’acceptation petite-bourgeoise de tout ce qui est. À l’extrême, il sera mangé et englouti par l’information, et son exigence de réalisme, quand la narration, quand elle était orale et une chaîne ininterrompue, était marquée par l’extraordinaire. À l’ère de la reproduction technique, c’est cela la destruction de l’aura : la fin de la parole vivante, et la fin de l’idée de la mort, évacuée du monde petit-bourgeois. Et de stigmatiser l’homme moderne, et sa prétention à s’émanciper de tout. Il m’a semblé cependant que cette attaque sévère contre le roman, du reste contradictoire avec le fait que Benjamin apprécie par exemple, et ô combien, Kafka, en qui il voit un avatar de l’angelus novus, cette figure messianique définie par sa capacité à ramasser et assembler les débris de l’histoire en les portant vers Dieu, devait être replacée dans la perspective plus longue de toutes les détractions et campagnes de calomnies dont il a été l’objet depuis sa naissance, si je peux en parler comme d’une personne et évoquer sérieusement sa prétendue bâtardise et la difficulté qu’on a à lui reconnaître une date et un lieu de naissance certains.
Comme la solution épicurienne pour expliquer le cosmos ne figurait pas dans le Timée, de même le roman ne figure-t-il pas dans la division des genres littéraires par Aristote[19] ; du coup il est en crise perpétuelle de légitimité pour n’avoir pas existé dans le berceau de l’humanité et pour être souillé du délit de l’inexistence, et donc de la génération spontanée. De telle sorte qu’il a été considéré tour à tour sous la triple figure de la débauche sur le plan des mœurs, de l’athéisme pour ce qui est de la religion et de la destruction de l’ordre politique et social, ou au contraire, comme chez Benjamin, comme l’incarnation même du conformisme petit-bourgeois. Le roman, comme les libertins, est un affranchi qui porte les traces de son initiale ignominie. Une lecture théologique du genre romanesque s’impose donc, sous les auspices de la lutte de Jacob avec l’ange.
De fait la critique du roman a des accents platoniciens – la vérité ne serait pas accessible par la littérature « divertissante ». Pour Hans Blumenberg « ce sont les restes platoniciens de notre tradition esthétique qui rendent contestable la place du roman dans notre esthétique traditionnelle et en font le genre de la mauvaise conscience esthétique[20] ». Le roman plus encore que la poésie relève du simulacre. Il mime la réalité, il l’utilise, mais il ne lui est pas fidèle. Il est très loin de rechercher les idées, puisqu’il s’intéresse précisément à ce qui ne ressemble pas aux Idées : les malformés, les échecs, etc., ce que André Gide écrit au chapitre XVII de la première partie des Faux-Monnayeurs : « Vincent parla de la sélection. Il exposa la méthode ordinaire des obtenteurs pour avoir les plus beaux semis; leur choix des spécimens les plus robustes, et cette fantaisie expérimentale d’un horticulteur audacieux qui, par horreur de la routine, l’on dirait presque: par défi, s’avisa d’élire au contraire les individus les plus débiles, — et les floraisons incomparables qu’il obtint. »
Le roman comme genre a été le plus souvent considéré sous l’angle de la bâtardise ou du libertinage. Le libertinage a été réduit, faussement, pour masquer la réalité du sens du mot, soit à l’émancipation par rapport à la religion, soit à une conduite sexuelle hors normes. Or il n’est pas dans la définition du libertinage d’être gravelure, ni même courant philosophique de rejet d’une croyance religieuse ; il désigne bien plutôt ce qui porte la trace de son étymologie, à savoir le renoncement à toute origine : libertus, l’affranchi, ou l’émancipé, ne revendiquant aucune paternité, échappant aux logiques de caste qui gouvernent les sociétés classiques, sociétés d’états. Ainsi des personnages, ainsi du genre, comme l’a démontré Marthe Robert dans son ouvrage classique, Roman des origines, origine du roman. Cette bâtardise n’est pas sans rappeler le personnage de Jésus lui-même à la paternité pour le moins trouble, pour ne rien dire de sa gestation. Alain Houziaux[21] développe cette dimension de Jésus né d’une relation adultérine de Marie sa mère, éventuellement prostituée, suggérée par Mathieu (1,19) et Jean (8, 47), ainsi que par des textes du Talmud. « De fait, le Jésus-Christ des Évangiles semble totalement ignorer qu’il est né “du Saint Esprit”. Lorsqu’il se présente devant le Sanhédrin, il aurait pu faire état des circonstances de sa naissance et du fait que, en conformité avec la prophétie d’Esaïe 7, 14, il était né d’une vierge. Mais il n’en est rien. Il ne laisse jamais entendre ni de près, ni de loin, qu’il a été conçu dans des circonstances miraculeuses et il ne fait jamais état de la virginité de sa mère. […] Le fait que Jésus désigne Dieu comme son « Père » ne suppose nullement qu’il considère qu’il ait été conçu de manière miraculeuse. D’ailleurs, avoir Dieu pour Père n’est en rien le privilège de Jésus et n’implique nullement une naissance miraculeuse. » La vie de Jésus pourrait donc être romanesque au sens le plus trivial du terme, et des auteurs n’ont pas manqué de s’emparer du personnage de Marie-Madeleine. Mais, si elle n’était pas romanesque, elle risquerait de pouvoir être qualifiée de mythique, ce qui fait encore plus horreur aux théologiens pour qui l’importance de la vie de Jésus, verbe incarné, est son historicité. L’Église comme le roman refuse le mythe. C’est sur cette base que les évangiles apocryphes ont été rejetés, en ce qu’ils fondaient la vie de Jésus dans un moule mythique « païen », non pas de héros, mais de figure sacrée.
Cependant ni le roman ni les évangiles ne refusent la transmission ni n’affirment une génération spontanée. Le roman passe son temps à chercher des modèles qu’il s’approprie sans avoir besoin de rendre compte de la façon dont il intertextualise[22]. Pour revenir à Charles Taylor et à sa quête d’authenticité, identifiée à la quête d’un sens qui dépasse l’individu et lui permette de s’accomplir comme soi, le sujet moderne fait l’expérience du fait que le sens lui manque et qu’il ne s’accomplit pas dans le cadre de l’immanence – « the immanent frame » – si celui-ci demeure obstinément fermé à toute ouverture au moins sur une possibilité de transcendance. Le drame de l’humanisme séculier est bien son incroyable clôture sur un horizon qui n’en est plus un et qui a pour conséquence que celui qui vit encastré dans cet horizon matériel n’aurait plus la capacité de donner du sens à ses actions et à son existence. À cet égard, athées et croyants sont chez lui au même plan : ils ont l’authenticité de la quête. En un sens, la quête et son inquiétude sont la position de l’homme dans son rapport à Dieu, les églises étant des organisations et des communautés, mais non pas des lieux où se reclasse la mystique. En ce sens le sujet moderne est toujours mystique. Or, pour le chrétien, la mystique est essentiellement imitation de Jésus ; or le problème de l’imitation de Jésus-hrist est la possibilité de l’antéchrist[23], l’imitateur, Satan.
L’Église redouterait ainsi dans le roman la postulation d’un antéchrist, un pseudo fils signifiant l’annulation du père, la non légitimité étant, d’un point de vue anthropologique, précisément la disparition du père. Le roman pose clairement le problème de la non légitimité, sans le faire en termes de retournement du stigmate, mais de l’émancipation. La crainte des religions se décline autour du thème de la sortie de la religion, et l’émancipation relève de ce thème, qui côtoie apostasie, hérésie. Le roman pourrait bien permettre l’hypothèse de ce Christ là, Jésus, comme un antéchrist, un faux messie, d’où la nécessité de l’Église de maintenir l’héritage juif, de refuser le marcionisme et la gnose, l’irréductible opposition entre un dieu créateur et un dieu rédempteur[24] et d’affirmer une filiation juive qui tempère théologiquement les ardeurs anti-judaïques des dimensions païennes qui la constituent à part égale.
La tentation du paganisme refait surface – celle du sacré – et le roman qui, refusant le langage allégorique et la métaphore, auquel il préfère toujours la métonymie, sa figure propre, serait en soi une allégorie de l’émancipation comme ouverture à la rupture du sens, présentant des situations dont il empêche toute lecture substantielle, semble donc devoir être l’écriture propre de la sainteté, articulant vérité et réalité dans un sens nouveau, qui n’est pas celui de Ricœur, Histoire et vérité[25], lequel défend, dans le contexte du « tournant linguistique », que l’histoire elle-même serait dépourvue de réalité, que la représentation historique se rapprocherait à ce titre de la fiction et que le fait n’aurait qu’une existence linguistique. Or ce qu’est le monde, peut-être un autre mot pour dire la réalité, ne va pas de soi, comme le montre bien Blumenberg. Le roman que l’on ne peut plus appeler « fiction » se joue dans ce cadre sotériologique, voire eschatologique, dans l’articulation du visible et de l’invisible que présentent ces saints « anonymes » que sont les personnages de roman, et j’entends ici saints comme ceux qui permettent de débarrasser l’homme de la tentation du sacré, ce qui est aussi un des rôles de la religion dans son versant moral (éthique) et politique (refus de l’un en politique au sens de La Boétie[26]). Les vies de saints et les romans présentent des personnages pleins de souillures. Voyons que Les Trois contes de Flaubert, suivant un ordre chronologique inverse, mettent en perspective leurs rapports, la vision moderne (celle d’un « Cœur simple ») éclairant a posteriori l’interprétation du récit « médiévalisant » et du récit antiquisant : trois figures de saints sans le savoir, puisque Iaokanann meurt avant l’annonce de la bonne nouvelle, que Julien est surtout un sanguinaire et Félicité une simplette qui voit l’Esprit saint dans son perroquet. Le parallèle s’expose encore plus clairement dans ces deux œuvres que sont d’un côté La Tentation de Saint Antoine et de l’autre Bouvard et Pécuchet.
Le travail à la fois réaliste et fantastique de Flaubert signale une singularité de l’écriture des vies de saint : exactitude méticuleuse à l’endroit de chaque détail de la vie des personnes dont on parle, et cela pour éviter de tomber dans le mythe. Ce qui compte, chez les saints, est l’exactitude incarnée de la rédaction des faits de leurs vies entendues comme des vies humaines, pécheresses, dans lesquelles on ne sait proprement pas identifier ce qui caractérise leur sainteté. Et c’est là que la fiction et l’histoire sont de fait liées, dans la recherche et le rappel scrupuleux qui excluent tout jugement et excluent d’en éliminer aucun au motif qu’il n’entrerait pas dans le tableau de tous les faits. L’Église procède toujours à un procès historiquement très circonstancié des existences avant canonisation ; cette historicité, ce désir de réalité, dans tous les sens du terme, fait écho au désir de faire le récit « historique », c’est-à-dire incarné de l’existence terrestre de Jésus. C’est un point capital : il n’est pas un personnage mythique.
Le roman témoigne de la position de l’auteur comme Dieu, non pas comme rival, mais comme analogon. Le romancier imite, non point au sens de la singerie, mais de l’approchement comme essai de conformation, le Dieu créateur et rédempteur dont les chemins sont réellement impénétrables. Mais cette révélation ne se fait pas sous le signe de la prédication ou de la certitude, mais bien de la liberté et de la mise en question – de l’ironie. En ce sens le genre romanesque prend place après la mort de Dieu et pose Dieu par sa négation sans que ce soit une théologie négative, au sens classique du terme. La parole faite lumière, la parole faite chair, présente dès le début de l’histoire selon la bible hébraïque, dans un récit qui exclut le dualisme et le sacré, implique comme une impossibilité de penser et d’écrire sans rencontrer le saint, le séparé, si bien que le roman, qui n’a aucun rapport avec le sacré, alimente le rapport le plus vivant avec lui, dans une exaspération de la tension inhérente à l’écriture fantastique présente depuis Rabelais ou Cervantès jusqu’à la science-fiction en passant par les romantiques allemands. Le romancier sauve de l’enfer des personnes dont le magistère aurait blâmé la vie morale, peu exemplaire, des assassins, des adultères, des incestueux, des affabulateurs, et place l’amour au centre de la vie humaine, scellant une nouvelle eucharistie dans l’écriture[27]. L’écriture romanesque est donc essentiellement métonymique, et jamais métaphorique, si bien que le roman est moins « un miroir qui se promène sur une grande route », selon la si célèbre phrase de Stendhal, qu’un hasardeux cheminement comme chez Modiano.
Les héros de roman qui revendiquent souvent la sainteté[28] pourraient correspondre à la catégorie de profane selon Tillich qui défend « la conviction qu’aucune muraille ne sépare le religieux du non-religieux ». D’après Tillich, le saint comprend le profane. « Le profane, écrit Tillich, n’est ni irréligieux ni athée… mais il exprime sa religiosité latente dans des formes qui ne sont pas religieuses[29] ». La vérité de la fiction fait sens dans ce cadre sotériologique, voire eschatologique, dans l’articulation du visible et de l’invisible que présentent ces saints, qui justement ne sont pas « anonymes », que sont les personnages de roman.
Le roman, explique Blumenberg, est une auto-affirmation de l’homme qui permet donc de poser la question de l’homme et d’y répondre, en une conscience accrue, en tournant le dos radicalement à une approche ontologique, puisqu’il renonce à l’en-soi et à une conception de la vérité comme dévoilement pour s’en tenir à la mise en évidence de la contingence radicale et de ce qui en est le double corollaire, à savoir le rôle de la culture, entendue comme le seul moyen de survie puisqu’elle est le domaine dans lequel la vie humaine commence à se développer et l’histoire à se manifester, et l’exigence de consolation. Le saint se définit également par la façon dont il incarne le refus de toute ontologie. Contre l’affirmation de Georg Lukacs selon lequel le roman serait l’ « épopée du monde délaissé de dieu[30] », le roman ne peut pas être une sécularisation de l’épique après la dédivinisation du monde, au contraire c’est à la théologisation du monde que remonte sa contingence, la facticité de l’article indéfini, l’afflux des possibilia. Les mondes auxquels le sujet avec des dispositions esthétiques n’est jamais prêt à appartenir qu’à contrecœur, dans la finitude disponible d’un contexte, sont l’incarnation de la thématisation de la réalité par le roman et la composante de l’ironie qui lui est essentielle. Nous voyons bien des points communs entre le roman et la foi chrétienne : le refus du mythe, le refus du dieu des philosophes ou monde des idées, l’affirmation du caractère indépassable de l’incarnation, de la diversité des vies humaines, de la liberté, et cela jusqu’à la bâtardise. Mais le roman, par l’ironie qui le définit et par la contingence qui est son ressort, s’arrête où le sacré commence. Le roman serait, à l’intérieur de la civilisation chrétienne, ce qui refuse le sacrifice et essaye autre chose pour élever l’homme, et du coup on comprend comment le roman s’est universalisé pour entrer dans toutes les cultures et s’y adapter. Le roman est aussi universel que le catholicisme ; mais, si on peut imposer la religion par force, ce qui s’est passé, on ne peut pas imposer une écriture.
Pour conclure, je rappelle que je n’ai voulu parler ici que de ce que je comprends derrière le rejet des romans par les théologiens. Cette vision est elle-même critiquable : c’est une certaine théologie, qui dit qu’il y a de la lumière là même où les gens eux-mêmes n’en voient pas. Dire que « je » sais des héros quelque chose qu’ils ne savent pas eux-mêmes, cela revient à dire aussi que dieu est quelque chose comme un manipulateur qui ne s’occupe pas de l’adhésion des gens. Les héros de romans donc sont les miroirs d’une certaine théologie. Le héros de roman est-il un saint ? Sans doute, rapporté à la doctrine catholique la plus inclusiviste, à laquelle on peut justement reprocher son inclusivisme. Il n’y a pas de théologie du roman, il est irrécupérable. L’Église ne le jalouse que quand elle essaye d’épouser la société.
[1]
Martin Goodman, Rome et Jérusalem (Paris : Perrin, 2009) ; Léon Chestov, Athènes et Jérusalem, essai de philosophie religieuse (1938) (Paris : Aubier, 1993).
[2]
Michael Camille, Image on the Edge : The Margins of Medieval Art (Cambridge : Harvard University. Press, 1992) : « résister, ridiculiser, renverser et inventer était non seulement possible, il n’existait pas de limites ».
[3] Certains le font remonter au XIIe (notamment Gingras, Le Bâtard conquérant. Essor et expansion du genre romanesque au Moyen Âge.). Cette incertitude confirme un caractère indéfini.
[4]
Charles Taylor, Les Sources du moi. La formation de l’identité moderne (Paris : Le Seuil, 1998).
[5]
Burke, La recherche philosophique sur l’origine de nos idées sur le sublime et le Beau (1757) ; Longin, Du sublime (1e ou 3e siècle).
[6]
Voir dans le présent volume l’article de Dan Arbib.
[7]
Voir Hans Blumenberg, Préfiguration. Quand le mythe fait histoire (Paris : Seuil, 2016).
[8]
Théoriquement en tout cas, car Luther et Calvin comptent comme « autorités ».
[9]
Pas de vénération du livre, par exemple.
[10]
Oscar Wilde, De profundis, traduit de l’anglais par J. Gattégno (Paris : Gallimard, « Folio essais », 1992), p. 150.
[11]
Voir article de Bernard Sesboüé, dans La Vertu des païens, sous la dir. de Sylvie Taussig (CNRS Éditions, à paraître).
[12]
K. Rahner, ibid., p. 203. Fin du paragraphe : “Mais reste vrai néanmoins que […] n’est chrétien, dans la dimension de l’historicité réfléchie de cette autocommunication transcendantale de Dieu, que celui qui se déclare expressément en faveur de Jésus le Christ par la foi et le baptême. »
[13]
Voir Lettres latines, passim, éditions Sylvie Taussig (Turnhout : Brepols, 2004).
[14]
Hans Blumenberg, « Le Concept de réalité » (Paris : Seuil, 2012), p. 53.
[15]
Ibid. p. 57.
[16]
Oscar Wilde, op. cit.
[17]
Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance (Paris : Gallimard, Tel, 1985).
[18]
Sylvie Taussig, « Le roman après (et avant) Benjamin : Jacob contre l’ange ? » (http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=114
[19]
Division qui ne renvoie du reste peut-être à rien, si la vision théorique d’Aristote a eu aussi peu de rapport avec la réalité des pratiques que le veut Florence Dupont par rapport à la tragédie (voir Florence Dupont, Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Paris : Aubier, 2007). Il n’empêche que la continuité de la lecture d’Aristote fait effet.
[20]
H. Blumenberg, « Le Concept de réalité », op. cit., p. 48.
[21]
Alain Houziaux, « Hypothèses sur le Fils de l’Homme », Topique 4/2010 (n° 113), p. 101-121 URL : www.cairn.info/revue-topique-2010-4-page-101.htm
[22]
Voir mon article « Les Atrides dans les Confessions de Jean-Jacques Bouchard : présence du burlesque ? », Papers on French Seventeenth Century Literature (PFSCL), Vol. XXXVI, No. 70, 2009, p. 221-243.
[23]
Voir Jean-Robert Armogathe, L’Antéchrist à l’âge classique (Paris : Mille et une nuits, 2005).
[24]
Voir Blumenberg, La Légitimité des temps modernes
[25]
Jeffrey Andrew Barash, « Paul Ricoeur und die Frage nach der Wirklichkeit der historischen Vergangenheit », in Der lange Weg der lnterpretation Perspektiven auf Paul Riceurs hermeneutische Phänomenologie, éds. Dominic Harion et Peter Welsen (Regensburg : S. Roderer Verlag, 2015) ou « (…) le tournant heideggérien dans l’interprétation de l’histoire chez Paul Ricœur » (en ligne conférence https://www.youtube.com/watch?v=0WRUTY62WRA). gaga
[26]
Étienne de la Boétie, Le Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un. Voir son interprétation pour les réalités modernes, par un psychanalyste égyptien, Mustapha Safouan, Pourquoi le monde arabe n’est pas libre, politique de l’écriture et terrorisme religieux, traduit de l’anglais par Catherine et Alain Vanier (Paris : Denoël, 2008).
[27]
Sur l’épiphanie de dieu après la mort de dieu chez les romanciers contemporains, voir Richard Kearney, Dieu est mort, vive Dieu. Une nouvelle idée du sacré pour le IIIe millénaire : l’anathéisme (Paris : Nil Éditions, 2011), notamment chapitre 5. C’est cependant dans un sens non phénoménologique que j’avance l’idée de la sainteté dans la littérature spécifiquement romanesque, donc non pas au niveau de la chair, mais de la parole. Voir une première esquisse dans Sylvie Taussig « Le roman après (et avant) Benjamin : Jacob contre l’ange ? », Mag Philo http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=114.
[28]
Notamment dans les romans les plus modernes : un exemple entre mille, d’une toute récente lecture, Eileen Myles, Chelsea Girl (1994) ou bien, plus classiquement, la sainteté laïque de Rieux, dans la Peste, de Camus, explicitement critique de la sainteté religieuse. Alors que Guillaume Monod définit l’humilité comme sainteté laïque (Doctorat de philosophie, « Au fondement de la relation thérapeutique : l’humilité »), les personnages de roman sont essentiellement porteurs de cette humilité : leur non existence est leur condition fondamentale – et cela vaut même pour les héros les plus plein d’hubris.
[29]
Werner Schuessler, « Penser Dieu après Nietzsche à l’exemple de Karl Jaspers et Paul Tillich », Le Portique [En ligne], 8 | 2001, mis en ligne le 09 mars 2005, consulté le 24 mai 2016. URL : http://leportique.revues.org/203
[30]
Georg LUKÁCS, La Théorie du roman [1920], Paris, Gallimard, 1989.