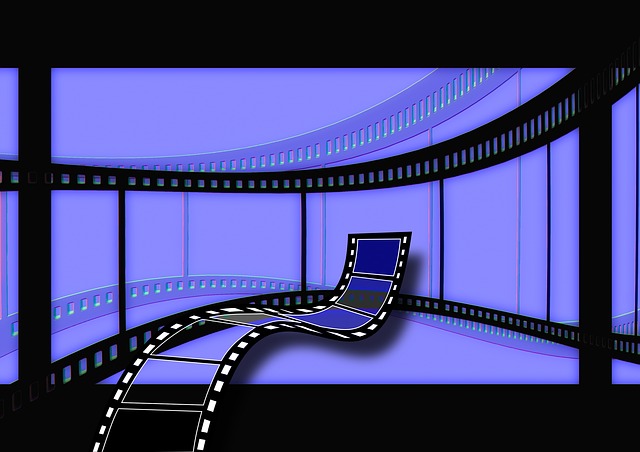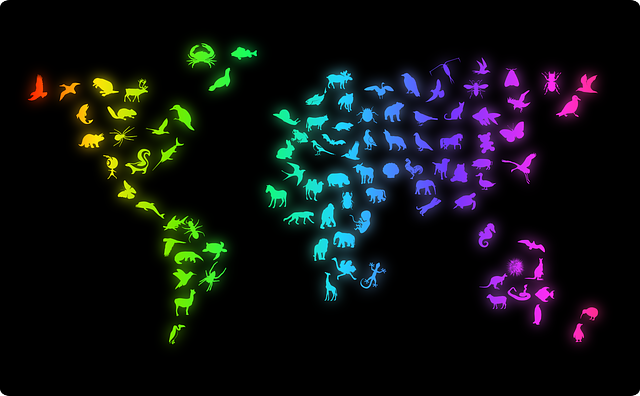« Le regard de la science ». Retour sur la métaphore du cinématographe dans le quatrième chapitre de L’Evolution créatrice (I)
Thomas Carrier-Lafleur, Universités de Laval et Paul-Valéry Montpellier III
Vous allez peut-être sourire de ma comparaison, mais quand je l’ai [l’= L’Évolution créatrice] eu fermé, il m’a laissé le même arrière-goût que j’avais éprouvé jadis en finissant Madame Bovary, l’écho, le prolongement d’une euphonie durable ; le bruissement d’un fleuve immense, sans remous, ni écumes, ni bancs de sable, mais qui continuait, en coulant à pleins bords, son cours tranquille et intarissable. Et puis cette justesse parfaite de vos images, qui n’accrochent jamais, ne font pas saillie à angles droits dans le discours comme des tableaux, mais invariablement clarifient la pensée et l’aident à s’épancher ! Ah ! oui, quel magicien vous êtes !
William James, Lettre à Henri Bergson (13 juin 1907)
Le présent article entend défendre l’hypothèse selon laquelle, pour bien comprendre les rapports entre la philosophie de Bergson et la science[1], il est nécessaire de penser à nouveaux frais la métaphore du cinématographe qui rythme et qui structure le quatrième et dernier chapitre de L’Évolution créatrice, « Le mécanisme cinématographique de la pensée et l’illusion mécanistique. Coup d’œil sur l’histoire des systèmes : le devenir réel et le faux évolutionnisme. »
L’utilisation de la métaphore cinématographique[2] permet à Bergson d’effectuer un geste de critique radical, qui enveloppe toute l’histoire de la philosophie, de Platon à Spencer, mais qui englobe également ces deux systèmes que sont la science antique et la science moderne, moments importants de sa critique. Après avoir résumé les positions de Bergson quant à la science, antique et moderne, et précisé l’importance de la métaphore cinématographique dans cette critique, nous tenterons, à partir des idées de Gilles Deleuze dans Cinéma 1 et Cinéma 2, de montrer qu’une autre conception philosophique de l’art cinématographique est possible, et en quoi ce changement de point de vue porte les fruits d’une nouvelle pensée de la science et du devenir qui, paradoxalement, n’en est pas pour autant moins bergsonienne.
Si selon Bergson le cinématographe est un paradigme pour la science et pour la philosophie, paradigme négatif en ce qu’il vient cristalliser toutes les insuffisances de l’entendement et du sens commun, il n’est pas impossible qu’une lecture moins dogmatique des capacités du médium induise des changements profonds à la « tendance cinématographique » de la perception et de l’intelligence. Pour le dire autrement, en tenant compte des évolutions esthétiques de l’art cinématographique, en particulier celles que ne pouvait prévoir Bergson ou que le philosophe n’a pas cru bon de relever, on en vient à faire le saut qui nous transporte du paradigme du cinématographe vers celui du cinéma, c’est-à-dire vers une pensée moderne des images en mouvement. Une nouvelle « méthode cinématographique » vient pour ainsi dire supplanter l’ancienne, et permet d’entrevoir dans son sillage de nouvelles possibilités pour la science et pour la philosophie. Le « regard de la science » dont parle Bergson dans le quatrième chapitre de L’Évolution créatrice ne serait donc pas celui d’un œil immobile dans son orbite, mais au contraire celui d’une caméra totale, libérée de ses attaches, décortiquant pour le spectateur tous les rapports de forces qui constituent le réel et le devenir. Au-delà des critiques et des recadrages que nous allons effectuer, le véritable fil rouge de notre réflexion sera ainsi de mettre l’accent sur la hardiesse méthodologique de Bergson, en montrant comment il a mis sur pied un système philosophique plurimodal au sein duquel métaphysique, science et esthétique sont indissociables.
Critique des sciences et architectonique de la pensée
Alors que la science antique découpe l’existence et ses phénomènes en instants privilégiés, à l’instar des Idées de Platon ou des formes d’Aristote, Bergson laisse entendre que la science moderne serait plutôt fondée sur une théorie des instants quelconques, c’est-à-dire où tous les moments dans la connaissance d’un objet se valent, grâce à une décomposition infinie du temps (Kepler et Galilée). À ce titre, le cinématographe, par sa décomposition du mouvement en photographies instantanées – vingt-quatre images par seconde selon le déroulement normal de la pellicule –, serait lui aussi un système qui reproduit le vivant à partir d’instants ou de moments quelconques. C’est ainsi que le mouvement cinématographié, étant caractérisé par l’équidistance de ses instants, et par là même de leur valeur quelconque, est analogue au nouveau regard de la science moderne et en représente ainsi une image adéquate.
Ce passage entre les deux genres d’instants n’est pas à prendre à la légère. Entre la pensée antique et la pensée moderne, il y a toute une révolution, qui se laisse appréhender non seulement par les deux conceptions opposées de la science, mais aussi par les changements généraux qui ont cours en esthétique. Par exemple la physique d’Aristote est en étroite symbiose avec tout l’art grec, et particulièrement avec la tragédie, puisque dans un cas comme dans l’autre le dénominateur commun de l’instauration, qu’elle soit scientifique ou esthétique, est la pose, la thèse (du grec thesis, position) : le moment privilégié. La tragédie grecque est inséparable de l’opposition entre deux extrêmes, deux poses exceptionnelles que rien ne rapproche mais qui pourtant ne peuvent être pensées séparément : c’est par exemple Antigone et l’incommunicabilité absolue entre loi humaine et loi divine, ou entre loi de la famille et loi de la cité, qui, malgré tout, ne peuvent qu’être pensées que l’une par rapport à l’autre. L’acmé est ce point de tensions entre les opposés qui ne pourra jamais être dépassé. Sans l’importance accordée à l’éloignement fondamental des thèses précises, mais contraires, il n’y aurait pas de tragédie grecque, au même titre que la physique antique est impossible sans la théorie des instants privilégiés qui la fonde. L’instant tragique, instant extrémal s’il en est, est une forme donnée comme transcendance, ce que lui reprochera beaucoup Bergson, pour qui il est impensable que les formes planent au-dessus de l’espace et du temps. Pour l’auteur de L’Évolution créatrice, il est en effet insensé de dire qu’un enfant devient un homme, car cela donnerait une transcendance inutile aux instants – « enfant » et « homme » – qui, plutôt que d’amener de la clarté, ne ferait qu’introduire un faux problème, un problème mal découpé. « La vérité est que, si le langage se moulait ici sur le réel, nous ne dirions pas “l’enfant devient homme”, mais “il y a devenir de l’enfant à l’homme[3]” », écrit avec force Bergson, dans une charge soutenue contre la philosophie d’un Zénon (défenseur exemplaire du faux devenir) en particulier et de la science antique en général.
En faisant le saut dans la logique de la science moderne, qui met l’accent sur une sorte d’immanence des instants, la durée devrait en principe être à nouveau en mesure de mordre sur les formes, et le devenir se défaire des habitudes nuisibles du langage. En adoptant le mouvement des instants quelconques, image la plus juste de ce qu’est le « devenir vrai », toute forme pourra occuper à la fois de l’espace et du temps. Contrairement à la philosophie et à la science antiques, la science moderne semble être capable de penser les formes sans les mettre dans l’éternel : il n’y a plus d’enfant et plus d’adulte, il n’y a que des devenirs, eux-mêmes composés par d’autres devenirs. Cette primauté nouvelle du quelconque sur le privilégié, du hasard sur la thèse, est à la base non plus du tragique théâtral, mais d’une esthétique en tout point différente qui commence à voir le jour : celle du roman moderne, de Cervantès à Proust[4]. C’est que rien n’est plus nuisible pour le roman que l’immobilité et l’atemporalité des formes. Le roman moderne ne cherche pas à reproduire une histoire par une série de poses ou d’instants, mais, tout au contraire, s’intéresse à ce qui se passe entre chacune de ces poses, chacun de ces instants. Contrairement à la tragédie, le roman, genre longtemps considéré comme « mineur » pour cette raison précise, met l’accent sur la quotidienneté des actions et sur la relative banalité de ses actants. Fils de la science moderne, le roman est un dispositif beaucoup plus réceptif par rapport au devenir : ses actions, ses formes et ses personnages ne sont pas atemporels, mais évoluent dans un espace-temps actuel et en mouvement (le fameux « chronotope » bakhtinien). De plus, le roman est le genre inclusif par excellence : il peut traduire tous les discours, reproduire toutes les formes d’écriture, se plier à toutes les contraintes, rendre possible toutes les expériences. On peut mettre de la philosophie comme de la poésie dans un roman, sans pour autant que le genre en soit altéré. Cette dimension polyphonique, indépendamment de l’histoire racontée, est porteuse d’une singulière philosophie. En effet, dans le roman, il n’y a pas un temps, mais des temps, puisque est octroyée à chaque acteur la possibilité de faire son temps. Le roman est la rencontre des différents temps produits par ses acteurs. De là naît son mouvement, qui n’a à peu près rien à voir avec celui de la tragédie grecque, tout comme la science moderne n’est pas pour Bergson la répétition naïve ou légèrement améliorée de la science antique, mais en propose plutôt une restructuration des plus radicales.
Ces brèves explorations du côté de l’esthétique nous indiquent une des qualités de la pensée bergsonienne de la science, point nodal du quatrième chapitre de L’Évolution créatrice : il s’agit d’une pensée architectonique et plurimodale, ce qu’indique par ailleurs le constant recours à la métaphore du cinématographe, dispositif par excellence de l’instant quelconque. À la lettre, le cinématographe opère mécaniquement, spontanément, ce que le roman moderne ne peut que suggérer métaphoriquement, ce pour quoi il est en droit l’image médiatrice représentant les avancées de la science moderne par rapport à la science antique. Dans cette critique générale des systèmes qu’est le quatrième chapitre de L’Évolution créatrice, philosophie, science et esthétique sont toujours pensées ensemble, sans pour autant que l’une ou l’autre ne soit condamnée à n’être que la pâle copie de sa voisine. Plus encore, cette compénétration des disciplines et des modes de pensée va de pair chez Bergson avec un souci très aigu de ne pas perdre de vue l’immédiateté de l’expérience, qui doit être entendue comme l’exacte opposée du sens commun. Il n’y a rien d’immédiat dans le sens commun, puisque les idées y ont déjà été reçues et que, en un éclair, les clichés viennent penser à notre place. La difficulté qui se pose à la lecture du chapitre sur « le mécanisme cinématographique de la pensée et l’illusion mécanistique » est donc de ne jamais perdre de vue la série qui va de la métaphysique à l’expérience immédiate, en passant par la science et par l’art. C’est la dimension pratique de la critique bergsonienne des systèmes que de nous permettre d’entrevoir de nouvelles « méthodes pour exister[5]. » La critique des systèmes, et par là même la critique de la science, est alors une occasion pour fabriquer de la pensée.
Or, après avoir commenté les deux systèmes scientifiques, Bergson renverse aussitôt la différence en apparence incommensurable entre les méthodes antiques et modernes de la science – instants privilégiés vs instants quelconques –, en montrant au contraire que finalement il ne s’agit que d’une différence de degré, et non pas de nature. Que l’on érige la connaissance d’un phénomène sur un moment quelconque ou sur un moment privilégié de son changement, cela revient au même, puisque dans les deux cas le temps sera traité comme une variable indépendante. Cette critique, Bergson la cristallise à nouveau à l’aide de la métaphore du cinématographe qui, de page en page dans ce chapitre, gagne en profondeur de réflexion. La tare méthodologique de la science antique et de la science moderne c’est qu’il s’agit du « même mécanisme cinématographique dans les deux cas, mais il atteint, dans le second, une précision qu’il ne peut avoir dans le premier[6]. » D’une part comme de l’autre, le mouvement universel fuit, et il ne reste que des mouvements, voire des moments de mouvements, peu importe qu’ils soient ou non quelconques. Si le temps comme flux créateur, et non plus comme variable indépendante, échappait à la science antique, Bergson tente de nous faire admettre qu’il échappe tout autant à la science moderne[7], alors qu’elle paraissait pourtant s’être engagée dans la bonne voie. Précisons les critiques que Bergson fait au dispositif cinématographique, car, dans la logique du quatrième chapitre de L’Évolution créatrice, leur apogée coïncide précisément avec l’ouverture de la grande critique des systèmes philosophique et scientifique, faisant ainsi du cinématographe l’exemple par excellence des erreurs de méthode et de perception.
Le sommet de la critique bergsonienne du cinématographe tient en quatre pages (EC, p. 304-307) très serrées qui sont rapidement devenues célèbres, non seulement grâce à la propre renommée du philosophe, mais aussi parce qu’elles viennent synthétiser de façon à la fois claire et imagée le discours social qui s’était formé en France et en Europe depuis 1895, date de la première projection publique d’une « vue animée » des frères Lumière, inventeurs du dispositif[8]. Dans ces pages, Bergson propose à son lecteur une sorte de fiction philosophique ayant pour sujet le cinématographe, afin de faire le point sur les deux sortes de devenirs (d’une manière un peu trop draconienne, mais qui souligne l’essentiel, on pourrait dire : d’une part, le devenir vrai de sa propre philosophie et, d’autre part, le faux devenir de toutes les autres). Par là même, le lecteur assiste à une condamnation en règle de l’art cinématographique des images en mouvement, au nom d’un inébranlable principe ontologique. Le narrateur bergsonien[9] propose à son lecteur d’imaginer la reproduction d’une scène animée sur un écran, « le défilé d’un régiment par exemple[10]. » Pour ce faire, il relève d’emblée deux manières. La première, évidemment impossible, consiste en ceci : « Ce serait de découper des figures articulées représentant les soldats, d’imprimer à chacune d’elles le mouvement de la marche, mouvement variable d’individu à individu quoique commun à l’espèce humaine, et de projeter le tout sur l’écran. Il faudrait dépenser à ce petit jeu une somme de travail formidable, et l’on n’obtiendrait d’ailleurs qu’un assez médiocre résultat : comment reproduire la souplesse et la variété de la vie ?[11] » Au-delà de l’invraisemblance de la solution proposée, on remarque un glissement de la question : de la « scène animée », on passe à « la souplesse et la variété de la vie ». La question est en effet de premier ordre, car elle touche aussi à l’« objet de la science » : c’est par notre compréhension de cette souplesse et de cette variété de la vie que nous pourrons « accroître notre influence sur les choses[12]. » Comme nous l’avions souligné plus haut, Bergson est sans doute l’un des penseurs qui fonctionnent le moins par clichés. Sa philosophie peut être comprise comme une incessante lutte contre les clichés, ce que nous montre déjà ce court passage de la fiction philosophique du cinématographe : Bergson ne croit pas au cliché « soldat ». Dans son défilé, chaque soldat doit avoir son mouvement à lui, même s’il n’est qu’un soldat parmi tant d’autres. Il doit y avoir autant de mouvements de soldats qu’il y a d’individualités. Bergson dira néanmoins que cette « première manière » de représentation est impossible. Elle n’est qu’une fiction. D’où l’autre façon de faire : « Maintenant, il y a une seconde manière de procéder, beaucoup plus aisée en même temps que plus efficace. C’est de prendre sur le régiment qui passe une série d’instantanés, et de projeter ces instantanés sur l’écran, de manière qu’ils se remplacent très vite les uns les autres. Ainsi fait le cinématographe[13]. » De la succession des immobilités rendue possible par le défilement monotone de la pellicule cinématographique dans le magasin du projecteur sera restituée une sorte de mouvement universel. Mais le philosophe ne saurait se laisser berner par un tel mécanisme, dont il remarque aussitôt la facticité et qu’il ravale au rang d’illusion :
Le procédé a donc consisté, en somme, à extraire de tous les mouvements propres à toutes les figures un mouvement impersonnel, abstrait et simple, le mouvement en général pour ainsi dire, à le mettre dans l’appareil, et à reconstituer l’individualité de chaque mouvement particulier par la composition de ce mouvement anonyme avec les attitudes personnelles. Tel est l’artifice du cinématographe. Et tel est aussi celui de notre connaissance. Au lieu de nous attacher au devenir intérieur des choses, nous nous plaçons en dehors d’elles pour recomposer leur devenir artificiellement. Nous prenons des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe, et, comme elles sont caractéristiques de cette réalité, il nous suffit de les enfiler le long d’un devenir abstrait, uniforme, invisible, situé au fond de l’appareil de la connaissance, pour imiter ce qu’il y a de caractéristique dans ce devenir lui-même. Perception, intelligence, langue procèdent en général ainsi. Qu’il s’agisse de penser le devenir, ou de l’exprimer, ou même de le percevoir, nous ne faisons guère autre chose qu’actionner une espèce de cinématographe intérieur. On résumerait donc tout ce qui précède en disant que le mécanisme de notre connaissance usuelle est de nature cinématographique[14].
Sans pour autant entrer dans les détails, et encore moins dans les raisons, de cette démonstration philosophique, beaucoup d’auteurs de l’époque ont été impressionnés par les images utilisées par Bergson dans ce passage. Alors même que le cinématographe était en train de s’institutionnaliser comme un art à part entière, l’élite intellectuelle tend à n’en conserver que la doxa mécanique et antilittéraire : est cinématographique ce qui n’a pas de prise sur la réelle complexité de la vie. Par exemple, dans L’Écho de Paris du lundi 21 novembre 1910, Paul Bourget rédige un article ayant pour titre « Tolstoï », où est discuté le style de l’écrivain russe : « Rappelez-vous […] Guerre et Paix et Anna Karénine, ces récits qui pourraient continuer indéfiniment, où les incidents se succèdent comme les images dans un cinématographe, sans progression, sans perspective, sans plan général, ces tableaux déroulés sous une même lumière qui en détache le moindre relief, et tous égaux en importance. » Un autre exemple, et pas le moindre, de la postérité de la critique cinématographique de Bergson se trouve dans Le temps retrouvé de Marcel Proust, publié de façon posthume en 1927, mais rédigé aux alentours de 1913, soit à peine quelques années après le choc de L’Évolution créatrice. On y lit en effet ceci : « Si la réalité était cette espèce de déchet de l’expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons : un mauvais temps, une guerre, une station de voitures, un restaurent éclairé, un jardin en fleurs, tout le monde sait ce que nous voulons dire ; si la réalité était cela, sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait et le “style”, la “littérature” qui s’écarteraient de leurs simples données seraient un hors-d’œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela, la réalité[15] ? » D’une certaine manière, il s’agit bien d’un reproche bergsonien, en cela que le romancier critique le manque de souplesse de l’appareil cinématographique : la décomposition du mouvement en instants quelconques ne change rien à l’affaire, le cinématographe n’a d’autre choix que de donner à voir des clichés, sans réalité et sans profondeur, des poses dans ce qu’elles ont de plus artificiel. La réalité existe pourtant bel et bien, mais elle se cache dans l’intervalle.
Un appareil qui décompose le mouvement à partir d’instants aléatoires – un cliché à chaque vingt-quatrième de seconde – ne fait que secrètement ou inconsciemment répéter la logique des poses et des instants privilégiés. La différence n’en est une que de surface, comme celle que Bergson remarque entre la science antique et la science moderne. L’homme est ainsi le pire ennemi de l’homme, et Bergson utilise coup sur coup deux métaphores d’ordre technique pour en rendre compte :
Notre activité va d’un arrangement à un réarrangement, imprimant chaque fois au kaléidoscope, sans doute, une nouvelle secousse, mais ne s’intéressant pas à la secousse et ne voyant que la nouvelle figure. La connaissance qu’elle se donne de l’opération de la nature doit donc être exactement symétrique de l’intérêt qu’elle prend à sa propre opération. En ce sens on pourrait dire, si ce n’était abuser d’un certain genre de comparaison, que le caractère cinématographique de notre connaissance des choses tient au caractère kaléidoscopique de notre adaptation à elles[16]. »
C’est parce qu’il est pris dans une logique de l’action que l’homme ne peut se défaire de ses habitudes « cinématographiques » : il procède par bonds, comme une vache va de touffe d’herbe en touffe d’herbe, éliminant de son champ de vision toute autre information, car elle ne lui serait en rien nécessaire. Un point est en effet central dans la philosophie bergsonienne : c’est le terrible anathème de l’action que de toujours devoir être nécessaire. Un mouvement n’est pas un devenir, mais une simple translation d’un point vers un autre. Alors qu’il aurait pu incarner un appareil scientifique et cognitif riche des plus belles promesses, le cinéma est aussitôt assimilé par le philosophe aux pires manies de l’intelligence humaine. La philosophie de la durée créatrice proposera de remonter la pente de ces mauvaises habitudes, afin de retrouver la candeur mais aussi la vérité d’une vision originelle du monde, débarrassée de l’opinion. Toute la critique bergsonienne de la méthode cinématographique, cette dernière parasitant tout aussi bien la connaissance que la science, repose à l’évidence sur l’existence d’une autre forme de durée, celle qui nous donne accès, à l’« autre moitié du réel[17]. » Cette durée est irréductible à toute décomposition mécanique, à toute analyse scientifique. Ce point est un des plus ambigus de toute la philosophie de Bergson, et il engage un enjeu que nous ne pourrons développer ici que sommairement, celui de sa critique de la relativité.
« Critique » est sans doute un terme un peu fort. On lui préférera celui de dialogue, même si une bonne partie constitue en fait un dialogue de sourds. Mieux, ce que Bergson souhaite, non plus dans L’Évolution créatrice mais dans Durée et simultanéité, c’est un recadrage de la physique einsteinienne, c’est-à-dire une mise en œuvre d’une interprétation philosophique de la théorie de la relativité qui soit en accord avec l’expérience immédiate, point focal de toute l’entreprise bergsonienne, là où se trouve le vrai devenir, tellement vrai qu’il est pour ainsi dire imperceptible. La science d’Einstein, radicalisant ainsi toute l’entreprise de la science moderne, ne représente pas pour Bergson une philosophie adéquate, à l’exception d’une idée qui, elle, est éminemment philosophique et l’intéresse au plus haut point, l’ayant déjà rencontrée par d’autres moyens : il existe une multiplicité irréductible de temps et de devenirs. Cette multiplicité est ce que Bergson tente à juste titre de définir comme l’immédiateté de l’expérience. C’est également en son nom, et grâce à la « méthode cinématographique », son plus parfait contraire, qu’il effectue sa critique des systèmes au quatrième chapitre de L’Évolution créatrice. Le défi de Bergson dans sa relecture de la théorie de la relativité est analogue à ce qu’il s’efforce de démontrer avec ce que nous avons nommé la fiction du « défilé du régiment » : l’infinité des blocs d’espace-temps singuliers n’est pas en contradiction avec l’unicité d’un temps réel, même que l’une et l’autre doivent coexister. Chaque soldat du régiment doit conserver son propre mouvement de soldat, alors même qu’ils sont tous pris dans le mouvement général, celui du défilé. Ce thème est d’ailleurs celui de tout l’ouvrage : chaque vivant possède un devenir qui lui est propre, tout en étant un élément de l’universel devenir de l’évolution. Tel est le défi lancé à la science moderne : se rapprocher de l’expérience immédiate, ne pas faire du temps une variable indépendante, en un mot, arrêter de cinématographier la durée.
Le rapport entre Bergson et Einstein permet de nuancer un peu les critiques du philosophe, et ainsi de suggérer que le procès de la science moderne n’est pas que négatif. Cette dernière, qui a su faire un pas dans la bonne direction en délaissant la primauté des instants privilégiés au profit de la multitude des instants quelconques, est presque à l’image de ce que doit être une philosophie du devenir vrai. Entre l’une et l’autre, ce n’est donc pas l’histoire d’une lutte ou d’une incompréhension, mais, plus simplement, d’une rencontre manquée. La science moderne, et la physique d’Einstein en premier lieu, par certains de ses principes, serait donc porteuse d’une nouvelle philosophie, celle que Bergson essaie d’instaurer dans L’Évolution créatrice, à la nuance près que l’on se défasse de la méthode cinématographique qui choisit le « temps-longueur » au détriment du « temps-durée ». Il nous reste maintenant à savoir si, par un changement au sein du paradigme cinématographique, il est possible d’imaginer de façon bergsonienne ce que serait la version positive de la science moderne. Et nous croyons que cette entreprise a tout d’un geste bergsonien, en ce qu’il s’agit de replacer le cinématographe dans le devenir qui lui est propre, ce qui, du même coup, nous offre un autre point de vue sur les potentialités philosophiques du médium.
[1] Nous proférons d’entrée de jeu notre dette envers les ouvrages suivants qui, de bien des manières, ont été une source d’inspiration constante lors de la rédaction de cet article : Arnaud François (dir.), L’Évolution créatrice de Bergson, Paris, Vrin, coll. « Études et Commentaires », 2010 ; Frédéric Worms et Jean-Jacques Wunenburger (éds.), Bachelard et Bergson. Continuité et discontinuité, Paris, Puf, 2008 ; Frédéric Worms (éd.), Annales bergsoniennes III. Bergson et la science, Paris, Puf, coll. « Épiméthée », 2007 ; Clélia Zernik, L’œil et l’objectif. La psychologie de la perception à l’épreuve du style cinématographique, Paris, Vrin, coll. « Essais d’art et de philosophie », 2012.
[2] Les vingt-huit occurrences du mot « cinématographique » ou de ses dérivés au cours du quatrième chapitre de L’Évolution créatrice sont utilisées par Bergson entre autres dans les expressions « nature », « habitudes », « imitation », « tendance » et, surtout, « mécanisme » et « méthode » cinématographiques.
[3] Henri Bergson, L’Évolution créatrice (1907), Arnaud François (éd.), Paris, Puf, coll. « Quadrige : Grands Textes », 2009, p. 312. Les prochains renvois à ce texte se feront à même le corps du texte, entre parenthèses, à l’aide du sigle « EC » suivi du numéro de la page citée. Par ailleurs, la suite du passage ne manque pas de critiquer à nouveau la méthode cinématographique, mauvaise image du devenir, mais image fidèle des mauvaises habitudes du langage desquelles la science et la philosophie doivent coûte que coûte se défaire : « Dans la première proposition, “devient” est un verbe à sens indéterminé, destiné à masquer l’absurdité où l’on tombe en attribuant l’état “homme” au sujet “enfant”. Il se comporte à peu près comme le mouvement, toujours le même, de la bande cinématographique, mouvement caché dans l’appareil et dont le rôle est de superposer l’une à l’autre les images successives pour imiter le mouvement de l’objet réel. Dans la seconde, “devenir” est un sujet. Il passe au premier plan. Il est la réalité même : enfance et âge d’homme ne sont plus alors que des arrêts virtuels, simples vues de l’esprit ; nous avons affaire, cette fois, au mouvement objectif lui-même, et non plus à son imitation cinématographique. Mais la première manière de s’exprimer est seule conforme à nos habitudes de langage » (id.).
[4] Sur ces questions, nous renvoyons à l’ouvrage classique du théoricien postformaliste russe Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, trad. Daria Olivier, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1978.
[5] Voir le passionnant ouvrage de Maxime Rovere, Spinoza. Méthodes pour exister, Paris, CNRS, coll. « Biblis », 2013.
[6] EC, p. 331.
[7] Bergson utilise une image des plus surprenantes : la science moderne « ne s’applique pas plus au devenir, dans ce qu’il a de mouvant, que les ponts jetés de loin en loin sur le fleuve ne suivent l’eau qui coule sous leurs arches » (p. 338).
[8] Sur ce point, on renverra le lecteur à l’impressionnant travail d’archives de Daniel Banda et José Moure, avec Le cinéma : naissance d’un art. 1895-1920, Paris, Flammarion, coll. « Champs : Arts », 2008.
[9] Nous nous autorisons à utiliser le terme littéraire de « narrateur » non pas pour désigner tous les « je » présents dans l’écriture de Bergson, ceux-ci renvoyant assez exclusivement au philosophe lui-même, mais à cette instance qui met en scène tous les moments les plus narratifs des ouvrages de Bergson, où le « je » acquiert une sorte de valeur allégorique, où encore lorsque sont imaginés des personnages. Sans sortir du quatrième chapitre de L’Évolution créatrice, on peut penser, pour donner un autre exemple, à ce passage où le « je » a une réelle valeur narrative et par le fait même fictionnelle : « Je vais fermer les yeux, boucher mes oreilles, éteindre une à une les sensations qui m’arrivent du monde extérieur : voilà qui est fait, toutes mes perceptions s’évanouissent, l’univers matériel s’abîme pour moi dans le silence et dans la nuit. Je subsiste cependant, et ne puis m’empêcher de subsister. Je suis encore là, avec les sensations organiques qui m’arrivent de la périphérie et de l’intérieur de mon corps, avec les souvenirs que me laissent mes perceptions passées, avec l’impression même, bien positive et bien pleine, du vide que je viens de faire autour de moi. Comment supprimer tout cela ? comment s’éliminer soi-même ? » (EC, p. 278). C’est selon nous un littéraire, Luc Fraisse, spécialiste de l’œuvre de Marcel Proust, qui a le mieux su rendre cette dimension particulière de l’écriture de Bergson, en désignant sa philosophie comme une esquisse de roman de formation (cf. « Bergson, la confrontation suprême », le dix-huitième et avant-dernier chapitre du monumental ouvrage L’éclectisme philosophique de Marcel Proust, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Lettres françaises », 2013, p. 1039-1209).
[10] EC, p. 304.
[11] Id.
[12] EC, p. 329.
[13] EC, p. 304.
[14] EC, p. 305 ; l’auteur souligne.
[15] Marcel Proust, Le temps retrouvé (1927), À la recherche du temps perdu (1913-1927), t. iv, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1989, p. 468.
[16] EC, p. 306 ; l’auteur souligne.
[17] EC, p. 342.