Le Paradoxe de l’Ancestralité : temps du sujet ou temps du monde ?
Yves Wadier, ancien Ingénieur Chercheur à EDF R&D et Chercheur Invité au LaMSID.
 L’hypothèse d’un « temps du sujet » conduit-elle à un paradoxe ? Si le temps est issu de la conscience, comment le temps a-t-il pu s’écouler avant l’apparition de l’homme sur la planète terre ? Pour élucider ce paradoxe proposé par Étienne Klein, il nous faut tout d’abord préciser les rapports entre sujet, temps et monde. Pour cela, nous partons de la célèbre formule d’Aristote : « le temps, c’est le nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur » et nous nous appuyons sur les analyses de quelques philosophes modernes. Nous concluons qu’il n’y a, en fait, aucune contradiction entre le « temps du sujet » et le déploiement de l’univers avant l’apparition de l’homme. La question du temps reste cependant posée, avec toujours la même énigme : à quoi correspond le temps du sujet dans le monde réel ?
L’hypothèse d’un « temps du sujet » conduit-elle à un paradoxe ? Si le temps est issu de la conscience, comment le temps a-t-il pu s’écouler avant l’apparition de l’homme sur la planète terre ? Pour élucider ce paradoxe proposé par Étienne Klein, il nous faut tout d’abord préciser les rapports entre sujet, temps et monde. Pour cela, nous partons de la célèbre formule d’Aristote : « le temps, c’est le nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur » et nous nous appuyons sur les analyses de quelques philosophes modernes. Nous concluons qu’il n’y a, en fait, aucune contradiction entre le « temps du sujet » et le déploiement de l’univers avant l’apparition de l’homme. La question du temps reste cependant posée, avec toujours la même énigme : à quoi correspond le temps du sujet dans le monde réel ?
1. Le temps du sujet mène-t-il à un paradoxe ?
Le « Paradoxe de l’Ancestralité » a été présenté par Étienne Klein dans son livre paru en 2007, intitulé « le facteur temps ne sonne jamais deux fois[1] », puis dans le cadre de différentes conférences[2], et tout récemment, fin 2016, dans un numéro spécial du magazine « La Recherche » consacré au thème « Le Temps[3] ». L’énoncé de ce paradoxe est le suivant :
L’humanité, espèce toute récente, n’a pas été contemporaine de tout ce que l’Univers a connu ou traversé, et il s’en faut de beaucoup : 2 millions d’années contre 13,7 milliards, cela fait un rapport de 1 à 6850 . . . L’Univers a donc passé le plus clair de son temps à se passer de nous. Dès lors, si l’on défend l’idée que le temps serait subordonné au sujet et ne pourrait exister sans lui, on voit surgir le problème : comment le temps a-t-il bien pu s’écouler avant notre apparition[4] ?
C’est donc le « temps du sujet[5] » qui est mis en question dans ce paradoxe, quand on le met en regard d’un monde sans sujet. S’agit-il d’un réel paradoxe ou, plus simplement, d’une formulation mal posée sur le plan philosophique ? Quelle que soit la réponse, il est important de tirer les choses au clair. En effet, tout l’intérêt de ce paradoxe – qu’Étienne Klein a raison de formuler – est de reposer, une fois de plus, la question du temps sous un aspect particulier. Cette question peut tout d’abord être posée de façon classique, comme le fait Thibaut Damour :
Le temps est-il quelque chose de réel qui s’écoule indépendamment des sujets humains qui le perçoivent, ou est-il quelque chose d’idéal qui, comme le professait Kant, n’est rien en lui même en dehors du sujet[6] ?
C’est à dire : quel est le lien entre le sujet et le temps « en général » ? Ce lien se limite-t-il à la pure subjectivité comme le propose Augustin qui définit le temps comme une simple « distension de l’âme[7] », ou s’ouvre-t-il sur la réalité du monde ? Le temps du monde (temps en physique), a-t-il quelque chose à voir avec le temps du sujet ?
Pour avancer sur toutes ces questions et pouvoir prendre position sur ce paradoxe, nous allons partir de la célèbre définition du temps proposée par Aristote dans sa Physique, Livre IV[8], en nous appuyant sur les analyses de quelques philosophes modernes (Martin Heidegger, Claude Romano, et André Comte-Sponville).
Mais pourquoi Aristote ? Pourquoi pas un autre philosophe ? Parce que d’une part, la définition d’Aristote est en connexion, comme nous le verrons plus loin, avec ce que l’on peut appeler le « temps en physique », défini par Albert Einstein en prélude à sa théorie de la relativité. Et d’autre part, elle est également en connexion avec les définitions d’autres philosophes (d’Augustin à Heidegger) et permet donc d’éclairer le sens du « temps du sujet ».
Donc, l’intérêt de cette définition, par rapport à notre problématique, est qu’elle fournit un lien entre « l’âme » et le « monde » au sens de « quelque chose d’extérieur à l’âme » (qui est « le mouvement »). Elle permet alors d’y voir plus clair sur ce paradoxe, c’est-à-dire sur le rapport entre le monde et son évolution, avant l’apparition de l’homme, et ce que l’on appelle le « temps du sujet » ou « temps de la conscience ». Notons qu’Aristote ne parle jamais de « sujet » mais « d’âme », si bien que nous emploierons le terme « d’âme » au sens de « sujet ».
2. Le lien entre « âme » et « temps » selon Aristote
La définition du temps proposée par Aristote a suscité maints commentaires et parfois certaines incompréhensions. Elle semble simple et évidente, mais cette simplicité et cette évidence ne sont qu’apparentes. Cette définition est la suivante :
Car c’est cela le temps, le nombre (nombré) d’un mouvement selon l’antérieur et le postérieur[9].
 On peut s’interroger sur son aspect « circulaire », puisqu’elle semble définir le temps à partir du temps, et c’est d’ailleurs pourquoi certains auteurs préfèrent la formulation « selon l’avant et l’après » qui met davantage en jeu la relation d’ordre sur les positions du mobile dans le mouvement. Selon Heidegger, cette dernière formulation garde une certaine légitimité, tout en ayant l’avantage d’éviter l’objection de la tautologie. Par ailleurs, toujours selon Heidegger, la définition proposée n’est pas une définition au sens « scolaire », mais : « Elle caractérise le temps dans la mesure où elle délimite la manière dont nous devient accessible ce que nous appelons temps. C’est une définition d’accès, une caractérisation de l’accès[10] ».
On peut s’interroger sur son aspect « circulaire », puisqu’elle semble définir le temps à partir du temps, et c’est d’ailleurs pourquoi certains auteurs préfèrent la formulation « selon l’avant et l’après » qui met davantage en jeu la relation d’ordre sur les positions du mobile dans le mouvement. Selon Heidegger, cette dernière formulation garde une certaine légitimité, tout en ayant l’avantage d’éviter l’objection de la tautologie. Par ailleurs, toujours selon Heidegger, la définition proposée n’est pas une définition au sens « scolaire », mais : « Elle caractérise le temps dans la mesure où elle délimite la manière dont nous devient accessible ce que nous appelons temps. C’est une définition d’accès, une caractérisation de l’accès[10] ».
C’est le « maintenant », avec son double aspect « dans un sens toujours le même, et dans un sens toujours différent[11] » qui est, implicitement, au centre de cette définition : « ce qui est compté, de manière explicite ou non, [ . . . ] ce sont les maintenant[12] ». Le maintenant, en quelque sorte, accompagne le mobile. Le maintenant d’avant, c’est l’antérieur, le maintenant d’après, c’est le postérieur. On peut aussi s’interroger sur le lien entre « temps » et « espace », et il y aurait bien d’autres remarques à faire pour mettre en évidence la subtilité et la difficulté de la pensée d’Aristote, mais laissons là ces remarques et revenons à notre point essentiel qui est « le lien âme / mouvement », et au final, celui entre « âme » et « temps ».
Nous avons donc en scène deux acteurs : d’une part « l’âme » qui nombre, et d’autre part « quelque chose d’extérieur » (le mouvement). Que se passe-t-il donc entre ces deux acteurs ? Sur ce point, Martin Heidegger considère, pour représenter le « quelque chose d’extérieur » lié au mouvement, cet objet usuel que tout un chacun utilise pour connaître l’heure, à savoir : « la montre ». Pour Heidegger le lien « âme / montre » est d’abord orienté de l’âme vers la montre, même si en retour, la montre nous donne la mesure du temps.
Nous disons tout naturellement et spontanément « maintenant » en regardant notre montre. Dire « maintenant » ne va pas de soi, mais en le disant, nous avons déjà prédonné le temps à la montre. L’heure n’est pas dans la montre elle même, mais, en disant « maintenant », nous avons par avance donné le temps à la montre qui nous donne alors la mesure (le « combien ») du maintenant[13].
Cette mesure du temps, cependant, nécessite l’adoption d’une unité de mesure qui ne se trouve pas dans l’âme mais dans la chose elle même (le mouvement des sphères célestes, l’ombre sur le cadran solaire, la chute du sable dans le sablier, le mouvement des aiguilles de l’horloge ou de la montre, . . . ). C’est pourquoi Claude Romano n’oriente pas le lien « âme / montre » de la même façon que Heidegger, mais plutôt dans le sens inverse, de la montre vers l’âme :
L’unité de mesure, par conséquent, n’est pas dans l’âme, même si la mesure (donc aussi le nombre nombré, le temps lui même) n’est pas sans l’âme : l’âme est la condition nécessaire, mais non pas suffisante, de la mesure du temps. Il n’est donc pas conforme à la pensée aristotélicienne d’affirmer que l’âme donne le temps à la montre ; elle reçoit, bien plutôt, du mouvement uniforme des aiguilles de la montre – ou du mouvement de l’ombre sur le cadran solaire – l’unité de mesure qui lui permet de décompter le temps, puisque cette unité de mesure réside dans le mouvement et lui seul. On pourrait affirmer, à la rigueur, que c’est la montre qui donne à l’âme le temps[14].
Il ne nous appartient pas de trancher sur cette question et dire qui a raison. Mais on peut faire remarquer que ce que l’âme reçoit, ce n’est pas tant l’unité de mesure « telle quelle », que les « ingrédients » qui la constituent (mouvement des sphères célestes[15], etc.), et qui permettent alors à l’âme de définir, précisément, cette unité. Car ce n’est pas la terre qui décide que sa révolution autour du soleil correspondra à une année, ce n’est pas l’ombre sur le cadran qui définit la distance correspondant à une journée, ni le sablier qui précise la quantité de sable écoulée pour permettre la « cuisson d’un œuf », etc. C’est bien « l’âme » qui fait ce choix.
Mais peu importe ! L’essentiel est que la définition d’Aristote met en jeu deux acteurs dont le dialogue aboutit à une définition du temps. L’âme est une condition nécessaire à l’existence de ce temps, mais non suffisante, alors que le mouvement, qui n’est pas dans l’âme, mais bien à l’extérieur, dans le monde, ne suffit certes pas pour définir le temps (qui est seulement « quelque chose » du mouvement) mais en constitue, en quelque sorte, le « substrat ». Ainsi nous avons progressé sur une interprétation du temps compris comme « temps du sujet » (ou de l’âme) mis en relation avec le monde extérieur au sujet. Il s’agit bien d’une interprétation, fondée sur la pensée d’Aristote, qui devrait nous aider à prendre position sur notre fameux paradoxe. Cependant, pour mieux conforter ce résultat, il ne serait pas inutile de le confronter avec un point de vue quelque peu contradictoire, s’il en est ? Justement il en est un, fourni par André Comte-Sponville qui ne partage pas le point de vue d’Aristote selon lequel : sans âme, pas de temps. Voici ce qu’il nous dit :
Que le temps ait besoin de l’âme pour être compté ou mesuré, soit ; mais pour être comptable ou mesurable ? Et donc : pour être ? Dans la mesure ou « nombre s’entend de deux façons » (comme ce qui est compté et ce qui sert à compter), et puisque « le temps, c’est le nombré » et que « le moyen de nombrer et la chose nombrée sont distincts », on ne voit guère où est le problème, ni ce qui pourrait embarrasser un esprit comme celui d’Aristote[16].
Aristote dit ceci : « le temps est nombre nombré. Sans âme, il n’y aurait pas de nombrer, pas de nombrant ; sans nombrant il n’y aurait pas de nombrable ni de nombré. Sans âme, il n’y aurait pas de temps[17] ». Cela semble clair. Mais on a l’impression qu’André Comte-Sponville, ayant une conception bien à lui du temps (sans doute un temps réel et sans sujet ?) ne s’en tient pas stricto sensu à la définition d’Aristote. Sa démonstration n’est pas très claire, et donc, on peut s’interroger : comment un temps sans âme, ni compté ni mesuré, pourrait-il être comptable ou mesurable ? N’est-ce pas une vue de l’esprit ? Mais écoutons la suite qui devient plus explicite :
L’absence d’âme supprimerait-elle le nombre des fruits d’un arbre, sous prétexte que nul ne saurait plus les compter ? Bien sûr que non[18] !
C’est vrai, on peut répondre : bien sûr que non ! Mais ne pourrait-on tout aussi bien répondre : bien sûr que oui ? Ou même, ne rien répondre du tout ? Car le problème, dans cette configuration particulière (absence totale d’âme, de conscience ou de sujet), n’est pas tant de savoir si le nombre existe, ou le temps, ou la chose, mais quel est le sens de cette existence ?
Pourquoi en irait-il autrement du nombre du mouvement ? Même sans l’âme, il y aurait du mouvement, donc du temps : « L’avant et l’après sont dans le mouvement, reconnaît Aristote, et, en tant que nombrables, constituent le temps[19] »
Dire « Même sans l’âme il y aurait du mouvement », admettons. Mais ajouter « donc du temps », là non ! Car l’avant et l’après sont liés au « maintenant » qui dépend incontestablement de l’âme.
Les jours n’en passeraient pas moins, si nulle âme n’était là pour voir se coucher le soleil ; ils ne s’en succéderaient pas moins, si nul n’était là pour le voir se lever[20].
A quoi bon une existence qui n’a pas de sens, excepté celui donné par l’hypothèse purement intellectuelle et contradictoire[21], qu’en fait, une âme particulière (sans doute celle de l’auteur de l’hypothèse) se glisse subrepticement sur la scène, pour se poser la question : est-ce que cette chose existerait si je n’étais pas là ? Les jours qui passent et se succèdent, pour personne, le soleil qui se lève et qui se couche, pour personne, quel sens cela a-t-il ? Laissons donc ce nombre, ce temps, cette chose, ces jours ou ce coucher de soleil, ainsi que leurs existences, au fond du trou noir où ils sont tombés, et d’où ils ne ressortiront jamais. Quelle ontologie pourrait on construire sur cette absence de sens ?
Imaginons que toute vie disparaisse sur terre. Qu’est-ce qui interdirait, intellectuellement, de se demander depuis combien de jours plus personne n’a vu se lever le soleil[22] ?
Il s’agit donc bien d’une vue de l’esprit et d’une démarche purement intellectuelle. Car, si toute vie disparaît sur terre, comment pourrions nous alors nous poser la question ? L’hypothèse d’un temps qui existerait en dehors de nous, c’est à dire en dehors de la conscience, et qui aurait pu conforter le paradoxe considéré, n’est peut être pas à rejeter, mais n’est soutenue par aucun argument convaincant.
Revenons à notre question initiale qui est celle de la relation « âme / temps », ou « âme » comme condition nécessaire de l’existence du temps, et écoutons ce que nous dit Francis Wolff qui ne parle pas de l’âme mais de la pensée, ce qui revient au même, et qui répond, d’une certaine manière, à André Comte-Sponville :
Le temps est-il dépendant de la pensée ? Question aussi vieille que la pensée du temps mais aussi aporétique que celle de la « chose en soi ». Toute tentative de penser la chose hors de la pensée se heurte au fait que nous la pensons. Va voir là-bas si j’y suis répond la chose – et toujours elle est pour nous, jamais en soi. Autant s’imaginer mort : si je m’imagine mort, je me vois voyant le monde sans moi, mais le fait que je le vois contredit le fait que je me suppose ne plus y être ; le voir c’est y être, y être c’est pouvoir le voir. Va voir là-bas si j’y suis, répond le monde – et il y est si nous y sommes[23]
En conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que Aristote, par sa définition, d’une part relie le temps au monde extérieur, via le mouvement, lequel apporte à l’âme les ingrédients d’une unité de mesure, eux- mêmes situés dans ce monde extérieur. Mais d’autre part, l’âme apparaît bien comme une condition nécessaire au temps, car c’est elle qui nombre, via les maintenant, les positions du mobile dans le mouvement. Et par ailleurs le temps de l’âme ou du sujet, centré sur le maintenant, apparaît implicitement dans cette définition.
3. Retour sur le « Paradoxe »
Revenons maintenant sur notre paradoxe : comment le temps a-t-il pu s’écouler avant l’apparition de l’homme sur terre, si l’on opte pour un « temps du sujet » et non pas pour un temps qui s’écoule dans le monde en dehors du sujet ?
Notons tout d’abord que la conscience (ou l’âme) de l’homme, n’a pas le pouvoir, bien sûr, de créer le monde. Cette conscience n’a pas de pouvoir divin. Mais cette conscience, par contre, comme nous l’avons dit précédemment, donne du sens au monde et à toutes les choses qui se manifestent à elle, qu’elles lui soient contemporaines ou qu’elles appartiennent à un lointain passé, qu’elles lui soient très proches ou qu’elles se situent au fin fond de l’univers. Le temps du sujet lui appartient et le constitue dans sa relation au monde. Mais quand on parle d’un temps qui est « quelque chose du mouvement », le mouvement en question appartient bien au monde extérieur, et ne dépend donc pas du sujet. Ce temps là n’est pas le temps du sujet, même s’il le présuppose. L’expansion de l’univers n’a donc pas besoin de l’homme pour se réaliser, mais elle a besoin de l’homme pour acquérir du sens. Maurice Merleau-Ponty avait donc, par avance, répondu à Étienne Klein et à son « Paradoxe de l’Ancestralité », dans son ouvrage « Phénoménologie de la perception » où il dit ceci :
Nous répondrions de la même façon aux questions que l’on peut se poser sur le monde avant l’homme. Quand nous disions plus haut qu’il n’y a pas de monde sans une Existence qui en porte la structure, on aurait pu nous opposer que pourtant le monde a précédé l’homme, que la terre, selon toute apparence, est seule peuplée, et qu’ainsi les vues philosophiques se révèlent incompatibles avec les faits les plus assurés[24].
C’est donc bien et très exactement la problématique soulevée par notre paradoxe qui est abordée ici par Maurice Merleau-Ponty, qui poursuit ainsi :
En réalité, ce n’est que la réflexion abstraite de l’intellectualisme qui est incompatible avec les « faits » mal compris. Car que veut-on dire au juste en disant que le monde a existé avant les consciences humaines ? On veut dire par exemple que la terre est issue d’une nébuleuse primitive où les conditions de vie n’étaient pas réunies. Mais chacun de ces mots comme chacune des équations de la physique présuppose notre expérience préscientifique du monde et cette référence au monde vécu contribue à en constituer la signification valable[25].
En d’autres termes, on ne peut évacuer la conscience d’un contexte que l’on considère, et où la conscience serait supposée, a priori, ne pas être. D’une manière ou d’une autre, et que ce soit via une simple pensée ou via une réflexion scientifique, la conscience est bien là, présente dans ce contexte.
Rien ne me fera jamais comprendre ce que pourrait être une nébuleuse qui ne serait vue par personne. La nébuleuse de Laplace n’est pas derrière nous, à notre origine, elle est devant nous, dans le monde culturel. Et, d’autre part, que veut-on dire quand on dit qu’il n’y a pas de monde sans un être au monde ? Non pas que le monde est constitué par la conscience, mais au contraire que la conscience se trouve toujours déjà à l’œuvre dans le monde[26]
Il n’y a donc aucune contradiction à considérer que l’univers s’est déployé au cours de milliards d’années avant l’apparition de la vie, puis de la conscience, sur la planète terre. Le « temps du sujet », issu de la conscience humaine, n’est en rien une condition nécessaire au déploiement de l’univers, mais il permet au sujet de donner du sens à ce déploiement, autant avant son apparition, qu’après.
La seule question qui reste alors posée, et qui est toujours non éclaircie, est la suivante : à quoi correspond ce « temps du sujet », c’est-à-dire notre temps à nous, dans le monde réel ? Car il semble clair que le concept de « mouvement », proposé par Aristote, n’est pas pleinement satisfaisant[27], pas plus que celui de changement, ces deux concepts étant, en fin de compte, compris comme dépendants d’un temps, cette fois-ci « physique ».Y a-t-il un temps du monde ou un temps physique et quel est-il ?
4. Temps du sujet ou temps du monde ?
La définition d’Aristote présente un double aspect : d’une part elle définit une mesure du temps (nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur), d’autre part elle introduit l’âme et son maintenant qui, même si Aristote ne le dit pas explicitement, conduit au temps du sujet. Cette définition du temps, comme mesure, est alors à rapprocher avec la définition du temps en physique proposée par Albert Einstein :
On entend par temps d’un événement l’indication de l’horloge (position des aiguilles) immédiatement voisine de l’événement[28].
Nous avons expliqué, dans un article précédent, en quoi cette définition suppose implicitement l’existence d’un sujet (et donc d’un temps du sujet) même si ce sujet est réduit à un simple observateur :
Cependant une horloge, en tant que telle, n’a ni indication, ni temps. Sans le définir de façon explicite, le physicien suppose l’existence d’un « observateur » capable de saisir (localement) l’indication de cette horloge, et plus généralement d’observer tel ou tel événement[29].
Il y a donc une très forte similitude entre les définitions d’Aristote et d’Albert Einstein, comme le confirme Claude Romano, qui signale cependant l’importance du repérage espace-temps en théorie de la relativité :
L’ajout décisif d’Einstein consiste ici uniquement dans la prise en compte de la position de l’horloge qui devient déterminante dans la compréhension relativiste de l’espace-temps[30].
La question qui reste posée, c’est autant « à quoi correspond le temps du sujet dans le monde réel ? », que « à quoi correspond ce temps en physique (qui n’est qu’une simple mesure) dans le monde réel ? ». Ou encore : « existe-t-il réellement un temps du monde, dont le temps en physique serait la mesure ? » L’option choisie, par certains philosophes et scientifiques, est la suivante : « le temps (du monde), en lui même, n’est rien ». Il y a bien un temps des philosophes qui est le temps du sujet, mais il n’y a pas de temps (du monde), ni d’ailleurs d’espace, pour servir de cadre aux événements du monde. Selon Carlo Rovelli :
Tout comme l’espace, le temps devient une notion relationnelle. Il n’exprime qu’une relation entre les différents états des choses. Il s’agit d’un changement simple, mais sur le plan conceptuel c’est un pas de géant. Nous devons apprendre à penser le monde, non comme quelque chose qui évolue dans le temps, mais d’une autre façon. Au niveau fondamental, il n’y a pas de temps[31].
Et c’est bien ce que confirme Marc Lachièze-Rey qui déclare, dans son ouvrage « Voyager dans le temps » :
Il est tout à fait possible d’exprimer toute la physique concrète en se passant de la notion de temps, ce qui correspond à la vision « relationnelle » de cette dernière. ( . . . ) Il est indispensable d’écarter la notion de temps dès que l’on s’intéresse, par exemple, aux possibilités de dépasser la théorie de la relativité[32].
Cette option ne règle pas tous les problèmes, bien sûr, car s’il n’y a pas un temps du monde, il reste à mettre au jour un concept premier[33], qui serait la source en particulier du mouvement, et plus généralement de tous changements. On rejoint là les débats actuels autour de la « gravité quantique », qui posent à nouveau la question du temps au niveau le plus fondamental (Alexis de Saint-Ours[34], Christian Wüthrich[35]).
Références
ARISTOTE, 2014, Œuvres Complètes sous la direction de Pierre Pellegrin, Paris, Éditions Flammarion.
COMTE-SPONVILLE ANDRÉ, 1999, L’être temps, Paris, Éditions PUF, Perspectives critiques.
EINSTEIN ALBERT, 2004, La théorie de la relativité restreinte et générale, Paris, Éditions Dunod.
HEIDEGGER MARTIN, 1989, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Paris, Éditions Gallimard.
KLEIN ÉTIENNE, 2007, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, Paris, Éditions Flammarion, NBS.
LACHIEZE-REY MARC, 2013, Voyager dans le temps, Paris, Éditions du Seuil.
MERLEAU-PONTY MAURICE, 1945, Phénoménologie de la perception, Paris, Éditions Gallimard.
ROMANO CLAUDE, 1999, L’événement et le temps, Paris, Éditions PUF, Epiméthée.
ROVELLI CARLO, 2012, Et si le temps n’existait pas ? Paris, Éditions Dunod.
SAINT AUGUSTIN, 2008, Les Confessions, trad. Joseph Trabucco, Paris, Éditions Flammarion.
SAINT-OURS, ALEXIS DE, 2011, « La disparition du temps en gravitation quantique », in Philosophia Scientiae.
WADIER YVES, 2016, « Einstein et le temps du sujet : ambiguïtés en physique relativiste », in Implications philosophiques.
WOLFF FRANCIS, 2011, « Un concept hybride du temps », in Revue de métaphysique et de morale, n° 72.
WÜTHRICH CHRISTIAN, 2012, « A la recherche de l’espace-temps perdu : questions philosophiques concernant la gravité quantique », à paraître in Soazig Le Bihan (dir.), La Philosophie de la Physique : D’aujourd’hui à demain, Paris, Vuibert.
YOURGRAU PALLE, 2005 Einstein / Gödel, préface de Thibault Damour, Paris, Éditions Dunod.
[1] Étienne Klein, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, Paris, Éditions Flammarion, NBS, 2007, pp. 77-79.
[2] Étienne Klein, « Le temps est-il un cas de conscience ? », conférence donnée sous l’égide de la BnF, de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, et de l’Université Paris Diderot, le 16 Janvier 2013.
[3] Étienne Klein, « Les instants se ressemblent-ils ? », La Recherche Hors Série : ‘Le Temps’, Janvier 2017.
[4] Id.
[5] Yves Wadier, « Einstein et le temps du sujet : ambiguïtés en physique relativiste », in Implications Philosophiques, 2016.
[6] Palle Yourgrau, Einstein / Gödel, préface de Thibault Damour, Paris, Éditions Dunod, 2005, p VI.
[7] Saint Augustin, Les Confessions, trad. Joseph Trabucco, Paris, Éditions Flammarion, 2008, Livre onzième, Ch 26.
[8] Aristote, Oeuvres complètes sous la direction de Pierre Pellegrin, Paris, Editions Flammarion, 2014.
[9] Aristote, op. cit., p. 597.
[10] Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Paris, Éditions Gallimard, p. 308.
[11] Aristote, op. cit., p. 597.
[12] Heidegger, op. cit., p 296.
[13] Ibid., p. 313.
[14] Claude Romano, L’événement et le temps, Paris, Éditions Puf, Epiméthée, 1999, p. 153.
[15] Notons que, pour Aristote, le mouvement de la « sphère des fixes » (ou de la sphère céleste) n’est pas un simple ingrédient mais le mouvement uniforme de référence qui fournit la mesure de tous les autres.
[16] André Comte-Sponville, L’être-temps, Paris, Éditions Puf, Perspectives critiques, 1999, p.17.
[17] Heidegger, op. cit., p 305.
[18] André Comte-Sponville, op. cit., p 17.
[19] Id.
[20] Id.
[21] contradictoire avec l’hypothèse de départ : « pas d’âme »
[22] André Comte-Sponville, op. cit., p 17.
[23] Francis Wolff, « Un concept hybride du temps », in Revue de métaphysique et de morale, 2011/4 (n°72), p. 487-512.
[24] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Éditions Gallimard (tel), 1945, p.494.
[25] Id.
[26] Id.
[27] Aristote s’appuie sur le système géocentrique pour définir son mouvement de référence qui est celui de la « sphère des fixes ». Cette représentation a été abandonnée après la révolution copernicienne. Existe-t-il un premier mouvement ? Existe-t-il un repère privilégié dans l’univers ? Il n’y a pas de consensus à l’heure actuelle sur ces questions.
[28] Albert Einstein, La théorie de la relativité restreinte et générale, Paris, Éditions Dunod, 2004, p. 27.
[29] Yves Wadier, « Einstein et le temps du sujet : ambiguïtés en physique relativiste », in Implications Philosophiques, 2016.
[30] Claude Romano, op. cit., p 74.
[31] Carlo Rovelli, Et si le temps n’existait pas ?, Paris, Éditions Dunod, 2012, p. 102.
[32] Marc Lachièze-Rey, Voyager dans le temps, Paris, Éditions du Seuil, 2013.
[33] Concernant ce « concept premier », Étienne Klein parlerait du « moteur du temps ».
[34] Alexis de Saint-Ours, « La disparition du temps en gravitation quantique », in Philosophia Scientiae, 2011, 15-3, pp 177-196.
[35] Christian Wüthrich, « A la recherche de l’espace-temps perdu : questions philosophiques concernant la gravité quantique », à paraître in Soazig Le Bihan (dir.), La Philosophie de la Physique : D’aujourd’hui à demain, Paris, Vuibert, 2012.










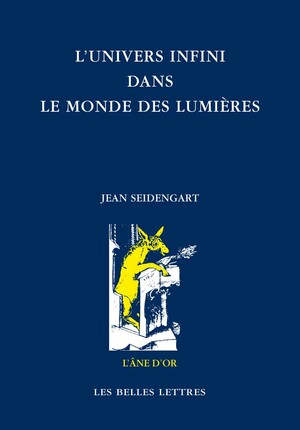




Imaginez une montagne de pierres, sans aucune vie pour interagir avec elle. Comment dire si le sommet de cette montagne est le passée ou le future, de même que pour le bas de la montagne ou n’importe quel autre partie? Rajoutez y de la vie, prenons un homme, il est au bas de la montagne, dans sa tête il se dit, je vais monter! De la, tout c’est déjà créé, le sommet sera dès lors cette pensée le future, une fois l’homme en marche vers le sommet, le point de départ représentera le passée, le temps de marche, le corps même de l’homme en plein mouvement sera le présent. Voilà ce qu’est dans toute sa simplicité le temps, une interaction entre de la vie et l’espace, créant l’espace-temps, sans vie, pas de temps et vice vers sa. D’une manière personnelle est plus spirituelle, le temps n’est existentielle que en sa signification, le temps nous annonce, à nous les êtres spiritueux, l’évolution à venir dans notre cycle de réincarnation, lui, notre cycle étant la seule réel valeur de temps existentielle car il est en évolution constante. Et oui, nous être humains sommes en constante évolution, dans l’ignorance ou la connaissance l’évolution de l’âme suis son cours sans contestes, comme une ligne droite. De part un certains nombres de vies vécu, l’âme évolue jusqu’à atteindre son apogée, l’existence terrestre final connaîtra alors tout du bien comme du mal (l’être parfait) la réel questions existentielle dès lors deviendra non plus « qu’est ce qu’il y a apres la mort? » Mais plutot « qu’est ce qu’il y aura après la fin de mon cycle de réincarnation? ».
Si le temps est issu de la conscience, comment le temps a-t-il pu s’écouler avant l’apparition de l’homme sur la planète terre ?
Si l’ame existe de tout temps peut on imaginer que, bien que non encore incarnée, elle puisse avoir été consciente du défilement du temps depuis 13,7 milliards d’années mais qu’en s’incarnant , il y a seulement 2 millions d’années, elle soit touchée par l’oubli de sa conscience antérieure désincarnée pour commencer le comptage qu’à partir de sa conscience incarnée ?
Pour aborder la question du temps, il est meilleur de se défaire de la notion d’âme et de préférer celle de conscience. Le philosophie irlandais Berkeley a posé que nos pensées n’existent pas hors de l’esprit. Le temps est évidemment une construction de l’esprit. Si nous enlevons le Dieu auquel le philosophe croyait, il ne reste plus grand monde pour donner une consistance (par la perception) à ce que nous désignons comme le réel. Le temps reste un fait de conscience matérialisé par le langage, pour reprendre une formulation d’un traducteur de soutra de l’idéalisme bouddhique à propos de la datation de végétaux au carbone 14.
Il y a environ 13,8 milliards d’années, la mesure du temps n’existait pas. L’univers était un objet au statut incertain, hyper-chaud et hyper-dense. Mais dire tout cela, c’est encore une représentation pour donner une consistance au monde parce que notre cerveau fabrique des récits et le temps en est un.