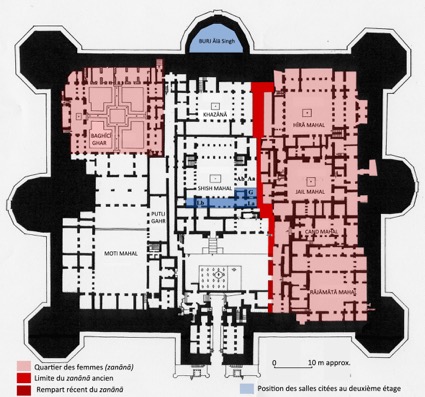Le national et le global dans le cinéma hindi contemporain
Rang de Basanti (La couleur du sacrifice[1]) et la fabrication d’une nouvelle masculinité et d’une féminité qui lui corresponde
Shoba Venkatesh Ghosh est Professeur au département d’Anglais de l’Université de Mumbai. Ses recherches et publications se situent à la croisée des « postcolonial gender studies » (« études postcoloniales et de genre ») et des études littéraires, du cinéma et culturelles.
On admet aujourd’hui communément, presque comme un cliché, dans les études sur le cinéma indien et dans les études culturelles, que le courant dominant du cinéma hindi[2] – peut-être la forme culturelle qui se réclame le plus fortement d’un statut « national-populaire » – est l’un des médiateurs les plus importants des identités collectives, des angoisses et des désirs. Wimal Dissanayake parle de ce cinéma comme « d’une force dominante en Inde qui offre un lieu utile pour l’échange de contenus et de valeurs culturelles et invite l’immense masse des amateurs de cinéma à participer aux discussions en cours sur la modernité culturelle » (Dissanayake 2003, 202). On a soutenu d’une manière quasi constante qu’il s’agit d’un terrain sur lequel les définitions et les redéfinitions de notre nation postcoloniale – et la place du genre parmi ces inventions et réinventions – continuent de s’inscrire (Chakravarty 1996 ; Prasad 1998 ; Gabriel 2010).
À travers la lecture d’un film hindi contemporain du tout début du xxie siècle – Rang de Basanti – qui a remporté un succès extraordinaire, le présent article s’interroge sur les processus spécifiques de la reformulation patriarcale qui se manifestent à un moment décisif dans l’histoire de la nation alors que les transformations du genre, les reconfigurations de classes et les flux mondialisés du capital et de la culture ont transformé l’espace de la nation en un lieu de nouvelles contestations. L’émergence de ce que l’on a appelé le « transnational » a-t-elle dépouillé la nation de son pouvoir dans les récits véhiculés par les films d’aujourd’hui ? Un imaginaire sexuel apparemment libéré des constantes de l’amour et du désir hétérosexuel a-t-il libéré le film hindi de l’emprise hégémonique de « l’idéal-traditionnel » cinématographique de la famille indienne[3] ? Cela s’est-il traduit par une représentation plus stimulante de la femme, ou bien de nouveaux cadres contraignants se sont-ils mis en place ? La dérégulation économique et ce qui est perçu comme la démission de l’État ont-ils conduit à « l’abandon par l’État de l’espace du récit filmé » (Raghavendra 2008 : p. 250), laissant au marché le soin de résoudre le conflit ? La lecture d’un certain nombre de films du nouveau millénaire suggère que les réponses du film hindi contemporain à cet instant historique sont loin d’être univoques ou dépourvues de contradiction. S’il existe une constante, c’est que le réseau de relations genre/sexe et la figure de la femme restent des éléments essentiels dans la façon dont ce cinéma fait son chemin à travers les sables mouvants du présent. C’est, globalement, la thèse que je défends dans cette étude d’un film clé.
L’élaboration d’une nouvelle masculinité et d’une féminité qui lui corresponde : Rang de Basanti
Sorti sur les écrans en 2005, Rang de Basanti a reçu un accueil enthousiaste du public. Cette histoire d’un groupe de jeunes de la classe moyenne urbaine, en rupture de bans, qui se radicalise sous l’influence d’une femme britannique en renouant avec un engagement nationaliste dans le contexte de la mondialisation, mérite qu’on s’y arrête pour plusieurs raisons et en particulier par son expérimentation créative du mélange des genres et sa réélaboration des modèles cinématographiques hérités. Il s’inspire de la tradition du nouveau film « nationaliste », apparu dans les années 1990
[4] dans le contexte de la libéralisation économique, de la mondialisation et du nationalisme culturel hindou ; mais, à la différence des films de ce genre, Rang de Basanti ne définit pas la nation par rapport à un « autre » extérieur. Il porte la trace des films des années 1980 et 1990 mettant en scène un justicier dont le rôle est tenu par un « jeune homme en colère » bien que la figure singulière et isolée du justicier soit ici partagée au sein d’un groupe de jeunes gens. On peut aussi le replacer dans la lignée des « films pour la jeunesse » qui ont proliféré au cours de la dernière décennie[5] en réponse à la nouvelle visibilité des jeunes comme consommateurs et catégorie électorale, considérés comme remplaçant progressivement le « public familial » d’antan. Cependant, à la différence de ses homologues, Rang de Basanti s’emploie moins à la diffusion d’aspirations à un mode de vie consumériste qu’il ne vise à former, au sein de la jeunesse, de nouveaux citoyens susceptibles de se réapproprier la nation et de la sauver des atteintes de l’État et de l’apathie sociale. Le film relève aussi du genre « historico-nationaliste » des années 1990 et du début des années 2000[6], mais intègre le passé dans une relation plus naïve avec l’actualité en faisant des allers retours entre le passé et le présent dans des mouvements parallèles. Rang de Basanti est aussi, comme tous les films hindis, principalement une histoire d’amour ; pourtant sa romance interraciale est inhabituelle dans le contexte d’un cinéma marqué par un profond malaise en ce qui concerne les relations entre « l’Inde » et « l’Occident ».
On considère généralement que Rang de Basanti a eu plus « d’influence » que la plupart des films récents : on lui attribue d’être à l’origine d’un débat sans précédent, voire d’avoir radicalement modifié la conscience et les pratiques sociales et politiques d’une génération entière de jeunes gens.
Il a fait émerger des débats qui étaient sous-jacents dans les courants dominants de la société, envahi les espaces socialistes [sic] et a pénétré la blogosphère. Situé dans l’Inde moderne, il a recréé la génération jean clad (ndt : qui s’habille en jeans), avec autant d’authenticité que les révolutionnaires auxquels elle s’opposait (Kumar 2010, p. 1).
[Le] film a non seulement amené le public à organiser des marches aux chandelles et des manifestations de protestation sur de nombreuses questions d’intérêt public, mais a aussi incité la jeunesse à s’investir en politique. RDB a donc soulevé plus de débats dans la presse indienne pour son portrait du nationalisme et des actions citoyennes qu’on aurait pu l’attendre de son jeune public (Dilip 2008, p. 4-5).
De telles extrapolations – des transformations de la conscience de la jeunesse dans le texte cinématographique aux changements radicaux dans le monde social qui l’entoure – surévaluent l’impact du film et opèrent un glissement fautif entre les lectures du réel et du reel (Ndt jeux de mots sur le réel et la bobine de film, reel en anglais). En adaptant le fameux commentaire du poète Auden sur les limites de la poésie, on pourrait dire que « le film ne fait rien advenir de nouveau[7] ». Ce que fait le cinéma populaire, néanmoins, c’est de répandre de nouvelles formes d’imagerie culturelle. Et Rang de Basanti a remarquablement mis en circulation l’iconographie de la manifestation aux chandelles. Tirée d’images des médias occidentaux, la vision élégante, tranquillement dramatique, d’une marche silencieuse dans la douce lumière des bougies a créé un peu plus qu’une nouvelle performativité de manifestations (non ouvrières) pour une classe urbaine éduquée accédant au global par la consommation d’une imagerie qui circule mondialement et restant profondément ancrée dans le maintien de ses privilèges dans l’espace même de la nation.
En effet, il y a eu des réactions extrêmement critiques contre ce qui est vu comme l’appropriation par le film de la rhétorique du patriotisme pour définir la citoyenneté comme la propriété d’une classe moyenne urbaine réduite mais privilégiée. Selon l’un des critiques, le prétendu impact du film ne va pas plus loin que l’excitation d’une « sentimentalité et d’une unité stupides » chez les groupes nantis auxquels il s’adresse, ignorant les inégalités sociales réelles qui non seulement persistent, mais se creusent et se renforcent (Grewal 2006 : 4115). Et, selon un autre commentateur, le film propose sous l’habit du patriotisme « un discours dissimulé qui privilégie des causes qui, loin d’être “pan-nationales”, dénotent les préoccupations de classes particulières convaincues qu’elles sont la nation » (Raghavendra 2006 : 1503). De plus, soutient ce critique, le « nationalisme » mis en avant par le film est douteux, car il suggère que « le nationalisme indien est mieux défendu par l’Occident mondialisé » (1505).
Ces quelques citations révèlent le chevauchement typique des grilles de lecture du film – classe, nationalisme, citoyenneté et mondialisation. À une exception près, étrange[8], ce qui reste relativement ignoré est la manière selon laquelle la reconfiguration des relations entre classe, identités nationale et mondiale procède essentiellement d’une ré-imagination des relations de genre. Le projet idéologique de Rang de Basanti est l’élaboration de nouvelles formes d’un désir hétérosexuel qui puisse orienter de manière centripète les pressions contraires actuelles pour les combiner et les harmoniser. Et la naissance d’un film sur le nouveau citoyen national implique de nombreuses initiatives stratégiques – une récupération historique de formes choisies de la masculinité ; le remplacement de la famille traditionnelle par une communauté masculine homo-sociale ; un parricide réel et métaphorique; un fratricide suggéré (et culpabilisant) ; et, de manière cruciale, une remise en cause de la vision binaire entre la femme « indienne » et la femme « occidentale » à travers un usage ciblé de l’histoire et des mythes.
La formule de dénégation obligatoire au début du film, qui pose le caractère fictionnel de ses personnages et déclare que « toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé n’est que pure coïncidence », est autoréflexive et révèle le caractère singulier de l’utilisation que Rang de Basanti fait de l’histoire. Son détour par le passé colonial est un exemple de ce que Quentin Skinner appelle « la mythologie de la prolepse » dans laquelle le passé est assimilé au présent. Il s’agit de la reconstruction particulière du passé qui se fait jour « quand l’historien est plus intéressé par la signification rétrospective d’un travail ou d’une action historique donnés que par son sens pour l’agent lui même » (Skinner 1988 : 44. Les italiques sont de l’auteur.) Le passé est donc reconstruit pour servir les nécessités du présent. Dans RDB, le retour circulaire au passé colonial sert à assumer la mondialisation actuelle et à la valider effectivement (ce qui est souvent qualifié par les détracteurs du film de forme de néocolonialisme.)
Dans les scènes du passé du début du film – les exécutions des révolutionnaires emprisonnés, Bhagat Singh, Ram Prasad Bismil, Ashfaqulla Khan et Rajguru, pendant les heures noires du mouvement anticolonialiste des années 1940[9] – la brutalité du régime colonial qui réprime le nationalisme dissident n’est que vaguement montrée. Ce qui est présenté, à l’inverse, avec un grand pouvoir émotionnel, ce sont les doutes personnels, la conscience et l’humanité du geôlier britannique McKinley, comme d’ailleurs son admiration pour les martyrs. Les gros plans serrés sur un McKinley tourmenté et sa voix[10] lisant son journal intime rétablissent et réinstallent la « conscience » et un souci éthique essentiel au cœur de la colonisation britannique. Les impératifs du nationalisme et la représentation du colonialisme par lui-même comme une « mission civilisatrice » sont dès lors harmonisés, ce qui peut être transposé à la période historique actuelle. Et le vecteur de ce transfert est la petite-fille de McKinley, Sue, réalisatrice de documentaires et indianophile invétérée, qui souhaite faire un film sur les martyrs indiens sur la base du journal intime de son aïeul. Elle quitte Londres et arrive en Inde, portant en elle à la fois le fardeau du passé et la promesse de l’avenir, et elle aidera à reformuler l’identité indienne sous le regard plein de sollicitude de l’Occident. En conséquence, dans une manœuvre créatrice unique, la colonisation historique et la mondialisation actuelle sont de fait « féminisées » et débarrassées de leur menace implicite envers l’identité indienne et la masculinité indigène.
La prise de contact de Sue avec le groupe qu’elle amènera à se radicaliser – cinq garçons étudiants à Delhi – s’effectue à travers la jeune Indienne moderne, Sonia. Étudiante à l’université de Delhi, elle est liée aux cinq jeunes hommes au cœur du drame. Jusqu’à l’arrivée de Sue, c’est Sonia qui joue un rôle pédagogique au sein du groupe d’amis. Elle représente la « bonne » modernité indienne, la voix de la raison et de la modération qui cimente le groupe et lui fournit son ancrage éthique. Au fur et à mesure que le film progresse, nous la voyons progressivement supplantée par Sue, l’Anglaise, qui devient à la fois un objet de désir et le nouveau centre de l’autorité morale. Ce qui est remarquable, c’est la manière dont le film organise cette intronisation sans l’exprimer sous la forme d’un antagonisme irréductible entre les modèles de la féminité indienne et occidentale. Typiquement dans le cinéma indien, « la femme blanche occidentale et la femme indienne agissent de conserve comme des figures oppositionnelles pour renforcer les notions d’indianité et les valeurs traditionnelles » (Dark, p. 1). En effet, dans Rang de Basanti, Sonia cède volontiers son rôle à Sue comme si elle faisait en quelque sorte l’aveu de sa propre obsolescence dans un champ global où la citoyenneté elle-même est déterritorialisée et adresse une revendication non seulement à la nation, mais aussi au monde (implicitement entendu comme l’Occident mondialisé). Il faut pour ce faire que l’identité nationale soit redéfinie comme un cosmopolitisme transnational qui peut indifféremment toucher les dividendes nationaux et mondialisés. La discussion suivante rend compte des processus narratifs et des modes de représentation par lesquels le film tente d’y parvenir.
Quand l’Anglaise atterrit à Dehli, elle est conduite à travers la ville jusqu’au logement que Sonia lui a trouvé. Le Dehli qui s’offre à son regard approbateur est une métropole aseptisée dont toutes les marques du « tiers monde » ont été effacées. Impressionnée, Sue déclare (à voix haute) : « C’est vrai – on tombe amoureux de l’Inde au premier regard. » Par une extension métonymique – et à partir d’une vision très élitiste de la ville – Delhi devient l’Inde, dévoilant la conception propre au film de la nation désirée/désirable. Dans la scène qui suit, Sonia organise des auditions pour trouver des acteurs pour le film de Sue. Dans un montage comique, de jeunes hommes et femmes sont montrés en train de jouer devant la caméra de Sue. Les acteurs masculins sont, dans l’ensemble, inexpérimentés, superficiels, vulgaires, obnubilés par Bollywood, mal informés, ou parodiques dans leur imitation de l’Occident. Les actrices également jouent leur rôle de femme infantile, narcissique selon les stéréotypes féminins du « filmi » (ndt mot utilisé pour désigner le film indien populaire), ou de la femme rigide (et confusément) « féministe ». L’œil de Sue derrière la caméra saisit, juge et rejette non seulement les acteurs, mais ceux qui sont implicitement désignés comme l’archétype d’une jeunesse inadaptée. Le terrain est alors préparé pour la fabrique d’une masculinité appropriée et d’une féminité qui lui corresponde.
Sonia emmène Sue à l’université pour y rencontrer ses amis – un groupe de jeunes hommes désenchantés, apolitiques et socialement non engagés, cyniques quant au rôle de l’État et à l’avenir de la nation indienne. Il s’agit au départ d’un groupe de quatre, qui intègre par la suite un cinquième individu pour former un ensemble homo-social à même de représenter en microcosme ce qui apparaît comme l’angoisse des jeunes en Inde. Le leader charismatique de ce groupe est DJ, joué par Aamir Khan, l’un des trois « Khans » qui règnent sur Bollywood depuis maintenant un certain temps. La peur de DJ de quitter son refuge universitaire exprime l’anxiété d’une génération paralysée par le champ considérablement élargi de la concurrence dans un paysage mondialisé. Le désir de Karan, cynique et blasé, de partir pour les États-Unis en laissant tout derrière est stimulé en lui par son sentiment de ce que la nation est figée, désuète et incompatible avec les aspirations de la jeunesse. Aslam, un musulman, se débat contre les structures communautaires et familiales qui empêchent l’entrée dans la modernité. (Il n’est pas rare que, dans le cinéma hindi, les musulmans soient « stigmatisés » en termes communautaire et religieux, répétant ainsi le stéréotype d’une communauté qui résiste à la modernité.) L’engagement militant de Laxman Pandey dans l’Hindutva, mouvement très marqué à droite, naît de l’inquiétude que ressentent les Indiens devant la menace d’une influence corruptrice de l’Occident. Et la peur de mourir sans avoir réussi à se marier exprimée en manière de plaisanterie par l’un des personnages, notoirement irresponsable, Sukhi, souligne une angoisse masculine de ne pas atteindre l’âge d’homme dans l’ombre de dirigeants qui continuent à maintenir la nation sous leur emprise déprimante.
En effet, les Pères – absents ou massivement présents – hantent ce récit de la lutte de jeunes hommes pour entrer dans la virilité et doivent être violemment « tués » pour que l’héritage de la nation puisse être remis aux Fils. Fort logiquement, le modèle de virilité emprunté à l’histoire par mimétisme est celui du militant nationaliste Bhagat Singh plutôt que celui de Gandhi, personnage doux, féminisé et non violent ; et l’État colonial est remplacé par l’État postcolonial actuel comme objet d’attaque militante. Et, selon l’habitude dans le cinéma hindi, si l’État est incarné par la figure du Père, la nation/communauté se cristallise dans la figure de la Mère qui fonctionne comme « incarnation de la morale ». Dans ce film, les mères continuent à incarner cette fonction, mais sont décalées et montrées comme étant abandonnées, trahies ou même brutalement attaquées par la vénalité des pères/de l’État.
La base homo-sociale de ce groupe de jeunes au centre du récit appelle un certain nombre de réflexions. Les premières scènes les montrent en proie à la lassitude politique et au cynisme. Ils sont cependant aussi représentés comme un club de jeunes gens turbulents liés par les codes de loyauté et de pratiques partagées par la jeunesse. Les images de DJ, Karan et Sukhi (et, dans une moindre mesure, d’Aslam et plus tard de Laxman Pandey) vêtus de jeans, gros buveurs, chevauchant leurs motos, roulant vite et crachant des réparties en argot, les érotisent sans l’ombre d’un doute et mettent en scène un style de vie attirant pour la jeunesse. La situation de Sonia comme la bonne copine au sein de ce cercle masculin est intéressante. Il est aisé d’identifier ici de quelle unité homo-sociale mythique s’inspire le film pour mieux l’infléchir – le groupe de cinq hommes et d’une femme rappelle instantanément l’histoire de Draupadi et des cinq frères Pandava dans le Mahabharata[11]. Dans le mythe, le lien homo-social des frères tient à la propriété sexuelle conjointe de Draupadi au sein d’une formation polyandre[12]. Le renouvellement de ce trope pré-moderne qu’opère le film implique un glissement fondamental, compte tenu que la polyandrie ne peut être même envisagée comme cadre légitime. Parce qu’elle est la seule femme parmi les cinq amis, Sonia pourrait, par sa seule présence, cristalliser un désir hétérosexuel et potentiellement défaire le contrat homo-social entre les amis. En conséquence, sa menace sexuelle est canalisée et neutralisée par le fait qu’elle est amoureuse d’Ajay Rathod, un pilote de l’Indian Airforce qui incarne, vis-à-vis des amis de Sonia, une sorte de frère plus âgé et respecté.
Ajay, en effet, semble appartenir à une époque historique antérieure – il est moderne, laïque et sans équivoque dans son engagement envers la nation. Il porte l’empreinte de l’optimisme nehruvien des premières décennies de l’Indépendance, et il incarne aussi le nouveau sujet national bourgeois construit dans les films nationalistes des années 1990, comme Roja et Bombay de Mani Ratnam. Ce sujet, qui ne se conçoit qu’au sein de la matrice de la nation, semble dépassé et doit céder la place à des représentations moins limitées de la virilité. Deux dialogues significatifs mettent en évidence la différence entre la vision de la nation d’Ajay et celle du groupe d’amis. Ajay exprime la fierté que lui inspire son pays, l’engagement qui en découle et la façon dont il a prêté serment pour en protéger sa souveraineté – son appartenance aux forces armées fait grand sens ici. Son patriotisme détermine son monde émotionnel, sa virilité et ses pratiques concrètes – il admet qu’il se réalise en revêtant « l’uniforme » et en pilotant l’avion qui défend les frontières du pays. Karan s’oppose à lui en lui demandant de quoi il est fier. De la pauvreté du pays et de la corruption, peut-être ? Ou peut-être, intervient Aslam, de son chômage endémique ? Leur « idée » de l’Inde a peu à voir avec son exception culturelle, ses traditions ou la sanctuarisation de ses frontières. Ce sont plutôt les indicateurs mondiaux de développement – pauvreté, corruption, chômage – qui sont la mesure de sa valeur et déterminent sa position dans l’échelle du monde. Ce que nous voyons ici est un glissement dans l’imaginaire de la nation et la suggestion qu’Ajay vit dans le passé. Si les pères doivent être tués, alors ce « frère » doit l’être aussi. C’est cependant un désir coupable de fratricide, et l’angoisse qu’il engendre est gérée, comme on pourra le voir dans le récit, par un déplacement de la culpabilité sur l’État. Et, dans le même mouvement, Sonia doit elle aussi sortir du cadre pour céder sa place à un modèle de féminité plus adapté à l’avenir.
Sue reconnaît dans ce groupe de jeunes des acteurs parfaitement adaptés pour jouer les rôles des personnages historiques de son film. Assurant un rôle pédagogique, elle leur permet de découvrir ce que sont l’idéalisme et l’engagement dans la cause nationaliste en leur faisant rencontrer l’histoire (c’est-à-dire en leur faisant assumer les rôles de ces personnages historiques que sont Bhagat Singh, Ram Prasad Bismil, Ashfaqulla Khan et Rajguru). Mais, ce qui est plus significatif dans notre débat, c’est que l’arrivée de Sue libère le désir hétérosexuel au sein du groupe. En tant que « chef de la meute » (Dark, 3), DJ la revendique comme objet de désir et est désiré en retour. La réciprocité et l’acceptation sociale de cette romance interraciale marquent une période nouvelle dans le cinéma hindi, dans lequel de tels appariements sont rares, généralement tourmentés, unilatéraux ou socialement inacceptables. Rang de Basanti se propose de parvenir, à travers cette histoire d’amour, à un rapprochement entre indien et occidental, modernité et tradition, national et global[13]. De manière significative, toutefois, la romance est interrompue, révélant l’inconscient trouble du scénario.
Alors même que la partie principale du film se concentre ostensiblement sur les transformations des amis au fur et à mesure qu’ils redécouvrent l’idéalisme nationaliste, un réajustement beaucoup plus fondamental intervient en dessous de la surface du scénario. Ce n’est pas seulement au groupe que Sue est progressivement intégrée : elle l’est également au tissu même de l’indianité. Sous la houlette de Sonia et sous la tutelle de la mère de DJ, elle prie dans un temple Sikh, visite une foire rurale, apprend à se vêtir comme une Indienne et à se nourrir comme les Indiens. Le global, semble-t-il, peut se loger sans inconfort, et sans provoquer d’inconfort, au sein de l’indien. Et, réciproquement, c’est à travers une naturalisation du global dans le local que l’indien peut se projeter lui-même au-delà des frontières nationales. À deux moments clés dans le développement de la romance, les amoureux se jurent fidélité. Lorsque, dans un moment de franchise sous les effets de l’alcool, DJ exprime son angoisse du monde extérieur, hors des quatre murs de l’université – « Ici je suis quelqu’un, tout le monde me connaît. Mais dehors… ? » – Sue répond : « Ne t’en fais pas, je suis avec toi. » Et, plus tard, les craintes de Sue que sa présence ne provoque des problèmes sont balayés par l’assurance en miroir de DJ – « Ne t’en fais pas, je suis avec toi. » L’histoire d’amour naissante semble bien sur le point de se consommer, et les nouvelles normes hétérosexuelles prêtes à voir le jour. Mais avant cela un déplacement clé doit avoir lieu ; le paradigme normatif hétérosexuel que constituent Ajay et Sonia doit être rejeté.
Ce déplacement est métaphoriquement cristallisé dans une séquence où les cinq amis, accompagnés de Sue, Sonia et Ajay, vont visiter une ruine médiévale dans les environs de Dehli. Là, Ajay déclare ses sentiments à Sonia qui les reçoit positivement. Une chanson d’amour chantée par une voix féminine retentit alors que l’écran montre les cinq amis et Sue en train de les féliciter en chahutant tout autour dans la bonne humeur. Sonia et Ajay sont filmés séparément du groupe, repliés sur leur amour et présentant l’image du couple conjugal parfait. Ce qui apparaît comme une pure et simple célébration de l’amour et de la camaraderie prend des couleurs plus complexes à cause de la manière dont les personnages sont montrés et cadrés. Dans une prise de vue, Sonia et Ajay sont en arrière-plan en train de s’embrasser, cadrés par une arche à travers laquelle on aperçoit les autres en train de folâtrer dans les profondeurs du cadre. La lumière brillante du soleil inonde le groupe dans le fond tandis que le couple, dont la silhouette se découpe dans l’ombre, prend une apparence évanescente, presque spectrale. Dans une autre scène, les fiancés, dans les bras l’un de l’autre, sont allongés sur une plateforme rocheuse en hauteur dans une représentation iconique de l’amour accompli. Ou, hypothèse plus dérangeante, est-ce la nostalgie de l’image classique des amants tragiques morts dans les bras l’un de l’autre ? Tandis qu’ils sont là, étendus sur le dos, un avion de combat vole haut au-dessus d’eux laissant échapper un panache aux couleurs du drapeau indien qui vient bientôt entourer le couple à l’intérieur de l’arc ainsi produit. C’est bien là le couple idéal engendré sous le signe de la nation. Ou bien, dans une lecture plus troublante, est-ce le tribut payé à la nation et l’adieu au couple conjugal qui est maintenant au bord de l’obsolescence[14] ? La séquence se termine sur l’image de l’autre couple « plus nouveau », DJ et Sue, qui, affichant publiquement leur amour, s’embrassent devant les amis. Il est intéressant de noter qu’ils sont cadrés depuis l’arrière. Cette réticence de la représentation semble pointer l’angoisse et l’incertitude du film quant à l’avènement de son couple interracial (mondialisé ?). Avec le ballet de ces deux couples dont l’un laisse place à l’autre, nous assistons donc à une « mort » suggérée et à une « naissance » hésitante.
La mort est actualisée et la naissance avortée par la tension de la narration qui va bientôt suivre – la disparition d’Ajay dans un avion défectueux acheté par l’État corrompu de mèche avec une industrie de l’armement rapace (représentée par le père de Karan) ; la réputation d’Ajay entachée par le ministre de la Défense qui fait peser sur Ajay, qui pilotait l’avion, la responsabilité de l’accident ; et les représailles des amis, se faisant eux-mêmes justice. C’est comme si le film se retrouvait, du fait de son imaginaire parricide/fratricide et de l’audace de ses désirs, plongé dans un tissu de contradictions qu’il s’emploie à résoudre à travers des mouvements narratifs « déformés ». La mort d’Ajay, déjà préfigurée comme un fratricide désiré[15], est imputée à l’État – aux politiciens corrompus, à la collusion frauduleuse entre l’État et le marché et à une mécanique qui criminalise l’innocent et attaque le faible. Lors d’un rassemblement public de protestation aux chandelles, la mère d’Ajay (représentant la nation vulnérable et réduite au silence) est rouée de coups de bâtons et sombre dans le coma. Cet événement non seulement justifie mais rend indispensable le meurtre des Pères par les Fils. Les amis tuent le ministre de la Défense dans un parricide métaphorique ; Karan, lui, tue effectivement son père.
Mais comment justifier la violence de la vengeance et marquer sa différence de nature avec la violence d’État ? L’Histoire trouve ici son utilité, et l’engagement de Bhagat Singh et de ses compagnons révolutionnaires est mis en abyme. Le mythe fournit aussi un palliatif à la culpabilité du parricide violent – le personnage de Draupadi est rappelé une fois de plus, mais à présent dans son rôle de « femme qui incite [à la violence] ». Dans une scène extraordinairement tendue dans laquelle les amis se demandent ce qu’ils pourraient faire pour rendre justice à Ajay et à sa mère, c’est une Sonia résolue et au visage de pierre qui fournit la solution – « Tuez-le ! » dit-elle avec force, en parlant du ministre de la Défense corrompu qui a diffamé Ajay lors de sa mort en suggérant qu’il aurait commis une erreur de pilotage, et a ordonné l’attaque contre les manifestants au cours de laquelle la mère d’Ajay a été grièvement blessée.
Dans son étude de la femme provocatrice (incarnée par les figures mythologiques de Kaikeyi et Manthara tirées du Ramayana, Draupadi dans le Mahabharata et celle, contemporaine, de Sadhvi Rithambara, une évangéliste Hindutva extrémiste de droite, célèbre pour ses discours violemment provocateurs contre les communautés minoritaires), Kumkum Sangari soutient que la provocation féminine est « une unité discursive ou narrative récurrente pour caractériser une “agentivité” tordue » (1999, 384), particulièrement dans les textes mythologiques/normatifs. Alors même que ces figures provocatrices semblent symboliser des femmes fortes et indépendantes qui incitent les hommes à s’engager dans certaines formes d’actions, leur nature est contradictoire, restreinte et souvent exploitée au service des hégémonies traditionnelles et pour assurer la pérennité de ces dernières[16]. Dans notre film, l’exhortation de Sonia s’exerce dans un cadre patriarcal. Sa provocation déplace la culpabilité de la violence des hommes vers sa propre personne sans que le pouvoir masculin en soit aucunement modifié. C’est aussi une manière de reconnaître que les femmes ne peuvent agir que par l’intermédiaire des hommes. De plus, comme elle est à l’origine de l’appel à une violence contestable et qu’elle exhorte à la réparation d’une faute commise contre elle personnellement, elle endosse les couleurs de la malignité féminine, ce qui justifie ensuite sa mise à l’écart progressive de l’histoire et son éviction par son homologue blanche.
Tout aussi significatif est le fait que Sue, l’Anglaise, ne soit pas le moins du monde complice de la violence et constitue une référence morale pour instruire son éventuelle critique. Cette autorité morale lui est conférée par un double mandat. Tout d’abord, en tant que représentante de l’Occident. Ensuite, et cela est plus remarquable, au terme d’un processus de désignation par la mère de DJ qui lui transmet tacitement l’autorité éthique qu’elle incarnait jusqu’alors.
En dépit de la logique narrative et des stratégies idéologiques du film, les ambivalences persistent. Faute de parvenir à concilier son goût pour la violence masculine spectaculaire avec son désir d’être accepté par un Occident supposé « éclairé », et comme s’il reconnaissait la puissance des Pères et les difficultés à arracher la nation à l’État afin de faciliter son entrée dans la mondialisation, Rang de Basanti se termine par la mort de ses protagonistes masculins. En réalité, le désir de l’Occident qu’il exprime (et de la femme blanche) apparaît lui-même confus et contradictoire. Le temps n’est pas venu, semble-t-il, pour l’accomplissement de cette romance. Pour l’instant, la nation en tant que lieu et garant de l’identité semble encore trop enracinée, et le sujet masculin national-mondialisé reste à venir. Dans l’une des dernières scènes, Sue et Sonia revisitent les ruines où les jeunes désirs avaient pris forme. Elles s’asseyent sur les vieux murs qui dominent un vaste horizon. La caméra, dans un mouvement lent, accompagne la sortie du cadre de Sonia (« drapée dans un voile de veuve » comme le dit Dark) et s’attarde en gros plan sur Sue qui attend, comme un rêve et une promesse, d’être appelée quand le moment sera venu.
Conclusion
Le présent article a pour ambition d’analyser une œuvre cinématographique importante de la première décennie du xxie siècle considérée comme lieu discursif crucial sur lequel des idéologies du genre/sexe s’élaborent dans un récit complexe de continuités et de ruptures avec le passé. Il permet de comprendre les mécanismes et les stratégies par lesquelles le cinéma hindi non seulement reflète, mais aussi fabrique de nouvelles formes de désir dans le contexte de l’insertion de l’Inde dans une nouvelle phase du capitalisme mondial qui façonne le nouvel imaginaire de l’Indien, de la nation et de l’identité individuelle et collective. Je soutiens que de nouvelles aspirations et de nouvelles angoisses s’inscrivent dans les scénarios cinématographiques contemporains et nous permettent d’y voir plus clair dans le tourbillon des forces qui modèlent notre présent. Derrière le message apparent de l’explosion d’images montrant l’égalité sexuelle, le relâchement des structures patriarcales traditionnelles et la prolifération de nouveaux discours sur le désir, le patriarcat en transformation met en place de nouveaux cadres d’endiguement. Mais, comme le suggère notre lecture de Rang de Basanti, des structures plus traditionnelles s’imposent en face des nouvelles menaces. Une lecture féministe fait apparaître, sous les préoccupations apparentes des films, les opérations genrées plus fondamentales qui les animent. Car, comme le fait remarquer Gabriel, « la manière dont la réorganisation des relations genre-sexe et la restauration de l’orthodoxie sexuelle patriarcale sont essentielles à la résolution des crises sociales et même nationales montre comment le sexuel est le bas-ventre du social » (Gabriel 2010 : 67. Les italiques sont de l’auteur).
Bibliographie
Aggarwal, Vidhu. 2010. « The Anti-Colonial Revolutionary in Contemporary Bollywood Cinema », CLCWeb : Comparative Literature and Culture, Vol 12, no 2. http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.1595
Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, University of Minnesota Press.
Bhabha, Homi. 1990. « Dissemination : Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation », In Homi Bhabha (éd.), Nation and Narration. Londres : Routledge.
Chakravarty, Sumita S. 1996. National Identity in Indian Popular Cinema. Delhi : Oxford University Press.
Dark, Jann. 2008. « Crossing the Pale : Representations of white Western Women in Indian Film and Media ». Transforming Cultures eJournal, Vol 3, no 1, February.
Dilip, Meghana. 2008. « Rang de Basanti : Consumption, Citizenship and the Public Sphere », Unpublished dissertation, Graduate School of University of Massachusetts Amherst.
Dissanayake, Wimal. 2003. « Rethinking Indian Popular Cinema: Towards newer frames of understanding », In Anthony Guneratne et al (éds), Rethinking Third Cinema. New York et Londres, Routledge.
Gabriel, Karen. 2010. Melodrama and the Nation: Sexual Economies of Bombay Cinema 1970-2000. New Delhi, Women Unlimited.
Ghosh, Shoba Venkatesh. 2009. « Girl Abroad: The Private and the Public in Jab We Met… », Economic and Political Weekly, Vol 44, no 17.
Grewal, Jasraman Singh. 2006. « Rang de Basanti : Morality and the Reservation Issue ». Economic and Political Weekly, Vol 41, no 39.
Kumar, Kshama. 2010. « Bhagat Singh Topless, Waving in Jeans : Melancholia through Mimesis in Rang de Basanti ». Wide Screen, Vol 1, no 2, June.
Prasad, Madhava M. 1998. Ideology of the Hindi Film: A Historical Construction. New Delhi : Oxford India.
Raghavendra, M.K. 2006. « Globalism and Indian Nationalism », Economic and Political Weekly, Vol 41, no 16.
———————-. 2008. Seduced by the Familiar : Narration and Meaning in Indian Popular Cinema. New Delhi : Oxford University Press.
Sangari, Kumkum. 1999. « Consent, agency, and rhetorics of incitement », in The Politics of the Possible : Essays on Gender, History, Narratives, Colonial India. New Delhi, Tulika.
Skinner, Quentin. 1988. « Meaning and Understanding in the History of Ideas », in Quentin Skinner and his Critics. éd. James Tully. Cambridge, Polity Press.
Uberoi, Patricia. 1990. 2006. Freedom and Destiny : Gender, Family and Popular Culture in India. New Delhi, Oxford University Press.
Vasudevan, Ravi S. 1989. « The Melodramatic Mode and the Commercial Hindi Cinema : Notes on Film History, Narrative and Performance in the 1950s », Screen, 30.3 (été), p. 29-50.
______ 2000. « The Political Culture of Address in a “Transitional” Cinema : A Case Study of Indian Popular Cinema », In C. Gledhill and L. William (éds.), Rethinking Film Studies. Londres, Arnold.
[1] Rang De Basanti se traduit littéralement par « recouvre-moi de couleur safran », qui est un refrain chanté par les martyrs nationalistes sur le chemin de leur exécution. Le safran est la couleur du sacrifice.
[2] Tandis que les films considérés comme populaires sont tournés dans toutes les principales langues indiennes c’est le cinéma hindi en provenance de Bombay (ou Mumbai), qui peut se réclamer plus généralement d’un statut panindien. Non seulement en termes de circulation et d’audience, mais aussi dans sa fonction unificatrice de création d’un public national en transformant l’hétérogénéité réelle de la nation en une identité nationale unique et globale et en une « communauté de sentiment » (Appadurai 1996, 8). C’est, par dessus tout, ce cinéma qui s’est arrogé le rôle crucial de fabriquer la norme du sujet postcolonial national.
Comme cela a été soutenu par les théoriciens, le processus de construction de la nation dans les sociétés postcoloniales est déchiré par une profonde ambivalence, entre les poussées modernistes du développement et le besoin de conserver l’exception d’une identité collective enracinée dans le passé primordial. Et comme la nation continue à être « racontée », les angoisses profondes créées par le fossé entre désir et échec s’inscrivent d’elles-mêmes dans le domaine de la culture. La femme, et plus généralement la matrice des relations entre le genre et le sexe, devient le lieu par excellence où ces anxiétés se manifestent et trouvent leur solution et où s’effectue l’articulation symbolique des désirs collectifs.
[3] On a souvent fait remarquer que la famille est l’une des « constantes » du cinéma hindi (Prasad 1998, Raghavendra 2008, Gabriel 2010). Les conflits historiques de la nation sont déplacés vers les conflits familiaux ou allégorisés sous cette forme. Mais la famille du cinéma hindi a peu à voir avec la famille sociologique réelle. La famille cinématographique est la famille « traditionnelle-idéale » (Raghavendra 2008, p. 37) ou la famille « emblématique » (Raghavendra 2008, p. 37), jamais affectée par les changements structurels et sociologiques réels qui ont marqué les diverses formes familiales en Inde. À travers le déploiement de ce mode mélodramatique, la crise sociale et nationale est réinterprétée comme un trouble familial et maintenue dans des solutions personnalisées, internes, principalement sous la forme d’une réorganisation des relations genre-sexe. À l’intérieur du discours nationaliste, la famille est un terrain essentiel où sont inscrits, énoncés et défendus les codes de la nation, de l’honneur de la communauté, de la propriété, le caractère sacré de la famille et de la culture. Si la famille hétéro-patriarcale du cinéma hindi reconnaît la sexualité transgressive (particulièrement féminine), c’est finalement pour la domestiquer, promouvoir l’endogamie, rendre invisible ou rejeter l’homosexualité et les autres pratiques sexuelles alternatives ; elle se fonde sur le substrat de l’homosocialité dans laquelle une « fraternité masculine » (Gabriel 2010, p. 109) assure un échange consensuel et approprié des femmes entre les hommes.
Cela dit, on peut aussi noter la « disparition » soudaine ou au moins dans la dernière décennie de cette famille « filmi » (« filmi » est un indianisme intraduisible qui témoigne du côté « réservé aux initiés » de la culture cinématographique hindi). J’ai soutenu ailleurs qu’il fallait mettre cet affaiblissement du modèle familial en relation avec l’insertion de plus en plus importante de l’Inde dans la mondialisation et avec la consolidation du marché (voir Ghosh 2009).
[4] Tels que Roja, Bombay, Dil Se, Border et Gadar pour n’en citer que quelques-uns.
[5] Dil Chahta Hai en est peut-être le meilleur exemple.
[6] La série de films sur Bhagat Singh et Lagaan peuvent être cités en exemple.
[7] « [F]or poetry makes nothing happen » (« Car la poésie ne fait rien advenir ») – W. H. Auden, « In Memory of W. B. Yeats » (1940).
[8] Voir, par exemple, Jaan Dark,
[9] Bhagat Singh, Shivaram Rajguru, Chandrashekhar Azad et Sukhdev Thapar furent exécutés par l’État colonial britannique en 1928 en représailles du meurtre d’un officier de police britannique. Bhagat Singh, à qui fut ensuite conféré le titre de Shaheed (« martyr ») est vénéré et régulièrement invoqué comme l’exemple parfait du révolutionnaire courageux et engagé.
[10] Censée être la voix de McKinley, c’est de nos jours la voix reconnaissable de l’acteur Aamir Khan qui joue à la fois le DJ d’aujourd’hui et le Azad historique. On peut interpréter ce transfert vocal comme une stratégie d’absolution, si ce n’est de validation, du colonialisme. À la fin des fins, comme le dit Aggarwal, « Rang de Basanti remet au goût du jour l’histoire d’amour comme lieu d’une collaboration imaginaire partagée par les sujets Indiens et Britanniques… » (Aggarwal 2010).
[11] Si l’on se réfère au mythe, c’est bien évidemment pour conférer de l’héroïsme aux jeunes protagonistes du film, qui se battent contre l’injustice et s’engagent pour recouvrer ce qui leur appartient comme les Pandavas le font dans le mythe. Il faut se souvenir que la grande bataille du Mahabharata représente l’apogée du combat des frères Pandava pour reconquérir le royaume dont ils ont été traitreusement expropriés par leurs cousins, les Kaurava.
[12] Dans l’épopée, Draupadi, la fille du roi Drupada du Panchal, est la récompense que remporte l’un des frères Padava, Arjuna, dans un concours de tir à l’arc. Après qu’ils sont retournés chez eux, leur mère Kunti demande aux frères de se partager la fiancée comme ils le font en toute chose, ce qui est la preuve de leur loyauté et de leur amour filial. Draupadi devient, dès lors, la femme des cinq frères.
[13] Il est important de noter que, dans l’univers du film hindi, il est difficile d’imaginer une quelconque approbation d’une histoire d’amour entre une femme indienne et un homme blanc.
[14] L’avion de combat est le signe avant-coureur de la réalité de la mort dans la mesure où, quelques séquences plus tard, Ajay s’écrase lors d’une sortie.
[15] Il est intéressant de noter que le chagrin qu’éprouvent les amis d’Ajay semble imprégné de culpabilité, presque comme s’ils s’en sentaient responsables.
[16] Sangari isole quatre traits centraux de l’exhortation féminine entendue comme unité discursive. Premièrement, elle peut démontrer l’entrée ou l’entrée partielle de la femme dans le domaine public masculin, dans la mesure où elle exhorte les hommes ou les appelle à rendre des comptes (d’une injustice réelle ou perçue comme telle). Deuxièmement, la femme partage les valeurs qu’elle incite les hommes à défendre et est impliquée dans la relation sociale qu’il s’agit de préserver, comme on le voit explicitement dans la figure de la femme Hindutva qui appelle l’homme hindou à agir contre « les autres » hommes non hindous en mettant en cause leur virilité. Troisièmement, l’exhortation féminine est une forme d’action de substitution parce que les femmes ne peuvent pas agir de façon indépendante, mais doivent agir à travers les hommes. Enfin, si exhorter c’est avoir la capacité d’inspirer, les femmes ne doivent pas nommer directement leur intérêt personnel ou matériel, mais le dissimuler sous une abstraction – comme la famille, l’honneur, la religion ou la nation. Elles ne peuvent pas, par exemple, exhorter à agir au nom de privilège de classe ou pour la réparation de torts qu’elles auraient personnellement subis. Et, la différence entre « nommer et ne pas nommer » est ce qui distingue la femme maléfique de la femme héroïque qui exhorte.