Langage et technique chez Lyotard
Langage et technique chez Lyotard
Jean-Baptiste Vuillerod. Ancien élève de l’ENS Lyon, agrégé de philosophie, rédige actuellement une thèse sur « L’anti-hégélianisme de la philosophie française des années 1960 » sous la direction d’Emmanuel Renault à l’Université Paris Nanterre (laboratoire Sophiapol).
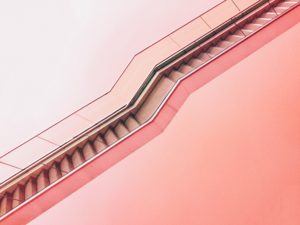 L’argument central du chapitre 4 d’États de choc tient en deux propositions. Premièrement, Lyotard aurait opposé de manière trop abrupte la technique et le langage en jouant le différend langagier contre la performativité technique, qui domine à l’ère postmoderne[1]. Deuxièmement, cette opposition l’aurait amené à une mollesse politique, qui privilégie la résistance plutôt que l’invention et qui bloque la pensée dans une entreprise négative ayant abandonné tout projet émancipateur, plutôt que de la porter vers la formulation de propositions positives à même de favoriser l’émancipation individuelle et collective[2]. Ainsi, contre Lyotard qui a fait son deuil des grands récits émancipateurs, portés notamment par les dialectiques hégélienne et marxiste, Stiegler entend renouer avec Hegel et Marx tout en les complétant par une pensée adéquate de la technique[3].
L’argument central du chapitre 4 d’États de choc tient en deux propositions. Premièrement, Lyotard aurait opposé de manière trop abrupte la technique et le langage en jouant le différend langagier contre la performativité technique, qui domine à l’ère postmoderne[1]. Deuxièmement, cette opposition l’aurait amené à une mollesse politique, qui privilégie la résistance plutôt que l’invention et qui bloque la pensée dans une entreprise négative ayant abandonné tout projet émancipateur, plutôt que de la porter vers la formulation de propositions positives à même de favoriser l’émancipation individuelle et collective[2]. Ainsi, contre Lyotard qui a fait son deuil des grands récits émancipateurs, portés notamment par les dialectiques hégélienne et marxiste, Stiegler entend renouer avec Hegel et Marx tout en les complétant par une pensée adéquate de la technique[3].
Nous nous proposons de revenir aux textes de Lyotard pour mieux saisir la pertinence du projet de Stiegler, tout en soulignant les torsions qu’il fait subir à la pensée lyotardienne. Pour cela, nous commencerons par rappeler les grandes thèses de La condition postmoderne de Lyotard, puis nous les confronterons à ce qu’en dit Stiegler.
Qu’est-ce que la condition postmoderne ?
Le postmodernisme, pour Lyotard, marque l’abandon des grands récits et transforme le mode de légitimation des savoirs. Il importe de le comprendre à l’aune de la modernité avec laquelle il rompt[4].
La modernité marquait l’âge du réinvestissement des grands récits dans l’entreprise de légitimation des savoirs. Cette légitimation a pris deux formes principales : l’une qui est de nature pratique, et l’autre qui est de nature théorique[5]. La première consiste à faire de l’humanité un sujet de la liberté qui, au sein de la nation, prend la forme d’un peuple sur la route du progrès[6]. C’est ce récit de la liberté qui légitime les savoirs transmis à l’université sous la IIIe République en France, par exemple, ou dans l’université prussienne, et que la philosophie pour sa part a également investi (chez Fichte, par exemple). La science est ici un moyen au service du développement d’une fin pratique qui est la liberté du peuple. Mais un second mode de légitimation s’est développé parallèlement qui est celui d’une légitimation de la science par elle-même. Cette légitimation fait du progrès scientifique une fin en soi, mais a besoin d’élaborer une science des sciences, c’est-à-dire une science spéculative qui cherche à légitimer les différents savoirs positifs[7]. La philosophie de Hegel, qui totalise les savoirs dans un système encyclopédique, est la représentante de ce second modèle.
Il y a bien sûr des grands récits qui ont oscillé entre ces deux modes de légitimation. Le marxisme en est le meilleur exemple puisqu’il a légitimé sa critique de l’économie politique à la fois par le développement du prolétariat et par un matérialisme dialectique hérité de Hegel, qui consiste en une science de la processualité immanente de l’histoire[8]. Mais un tel modèle ne remet pas en cause la bipartition introduite par Lyotard, il n’en est qu’une articulation originale.
Ce qu’il importe de comprendre, c’est que, dans les deux cas, qu’il s’agisse du récit spéculatif ou du récit de l’émancipation, nous avons affaire à des « grands » récits, que Lyotard nomme aussi des « méta-récits ». Par là, il faut entendre un procédé de légitimation des sciences qui leur est extérieur. Dans un cas, il s’agit de légitimer la science par la pratique, dans l’autre, par la philosophie. La modernité désigne donc un mode de légitimation hétéronome des sciences. Cette idée est importante pour comprendre précisément la thèse de Lyotard. Ce dernier ne prétend nullement que les récits soient à bannir de la légitimation des sciences. D’une part, il affirme que ces récits sont sans doute nécessaire et qu’il serait illusoire de prétendre s’en passer complètement[9]. Il faut bien raconter les découvertes scientifiques et construire des histoires pour comprendre ce qui arrive, pour donner du sens à la trame des faits, car le savoir positif ne se suffit jamais à lui-même. D’autre part, Lyotard limite sa critique des récits à la forme qu’ils ont pris historiquement. C’est un jugement en fait, et non en droit, de sorte qu’on peut imaginer des récits plus pertinents, des récits qui ne soient plus des grands récits ou des méta-récits[10].
Si la postmodernité rompt avec ces grands récits, c’est parce qu’elle se caractérise par une « dissémination des jeux de langage[11] ». Cela signifie que chaque ordre discursif répond à ses propres règles et ne peut plus empiéter sur les autres. La conséquence en est, premièrement, que le langage prescriptif de la pratique ne peut plus venir légitimer les savoirs qui appartiennent à un langage dénotatif et que, de ce fait, le récit de l’émancipation n’est plus pertinent ; deuxièmement, qu’il n’y a plus de langage universel à même de totaliser l’ensemble des savoirs, ce qui discrédite le projet hégélien[12]. Il ne reste plus qu’une pluralité de savoirs positifs, jouant chacun son propre jeu. Les mathématiques ont leurs règles, la physique aussi, la biologie également, et l’écart se creuse plus encore entre les sciences de la nature et les sciences humaines (histoire, sociologie, économie, psychologie, philosophie, etc.), qui répondent à leurs propres règles, et cela de façon tout autant éclatée en leur sein. Le différend, chez Lyotard, désigne cet éclatement en pointant l’impossibilité d’un langage commun. Il signifie l’impossible traduction d’un langage dans un autre et constitue ce qu’on appelle la postmodernité.
Ce constat d’un passage de la modernité à la postmodernité appelle deux questions. D’abord, quelle est la cause de cette évolution ? Ensuite, quel est le nouveau principe de légitimation des savoirs dans le postmodernisme ?
S’interrogeant sur ce qui a causé le passage de la modernité à la postmodernité, Lyotard mentionne des causes externes, comme l’essor des techniques, qui aurait déplacé le questionnement sur les moyens de l’action plutôt que sur ses finalités, ou bien le libéralisme keynésien, qui aurait fait triompher le capitalisme contre le récit communiste ; mais c’est bien plus sur la cause interne du processus qu’il insiste. Selon lui, c’est l’équivocité inhérente aux grands récits qui les a fragilisés. Ceux-ci seraient grevés dès le départ par une contradiction insoluble qui aurait causé leur perte. En ce qui concerne le récit spéculatif, cette contradiction vient du fait que la philosophie cherche à légitimer des savoirs dont elle doute. Ainsi, chez Hegel, la philosophie doit répondre à l’insuffisance du savoir positif[13]. Cela a pour conséquence de venir fragiliser ce que pourtant la philosophie est censé justifier. Pour le récit de l’émancipation, la contradiction se tient dans l’écart qui existe entre la vérité scientifique et la justice politique, les deux jeux de langage ne répondant pas aux mêmes règles et n’étant par conséquent pas compatibles[14]. Quel que soit le grand récit auquel on se réfère, il y a donc une « érosion interne du principe de légitimité du savoir[15] » tel qu’il s’est déployé dans la modernité. Autrement dit, c’est la modernité elle-même, avec ses tensions constitutives, qui a rendu nécessaire la postmodernité.
Si l’on s’interroge maintenant sur le principe de légitimation qui est venu remplacer les grands récits, il faut prendre en compte toute la complexité de la réponse lyotardienne. En effet, Lyotard ne donne pas une, mais deux réponses à cette question. D’un côté, il affirme que la performativité technique est devenue le principal mode de légitimation des savoirs. L’administration de la preuve a lié la science expérimentale à la technique, mais cette dernière a en même temps été récupérée par le capitalisme. Le désir d’enrichissement du capitalisme a favorisé le développement des techniques pour constituer une société tout entière fonctionnelle et efficiente. Au sein d’une telle société, le seul critère du savoir devient son efficacité[16]. Il persiste bel et bien, dans les sciences, un critère dénotatif de vérification de la preuve, mais celle-ci est subordonnée à un critère de performativité qui a pour but d’accroître la puissance[17]. Les savoirs n’étant plus légitimés par les grands récits, ils se voient légitimés par leur efficacité dans la recherche du pouvoir et de la richesse, c’est-à-dire par leur capacité à répondre à l’exigence de performativité technique au sein d’une société fonctionnelle. Cette légitimation par la performativité ne concerne d’ailleurs pas seulement la production des savoirs, mais aussi leur transmission. L’enseignement a en effet de moins en moins pour but de transmettre des savoirs désintéressés. Sa tâche est bien plutôt de « former des compétences, et non des idéaux[18]. » La professionnalisation de l’enseignement supérieur doit ainsi être resituée dans le cadre d’un nouveau mode performatif de légitimation des savoirs au sein du capitalisme.
Mais là n’est pas le dernier mot de Lyotard qui pense aussi un mode concurrent de légitimation. À ses yeux, le critère de performativité technique n’est pas entièrement dominant et la société n’est pas totalement fonctionnelle. C’est pourquoi il critique la théorie des systèmes de Luhmann qui privilégie le critère d’efficience fonctionnelle sur tout autre. Pour Lyotard, ce n’est pas seulement ainsi que fonctionne le savoir. Non seulement les scientifiques ont d’autres critères de légitimation[19], mais le primat de la performativité technique en science ferait de cette dernière un pur pouvoir qui réprime tout ce qui, en elle, n’est pas jugé assez productif pour le champ scientifique[20]. Habermas a ainsi raison de valoriser le langage par rapport à la technique pour penser la société. Mais il a tort, selon Lyotard, de valoriser au sein du langage le consensus plutôt que le différend. En cela, Habermas reste prisonnier des grands récits de l’émancipation, il reste un moderne[21]. C’est que « le consensus est un horizon, il n’est jamais acquis[22] ». Jamais la société n’atteindra une harmonie consensuelle qui serait synonyme d’une émancipation acquise. C’est le dissensus, ou le différend, qui caractérise tant le social que la science.
Habermas et Luhmann sont par conséquent renvoyés dos-à-dos au profit d’un nouveau mode de légitimation des savoirs qui reposerait sur le différend lui-même :
Où peut résider la légitimité après les métarécits ? Le critère d’opérativité est technologique, il n’est pas pertinent pour juger du vrai et du juste. Le consensus obtenu par discussion, comme le pense Habermas ? Il violente l’hétérogénéité des jeux de langage. Et l’invention se fait toujours dans le dissentiment. Le savoir postmoderne n’est pas seulement l’instrument des pouvoirs. Il raffine notre sensibilité aux différences et renforce lui-même notre capacité de supporter l’incommensurable. Lui-même ne trouve pas sa raison dans l’homologie des experts, mais dans la paralogie des inventeurs.[23]
Une fois que l’on a dit que le critère de performativité technique ne suffisait pas pour comprendre l’activité du scientifique qui recherche le vrai, et que la solution langagière de Habermas, en tant qu’elle rejette le dissensus pourtant inéluctable, est insuffisante, alors il faut opter pour la solution à la fois langagière et dissensuelle. Il s’agit de l’invention de nouveaux coups au sein des jeux de langage. Bien sûr, il faut que la collectivité scientifique accepte les nouvelles règles inventées, mais le critère de leur légitimation est précisément leur capacité à créer de nouveaux énoncés : « La seule légitimation qui rend recevable en fin de compte une telle demande est : cela donnera naissance à des idées, c’est-à-dire à de nouveaux énoncés[24]. » Il s’agit bien pour la science de produire des énoncés dénotatifs[25], mais ces énoncés ont besoin de règles, c’est-à-dire d’énoncés prescriptifs dont le critère est la capacité à inventer de nouveaux coups scientifiques. La science cherche donc bien à connaître des objets, mais cette connaissance n’est pas soumise à des impératifs techniques d’efficience, elle dépend bien plutôt d’une capacité d’inventivité. Elle est ainsi « un modèle de « système ouvert » dans lequel la pertinence de l’énoncé est qu’il « donne naissance à des idées », c’est-à-dire à d’autres énoncés et à d’autres règles de jeux[26]. » De ce point de vue, elle a pour fonction de lutter contre la tendance systémique de la société[27].
La fin des grands récits dans la postmodernité trouve ainsi une solution non-technologique à l’éclatement des jeux de langage qui la caractérise. Contre la tendance à la performativité technique, Lyotard promeut la capacité pour le langage d’inventer de nouveaux coups et de venir perforer toute fermeture du système. Le postmodernisme apparaît porteur à la fois d’espoirs et de menaces. Les espoirs sont à situer, selon Lyotard, dans le différend des jeux de langage, alors que les menaces sont constituées par l’importance croissante du critère technique d’efficience dans nos sociétés capitalistes. La lutte entre ces deux tendances est l’enjeu de la « condition postmoderne ».
Les objections de Stiegler
Nous pouvons maintenant revenir à la critique que fait Stiegler de La condition postmoderne dans États de choc. Rappelons que, pour Stiegler, Lyotard opposerait de manière rigide la technique et le langage, d’une part, et valoriserait la résistance au détriment de toute capacité inventive, d’autre part. Cela l’aurait amené à rompre avec la perspective de l’émancipation qu’une pensée adéquate de la technique, comme pharmacologie positive, serait à même de mener à bien. Cette dernière, selon Bernard Stiegler, consiste en une analyse des différentes médiations technologiques indispensables au développement de la pensée. Cette analyse doit mettre en évidence les dangers inévitables que recèle le rôle fondamental des technologies dans la formation de la pensée, mais elle cherche également à promouvoir la possibilité de leur usage positif et inventif pour l’individu et la société dans son ensemble – de là l’idée d’une « pharmacologie positive ». C’est depuis ce point de départ qu’États de choc introduit le dialogue critique avec la pensée lyotardienne. Notre bref parcours de La condition postmoderne nous permet cependant de nuancer les deux reproches que Stiegler adresse à l’encontre de Lyotard, mais de lui donner raison en ce qui concerne la perspective émancipatrice de sa critique.
Dans quelle mesure est-il possible de dire que Lyotard oppose radicalement la technique et le langage ? Certes, comme nous l’avons vu, il est vrai que Lyotard prend le parti de Habermas contre la société fonctionnelle de Luhmann. Il pense qu’il faut faire valoir la créativité du langage contre l’impératif d’efficience et de performativité du paradigme technologique. Mais il ne faut pas pour autant oublier que toute l’analyse de Lyotard repose sur le cadre conceptuel des jeux de langage, hérité de Wittgenstein. Si bien qu’il faut admettre un « langage sans dehors[28] » et qu’il faut réinscrire la technique comme un langage parmi d’autres. En ce sens, la technique est un jeu de langage comme un autre : « Ce sont donc des jeux dont la pertinence n’est ni le vrai, ni le juste, ni le beau, etc., mais l’efficient : un « coup » technique est « bon » quand il fait mieux et/ou quand il dépense moins qu’un autre[29]. » On peut interroger la pertinence d’un tel geste qui fait de la technique (mais aussi de l’affect et du silence[30]) un langage ; cependant, à proprement parler, si l’on respecte la perspective théorique de La condition postmoderne, la technique n’est pas étrangère à la langue chez Lyotard.
Stiegler va donc trop loin lorsqu’il considère que Lyotard opposerait foncièrement langage et technique. Ce n’est pas là qu’est la divergence entre les eux auteurs. Il serait plus exact de dire que Lyotard a tendance à rabattre la technique sur le langage, pendant que Stiegler, au contraire, aurait tendance à rabattre le langage sur la technique[31]. Cette divergence vient du fait que Lyotard se fait finalement une conception tout à fait traditionnelle de la technique, comme simple moyen efficace en vue d’une fin. Cela est clair dans le texte « Logos et tekhnè » auquel se réfère Stiegler, lorsque Lyotard distingue trois formes de mémoires et qu’il différencie notamment la remémoration comme mémoire active, réductible à une activité technique[32], de la mémoire anamnésique qui, elle, est une capacité d’invention irréductible à toute technique et que seule l’idée d’une écriture sans traces, et donc sans technique, pourrait approcher[33]. Or, c’est précisément cette pensée traditionnelle de la technique que Stiegler remet en cause, en montrant que la pensée ne pouvait pas se passer de la médiation technologique et qu’il fallait parvenir à thématiser une capacité d’invention à l’intérieur même des milieux techniques dans lesquels évolue inévitablement l’esprit humain[34].
Il semble de même exagéré de considérer que Lyotard se serait contenté de promouvoir la résistance contre toute inventivité. Nous avons vu que la nouvelle légitimité des savoirs, telle que la présente La condition postmoderne, vient d’une capacité d’invention du langage. Certes, Lyotard valorise la résistance[35], mais cette résistance est inventive. Stiegler est donc trop sévère sur ce point. Mais il a raison d’interroger la possibilité pour l’invention lyotardienne d’œuvrer en faveur de l’émancipation. C’est en ce sens que sa critique de la résistance lyotardienne est pertinente.
Il est vrai que, dans une certaine mesure, Lyotard a abandonné l’idée d’émancipation[36]. La possibilité même de changer le monde et l’ensemble de ses structures sociales lui semble relever d’un mythe en lequel plus personne ne croit. C’est pourquoi la résistance inventive qu’il valorise est purement « locale[37] ». La dissémination des jeux de langage fait qu’aucune transformation globale du mode de fonctionnement fondamental de nos sociétés n’est envisageable à l’époque postmoderne. Or c’est précisément ce que refuse Stiegler pour qui une pensée adéquate de la technique doit nous permettre de repenser l’ossature même de nos sociétés[38]. C’est là l’enjeu de toute la discussion qu’engage Stiegler avec La condition postmoderne : retrouver la foi dans les perspectives émancipatrices que le postmodernisme, tel que l’a théorisé Lyotard, a abandonnées ; rompre avec cette « mollesse politique typique de la fin du XXe siècle[39] ». C’est pourquoi Stiegler, au chapitre 5 d’États de choc, se propose de relire les grands récits de Hegel et de Marx à l’aune de sa propre conception de la technique. Par là, il renoue à la fois avec un projet politique trop vite jugé dépassé, mais aussi avec les philosophies qui l’ont porté et que le postmodernisme, avec sa critique virulente de Marx et plus encore de Hegel, a trop légèrement abandonnées.
Le débat entre Stiegler et Lyotard porte donc moins sur les points théoriques soulevés par États de choc que sur les perspectives politiques promues par les deux philosophes. L’insistance proprement stieglérienne sur la technique vise à trouver un point à partir duquel une critique globale et générale de l’organisation sociale et de nos modes d’existence soit possible. Ce n’est pas tant que Lyotard en soit resté à une opposition simpliste entre technique et langage, ni même qu’il ait été incapable de thématiser l’inventivité, qui est en jeu ; c’est bien plutôt la portée de cette inventivité qui est en cause et qui, pour Stiegler, ne doit pas se limiter à un coup local, mais doit renverser l’ensemble de l’échiquier sur lequel nous jouons. L’indéniable mérite de la philosophie de Bernard Stiegler est au moins de nous confronter à cette question.
[1] B. Stiegler, États de choc, Paris, Mille et une nuits, 2012, p. 149 : « Je crois que, dans sa réponse à Max Gallo, Lyotard va trop vite quant aux questions qui concernent la technique et la technologie, en particulier lorsqu’il tend à opposer technique et langage pour justifier le retrait dans lequel, face à la demande des représentants politiques, les « témoins du différend » devraient se tenir comme il le fait lui-même. »
[2] Ibid., p. 171 : « (…) cette fin de non-recevoir paraît poser en principe qu’il est impossible d’inventer, l’opération d’invention étant laissée aux technocrates au nom du différend, et les « témoins » se retranchant dans la « résistance ». » (Sauf indication contraire, c’est l’auteur qui souligne.)
[3] Ibid., p. 173.
[4] Sur la conception du postmodernisme chez Lyotard, on pourra consulter C. Pagès, Lyotard et l’aliénation, Paris, PUF, 2011, chap. 4 ; A. Gualandi, Lyotard, Paris, Perrin, 2009, chap. 3.
[5] J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p. 53 : « Le mode de légitimation dont nous parlons, qui réintroduit le récit comme validité du savoir, peut ainsi prendre deux directions, selon qu’il représente le sujet du récit comme cognitif ou comme pratique : comme un héros de la connaissance ou comme un héros de la liberté. »
[6] Ibid., p. 55 : « On retrouve le recours au récit des libertés chaque fois que l’État prend directement en charge la formation du « peuple » sous le nom de nation et sa mise en route sur la voie du progrès. »
[7] Ibid., p. 58-59 : « Dans cette perspective, le savoir trouve d’abord sa légitimité en lui-même, et c’est lui qui peut dire ce qu’est l’État et ce qu’est la société. Mais il ne peut remplir ce rôle qu’en changeant de palier, pour ainsi dire, en cessant d’être la connaissance positive de son référent (la nature, la société, l’État, etc.), et en devenant aussi le savoir de ces savoirs, c’est-à-dire spéculatif. Sous le nom de Vie, d’Esprit, c’est lui-même qu’il nomme. »
[8] Ibid., p. 61-62 : « Il serait aisé de montrer que le marxisme a oscillé entre les deux modes de légitimation narrative que nous venons de décrire. »
[9] Ibid., p. 49 : « Il n’est donc pas exclu que le recours au narratif soit inévitable ; pour autant du moins que le jeu de langage de la science veuille la vérité de ses énoncés et qu’il ne puisse pas la légitimer par ses propres moyens. Dans ce cas, il faudrait reconnaître un besoin d’histoire irréductible, celui-ci étant à comprendre, ainsi que nous l’avons ébauché, non pas comme un besoin de se souvenir et de projeter (besoin d’historicité, besoin d’accent), mais au contraire comme un besoin d’oubli (besoin de metrum). » Lyotard reconnaît que sa propre entreprise reste elle-même un récit : « Nous-mêmes n’avons-nous pas besoin, en cet instant, de monter un récit du savoir scientifique occidental pour en préciser le statut ? »
[10] Ibid., p. 50 : « Mais on gardera présente à l’esprit, au cours des considérations suivantes, l’idée que les solutions apparemment désuètes qui ont pu être données au problème de la légitimation ne le sont pas en principe, mais seulement dans les expressions qu’elles ont prises, et qu’il n’y a pas à s’étonner de les voir persister aujourd’hui sous d’autres formes. »
[11] Ibid., p. 66.
[12] Ibid., p. 67-68 : « On peut retirer de cet éclatement une impression pessimiste : nul ne parle toutes ces langues, elles n’ont pas de métalangue universelle, le projet du système-sujet est un échec, celui de l’émancipation n’a rien à faire avec la science, on est plongé dans le positivisme de telle ou telle connaissance particulière, les savants sont devenus des scientifiques, les tâches de recherche démultipliées sont devenues des tâches parcellaires que nul ne domine ; et de son côté la philosophie spéculative ou humaniste n’a plus qu’à résilier ses fonctions de légitimation, ce qui explique la crise qu’elle subit là où elle prétend encore les assumer, ou sa réduction à l’étude des logiques ou des histoires des idées là où elle y a renoncé par réalisme. »
[13] Ibid., p. 64 : « De cette façon, le récit spéculatif contient en lui-même, et de l’aveu de Hegel, un scepticisme à l’endroit de la connaissance positive. »
[14] Ibid., p. 66 : « Or cette légitimation fait d’emblée problème, nous l’avons vu : entre un énoncé dénotatif à valeur cognitive et un énoncé prescriptif à valeur pratique, la différence est de pertinence, donc de compétence. Rien ne prouve que, si un énoncé qui décrit ce qu’est une réalité est vrai, l’énoncé prescriptif, qui aura nécessairement pour effet de la modifier, soit juste. »
[15] Ibid., p. 65.
[16] Ibid., p. 74 : « C’est plus le désir d’enrichissement que celui de savoir qui impose d’abord aux techniques l’impératif d’amélioration des performances et de réalisation des produits. La conjugaison « organique » de la technique avec le profit précède la jonction avec la science. Les techniques ne prennent de l’importance dans le savoir contemporain que par la médiation de l’esprit de performativité généralisée. »
[17] Ibid., p. 75-76 : « L’administration de la preuve, qui n’est en principe qu’une partie de l’argumentation elle-même destinée à obtenir l’assentiment des destinataires du message scientifique, passe ainsi sous le contrôle d’un autre jeu de langage, où l’enjeu n’est pas la vérité, mais la performativité, c’est-à-dire le meilleur rapport input/output. » Et p. 77 : « Ainsi prend forme la légitimation par la puissance. Celle-ci n’est pas seulement la bonne performativité, mais aussi la bonne vérification. Elle légitime la science et le droit par leur efficience, et celle-ci par ceux-là. »
[18] Ibid., p. 79.
[19] Ibid., p. 102 : « Si l’on se tourne vers la pragmatique scientifique, elle nous apprend précisément que cette identification est impossible : en principe, aucun scientifique n’incarne le savoir et ne néglige les « besoins » d’une recherche ou les aspirations d’un chercheur sous prétexte qu’ils ne sont pas performatifs pour « la science » comme totalité. »
[20] Ibid., p. 103 : « Mais, quand l’institution savante fonctionne de cette manière, elle se conduit comme un pouvoir ordinaire, dont le comportement est réglé en homéostase. »
[21] Ibid., p. 98 : « D’autre part, le principe du consensus comme critère de validité paraît lui aussi insuffisant. Ou bien il est l’accord des hommes en tant qu’intelligences connaissantes et volontés libres obtenu par le moyen du dialogue. C’est sous cette forme qu’on le trouve élaboré par Habermas. Mais cette condition repose sur la validité du récit de l’émancipation. »
[22] Ibid., p. 99.
[23] Ibid., p. 8-9.
[24] Ibid., p. 105.
[25] Ibid., p. 104.
[26] Ibid.
[27] Ibid., p. 103 : « Pour autant qu’elle est différenciante, la science dans sa pragmatique offre l’antimodèle du système stable. »
[28] A. Gualandi, Lyotard, op. cit., chap. III.
[29] J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, op. cit., p. 73.
[30] Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, Paris, Minuit, 1983.
[31] B. Stiegler, États de choc, op. cit., p. 156 : « Car le problème est que l’ »interaction communicationnelle » a été réduite en bouillie pour des raisons que Lyotard ignore superbement ici (mais ce n’est pas le cas de Habermas, même s’il aura toujours gravement négligé la technicité dans la langue), et par ce que j’ai appelé, en un tout autre sens que Lyotard, la dissociation, c’est-à-dire par la destruction des milieux associés qui constituent les champs symboliques en général – qui ne sont évidemment pas réductibles au langage et à la communication, et qui sont toujours techno-logiquement surdéterminés. »
[32] J.-F. Lyotard, « Logos et tekhnè, ou la télégraphie », in L’inhumain. Causeries sur le temps, Paris, Galilée, 1988, p. 63 : « Le teknologos est donc remémoration, et pas seulement habitude. Sa capacité sui-référentielle, réflexion au sens habituel, critique si vous voulez, s’exerce en se remémorant ses propres présupposés et ses sous-entendus en tant que ses limitations. »
[33] Ibid., p. 67 : « Je ne vois que l’écriture, elle-même anamnèse de ce qui n’a pas été inscrit, pour supporter la comparaison avec cette règle a-technique, ou a-technologique. Car elle offre à l’inscription le blanc du papier, blanc comme la neutralité de l’oreille analytique. »
[34] On retrouve dans ce débat portant sur une capacité d’invention sans traces techniques – position que défend Lyotard –, le même débat que celui qui existe entre la plasticité de Catherine Malabou et la pensée de la trace de Stiegler. Il y a en effet chez Catherine Malabou l’idée d’une productivité première du vivant, une archi-écriture qui précède toute inscription technique, alors que, chez Bernard Stiegler, c’est l’inscription technique qui est première et qui transforme en ce sens l’archi-écriture en une archi-lecture, qui pose que l’on a toujours déjà affaire à un donné. Cette tension s’origine bien sûr dans deux lectures de la philosophie de Jacques Derrida.
[35] Ibid. : « Cette écriture come passage ou anamnèse, nous l’envisageons, chez les écrivains, les artistes (c’est la perlaboration de Cézanne, évidemment), comme une résistance (dans un sens non psychanalytique, je pense, plutôt dans le sens du Wilson de 1984 d’Orwell) aux synthèses de frayage et de balayage. » La référence à 1984, ici, est hautement signifiante, puisque la résistance de Wilson, dans le livre, aboutit à l’échec et au désenchantement.
[36] Cf. C. Pagès, Lyotard et l’aliénation, op. cit., chap. 4.
[37] J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, op. cit., p. 99 : « Il faut supposer une puissance qui déstabilise les capacités d’expliquer et qui se manifeste par l’édiction de nouvelles normes d’intelligence ou, si l’on préfère, par la proposition de nouvelles règles du jeu de langage scientifique qui circonscrivent un nouveau champ de recherche. C’est, dans le comportement scientifique, le même processus que Thom appelle morphogenèse. Il n’est pas lui-même sans règles (il y a des classes de catastrophes) mais sa détermination est toujours locale. » (nous soulignons).
[38] B. Stiegler, États de choc, op. cit., p. 155.
[39] Ibid., p. 167.














