L’affaire Séralini (2/2)
L’affaire Séralini et la confiance dans l’ordre normatif dominant de la science
Florence Piron, Université Laval et Thibaut Varin, Université Laval
cet article est sous licence CC BY SA
Vous pouvez télécharger pour le lire en intégralité en pdf
Cet article a été publié dans le dossier 2014 – la confiance.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des contributions du dossier
Un cadre normatif pour décrire les conditions de production de la « bonne » science
Le panorama historique du métier de chercheur scientifique présenté par Jean-Jacques Salomon[1] montre bien que le statut de l’institution scientifique, malgré tous ses avatars au fil du temps, a toujours reposé sur une condition structurelle qui, pour les constructivistes, est d’ordre social, culturel et politique, et, pour les positivistes/rationalistes, est d’ordre épistémique ou cognitif : la séparation radicale et abyssale[2] entre ceux qui « savent » – et qui apprennent très vite à se reconnaître entre eux et à se traiter comme des « pairs » -, et ceux qui ne savent pas, les « impairs », les « profanes », les « gens ordinaires ». Ceux qui savent ont réussi à sortir de l’état primitif d’ignorance, symbolisé dans la culture occidentale par la « caverne de Platon », à force de raisonnement, de travail intellectuel, de maniement de la méthode scientifique, de longues heures d’étude, etc. Cette sortie de la caverne leur permet de connaître le monde tel qu’il est, dans sa vérité, alors que les ignorants, les impairs, englués dans leurs préjugés spontanés, leurs perceptions, leurs émotions, leurs représentations sociales, leur irrationalité, leur « sens commun », etc. y restent enfermés. Ces derniers ont donc besoin que les premiers leur expliquent comment est le monde et justifient donc l’existence de l’institution scientifique, conservatrice et productrice des savoirs scientifiques.
Sans cette séparation entre ceux qui savent (quelque chose d’unique et de précieux, de difficilement accessible) et ceux qui ne savent pas, tous les savoirs seraient également partagés et la science n’aurait pas de raison d’être. Sans cette séparation, il ne serait pas non plus nécessaire de construire une relation de confiance entre ceux qui ne savent pas et ceux qui savent ou, plus précisément, d’établir les bases de la confiance de ceux qui ne savent pas envers ceux qui savent et qui ont ainsi la responsabilité de leur décrire le monde tel qu’il est dans sa vérité, sans les tromper. La vérité est indissociable de la confiance.
Cette séparation radicale attribue en effet à ceux qui obtiennent le statut de savants/chercheurs un privilège épistémologique, c’est à dire un accès privilégié à la vérité (cognitif ou social, selon les postures) par rapport aux autres. De manière intéressante, Matthieu Calame[3] voit dans cette situation un parallèle avec le cléricalisme chrétien qui a imaginé un clergé plus près de la vérité divine que le « commun des mortels » et doté de ce que Michel Foucault appelle le pouvoir de véridiction, de dire le vrai.
La contrepartie de ce privilège épistémologique est l’exigence, imposée à ceux qui y prétendent, de rester en dehors de la caverne, c’est-à-dire en dehors du monde séculier, de la société, là où les personnes en proie à des passions et intérêts multiples ne peuvent qu’être aveuglées sur elles-mêmes et ce qui les entoure[4]. Selon ce cadre normatif, la connaissance est incompatible avec une présence dans un monde traversé par des passions et des intérêts. Prétendre à la connaissance tout en manifestant des intérêts ou des passions serait le signe d’un échec de la sortie de la caverne, alors que le désintéressement et la « froideur » seraient la preuve de la réussite.
Cette distanciation, que certains appellent l’objectivité ou la neutralité, est une condition nécessaire à l’instauration de ce que Origgi[5] appelle la « confiance épistémique », c’est à dire la confiance dans la forme d’autorité à la fois morale et cognitive qui est associée au privilège épistémologique du savant. Origgi[6] rappelle à ce propos le mythe inauguré par Robert Boyle, un savant humaniste « désintéressé, cultivant ses recherches pour le pur plaisir de la connaissance et sans poursuivre d’ambition personnelle » (p.46), qui perdure toujours, par exemple dans le personnage de Marie Curie, incarnation éternelle de l’amour désintéressé de la connaissance, le seul amour (abstrait) acceptable. Ce mythe, au cœur du cadre normatif dominant de la science, apparaît aussi dans la dimension du désintéressement propre à l’éthos de la science selon Merton[7] et dans le concept de communauté scientifique : une communauté de pairs se situant hors du monde et mettant en commun des efforts désintéressés pour connaître et comprendre le monde d’une manière définie collectivement et qui doit être respectée par « la République de la science »[8].
Ce que ce mythe nous dit aussi en creux, c’est que la connaissance est inévitablement corrompue par la politique et la société où naissent, vivent et meurent les passions et les intérêts. La distanciation des savants par rapport à la société devient alors une condition de l’incorruptibilité nécessaire à l’accès à la vérité et donc de la confiance dans la science. Cette confiance, finalement, repose sur l’incorruptibilité des chercheurs à l’endroit des passions mondaines ou du moins sur son apparence qui peut s’obtenir de différentes manières. Pensons par exemple à la norme paradoxale de l’écriture scientifique : elle conduit l’auteur à se dépersonnaliser, à faire disparaître sa voix de son texte scientifique, pour faire comme si ce texte provenait directement d’un lieu hors du monde (celui de la connaissance). Mais elle mentionne très clairement, dans le lieu de publication, le nom de l’individu qui est à l’origine du texte et dont la valeur se mesure de plus en plus par le nombre de publications… On peut voir un bel exemple de la voix dépersonnalisée de cette science « incorruptible » dans cette déclaration de Fotis Kafatos[9], Président du Conseil scientifique du Conseil européen de la Recherche en 2007 : « La science n’accepte pas les convictions qui ne reposent pas sur des démonstrations. Elle refuse les préférences personnelles ou les révélations. Elle soumet toutes les propositions au critère impitoyable de l’expérimentation, de la concordance avec les connaissances déjà acquises et de la logique », déclare-t-il. Cette formulation laisse entendre que la science existe par elle-même, indépendamment du monde, des humains, qu’elle est intraitable dans ses exigences de vérité et d’objectivité et que c’est ainsi qu’elle reste non corrompue et peut inspirer la confiance de tous, notamment de ceux qui ne savent pas. « Attention Danger ! La politique met en péril l’évaluation scientifique des risques ! » s’écrie Marcel Kuntz[10], un des critiques les plus virulents de Séralini qui a remis en cause une étude à laquelle il a participé.
Pour les sociologues et les historiens des sciences qui étudient les liens aussi nombreux que complexes entre l’État et la science, l’évocation d’une telle séparation entre la science et le monde (social, culturel, politique) ne sert qu’à nourrir le « déni »[11] au fondement du cadre normatif que nous décrivons, à savoir le déni du caractère intrinsèquement politique de la science : « L’idéologie de la science véhicule le thème de l’acteur séparé de l’instrument comme le seul moyen de préserver l’intégrité de la poursuite du savoir, alors que dans les faits la contamination de l’instrument – la corruption, aurait dit Oppenheimer – n’a pas cessé d’illustrer les liens de dépendance croissante des chercheurs à l’égard d’intérêts et de valeurs qui n’ont plus rien à voir avec les normes proclamées de l’institution »[12]. En fait, ces liens de dépendance des chercheurs ou des savants envers le reste de la société ont toujours fait partie de la fabrication du savoir scientifique, comme l’explique, entre autres, l’historien des sciences Steven Shapin dans son livre au titre explicite Never Pure. Historical Studies of Science as if It Was Produced by People with Bodies, situated in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and Authority.[13] Les institutions qui ont produit et aspirent à produire des connaissances scientifiques sont ancrées dans des sociétés et des époques variées, caractérisées par des préoccupations, des modes de problématisation[14] et des questionnements, mais aussi des ressources à consacrer à la recherche scientifique, qui leur sont spécifiques. Pourtant, le cadre normatif dominant de la science – notamment à travers l’absence d’enseignement d’histoire ou de sociologie des sciences dans les facultés de sciences – prétend que cet ancrage social et politique n’a ou ne devrait avoir aucun impact sur le savoir produit (qui vise l’universel), si bien que les scientifiques pourraient légitimement ne pas en tenir compte. C’est cette volonté d’effacement que Salomon résume par l’idée de « déni ».
La séparation entre savants et ignorants, science et société, de même que le privilège épistémologique qu’elle procure aux premiers, s’incarne concrètement dans l’élaboration d’une procédure de plus en plus complexe et spécialisée de validation des savoirs scientifiques à l’intérieur de la communauté des pairs. Cette procédure permet de construire des relations de confiance, « cette composante fondamentale de la connaissance, non seulement dans la transmission du savoir d’un individu à l’autre, mais aussi dans sa production : la validité d’un résultat scientifique ne pourrait pas être établie indépendamment des réseaux sociaux de confiance et d’autorité qui en assurent la production (il est intéressant de noter que la racine latine du mot validité signifie pouvoir; validus : fort, puissant, bien portant) »[15], explique Origgi. Au cœur de ces pratiques destinées à inspirer la confiance se trouve l’utilisation d’une méthode qualifiée de scientifique au sein d’une unité universitaire reconnue (laboratoire, équipe, département, école doctorale, etc.) par des chercheurs professionnels (rigoureux, objectifs, sincères, compétents, diplômés et, sur le plan éthique, incorruptibles et désintéressés par ce qui les détournerait de leur « déontologie » évoquée par Villani), régulièrement évalués par différentes instances, dans le but de réaliser une étude sur un sujet jugé digne d’intérêt par des organismes subventionnaires et dont les résultats seront publiés dans une revue scientifique à la suite d’un processus d’évaluation par les pairs.
Ces conditions normalisées du travail scientifique forment l’ordre normatif dominant de la pratique scientifique contemporaine, au-delà de la diversité des paradigmes et des disciplines scientifiques. Elles donnent un ancrage concret à la confiance en la science demandée à la « société » : « la confiance dans la science devrait être assurée par l’objectivité et la transparence des critères indirects de réputation (nombre de publications, taux de citation dans d’autres publications, classement des revues en fonction de l’autorité scientifique qui leur est accordée) et par le système de peer-review, une modalité de filtrage de l’information propre aux revues scientifiques »[16]. À noter que nous ne discutons pas ici de la valeur ou de la signification de ce cadre normatif, ni de la possibilité de le transformer. Nous ne faisons qu’en prendre acte pour le moment.
Où se situe Séralini par rapport au cadre normatif dominant de la science?
La réponse à cette question est simple : il a tout mélangé, se situant à la fois dans le cadre normatif dominant de la science et en dehors, franchissant constamment la ligne pourtant abyssale et structurante séparant la science et la politique. Nous suggérons que c’est cette « hybridité » de Séralini qui a déstabilisé certains commentateurs qui, au contraire, tirent du respect de cette frontière leur légitimité de savants ou leur confiance dans la science. Leur rencontre avec cette hybridité peut aussi avoir mis au jour des tensions plus ou moins explicites qui parcourent le cadre normatif dominant de la science qui n’est peut-être plus aussi dominant et consensuel qu’il en a l’air… C’est ce que nous voulons montrer dans ce qui suit.
D’un côté, Séralini a suivi tout le processus « normal » exigé comme garantie de scientificité pour son travail. Il a mené une étude rigoureuse et fiable (personne n’y a trouvé d’erreur ou de fraude), à la mesure des moyens financiers qu’il a pu mobiliser. Il a ensuite soumis son texte, le 11 avril 2012, au processus d’évaluation par les pairs qui a abouti à sa publication dans Food and Chemical Toxicology le 19 septembre. Ce filtrage par l’évaluation des pairs en a donc légitimement fait un texte scientifique, ce qui a nettement embarrassé plusieurs critiques, puisqu’ils ne pouvaient, du moins jusqu’au moment de la dépublication, nier la dimension ou qualité scientifique du texte sans remettre en question le système d’évaluation par les pairs qui la lui avait accordée. Les auteurs de la « déclaration des six académies » n’ont pourtant pas hésité à franchir ce pas en minimisant le rôle et la crédibilité générale du processus d’évaluation par les pairs, pourtant au cœur du cadre normatif qu’ils défendent… Idem pour le médecin et blogueur Hervé Maisonneuve qui en vient à présumer que « le rédacteur en chef a vu l’intérêt de sa revue avec ce ‘hot paper’, et pas l’intérêt de la science : il a probablement choisi des reviewers complaisants »[17], accusation très grave susceptible de miner la confiance dans l’efficacité et l’incorruptibilité du système.
Au lieu d’attendre patiemment les répliques à son article ou de le vulgariser progressivement, ce que propose de faire le cadre normatif dominant, Séralini a choisi, avec ses partenaires, de créer les conditions de la relance du débat politique sur la règlementation des OGM qu’il voulait obtenir en même temps que faire de la science. Pour cela, il a mobilisé un média généraliste de manière spectaculaire, « à outrance » selon une commentatrice[18], adoptant de ce fait la stratégie qu’Hans Peter Peters[19] nomme la « médialisation de la science », c’est à dire l’intégration, par les chercheurs, de l’existence des médias dans leur travail scientifique, au lieu de les voir comme des ennemis ou des relayeurs externes à leur travail. Cette médialisation est une dimension nouvelle du travail scientifique, probablement liée à l’Internet et au Web 2.0, qui n’a pas encore trouvé sa place dans le cadre normatif de la science ou même du journalisme scientifique puisqu’elle a au contraire créé un tollé généralisé dans ce milieu. Pascal Lapointe, de l’Agence Science-Presse, choqué par l’utilisation de l’embargo dans cette stratégie, a rassemblé dans son article[20] plusieurs citations d’autres journalistes scientifiques qui dénoncent ce type de « communication de la science », sans partage égal des informations, ni débat argumenté autour d’une contre-expertise (selon eux). Sylvestre Huet, du journal Libération[21], estime que Gilles-Eric Séralini a « organisé, sciemment, les conditions d’une mauvaise information du public ». Selon lui, conférer l’exclusivité de son étude à un seul média pendant une semaine revenait à empêcher toute contre-expertise ou confrontation à d’autres sources. Le ton amer de cet article reflète peut-être aussi l’intuition que la médialisation en général pourrait fragiliser la pertinence du journalisme scientifique, toujours pour le moment officiellement responsable de faciliter le passage de la frontière entre la science et le reste du monde.
Séralini a été encore plus loin dans le brouillage de cette frontière puisqu’il a planifié, simultanément à la parution de l’article scientifique et à sa médiatisation, le lancement des produits « mondains » que sont un film et un livre grand public. Ce triple franchissement (média, livre, film) de la frontière entre science et politique dans le but de mettre en valeur à la fois un article scientifique et un combat politique a pu apparaître non seulement comme une forme de déloyauté à l’endroit du consensus sur cette frontière au sein de la « communauté scientifique », mais aussi comme un signe de sa dissolution possible et de la fin du consensus à la suite de la remise en question du cadre normatif dominant.
C’est ce qui pourrait expliquer des réactions comme celle du biologiste de l’UQAM Luc-Alain Giraldeau[22] qui voit dans les choix de Séralini une « collusion sans précédent entre un chercheur idéologue, ses bailleurs de fonds et un média à l’affût d’un scoop juteux dans le monde manichéen des grands complots de la science traditionnelle ». Ce jugement sans nuances diabolise d’un seul coup une équipe de recherche, des organismes et un grand média français, mais aussi toute tentative de critique politique des sciences. L’emploi du terme « collusion », qui n’est pas innocent dans une actualité politique montréalaise marquée par d’énormes scandales de collusion[23], fait baigner tous les alliés de Séralini dans une aura de corruption et de malhonnêteté. Un chercheur idéologue, c’est, pour M. Giraldeau, une personne qui prétend faire de la science et réaliser un programme politique en même temps, du même lieu de parole, alors que, selon le cadre normatif de la science, l’agenda politique et le recours aux médias ne peuvent que corrompre la science et donc la confiance qu’elle inspire, « le citoyen venant à se demander si la recherche scientifique n’est pas juste le résultat d’une question d’opinions »[24]. Lorsque, de plus, les résultats scientifiques confirment les positions politiques, il n’y a plus de doute : il doit y avoir eu une manipulation, une corruption de l’étude, du chercheur, du média, de la revue, de la méthode, des données, ou même une collusion entre tous ces acteurs, c’est-à-dire une entente illégale, illégitime, qui bafoue le bien commun. Selon un texte de Bernard Meunier, pharmacochimiste et membre de l’Académie des sciences, en dévoilant son étude de cette manière, Séralini s’est comporté « en marchand de la peur pour vendre du papier et faire de l’Audimat »[25]; Meunier reprenait ainsi l’expression déjà utilisée par le biologiste Marc Fellous à propos de Séralini et qui lui a valu une condamnation pour diffamation en 2011[26]. Le degré de colère poussant ainsi des chercheurs à sortir de leur « neutralité » conventionnelle reflète, sur le plan normatif, le choc que les choix de Séralini imposent à un cadre normatif qui paraissait pourtant consensuel et définitif.
Ce choc pourrait expliquer la sévérité exceptionnelle et l’acharnement de plusieurs commentateurs, même issus d’autres disciplines, à trouver des défauts à l’étude de Séralini. C’est comme si cette étude ne pouvait pas, sur le plan normatif, être à la fois « vraie » (scientifiquement valide) et « efficace », politiquement réussie. Or, sur le plan politique, toute l’affaire a été un grand succès, une réussite totale[27], indique le texte de Stéphane Foucart, journaliste au journal Le Monde; l’échec doit donc être dans la science. Foucart en vient ainsi à dévaloriser les aspirations scientifiques de Séralini, estimant que son étude n’avait pas vraiment pour but d’accroitre les connaissances sur la toxicité éventuelle des OGM, mais de lancer un débat public sur la faiblesse des tests réglementaires pour la mise sur le marché des produits génétiquement modifiés. Un article du journaliste scientifique Sylvestre Huet fait la même déduction : « si l’objectif n’est pas la discussion scientifique mais l’opinion publique – comme semble le montrer l’appareil de communication mis en place autour de l’expérience – alors le but a été atteint avec succès. » Par contre, sur le plan de la connaissance et de la transmission d’information « vraie », c’est un désastre, selon ce même journaliste : « la confusion finale [joue] parfaitement son rôle, à l’instar des « marchands de doutes » à l’oeuvre sur d’autres sujets, du tabac au climat. »[28]. Séralini, un des rares chercheurs à faire de la recherche indépendante sur des produits industriels lucratifs par souci de la santé publique, est ici représenté comme le pivot d’une conspiration anti-science à l’instar des experts de l’industrie du tabac. Cette exagération évidente permet d’imaginer l’intensité du choc du journaliste face à la délinquance normative de Séralini, ainsi que sa nostalgie quand il la compare aux pratiques de la science « normale », incarnée, selon lui, par l’attitude des chercheurs du CERN intrigués par leurs résultats sur les neutrinos[29]. L’emploi de l’expression « science normale » confirme ici que le terrain de cette réaction est normatif et non pas uniquement épistémique (touchant aux aspects techniques de la recherche scientifique), comme tant de critiques ont pourtant tenté de dire.
L’hybridité de la position de Séralini, à la fois scientifique et politique, est d’autant plus difficile à penser pour les « intégristes » du respect de la frontière entre science et politique qu’elle est totalement volontaire et consciente et que Séralini ne manifeste ni regrets ni ambivalence. Dans l’entrevue qu’il nous a accordée, comme dans un autre article du Nouvel Observateur[30], Séralini a précisé que cette stratégie médiatique avait été prévue pour attirer un maximum d’attention politique sur son travail, notamment afin de mobiliser les acteurs du débat public sur les failles du processus d’évaluation des OGM et d’empêcher un étouffement de son travail par Monsanto. Son but n’était donc pas uniquement de « faire avancer les connaissances ». Mais il l’était aussi! Cette double prétention empêche la communauté scientifique de pouvoir simplement tolérer ses extravagances politiques.
Mais s’agit-il vraiment d’extravagances? L’entêtement de Séralini à faire des recherches indépendantes sur les OGM a-t-il un sens? Le savoir fondé sur son expérience accumulée en trente ans de travaux dans ce contexte confine-t-il à la paranoïa ou a-t-il une autre signification? Nous allons montrer, dans le deuxième temps de cette analyse, que les choix de Séralini ont bouleversé une autre dimension du cadre normatif dominant de la science, encore plus difficile à supporter : le déni de la corruptibilité de la science et des scientifiques, notamment dans le contexte contemporain qui encourage les partenariats entre la science et l’industrie privée.
Séralini et la sortie du déni de la corruptibilité de la science
La compréhension du « politique » dans les commentaires critiques ci-dessus paraît bien spécifique. Le politique y est associé à quelque chose de sale, de malhonnête, de corrupteur, de « mauvais ». Cette conception évoque certes, comme nous l’avons vu, le rejet normatif du politique comme porteur d’intérêts et de passions primaires pouvant compromettre le privilège épistémologique des chercheurs, mais elle fait aussi référence à l’état de la démocratie contemporaine marquée par un cynisme et un sentiment d’impuissance et de défiance accrus des citoyens face à leurs décideurs, à leurs élites, qui paraissent incapables de résister à la corruption, à la tentation du pouvoir personnel et à la protection de leurs intérêts privés au détriment du bien commun. Dans un contexte néolibéral[31] qui survalorise l’argent et la croissance économique, la confiance dans le politique et dans sa capacité de générer une démocratie inspirant honneur et fierté n’est plus là. Appelons cet état de chose le côté sombre du politique.
En même temps, de nombreux observateurs perçoivent une nouvelle vitalité dans la société civile qui semble vouloir réinventer des formes de vivre-ensemble plus coopératives, plus participatives, plus égalitaires, plus proches de l’idéal du bien commun. Le « politique » peut alors trouver un autre sens comme lieu de débat sur les valeurs et les finalités collectives, d’élaboration de l’action commune en vue de construire une Cité juste et accueillante pour tous et de prise de parole individuelle pour faire valoir ce que serait une vie signifiante pour soi et pour autrui. Cette conception éthique du politique (son côté clair) vise une vie bonne, pour et avec autrui, dans des institutions justes[32]; elle apparait bien moins souvent dans les médias que le côté sombre du politique.
Le désir d’agir dans la société exige de prendre en compte les deux côtés du politique. En ignorer le côté sombre maintient la personne dans une situation de naïveté qui, en masquant les obstacles, l’empêche de réaliser ses objectifs ou de participer au débat public. Inversement, se limiter à une version cynique du politique mène à s’auto-exclure de l’aspiration à une vie collective signifiante.
Or, comme l’explique Jean-Jacques Salomon dans son grand livre Les scientifiques, entre pouvoir et savoir, les chercheurs sont formés à se désintéresser du politique qui leur est toujours présenté comme menaçant et corrupteur. Cette pratique normée de l’apolitisme scientifique les protège peut-être de certains dérapages, mais elle a au moins deux désavantages majeurs : non seulement elle rend les chercheurs aveugles à la dynamique politique, claire et sombre, qui anime les rapports entre la science et la société dans laquelle ils travaillent, mais elle les éloigne des débats démocratiques sur les politiques scientifiques qui, pourtant, déterminent les conditions dans lesquelles ils pratiquent la recherche scientifique. Elle limite considérablement leur capacité d’agir, y compris contre la marchandisation accrue de la connaissance qui se dessine sous leurs yeux par le biais de l’économie du savoir, en complète contradiction avec l’idéal du désintéressement qu’on continue pourtant à leur présenter comme la norme à respecter. C’est le grand déni au cœur du cadre normatif dominant de la science contemporaine.
Cette convention d’apolitisme échoue inévitablement à produire son effet « protecteur » : dès les premières demandes d’admission à un programme de doctorat, les futurs chercheurs non seulement réalisent à quel point la recherche scientifique est profondément politique dans son sens sombre, c’est-à-dire traversée par des passions et des intérêts parfois irrationnels souvent liés à l’argent ou au prestige, mais ils découvrent l’hypocrisie du cadre normatif qui prétend que cela n’existe pas ou ne compte pas. Également coupés du coté clair du politique, non seulement ils ne savent pas comment réintroduire des valeurs et de l’aspiration au bien commun dans leur travail scientifique, mais ils craignent qu’une telle réflexion, par exemple sur la responsabilité sociale de la science, nuise à leur intégration dans la « cité idéale de la science », dans le groupe des pairs.
La position de Séralini va à contre-courant de cette cécité conventionnelle. Tous ses choix, notamment de médialisation, expriment clairement sa conscience des rapports de forces qui imprègnent le champ de la recherche scientifique sur les biotechnologies et les pesticides, et en particulier des difficultés qui guettent ceux qui adoptent une posture indépendante et critique de la grande industrie, partenaire privilégié de l’État en ces temps néolibéraux. Mais sa résilience et sa combativité, de même que ses victoires, indiquent aussi une certaine confiance que le souci du bien commun l’emportera, que les institutions corrompues sauront s’autoréguler, que la quête du profit ne l’emportera pas toujours sur les autres valeurs. N’a-t-il pas réussi à obliger l’Agence européenne à publier le 14 janvier 2013 les données scientifiques qui lui avaient été soumises par les chercheurs de Monsanto pour l’homologation de maïs NK603[33] ? Même si Monsanto menaçait de la poursuivre pour cette raison[34]?
Séralini non seulement est sorti du déni, mais son évocation des liens d’intérêts qui parcourent la science des OGM et des pesticides qui leurs sont associés ne le conduit pas à renoncer de tenter d’y faire une science indépendante et au service du bien commun. Autrement dit, sa conscience du caractère corrupteur de la société ne l’amène pas à renoncer à la connaissance, ce qui constitue un brouillage supplémentaire de la séparation normative entre science et politique, entre connaissance et ignorance, passions et intérêts. Cette position révèle une fois de plus sa délinquance par rapport au cadre normatif de la science, incluant l’hypocrisie conventionnelle de ce cadre.
Séralini est-il paranoïaque? Voit-il des complots partout? C’est ce que plusieurs commentateurs répètent. Pourtant, la liste des liens d’intérêts qui sont apparus au fil de l’affaire Séralini et qui sont susceptibles d’entrer en conflit avec le déroulement normal du processus de validation scientifique est impressionnante.
- L’agence de presse Science Media Center, qui a alimenté plusieurs quotidiens, dès le lendemain de la publication de l’étude de Séralini, avec des commentaires dévastateurs d’experts américains, est financée par la grande industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, même si elle se présente comme « indépendante »[35].
- Ralf Reski, ce biotechnologiste qui avait démissionné avec fracas du comité éditorial d’une revue qui avait accepté un manuscrit co-signé par Séralini en février 2014, révèle sur son cv mis en ligne[36] qu’il a reçu 20.9 millions d’euros en subvention de recherche, dont 53% de l’industrie et 47% du secteur public.
- Plusieurs personnes impliquées dans l’autorisation de mise sur le marché du maïs NK603 en Europe ont fait partie des comités du Haut conseil des biotechnologies et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui ont auditionné Séralini durant l’automne 2012. Comme Séralini l’a remarqué durant l’entrevue que nous avons réalisée, les liens étroits entre ces organismes et l’industrie nuisent à la constitution d’une expertise contradictoire solide au sein des institutions universitaires. Quant aux agences régulatrices, elles sont devenues, selon les mots de Séralini, des « tribunaux militaires » au service du développement économique et non plus de la science.
- L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a une faible crédibilité en matière de surveillance des conflits d’intérêts. Par exemple, il est connu que certains de ses membres (dont son ancienne présidente, Diána Bánáti) offrent des services de consultance à l’ILSI (l’International Life Sciences Institute, une agence créée en 1978 par des géants de l’agroalimentaire comme Coca-Cola, Heinz, General Foods et Monsanto) en même temps qu’ils évaluent les produits de ces mêmes compagnies[37]. L’EFSA fonde ses autorisations sur des études générées par les firmes elles-mêmes[38] et nomma Juliane Kleiner, qui avait travaillé sept ans à l’ILSI, comme Directrice de sa stratégie scientifique[39]. Le rapport de Corporate Europe Observatory d’octobre 2013 révèle que plus de la moitié des 209 chercheurs siégeant sur les comités de l’EFSA ont des liens avec l’industrie qu’ils doivent réguler[40].
- Selon un article de Lyon Capitale[41], il semblerait qu’avant d’annoncer le rejet de l’étude Séralini, une concertation aurait eu lieu entre les six agences européennes de sécurité sanitaire lors d’une téléconférence organisée par l’EFSA.
- Bon nombre des détracteurs les plus farouches de l’étude de Séralini ont des liens étroits avec l’industrie tels que l’ancien directeur de l’INRA Gérard Pascal ou Mark Tester, professeur à l’Université d’Adélaïde, qui ne cachent pas leurs liens avec Monsanto, Bayer ou Syngenta, ou encore Bruce Chassy, l’expert interrogé par le New York Times. C’est également le cas d’une chercheuse de l’Université de Davis (Californie), Martina Newell-McGoughlin, qui est l’une des quatre experts de la task force mise en place par l’ILSI sur les OGM. L’ILSI se félicite ouvertement d’avoir influencé les directives de l’Agence européenne (EFSA) en faveur du développement des OGM[42].
- Un des articles les plus agressifs contre l’étude de Séralini réfère comme contact le professeur Paul Christou, de l’Université de Lleida. Un rapide coup d’œil à son cv et à ses brevets révèle ses liens étroits avec la compagnie Agracetus[43] qui a inventé le soja résistant au round-up ready et qui fut achetée par Monsanto en 1996[44].
- La dépublication de l’article de Séralini pour résultats « non concluants » cache mal derrière un rigorisme méthodologique superficiel et flou l’arrivée d’un ancien employé de Monsanto au comité éditorial de la revue, Richard Goodman.
- Séralini a été accusé par certains commentateurs d’avoir lui-même des liens avec de grandes entreprises de distribution alimentaire regroupées dans l’Association CERES. Séralini se défend en disant que le CERES n’a pas eu de droit de regard sur la conduite ou les résultats de l’étude, ou encore que le but de l’étude n’était pas d’obtenir une autorisation de commercialisation d’un produit.
Le biologiste Frédéric Jacquemart, atterré par la dépublication de l’article de Séralini et par le refus de la revue Food and Chemical Toxicology de dépublier un autre article utilisant le même protocole, mais ayant généré des résultats positifs pour l’OGM étudié, fait le constat suivant : « On savait bien que la prétendue neutralité des scientifiques et des experts n’était bien que prétendue, nous en avons maintenant la preuve, l’affaire Séralini aura au moins servi à clarifier les choses »[45]. Autrement dit, le déni de la corruptibilité de la science, pourtant partie prenante de son cadre normatif dominant et persistant malgré les « affaires » de plus en plus nombreuses, n’est plus tenable après l’affaire Séralini et cela fait mal aux chercheurs en sciences du vivant ou en technologie qui, bien plus que les chercheurs en sciences sociales et en philosophie, en avaient fait le centre de leur credo, de leur ethos, de leur confiance dans la science.
Il n’est pas difficile de comprendre que les chercheurs, autant ceux qui ont des liens d’intérêt avec l’industrie des OGM que ceux qui n’en ont pas, se soient sentis, pour des raisons différentes, bouleversés et symboliquement attaqués par les actions de Séralini, complètement déstabilisatrices de leur cadre normatif de référence qui, auparavant, départageait clairement la science et le reste, notamment les intérêts privés et le désir d’argent. Il nous semble que cette mise au jour publique, avec tambours et trompettes, de l’importance de l’argent et de l’industrie dans la pratique scientifique, impensée par le cadre normatif de la science, a pu conduire certains acteurs scientifiques ou industriels à préférer s’en prendre à la personne de Séralini plutôt qu’à réfléchir aux conséquences de cette sortie du déni.
À cet égard, le sous-développement de la pensée politique des chercheurs ne leur rend pas service. Car cette importance accrue de l’argent dans la communauté scientifique, comme moyen ou comme finalité (source de prestige et de pouvoir) n’est pas un détail. Elle renvoie au contexte néolibéral dans lequel nous vivons et qui a inspiré les politiques scientifiques contemporaines, par exemple, au Canada, la politique Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada[46]. Ces politiques valorisent le rapprochement entre les chercheurs (ou centres de recherche), vus comme la source d’innovations technologiques commercialisables, et l’industrie qui a le financement nécessaire à cette commercialisation. Le but de cette économie du savoir, lancée par l’OCDE en 1996, est d’augmenter le PIB et la croissance économique des pays. La science apparaît actuellement de plus en plus asservie à ces objectifs de croissance.
Le défi des tenants de l’économie du savoir fut de faire accepter cette situation aux chercheurs fidèles au cadre normatif dominant de la science et à son exigence d’incorruptibilité. Une des façons de faire, dont on retrouve la trace dans certains textes évoquant l’affaire Séralini, fut de rendre la corruption par l’argent plus naturelle et acceptable que celle par le politique, de dé-diaboliser l’argent en (sur)valorisant les chercheurs qui accumulent les subventions et commandites et en ridiculisant ceux qui n’en ont pas. C’est ainsi que la valeur des chercheurs est de plus en plus représentée, notamment dans leurs dossiers professionnels, par les sommes d’argent qu’ils réussissent à obtenir, que ce soit de l’État ou de l’industrie. Le curriculum vitae du chercheur Reski en est un bel exemple. En revanche, le militantisme politique ou associatif et autres formes d’engagement social ne font toujours pas partie des cv des chercheurs et peuvent même les marginaliser.
Les chercheurs contemporains apparaissent alors en tension entre un idéal normatif de science désintéressée, à distance du monde social et politique, tendue vers la vérité, dont ils pensent qu’elle peut générer la confiance du public, et un nouvel idéal de chercheur-entrepreneur[47], dont la valeur repose sur des critères quantitatifs et financiers et qui a la confiance des politiques scientifiques d’inspiration néolibérale. Pour une minorité qui vit très bien cette tension, pour une autre qui refuse de la voir, pour une autre qui pense que son incorruptibilité ontologique la protège de toute corruption monétaire, combien de souffrances morales et cognitives non dites, non exprimées, cette tension suscite-t-elle parmi les chercheurs ? L’affaire Séralini a aussi contribué à mettre au jour cette situation.
Concluons cette section sur la question de la confiance. À l’inverse de la position de Cédric Villani citée plus haut, il nous semble que c’est l’affaire Séralini, c’est-à-dire l’ensemble des commentaires et réactions aux événements du 19 septembre 2012, et non l’article en lui-même, qui a porté les coups les plus décisifs à la confiance de la société dans la science. Cette affaire a en effet montré un cadre normatif aveugle, hypocrite, incapable d’aider les chercheurs à prendre position dans un monde néolibéral qui encourage la corruption de la science et son asservissement à des fins lucratives. Elle a montré des chercheurs littéralement achetés par l’industrie afin de préserver ses intérêts privés, qui participent en même temps sans hésitation aux grandes institutions publiques qui ont pourtant pour mandat de préserver l’intérêt général (et la santé publique). Elle a montré des « intégristes » normatifs prêts à dénigrer les conventions scientifiques de base (l’évaluation par les pairs) pour mieux assassiner un texte. Elle a montré un journalisme scientifique plus soucieux de défendre l’orthodoxie normative de la frontière entre la science et la société que d’enquêter sur des conflits d’intérêts pourtant apparents en quelques clics sur le Web[48]. Les rebondissements liés à la dépublication ont montré la fragilité des bases de l’autorité de la science, de la parole scientifique et, par ricochet, du dispositif d’expertise auquel les États et citoyens font pourtant confiance pour la gestion des risques. Les bases de la confiance, qui suppose une croyance dans la capacité de ceux à qui on l’accorde de privilégier le bien commun, sont ici véritablement sapées.
Un autre cadre normatif pour la confiance dans la science ?
Plutôt que de proposer encore une fois une « purification » de la science comme solution pour reconstruire la confiance qu’elle veut inspirer à la société, nous proposons un renouvellement du cadre normatif de la science et, par conséquence, de la source de la confiance dans la science.
Ce nouveau cadre renoncerait à la séparation radicale entre la science et la société, au grand partage entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, au profit d’une justice cognitive reconnaissant et encourageant l’existence d’une pluralité de savoirs[49] complémentaires et non rivaux dans la revendication d’un privilège épistémologique : savoirs scientifiques, savoirs pratiques, savoirs traditionnels, savoirs expérientiels, savoirs politiques. Ce cadre normatif valoriserait les communautés épistémiques hybrides, formées de chercheurs professionnels et de non-chercheurs, qui se créent actuellement un peu partout dans le monde, dans l’ombre de l’establishment scientifique : la recherche-action collaborative, la science citoyenne (Citizen science), l’Open science, les laboratoires vivants, en somme une multitude de façons de co-créer de la connaissance dans un cadre participatif et égalitaire[50].
Ce cadre normatif privilégierait le partage des données de recherche, des livres et des articles scientifiques en faisant du libre accès la forme privilégiée de publication scientifique, y compris au moment de l’évaluation des articles. En ce sens, l’évaluation ouverte pratiquée par quelques revues[51], qui consiste à publier les évaluations scientifiques d’un article, ainsi que la réponse des auteurs de l’article, en même temps que l’article, est une voie très prometteuse qui éviterait les pratiques de « dépublication » comme celle subie par l’article de Séralini.
Il encouragerait les chercheurs à réfléchir à leur place dans le monde, à leur responsabilité sociale, à leurs valeurs et à celles des communautés auxquelles ils appartiennent, ainsi qu’à l’ancrage social, culturel et politique de la science qu’ils fabriquent, au lieu de perpétuer le grand déni. Il leur montrerait que cette réflexion et cette prise de conscience n’impliquent nullement une dévalorisation de leur travail de connaissance du monde – sauf s’ils restent accrochés à l’autre cadre normatif.
Ce nouvel ordre normatif de la science susciterait chez les citoyens chercheurs et non chercheurs une confiance éclairée, vigilante, non passive et non déférente, dans une connaissance vivante, juste et responsable, qui n’a peur ni des valeurs, ni des passions, ni de la politique dans son sens sombre et dans son sens clair.
[1] Jean-Jacques Salomon, 2006, Les scientifiques, entre pouvoir et savoir, Albin Michel.
[2] Expression du sociologue des sciences Boaventura de Sousa Santos, dans Global Cognitive Justice (2007).
[3] Matthieu Calame, 2011, Lettre ouverte aux scientistes, Éditions Charles Léopold Mayer.
[4] Cette exigence est bien plus évidente et apparemment facile à respecter pour les chercheurs en sciences naturelles ou du vivant que pour les chercheurs en sciences sociales, en général plus sensibilisés à l’ambiguité de leur posture épistémologique.
[5] Gloria Origgi, Qu’est-ce que la confiance?, Paris, Éditions Vrin, 2008.
[6] Gloria Origgi, Qu’est-ce que la confiance?, Paris, Éditions Vrin, 2008.
[7] Merton R. K., « The Normative Structure of Science » (1942) in Storer N.W. (ed.), The Sociology of Science, Chicago, 1973, University of Chicago Press, p. 267-278.
[8] Voir aussi le chapitre « L’idéal de la cité scientifique » dans le livre de Jean-Jacques Salomon, Les scientifiques, entre pouvoir et savoir, Albin Michel, 2006.
[9] Déclaration de Fotis Kafatos (2007), www.biotechnologies-vegetales.com, citée dans Calame, Lettre ouverte aux scientistes.
[10] Marcel Kuntz : « Oui, la publication de Séralini est un poison », http://www.marcel-kuntz-ogm.fr/article-publi-seralini-poison-123001107.html
[11] Jean-Jacques Salomon. 2006. Les scientifiques, entre pouvoir et crise. Albin Michel.
[12] Jean-Jacques Salomon, livre cité, p. 393.
[13] The Johns Hopkins University Press, 2010.
[14] Michel Foucault, 1984, « Qu’est-ce que les lumières ? » Dits et écrits, Gallimard.
[15] Gloria Origgi, Qu’est-ce que la confiance?, Paris, Éditions Vrin, 2008, p. 37.
[16] Gloria Orrigi, Qu’est-ce que la confiance? P.45.
[17] Hervé Maisonneuve « L’imposture Séralini sur les OGM : une revue qui augmente sa notoriété avec un article qui devrait être cité », h2mw.eu/redactionmedicale, 1 février 2013.
[18] Aurélie Haroche, http://www.jim.fr/pharmacien/e-docs/pesticides_polemiques_sur_les_resultats_de_gilles_eric_seralini__143644/document_actu_pro.phtml
[19] Hans Peter Peters et al. 2008, « Medialization of Science as a Prerequisite of Its Legitimization and Political Relevance » in Communicating Science in Social Contexts pp 71-92 10.1007/978-1-4020-8598-7_5.
[20] Pascal Lapointe, 22 septembre 2012, L’étude anti-OGM: comment s’assurer des médias favorables, http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2012/09/22/letude-anti-ogm-comment-sassurer-medias-favorables.
[21] Sylvestre Huet, 21 septembre 2012, OGM, Séralini et le débat public, sciences.blogs.liberation.fr.
[22] Luc-Alain Giraldeau, « L’affaire des OGM : les dangers de la collusion entre chercheurs et media », Découvrir: le magazine de l’ACFAS, octobre 2012.
[23] Voir ce dossier sur le site de radio-Canada : http://ici.radio-canada.ca/collusion-qc
[24] Luc-Alain Giraldeau, octobre 2012, « L’affaire des OGM : les dangers de la collusion entre chercheurs et média », http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2012/10/l-affaire-ogm-dangers-collusion-entre-chercheurs-media.
[25] Faut-il encore avoir peur des OGM?, lefigaro.fr, 28 janvier 2013
[26] Marie Kostrz, 18 janvier 2011, « Le chercheur anti-OGM Séralini remporte son procès en diffamation », rue89 http://rue89.nouvelobs.com/planete89/2011/01/18/le-chercheur-anti-ogm-seralini-remporte-son-proces-en-diffamation-177559
[27] Cité dans « OGM : retour sur « l’affaire Séralini » et le journalisme scientifique » par Sophia Aït Kaci, publié en ligne le 29 juillet 2013 dans Acrimed – Observatoire des médias
http://www.acrimed.org/article4063.html et en avril 2013 dans le n°7 de Médiacritique(s), le magazine imprimé d’Acrimed.
[28] Sylvestre Huet, « OGM: l’affaire Séralini suite, fin et suite… » 2 décembre 2013 http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/12/ogm-larticle-de-g-e-s%C3%A9ralini-r%C3%A9tract%C3%A9.html.
[29] Sylvestre Huet, 8 juin 2012, « Les neutrinos plus rapides que la lumière ? Non et fin de l’histoire », http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2012/06/neutrinos-plus-rapides-que-la-lumi%C3%A8re-non-et-fin-de-lhistoire.html.
[30] Denis Pilato, 2012, « OGM : comment Monsanto communique pour contrer les critiques », leplus.nouvelobs.com, 25 septembre 2012
[31] Pierre Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte, 2009.
[32] Paul Ricoeur, 1990, Soi-Même comme un autre. Le Seuil.
[33] « OGM : retour sur « l’affaire Séralini » et le journalisme scientifique » par Sophia Aït Kaci, publié en ligne le 29 juillet 2013 dans Acrimed – Observatoire des médias
http://www.acrimed.org/article4063.html et en avril 2013 dans le n°7 de Médiacritique(s), le magazine imprimé d’Acrimed.
[34] Monsanto threatens to sue EFSA over publication of GM maize data, gmwatch.org, 8 mars 2013
[35] « OGM : comment Monsanto communique pour contrer les critiques », leplus.nouvelobs.com, 25 septembre 2012.
[36] Voir la page https://www.plant-biotech.net/members/CV_Reski_BE_2014.pdf.
[37] « Des agences de l’UE entachées par des accusations de conflits d’intérêts », euractiv.com, 10 mai 2012
[38] « OGM : comment une étude bidonnée par Monsanto a été validée par les autorités sanitaires », actuwiki.fr/environnement/, 31 octobre 2012
[39] UE – L’AESA ET L’INDUSTRIE : DES RELATIONS INCESTUEUSES RENOUVELÉES, infogm.org, mai 2013.
[40] Rapport Unhappy meal. The European Food Safety Authority’s independence problem, à la page http://corporateeurope.org/efsa/2013/10/unhappy-meal-european-food-safety-authoritys-independence-problem.
[41] « Étude Séralini sur les OGM : la riposte des agences sanitaires était concertée », lyoncapitale.fr, 3 décembre 2012.
[42] « Gilles-Eric Séralini, le chercheur qui dérange », oragesdacier.info, 4 décembre 2012
[43] Voir la page http://www.biotechprofiles.com/companyprofile/Monsanto.aspx.
[44] Voir la page http://patents.justia.com/inventor/paul-christou.
[45] Frédéric Jacquemart, 30 janvier 2014, « L’industrie aux commandes de la science? » http://blogs.mediapart.fr/blog/frederic-jacquemart/300114/lindustrie-aux-commandes-de-la-science
[46] www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_00231.html.
[47] Sheila Jasanoff, Designs on nature, Princeton university Press, 2005.
[48] Comme nous avons pu le faire dans le cas de Ralf Reski et de Paul Christou.
[49] Boaventura de Sousa Santos (ed.), 2007, Cognitive Justice in a Global World: Prudent Knowledges for a Decent Life, Lexington Books.
[50] Florence Piron, « La portée critique de la science citoyenne », conférence, FSI, Université Laval, 13 février 2014.
[51] Par exemple, le EMBO journal, du groupe Nature, « makes the editorial process transparent for all accepted manuscripts, by publishing as an online supplementary document (the Peer Review Process File, PRPF) all correspondence between authors and the editorial office relevant to the decision process. This will include all referee comments directed to the authors, as well as the authors’ point-by-point responses. ». Voir aussi la revue Science ouverte à http://scienceouverte.com.ulaval.ca.










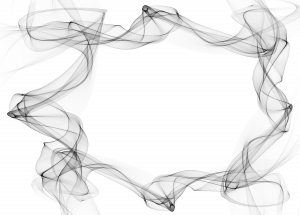





Bonjour,
Je souhaitais vous interroger sur un point précis : évoquant la notion de médialisation(fr)/medialization(en), vous la rattachez au nom de Hans Peter Peters (2008). Ne connaissant pas ce concept (?) j’ai interrogé rapidement le web pour trouver que, d’après Schäfer, « Peter Weingart first introduced the term “medialization” to the literature,but the process of change described as such and its basic characteristics are found in the writings of many scholars ». Votre choix, de rattacher cette notion à H.P. Peters et non pas à Weingart par exemple tient-il à une orientation particulière de la pensée de Peters à ce sujet ou seulement au fait que, la notion étant, si ce n’est nommée, du moins travaillée par de nombreux chercheurs, cette référence, avec laquelle vous pouviez être familière, en valait une autre ?
[Schäfer, From Public Understanding to Public Engagement: An Empirical Assessment of Changes in Science Coverage, Science Communication, 2009]
Cordialement