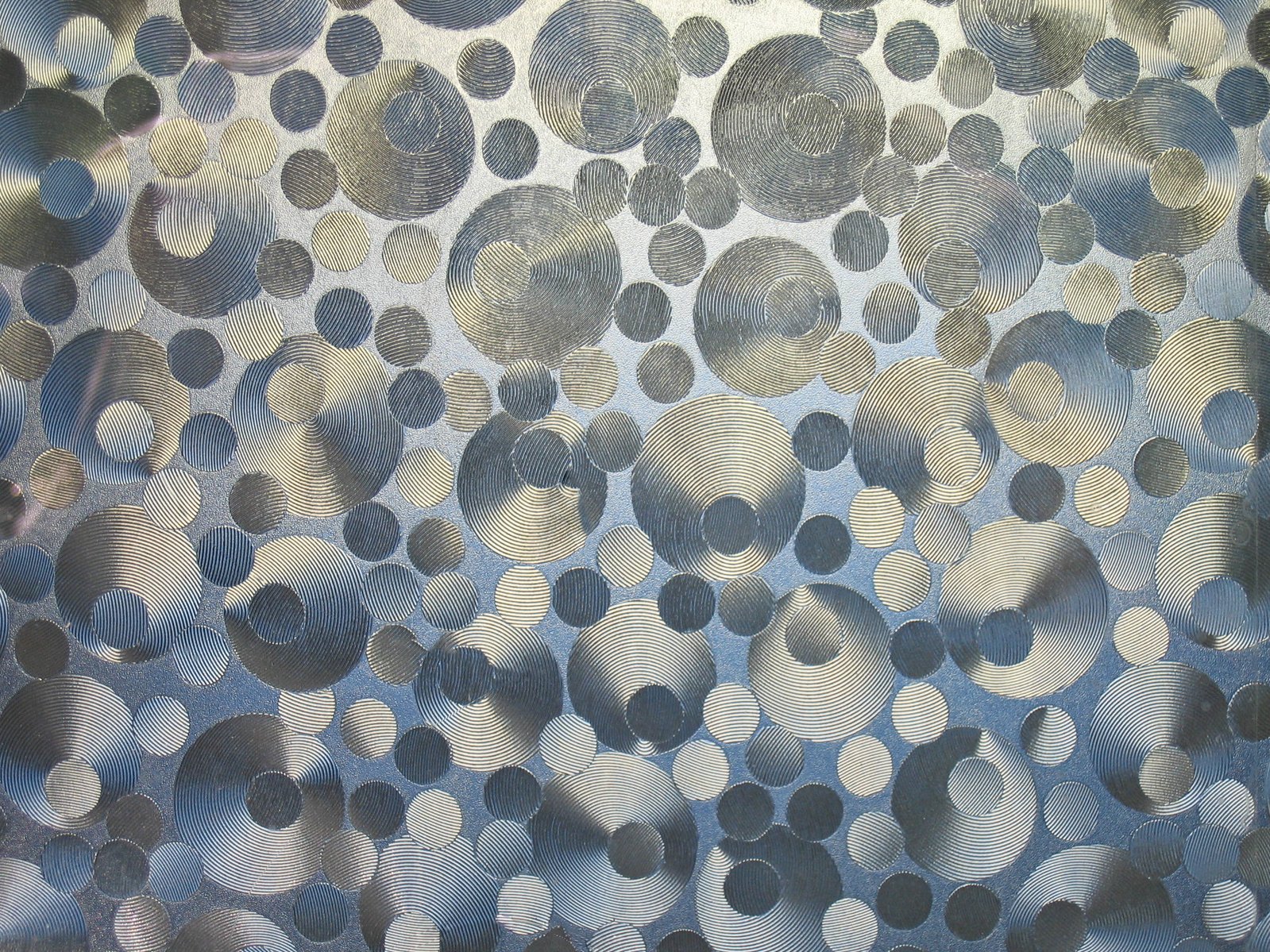L’addiction au prisme de la perspective sociologique
[box] Victor Collard, EHESS – École des hautes études en sciences sociales
Introduction
Loin de la vision grandiloquente des querelles épistémologiques menées au nom d’une vision héroïque de la Science, l’ontologie spinoziste conçoit les individus, et donc les chercheurs, comme des « modes » dotés d’un conatus qui n’est autre qu’un désir potentiellement illimité et exclusivement borné par un autre à même de le contester. Cette vision du monde social comme agonistique de désirs, que la sublimation dans le champ scientifique ne peut que temporairement masquer, pourrait rendre compte de cette sorte de lutte perpétuelle que se mènent les disciplines pour l’hégémonie, tant sur les objets d’études potentiels que les crédits de financement etc. Dans cette perspective, la question de l’addiction, objet aux frontières disciplinaires troubles, pourrait probablement être considérée comme un cas paradigmatique.
Contre le traitement majoritairement biologique ou psychologique de l’addiction, une assez vaste littérature sur cette question a vu le jour, qui vise à combler le retard de la sociologie à traiter ces objets sans que les différences soient toujours très marquées1. Cette sociologie, heuristique à bien des égards, reste néanmoins la plupart du temps centrée sur les acteurs. La sociologie des addictions se confond dès lors souvent avec la sociologie des drogues et s’intéresse par exemple aux pratiques sociales de consommation ou aux immersions dans le milieu de l’économie souterraine2, mais rarement au point de vue « macrosociologique » analysant les causes parfois lointaines de ces phénomènes. Jean-Pierre Couteron en est un des rares exemples, qui définit la société d’« addictogène » en privilégiant de porter son regard sur les ressorts sociaux des addictions : « Le premier est celui d’un estompage des contenants collectifs, du cadre d’appartenance, des mutations du lien social »3.
Dans la perspective que nous souhaiterions proposer ici, la psychologie ou la biologie, disciplines principalement interrogées lorsque l’on s’intéresse aux phénomènes addictifs, sont vues comme une façon d’exprimer de façon locale, par l’intermédiaire d’une réaction psycho-physique en aval, des causes parfois profondes mais généralement négligées de par leur large invisibilité immédiate. C’est par exemple la dépendance à la nicotine qu’il s’agira communément de traiter dans le cas d’une addiction à la cigarette alors qu’une montée générale du stress dans les sociétés, accentuant la consommation de ce psychotrope, sera appréhendée comme un événement trop lointain pour être pertinent. Ne niant pas les progrès scientifiques que constitue par ailleurs l’explicitation des mécanismes biologiques à l’œuvre dans le fonctionnement du corps et surtout du cerveau, les sociologues estimeront profitable, dans une perspective différente, de regarder au-dessus des individus, c’est-à-dire au niveau du « social ». Le placement de la focale dans l’étude d’une addiction ne constitue naturellement pas qu’un enjeu épistémologique mais conditionne le niveau de la réponse qui sera apportée : à un point de vue biologique ou psychologique qui privilégiera une approche centrée sur l’individu et sa prise en charge personnelle, s’opposera un point de vue sociologique privilégiant un traitement centré sur les déterminants sociaux de cette pratique. Dans le premier cas, c’est une vision volontariste qui est engagée et qui fait de la personne en situation d’addiction l’entrepreneur de son rétablissement, alors que le second point de vue insiste sur la complexité et le grand nombre des mécanismes causaux à prendre en compte. C’est probablement la difficulté de diagnostiquer ces causes, et plus encore de prétendre les contrer, qui décourage à adopter cette perspective, face à des solutions locales plus identifiées mais qui ne sont, dans l’optique défendue dans cet article, que des conséquences d’une chaîne causale qu’il serait possible de remonter plus en amont.
L’adoption d’un point de vue sociologique sur les addictions ne concerne pas seulement la nature du diagnostic à leur porter mais permet aussi d’envisager d’élargir leur spectre. Le courant sociologique holiste, en sa version structuraliste, a en effet insisté de longue date sur l’inconscient qui préside aux actions des individus. La grande leçon de cette sociologie insiste sur le caractère déterminé des pratiques dites « individuelles », des plus banales aux plus complexes. En ne se concentrant pas uniquement sur les addictions les plus courantes mais en questionnant la liberté ou non des actions, il s’agirait dès lors d’esquisser des chemins moins empruntés d’une « macrosociologie » des addictions à même de mieux les reconnaître afin de mieux pouvoir les combattre. La problématique de l’addiction au travail (workaholism), trop souvent placée à l’échelle de l’acteur ou méso-sociale de l’entreprise, fournira une illustration de cette appréhension différente de l’addiction que nous souhaiterions esquisser.
1. Un conflit d’approches réel mais ambivalent
La représentation spontanée des addictions devant prioritairement être rapportées à des causes biologiques entraîne un certain nombre de considérations épistémologiques concernant une opposition réelle mais parfois exagérée entre sciences naturelles et sciences sociales.
Se voulant exhaustive et à même de satisfaire tout le monde4, la définition de l’addiction par Eric Loonis aurait de quoi laisser songeurs nombre de sociologues : « l’addiction est une activité corporelle ou psychique, produisant une activation cérébrale, destinée à occulter une dysphorie antécédente, consistant en une souffrance psychique intrinsèque et une menace existentielle »5. C’est que le prisme psychologique et physiologique qui lui semble réservé rend a priori inopérant le concours de sociologues formés à une école durkheimienne qui leur a fait d’une part prendre leurs distances avec la psychologie et les sciences naturelles et réservé d’autre part leurs investigations aux objets proprement sociologiques que sont les faits sociaux. Il y a pourtant une part de légende, renforcée par les oppositions scolaires inlassablement critiquées par Bourdieu, dans cette opposition tranchée entre sociologie et sciences naturelles. Dominique Guillo6 note en effet chez le « premier »7 Durkheim un recours surprenant et non anecdotique au discours biologique :
La biologie est omniprésente dans les premiers travaux de Durkheim, en particulier dans De la division du travail social8 et dans Les règles de la méthode sociologique9. Et cette référence insistante aux sciences de la vie ne se limite pas à quelques analogies, investies simplement d’un rôle heuristique. Dans certains passages, une conception de l’homme nettement naturaliste et évolutionniste, aux accents parfois sexistes et ethnocentristes, paraît même dominer l’argumentation du sociologue français10.
Pourtant, Bourdieu et ses co-auteurs insistaient dès Le Métier de sociologue, dans une posture qu’on sentait déjà défensive, sur le conflit possible entre sciences dites dures et sciences sociales, en affirmant le principe explicitement attribué à Durkheim de« ne pas abdiquer prématurément le droit à l’explication sociologique ou, en d’autres termes, de ne pas recourir à un principe d’explication emprunté à une autre science, qu’il s’agisse de la biologie ou la psychologie, tant que l’efficacité des méthodes d’explication proprement sociologique n’a pas été complètement éprouvée »11. Dans Le Suicide, publié en 1897, Durkheim mettait pour la première fois à œuvre les principes méthodologiques qu’il avait préalablement définis dans Les règles de la méthode sociologique publié en 1895. Il considérait que la psychologie ou la biologie12 donnent une représentation intime et singulière de ces phénomènes et négligent leurs déterminants sociaux. Dans le cas du suicide, la psychologie insistera sur les mécanismes psychiques de tristesse ressentis par l’individu avant l’acte macabre quand la sociologie s’intéressera aux raisons profondes, plus lointaines et plus cachées que va mettre en avant Durkheim (appartenance à une classe sociale, religion, lieu d’habitation etc). Si le suicide est un fait social à part entière – il exerce sur les individus un pouvoir coercitif et extérieur –il peut alors être analysé par la sociologie. Durkheim a incontestablement marqué les différences d’objets13, marquant une séparation épistémologique « à chacun son dû » entre la psychologie et la sociologie, mais on doit probablement davantage voir dans cette délimitation une séparation de points de vue : « le suicide de tel ou tel individu » qu’évoque D. Guillo14 n’est pas plus psychologique que social en soi mais peut être appréhendé par la psychologie qui insistera sur les mécanismes cognitifs à l’œuvre ou bien par la sociologie qui n’y verra pas un phénomène isolé mais le reliera à des causes moins visibles car socialement structurées. Il est vrai que Durkheim donnait lui-même l’impression de séparer les activités potentiellement appréhendables comme des « faits sociaux » de celles purement organiques telles que « boire, manger » et ne méritant pas selon lui ce qualificatif15. Bourdieu dans la Distinction16 aura néanmoins tenté de radicaliser le geste durkheimien en postulant qu’il est possible de sociologiser, c’est-à-dire de rendre raison sociologiquement d’actions aussi triviales que la consommation d’aliments17.
Ces quelques éléments en préalable épistémologique visaient à situer cet objet d’étude qu’est l’addiction dans l’opposition complexe entre la biologie et les sciences sociales tout en montrant qu’à l’intérieur même de la sociologie, un père fondateur comme Durkheim avait lui-même été parfois ambigu dans son rapport à ces disciplines. Cette opposition ne signifie pas qu’existe un équilibre des forces dans une littérature scientifique où domine largement la perspective biologique. La prééminence de celle-ci sur ces thématiques n’avait pourtant rien d’évident étant donné son lourd passé qui la maintenait jusqu’à une période récente à l’écart des débats de société18, avant qu’une certaine libération de la parole naturaliste conduise par exemple l’éthologue Franz de Waal à affirmer qu’en « « cette fin de ce siècle de plus en plus darwinien, et à la veille de ce qui sera sans aucun doute un millénaire darwinien, nombreux sont ceux qui prétendent encore que notre comportement est principalement ou entièrement culturel », alors que la nature « détermine en réalité tout ce que nous faisons et ce que nous sommes » »19. Loin d’être un phénomène isolé, Troy Duster note depuis les années 1980 « une augmentation géométrique des publications décrétant l’existence d’une base génétique pour des phénomènes aussi disparates que la timidité, le viol, la maladie mentale, l’alcoolisme, la criminalité et même la position sociale et économique »20 dont il est significatif que Pierre Bourdieu en ait signé une préface « Pour une « généthique » » dans laquelle il affirme avec force que « le conservatisme a toujours eu partie liée avec toutes les formes de pensée qui tendent à réduire le social au naturel, l’historique au biologique »21.
2. Les apports possibles d’une « sociologie spinoziste » des addictions
La sociologie a donc lutté en tant que science jeune pour accéder à une relative autonomie et revendiquer la pertinence de son point de vue face à la philosophie, la psychologie ou les sciences naturelles. Comme la définition d’E. Loonis en donnait un exemple, le phénomène de l’addiction est, sinon exclusivement, du moins prioritairement appréhendé d’un point de vue médical, qu’il concerne diverses substances telles que la consommation de drogues, la dépendance à la cigarette ou l’ingestion abusive de nourriture, et c’est par conséquent dans une même optique que sont traditionnellement pensés les moyens en vue de la réfréner. Pour illustrer la pertinence et l’intérêt de recourir à une perspective sociologique, nous voudrions montrer dans un premier temps que par le diagnostic nouveau qu’elle porte sur l’addiction, elle modifie substantiellement la manière de la traiter, et d’autre part qu’elle permet de radicaliser sa définition en ne la réservant pas, comme c’est souvent le cas, à certaines dépendances, mais peut-être à l’immense majorité des activités sociales. La philosophie de Spinoza nous sera un allié théorique précieux dans ce cadre, en tant qu’elle présente des congruences réelles avec la sociologie holiste comme le résume F. Lordon :
On n’aurait guère de peine à évoquer toutes les caractéristiques de la philosophie spinoziste qui font étrangement écho aux thèses structuralistes et qui, depuis la désubstantialisation de l’homme, la conception de l’individualité comme nexus de rapports, jusqu’au déterminisme rigoureux, en passant par la dépossession de la conscience et de la volonté, la font considérer rétrospectivement comme un anti-humanisme théorique avant la lettre22.
Paradoxalement, les postulats de départ du point de vue biologique dont nous souhaitons nous écarter sont pourtant précisément présents pour la plupart chez Spinoza alors même que cet auteur pourrait nous permettre de dépasser ces antinomies. Des ouvrages célèbres du courant biopsychologique d’Antonio Damasio tels que Spinoza avait raison, Odile Jacob, 2003 ou L’erreur de Descartes, Odile Jacob,1995 ont en effet symbolisé la prééminence d’une métaphysique spinoziste sur la métaphysique cartésienne notamment par la représentation moniste du corps et de l’esprit qu’a développée le penseur hollandais contre le dualisme cartésien. Sébastien Lemerle établit également sciemment un parallèle entre biologisme et spinozisme en reprenant la définition célèbre du conatus dont il fait le principe central des théories biopsychologiques23. Enfin, le concept de « nature humaine » qui sous-tend ces explications est un tabou légitime24 que partagent les visions biopsychologique et spinoziste25.
Dans le cadre d’un traitement efficace de l’addiction tel que Spinoza et la sociologie holiste pourrait nous en fournir les premières pistes, l’une des propositions les plus importantes du philosophe hollandais avertit à l’intention de tous ceux qui pensent que l’affichage d’une morale pourrait être suffisant que « La vraie connaissance du bien et du mal, en tant que vraie, ne peut réprimer aucun affect, mais seulement en tant qu’on la considère comme un affect »26 et c’est dans cette perspective qu’il reprend les mots d’Ovide : « je vois le meilleur et l’approuve, je fais le pire » (Éthique, IV, § XVII). Rationaliste par excellence, faisant de la Raison et de son extension à tous les individus la vertu suprême, Spinoza n’est pas pour autant dupe de la faiblesse intrinsèque de celle-ci par rapport aux passions et que Bourdieu aimait à résumer en disant qu’« il n’y a pas de force intrinsèque de l’idée vraie »27. En ce sens, la simple conscience rationnelle de l’addiction par l’individu affecté ne suffira pas à son extinction et tout phénomène addictif ne peut pas se combattre sur le terrain de la raison pure. C’est ce que note d’une certaine façon S. Lemerle à propos des revues et ouvrages ayant adopté un point de vue biopsychologique et qui conduit à une vision « entrepreunariale » dans laquelle, parce que l’individu est postulé libre, autonome et responsable, il pourra sortir de sa situation à force de volonté :
Lorsqu’il s’agit de conquérir un lectorat, il est toujours plus payant de promouvoir des approches optimistes présentant un projet d’amélioration, même modeste, de la situation de chacun pris isolément, que des analyses portant sur des structures symboliques ou socioéconomiques inaccessibles aux individus, aussi souverains soient-ils28.
Contrairement aux chimères d’une reprise en main de l’individu souffrant d’une addiction par une décision rationnelle et par l’effort consenti par son libre-arbitre, la vision spinoziste fait de l’« affect » le guide qui oriente les actions des individus dans une certaine direction. Dans cette perspective, l’affichage froid des statistiques de mortalité en cas de consommation prolongée d’une substance aura par exemple toujours moins de poids sur une personne que le choc de la mort d’un proche dans les mêmes circonstances, l’autorité symbolique de l’avertissement du médecin, ou encore plus largement tous les affects de tristesse dus à la perte de son cadre de socialité. Spinoza décrit un mécanisme quantitativiste selon lequel « un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n’est par un affect contraire et plus fort que l’affect à réprimer » (Éthique, IV, § VII) qui indique l’affrontement affectif qu’il faudra opposer à l’addiction qui ne cessera que sous l’effet d’un affect de sens contraire et de plus grande intensité. En ce sens, Neal Grossman en résume toute la dimension aporétique :
Certes, de la connaissance du bien et du mal surgit le désir de chercher le premier et de fuir le second ; mais la force de ce désir est souvent faible par rapport aux désirs qui résultent de l’effort des divers modèles et sous-systèmes en nous. Ainsi, l’individu présentant une addiction au tabac devrait savoir que le tabagisme n’est pas bon pour lui et de ce savoir devrait naître un désir d’arrêter de fumer, mais ce désir qui, comme le dit Spinoza, jaillit de la raison, sera faible par rapport au désir qui découle de l’effort du modèle addictif de se perpétuer29.
Henri Atlan, biologiste marqué par la lecture de Spinoza, résume ce que la pensée spinoziste peut apporter au traitement de l’addiction en écartant l’hypothèse intellectualiste :
Il y a un exemple de ce que, comme toute addiction, un désir initialement neutre, comme le désir de boire un alcool par exemple, peut être aliéné et aliénant quand il est excessif. Et comme toute addiction aussi, il ne peut pas être atténué sinon supprimé par la seule prise de conscience de son existence et la connaissance intellectuelle de sa nature et de sa force. Il faut en outre un effet sur le corps, c’est-à-dire sur l’ensemble de ce qui constitue la force des affects. Il faut autrement dit que d’une façon ou d’une autre cette connaissance soit tricotée et intégrée à elle-même comme un affect susceptible d’orienter le désir30.
Le concept d’« addiction » ne faisait certes pas partie en tant que tel de l’horizon intellectuel des philosophes du XVIIème mais en réfléchissant aux critères d’une « vie bonne », ceux-ci ont été conduits à proposer des distinctions quant aux actions jugées « bonnes » ou « mauvaises » qui pourraient correspondre à la frontière que tentent d’établir certains entre addictions et « pratiques saines ». Aux propositions 42 et 43 de la partie IV de l’Éthique, Spinoza marque une différence importante entre Hilaritas31 et Titillatio32. Il démontre que l’Allégresse (Hilaritas) et le Chatouillement (Titillatio) se séparent quant à ce que cette dernière ne concerne pas toutes les parties du corps en même temps. Une action est donc jugée bonne par Spinoza quand elle ne provoque pas un plaisir ne sollicitant qu’une faible part de notre corps mais qu’elle implique au contraire l’augmentation de la puissance d’agir de l’ensemble des parties du corps de l’individu. Ne faisant donc volontairement pas sa part aux « propriétés » de l’addiction généralement mises en avant, telles que dépendance et souffrance, cette hiérarchie des plaisirs qu’établit Spinoza explique pourquoi certaines actions, en ce qu’elles mobilisent une ou plusieurs parties du corps mais rarement son ensemble, sont déconsidérées par le penseur hollandais. Toute passive qu’elle soit, l’Hilaritas présente du moins l’avantage de ne pas déséquilibrer les rapports entre les parties du corps et d’être ainsi, comme le dit Spinoza, « toujours bonne ». Le philosophe hollandais va néanmoins plus loin car tout son effort intellectuel aura consisté en l’effort de libérer les hommes des passions, c’est-à-dire des actions dont ils ne sont pas « cause adéquate » et dont ils ne peuvent dès lors estimer les mener en toute liberté. La lutte contre l’addiction pourrait relever d’une logique similaire et s’inspirer avec profit de la démarche de libération spinoziste au risque de faire vaciller considérablement la frontière du normal et du pathologique…mais n’est-ce pas une fonction de la sociologie holiste, telle que la concevaient Durkheim et Bourdieu, que de déciller les individus sur les réelles motivations de leurs actions, rejoignant la formule de Spinoza :
Les hommes se trompent en ceci qu’ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Cette idée qu’ils ont de la liberté vient donc de ce qu’ils ne connaissent aucune cause à leurs actions» (Éthique, II, § XXXV).
La perspective nouvelle offerte par une certaine sociologie holiste, en lien avec la philosophie déterministe de Spinoza, permet de mettre au jour un traitement de l’addiction radicalement différent des entreprises intellectualistes. Ce point de vue sociologique recèle peut-être également d’autres promesses quant à la possibilité de radicaliser la définition et d’accroître le périmètre un peu convenu des addictions. Il est en effet possible de se demander si une conception élargie mais loin d’être déraisonnable de celles-ci ne pourrait pas inclure plus généralement toute illusio étudiée par Bourdieu, c’est-à-dire toute activité sociale actualisée dans un « champ » et dans laquelle un individu a trouvé à s’investir de manière déterminée. Il n’est en effet pas simple de définir à partir de quel seuil une activité devient une addiction. Concerne-t-elle uniquement les pratiques, quel que soit leur objet, qui accaparent un individu un certain nombre d’heures par jour ? Doit-on nécessairement ajouter une dimension subjective de souffrance ressentie au risque de manquer ce que la terminologie marxiste, dans une perspective cette fois objectiviste, a appelé « aliénation » ou « fausse conscience de classe » ? A l’inverse, une vie sans addiction sociale ou illusio est-elle autre chose qu’une forme de mort sociale ? En reconfigurant la catégorie marxiste si fameuse d’ « aliénation », F. Lordon permet peut-être de repenser l’ensemble des illusios comme addiction sociale dans un domaine particulier et dont Bourdieu précisait, en recourant au vocabulaire significatif d’« emprise » :
Ce qui est vécu comme évidence dans l’illusio apparaît comme illusion à celui qui ne participe pas de cette évidence parce qu’il ne participe pas au jeu. Les sagesses cherchent à désamorcer cette sorte d’emprise que les jeux sociaux détiennent sur les agents socialisés. Ce n’est pas chose facile : on ne se détache pas par une simple conversion de la conscience33.
Pour ne prendre qu’un exemple, l’artiste ne s’accordant jamais de repos pour mener à bien ses projets n’est-il pas en effet, toute valorisée socialement que soit son activité, prisonnier inconscient de cette occupation dont il peut à bon droit déclarer qu’elle le rend heureux mais dont il n’a généralement pas la réflexivité de considérer qu’un ensemble de déterminations, de sa socialisation primaire jusqu’aux rencontres qu’il a faites, l’ont poussé dans une direction dont il ne pourrait aujourd’hui revenir ? A l’inverse d’H. Atlan qui évoque, dans le passage cité plus haut, un désir neutre « aliéné et aliénant quand il est excessif », la pensée spinoziste établit que l’aliénation est la condition universelle des hommes en tant qu’ils désirent. La sociologie ne fait en ce sens pas seulement proposer un diagnostic différent des causes des addictions mais permet aussi d’élargir le champ de celles-ci au point de se demander si elles ne sont pas un trait commun aux individus, parce qu’universellement aliénés. C’est la connaissance des causes véritables et le remplacement des idées confuses par les idées adéquates nées de cette connaissance qui forment le réquisit de la libération spinoziste. Dès lors, seule la voie spinoziste permettant de passer du régime des affects passifs à celui des affects actifs, c’est-à-dire d’affects dont l’auteur pâtît en ce qu’ils lui sont déterminés par l’extérieur à des affects dont leur auteur est entièrement la cause, pourrait correspondre à une désaddiction réelle.
3. Illustration des vertus de la perspective sociologique : l’exemple du workaholism
Le phénomène d’addiction au travail répandu sous son nom anglo-saxon de workaholism pourrait constituer un exemple illustrant notre idée des gains possibles d’une analyse macrosociologique des addictions, dans le traitement non intellectualiste à lui apporter et dans la prise en compte élargie de ses avatars au-delà des figures convenues de la dépendance aux substances psychotropes. L’addiction au travail, généralement appréhendée du point de vue psychologique, est définie comme :
un investissement excessif dans les activités professionnelles s’accompagnant d’une présence abusive sur le lieu du travail et/ou de la recherche frénétique de la performance ou de la productivité, à l’origine d’une négligence ou d’un désintérêt pour les autres domaines de la vie et pouvant conduire à des répercussions physiques et psychologiques culminant dans un stade d’épuisement professionnel (« burnout »)34.
Le chapitre qui lui est consacré dans un ouvrage collectif comporte une section intitulée « Raisons sociales et économiques », retranscrite intégralement ci-dessous, et qui symbolise par sa très faible ampleur et la généralité de ses propos le peu d’importance accordée à cette forme nouvelle de l’addiction.
Si le structuralisme peut être très généralement défini comme l’étude des petites et grandes structures qui conditionnent le comportement des individus sans que ceux-ci n’en soient conscients, le workaholism au-delà de ses manifestations purement phénoménologique et clinique, gagnerait à être étudié du point de vue de ses causes sociales. Le point commun de ceux que leurs différents contempteurs ont nommé au choix « philosophes du soupçons » ou encore « anti-humanistes », dont Spinoza serait l’une des premières figures, est en effet le caractère inconscient et déterminé par l’extérieur qui caractérise l’action des hommes, déterminés sans qu’ils le sachent, et aussi libres, selon l’image kantienne, qu’un « tournebroche qui, lui aussi, une fois qu’il a été remonté, accomplit son mouvement de lui-même »36… Ce point de vue n’est pas sans inconvénient puisque le caractère inconscient des effets des structures tient en grande partie à l’invisibilité des institutions avec lesquelles les individus entrent en contact pourtant quotidiennement. Il est en effet difficile à un individu de se remémorer sa dernière rencontre avec la déréglementation financière ou, de manière encore plus générale, avec le « régime d’accumulation néolibéral » tel que l’a défini en économie le courant de la Régulation. L’intensification de la concurrence sera par exemple vécue par les salariés au niveau de l’entreprise, par l’intermédiaire de nouvelles contraintes managériales, ces dernières étant rarement appréhendées par eux comme conséquence de transformations économiques plus profondes dont les équipes managériales ne sont que les supports passifs. Plutôt que de ne considérer que le résultat addictif et d’en étudier ses manifestations, la sociologie s’intéresse ainsi au « processus addictant » c’est-à-dire à l’émetteur, au cadre institutionnel qui permet, voire engendre, celui-ci. C’est dans cette perspective sociologique qu’il serait pertinent d’explorer, s’agissant du workaholism, les conséquences d’une transformation d’un capitalisme qui ont fait de l’addiction au travail, quasiment impossible au cours des siècles précédents, l’aliénation moderne propre à ce régime institutionnel. S’il ne faut pas repousser une hypothèse pour la simple raison que l’administration de la preuve en est complexe, force est d’admettre la singulière difficulté de ce point de vue macrosociologique qui pourrait également s’intéresser aux cas de l’addiction au jeu (gambling addiction) ou à l’alcool en montrant les conditions sociales de possibilité de ces pratiques. Ces deux addictions pourraient être analysées, à titre de pure hypothèse intuitive et au sein d’un ensemble de causes plus larges qu’il s’agirait également d’explorer rigoureusement, comme conséquences d’une dégradation de la situation économique portant à des pratiques que des temps plus prospères avaient tendance à exclure. Il va de soi qu’il s’agit là d’une illustration caricaturale dont le caractère de « sociologie spontanée » ne doit être qu’une incitation à explorer plus en détail cette conjecture pour la confirmer ou l’infirmer. A contrario, il ne serait en effet pas totalement absurde de penser à titre tout aussi purement hypothétique que les addictions au jeu sont statistiquement plus élevées lorsque les inégalités économiques et sociales se réduisent, en tant que le souci de se distinguer et l’aspiration aux gains d’argent rapides deviennent dès lors plus intenses.
Pour en revenir à l’addiction au travail, dans le cadre d’institutions capitalistes qui ne laissent de toute façon pas d’autre choix du point de vue de la reproduction matérielle que le salariat37, celle-ci pourrait alors être considérée comme une sorte de nécessité faite vertu. Le workaholism serait-il pensable dans un cadre non-capitaliste et n’est-il pas une conséquence d’un cadre économique dans les structures duquel évoluent et s’adaptent les individus ? Le salariat tel que l’analysait Marx est en effet un rapport social asymétrique auquel ne peuvent, sauf rares exceptions, échapper les individus : « cette vérité première du rapport salarial est qu’il est d’abord un rapport de dépendance, un rapport entre agents dans lequel l’un détient les conditions de la reproduction matérielle de l’autre et que tel est le fond inamovible, l’arrière-plan permanent de tout ce qui pourra s’élaborer par là-dessus »38. F. Lordon forge le concept d’épithumè39, en référence à celui foucaldien d’epithème ainsi qu’à celui de thumos, pour caractériser le régime de désir mobilisant les individus dans le travail. Au sein de cet epithumè capitaliste, et dans la lignée des travaux régulationnistes, F. Lordon distingue trois régimes d’affects qui scandent les transformations du capitalisme depuis le XIXème siècle. Dans le premier régime dit « concurrentiel » de la fin du XIXème siècle, l’affect général est intrinsèque et de tristesse : l’enrôlement salarial est lié à la survie et à la reproduction matérielle et tout salarié récalcitrant est quasiment condamné40. Dans le second régime qui caractérise la période fordienne dite des Trente Glorieuses, l’affect principal est extrinsèque et mobilise les salariés par la promesse des possibilités élargies d’acquisition que l’on a résumées par le terme de « consommation de masse ». Enfin, le régime post-fordien ou néolibéral marque le retour à une mobilisation affective intrinsèque par le travail en lui-même, source de joie et de « réalisation ». En alignant désirs patronal et salarié, ce régime est ainsi censément intrinsèquement pourvoyeur d’affects de joie en tant que les salariés sont requis de « se réaliser dans leur travail ». Comme le souligne F. Lordon, « s’il peut désormais les convaincre de la promesse que la vie salariale et la vie tout court de plus en plus se confondent, que la première donne à la seconde ses meilleures occasions de joie, quel supplément de mobilisation ne peut-il en escompter ? »41. Cette addiction au travail était ainsi impossible dans une configuration antérieure du capitalisme qui faisait de l’emploi la seule contrepartie à la reproduction biologique des individus, c’est-à-dire dans laquelle il n’était pas envisageable de pouvoir s’y épanouir. Aujourd’hui, à l’inverse, des « chargés de bonne humeur » sont employés par certaines entreprises dans le but de favoriser la dépendance des salariés à un cadre professionnel à même de leur procure parfois plaisir et relations de sociabilité.
A l’encontre d’une vision uniquement centrée sur les contraintes du management, etc., il s’agit de remonter plus haut dans la chaîne des causes afin d’analyser les raisons de plus longue distance qui conduisent à ces évolutions trop souvent jugées tombées du ciel. En permettant de remonter au cadre institutionnel, le point de vue sociologique donne à voir les causes profondes, bien que non exclusives, d’événements trop souvent étudiés dans leurs manifestations locales. Là réside rien moins que l’enjeu même de la sociologie à laquelle Durkheim confiait la tâche de substituer aux « faits divers » des « faits sociaux », donnant lieu à une intelligibilité nouvelle, ce que disait également de manière forte Bourdieu lorsqu’il écrivait à propos de la sociologie dont la part intrinsèquement politique n’était pas niée : « Il me semble que le chercheur n’a pas le choix aujourd’hui : s’il a la conviction qu’il y a une corrélation entre les politiques néolibérales et les taux de délinquance, et tous les signes de ce que Durkheim aurait appelé l’anomie, comment pourrait-il ne pas le dire ? »42.
Le caractère potentiellement « totalitaire » d’une vision consistant à « faire le bonheur des gens contre leur gré » et à affirmer que même ceux qui s’épanouissent dans leur activité professionnelle ne le font que par nécessité faite vertu ne manquera pas d’être soulevé, en partie à juste titre. Cependant, d’une part Spinoza montre par l’absurde qu’aussi invraisemblable que cela puisse paraître, s’il apparaissait à un individu plus agréable d’être suspendu à une potence qu’à sa table il « agirait comme le dernier des idiots s’il ne se pendait pas »43. D’autre part, il s’agit moins de faire un quelconque tri entre certaines addictions sociales jugées plus nocives que d’autres -Spinoza en est d’autant moins suspect qu’il affirme qu’il n’y a pas de Bien et de Mal en soi mais seulement du Bon ou du Mauvais suivant la complexion propre à chaque individu (Éthique, IV, Préface) – que de montrer la servitude passionnelle dont tous les individus sont les sujets. C’est là d’ailleurs la subtilité de l’addiction sociale puisqu’à l’inverse de la dépendance aux drogues elle n’entraîne parfois ni conséquence pour la santé ni souffrance sociale apparente. Pourtant, en la réinsérant par concaténation -c’est-à-dire en rétablissant le long enchaînement de causes et d’effets généralement inaccessibles aux individus- comme conséquence d’un cadre s’imposant à eux sans qu’ils en aient conscience et déterminant leurs choix et l’horizon de leurs désirs, il est possible de favoriser cette libération par la prise de conscience corporelle des déterminismes, commune au spinozisme et à une certaine sociologie critique.