« La terreur de l’imprévu »
« La terreur de l’imprévu » : Sur la signification politique de l’uchronie dans Le complot contre l’Amérique de Philip Roth
Kevin Ladd. Professeur de philosophie en CPGE au lycée Montaigne (Mulhouse). Docteur en philosophie et chercheur associé au centre Chevrier de l’Université de Bourgogne.
Résumé
L’article examine, en se fondant principalement sur l’étude du Complot contre l’Amérique et de l’œuvre tardive de Philip Roth, la signification politique de cette forme d’« expérience de pensée » qu’est l’uchronie (« alternate history »), par contraste avec la contre-utopie (« dystopia »). Roth décrit une « vague de l’histoire » aussi « invraisemblable » qu’« irréfutable », et il convient de s’interroger sur l’intérêt politique qu’il y a à rappeler cette fragilité essentielle de la trame historique. L’article émet l’hypothèse que Roth, lecteur d’Orwell, met en question la figure de « l’homme ordinaire » et l’idée de « décence commune » défendues par le romancier britannique. Selon Roth, le genre de morale individuelle et optimiste que plébiscite la démocratie américaine, et qui fait en partie sa valeur, constitue aussi sa principale faiblesse.
Mots-clés : Philip Roth – George Orwell – Expérience de pensée – Uchronie – Histoire – Contre-utopie – Démocratie
Abstract
This paper investigates the political meaning of alternative history as a « thought experiment », contrasting it with dystopia, mainly through the study of The Plot Against America and Philip Roth’s later work. Roth describes a « wave of history » as « unlikely » as it is « undeniable », and one has to wonder whether reminding the reader of history’s essential fragility is politically relevant. The article suggests that Roth, a reader of Orwell, challenges the figure of the « ordinary man » and the Orwellian notion of « common decency ». According to Roth, the kind of individualistic and optimistic morality that American democracy promotes, while it’s part of its worth, also constitutes its main weakness.
Keywords : Philip Roth – George Orwell – Thought experiment – Alternate history – Dystopia – Democracy
C’était là notre vice :
d’avancer avec, toujours, la tête tournée en arrière.
Giorgio Bassani[1]
Introduction : « Dé-fataliser le passé[2] »
1. Lindbergh, le nom d’une catastrophe
Pourquoi écrit-on une uchronie ? Et que fait-on en l’écrivant ? Le complot contre l’Amérique (2004) est d’abord une méditation sur les entrelacs et les conflits de l’histoire et de la mémoire[3]. C’est la tentative d’un romancier de 70 ans pour donner une consistance à ce qui n’aura été, pour l’enfant Philip Roth, qu’abstraction ou source d’incrédulité : la persécution des Juifs d’Europe – une éducation à distance « dans la souffrance de l’histoire[4] ». C’est aussi, dans l’esprit de La contrevie (1986), « une hypothèse ludique et une spéculation sérieuse tout à la fois[5] » sur l’identité des descendants d’immigrés juifs européens aux États-Unis. C’est enfin une façon de mettre en lumière une période un peu oubliée de l’histoire américaine – les années d’avant-guerre marquées par le fascisme et les sympathies nazies d’hommes comme Ford ou Lindbergh. Une chose pourtant est de reconstituer une période de l’histoire par le biais de personnages de fiction (tel le militant Ira « Iron Rinn » Ringold dans J’ai épousé un communiste) dans le but de redonner de sa chair à l’histoire momifiée des chronologies et des manuels, autre chose de transformer des figures historiques comme Lindbergh ou Winchell en acteurs d’événements qui ne se sont jamais produits.
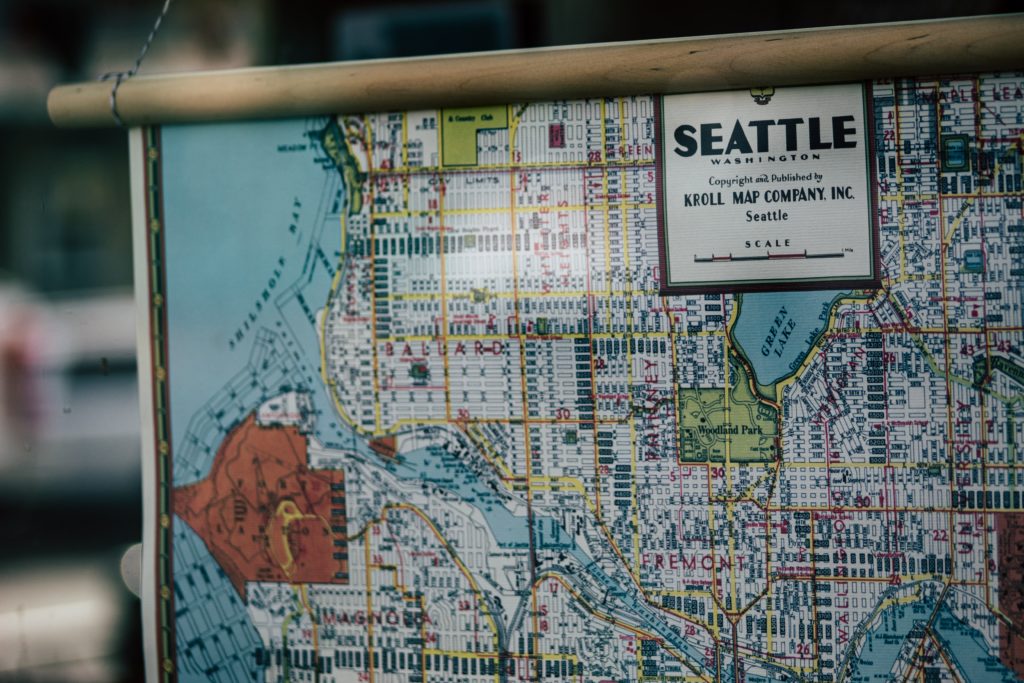 L’hypothèse d’un Lindbergh président n’a pas, en ce sens, pour but premier de nous faire « revivre une période » : d’autres moyens plus sobres auraient été à disposition du romancier. Le Complot n’est pas non plus une mise en garde politique au sens où le sont Impossible ici ou 1984, du fait que la « peur » qui s’y exprime est en premier lieu rétrospective[6]. Ce roman, qui paraît de prime abord et historique et politique, n’est donc en réalité ni l’un ni l’autre ; mais comme il parle et de politique et d’histoire, on doit en conclure que son objet principal réside dans le rapport entre les deux.
L’hypothèse d’un Lindbergh président n’a pas, en ce sens, pour but premier de nous faire « revivre une période » : d’autres moyens plus sobres auraient été à disposition du romancier. Le Complot n’est pas non plus une mise en garde politique au sens où le sont Impossible ici ou 1984, du fait que la « peur » qui s’y exprime est en premier lieu rétrospective[6]. Ce roman, qui paraît de prime abord et historique et politique, n’est donc en réalité ni l’un ni l’autre ; mais comme il parle et de politique et d’histoire, on doit en conclure que son objet principal réside dans le rapport entre les deux.
Dans le droit fil de la « trilogie américaine » (1997-2000), qui explorait le thème du caractère imprévisible et proprement catastrophique de l’histoire[7], Roth met en effet l’accent sur la faiblesse de la démocratie face à la toute-puissance de l’événement. Cela va au-delà du constat portant sur la fragilité du libéralisme en tant que culture politique[8] : ce sont les institutions démocratiques elles-mêmes, un produit de l’histoire, qui sont mises en péril par l’histoire. L’histoire, pour ce lecteur de Malamud qu’est Philip Roth, n’est ni cycle, ni providence[9], ni processus orienté[10], mais mouvement aveugle et incontrôlable, qui se déploie en une série de catastrophes. La catastrophe, c’est ce qui n’est reconnu rétrospectivement comme possible que parce que cela a bel et bien été réel ; et si l’hypothèse de Lindbergh président laisse le lecteur (comme les personnages, du reste) incrédule mais confusément horrifié, c’est là, paradoxalement, tout le propos du livre. L’histoire accouche de ce personnage certes pas impossible mais pas pour autant prévisible, le « président Lindbergh ».
2. Lindbergh et Philip Roth : Uchronie, autofiction et métafiction
Le Complot n’est pas seulement l’histoire de Charles Lindbergh : c’est aussi celle d’un certain Philip Roth né, comme le romancier du même nom, en 1933. En tant que parodie de témoignage historique en première personne, le roman, qui relève de la « métafiction »[11], peut être décrit comme uchronie d’autofiction – ou autofiction uchronique. La réversibilité des deux formules devrait toutefois susciter la méfiance. Autofiction et uchronie sont deux choses très différentes, pas seulement parce que celle-ci a une portée politique qui fait défaut à celle-là, mais surtout parce que l’une et l’autre ont leurs racines dans deux formes très différentes de scepticisme. L’autofiction est une héritière de Montaigne, de Hume, de Nietzsche : elle exprime l’idée, devenue banale, que l’introspection est impossible, ou dénuée de vérité, que Je est un autre, que l’autre est inconnaissable[12], que le personnage s’évanouit dans le récit[13], et qu’il ne reste qu’à substituer à l’auteur le personnage-récit – après Portnoy, Zuckerman et Kepesh entre en scène un personnage nommé Philip Roth qui ne se réfère qu’en partie à Philip Roth le romancier[14]. Il y a bien entendu circulation entre les thématiques politiques et l’autobiographie : par exemple, que le Complot adopte le point de vue de l’enfant[15] est cohérent avec le fait que, dans l’ensemble de l’œuvre romanesque de Roth, le narrateur ou le personnage principal est témoin bien davantage qu’acteur politique[16]. Les figures politisées, dans l’Amérique de Roth, ce sont plutôt des jeunes femmes décrites comme sans attrait – Sheila Epstein[17], qui préfigure la Meredith Levov de Pastorale américaine – ou bien de vieux tribuns comme Walter Winchell. Par contraste, la révolte des jeunes hommes est plus culturelle que politique[18]. Mais d’une part, comme l’écrit Roth dans une formule rarement citée, « il y a un moment dans tout acte où le problème de savoir s’il s’agit de soi ou de quelqu’un d’autre reste strictement académique[19] ». D’autre part, ce n’est pas cet aspect du livre qui m’intéresse – le complot contre l’autobiographie, si je puis dire, comme dans Les faits –, ni de savoir si un personnage qui vit une autre histoire est encore le même, mais le thème historique et politique que l’auteur a choisi de traiter.
Or sur ce point Roth n’a rien de particulièrement « post-moderne » – post-modernité dont il épingle à l’occasion les principales têtes d’affiche[20]. Nulle trace chez lui de ce scepticisme outré à la Foucault ou à la Paul Veyne, qui voudrait qu’il n’y ait jamais de faits en histoire[21], seulement des « interprétations », jamais de vérité, seulement du « pouvoir »[22]. Contrairement à ce qu’on lit fréquemment[23], il ne me semble pas que la question principale de Roth dans le Complot ait à voir avec l’écriture de l’histoire ou la distinction history-story : les commentateurs semblent souvent confondre le caractère imprévisible et le caractère inconnaissable des causalités historiques[24]. L’envers de l’histoire est le mythe : or Roth a régulièrement décrit la perte des illusions d’une génération à l’égard de la « mythologie américaine »[25]. L’envers de la démocratie est la mystification, comme Roth l’a montré dans Tricard Dixon, en se plaçant dans les pas d’Orwell[26]. Mythe et mystification sont au cœur du Complot : le mythe d’une démocratie américaine immunisée, par son histoire, contre la mystification politique[27].
3. Lindbergh et Tricard Dixon, d’une satire l’autre
Dès lors, quel but politique Roth se propose-t-il, « dans un pays où, depuis La case de l’oncle Tom, aucun livre n’a jamais moindrement infléchi le cours des choses[28] » ? Tout un aspect du roman consiste à avertir le lecteur, précisément, de la vanité des mises en garde. Comme 1984 et Impossible ici, auquel Roth fait allusion dans Pastorale américaine[29], le Complot dépeint certes les menaces qui pèsent sur la culture libérale des démocraties occidentales. Mais si Roth n’a pas repris la veine satirique de Henry Mencken[30], Sinclair Lewis ou Joseph Heller, l’auteur de Catch 22 – si en d’autres termes le Lindbergh du Complot n’est pas un avatar de Tricard Dixon –, c’est que le danger qu’il représente est bien différent, et que le risque de corruption du langage n’est pas le seul à menacer la démocratie[31]. La figure de l’aventurier Charles Lindbergh[32] est la solution que Roth a trouvée à un problème d’ordre politique autant que littéraire[33] : comment personnifier le danger fasciste[34], lui donner un visage, sans pour autant personnaliser les enjeux historiques et politiques ?
I. Réécrire l’histoire en romancier
Le temps est un enfant qui s’amuse, il joue au trictrac.
À l’enfant la royauté.
Héraclite, fragment B52
Une chose qui surprend dans la plupart des commentaires du Complot, c’est l’absence de prise en compte du travail de l’écrivain et du sens qu’il y a à réécrire l’histoire en romancier – ni pour la romancer, ni pour l’exhumer (pensons au Nat Turner de William Styron), ni pour en « recouvrer la possession[35] », ni même pour faire entendre la multiplicité de ses voix[36]. Réécrire l’histoire, c’est pour Roth prendre une revanche sur « l’imprévu intransformé[37] » de l’histoire vécue, se mettre à l’abri de l’histoire réelle et « prêter un sanctuaire au combat des assiégés[38] ». Mais justement : un historien de métier pourrait lire le Complot comme un divertissement plus ou moins efficace et instruit, et y voir dans le même temps une forme (bien peu orwellienne) d’irresponsabilité scientifique, donc politique. L’imagination littéraire a ses propres règles, soit, mais l’écrivain se condamne parfois à écrire des choses tout bonnement fausses, et peut-être même à amener de l’eau au moulin de tous les faussaires de l’histoire – en particulier lorsqu’il adopte un titre aussi connoté que celui de « complot ».
Il y a une part de vérité biographique et, pour ainsi dire professionnelle, dans cette irresponsabilité[39] : le Nathan Zuckerman de J’ai épousé un communiste et le Philip Roth du Complot n’aspirent nullement à faire l’histoire[40]. Quant au romancier, il est de toute façon hors de l’histoire[41], non pas parce qu’il est un faiseur d’histoires, mais parce que raconter n’est pas agir, et qu’à moins de posséder le génie de Cervantès, de Swift ou d’Orwell, ou l’élan révolutionnaire de Rousseau, de Paine ou de Marx, décrire le monde ne suffit pas à le changer[42].
Il faut pourtant aller plus loin : l’irresponsabilité du romancier reflète en réalité celle de l’histoire, qui ne respecte ni les hommes ni les peuples, et semble obéir à une mécanique aveugle et détraquée[43]. La contingence radicale du roman, dans le choix de son intrigue et de ses péripéties[44], exprime celle de l’histoire. Le travail de l’écrivain rend manifeste, à sa façon, le paradoxe décrit par René Rémond : « La distorsion entre l’incapacité des contemporains à prévoir leur propre avenir et l’aptitude des historiens à en rendre compte a posteriori est troublante.[45] » On demandera par exemple « pourquoi Lindbergh ? » Mais, implicitement, Roth semble demander : « Et pourquoi Roosevelt, pourquoi Churchill – pourquoi Hitler ? » Celui qui prétendra qu’on peut rendre raison de Hitler mais pas de Lindbergh aura simplement oublié l’avertissement de René Rémond. L’uchronie est ce procédé qui permet de revenir, en-deçà d’une « histoire bénigne, où tout ce qui [est] inattendu en son temps [devient] inévitable dans la chronologie de la page[46] », à ce que l’histoire a d’étonnant et d’effrayant. Le lecteur vit ainsi chaque événement en dehors du contexte sécurisant que procure sa propre connaissance rétrospective, et est mieux à même d’apercevoir la nature profondément anhistorique et archaïque du nazisme[47]. L’uchronie fait voir ce qu’il y a de vain à vouloir arraisonner ou enfermer la contingence et le chaos de l’histoire dans quelque récit que ce soit[48], puisque l’histoire a la même autorité discrétionnaire sur les événements qui se produisent que le romancier sur les péripéties qu’il invente. Le lecteur de romans est aussi peu fondé que le témoin du temps présent à dire : « Je savais comment tout cela devait finir. » Qu’une histoire ait un sens voire une forme d’évidence implique tout, sauf qu’elle était la seule possible.
L’art romanesque n’a rien de gratuit : ce qui par exemple apparaît souvent comme une faiblesse narrative du Complot, la soudaine et inexpliquée disparition de Lindbergh, vise à montrer que ce ne sont pas la force des valeurs libérales ni la vigueur des institutions démocratiques qui ont tenu le fascisme en échec, mais plutôt quelque chose de l’ordre du « grain de sable » pascalien[49]. Symétriquement, le personnage de Lindbergh ne semble pas même digne du danger qu’il représente : ni génie du mal, ni personnalité se signalant par un talent politique spécial ou une volonté à toute épreuve, il est étrangement désincarné, lointain, sans vie – même le terme de « complot » paraît trop grand pour lui. Et pourtant Roth nous dit, dans une satire élevée au carré du Louis Bonaparte que croquait Marx dans le 18 Brumaire, que même lui peut constituer le pire des dangers.
II. Deux « expériences de pensée[50] » : l’uchronie et la contre-utopie
Mais à quoi bon toutes ces suppositions ? Ça ne mène jamais à rien. C’est absurde de supposer quand il y a tant de faits réels à prendre en considération.
Sinclair Lewis[51]
Le choix même d’écrire un roman politique annonce un rappel ou une mise en garde. Or, comme le souligne Bernard Williams, « les rappels à l’ordre sont utiles là seulement où quelque chose est susceptible d’avoir été oublié[52] » : quels sont ces faits ou ces vérités d’ordre politique qui, dans le Complot, méritaient d’être rappelés ?
Il y a en premier lieu les faits qu’on oublie, ou dont l’histoire elle-même est l’oubli[53]. Des faits nullipares, ou à la descendance prématurément disparue, qui sont autant de potentialités non réalisées mais font tout de même partie de l’histoire d’une nation – comme la « force sociopolitique » qu’a pu représenter le fascisme aux États-Unis dans les années 1930 et 1940[54]. Le post-scriptum du Complot, qui contient des indications chronologiques précises, montre que le roman n’est pas qu’une simple « spéculation historique[55] », mais qu’il est bel et bien fondé sur des faits, des faits sur lesquels reposent à leur tour d’autres faits possibles. Rappeler ces faits, ce que Roth appelle joliment « éclairer le passé à la lumière du passé[56] », c’est du même coup rappeler le caractère récent et non achevé de la démocratie libérale aux États-Unis. Au cœur du monde libre des années 1930 et 1940 prospéraient en effet d’authentiques fascistes comme Ford et Lindbergh qui, à la différence de Moseley en Angleterre, ne connurent jamais la disgrâce. Roth explique : « Ce qui compte dans mon roman, ce ne sont pas les épreuves que [Lindbergh] impose aux Juifs […] mais ce que les Juifs redoutent qu’il soit capable de faire d’après ce qu’ils l’entendent dire publiquement.[57] » Voilà la raison de la « peur perpétuelle[58] » sur laquelle s’ouvre et se clôt le roman (la première phrase est aussi le titre du dernier chapitre) : ces persécutions en puissance le sont restées ; elles ne sont jamais devenues ce qu’elles ont pu être en Europe à la même époque ; mais, pour cette même raison, elles n’ont jamais pu disparaître, et on n’a jamais pu en faire le deuil[59]. Le lecteur vit cette sourde appréhension du mal qui reste tapi dans le monde des possibles non réalisés.
Mais, inversement, le Complot vise aussi à provoquer une double prise de conscience, d’une part d’un antisémitisme institutionnel aux États-Unis jusque dans l’après-guerre (les Juifs étaient, comme les Noirs, exclus de fait des plus grandes universités, rappelle La Tache), d’autre part que « les Juifs de ce pays sont devenus tout ce qu’ils sont devenus parce qu’il ne s’est rien passé[60] » de ce qui a pu se passer en Europe et que leur a été laissée la possibilité « d’échapper à l’histoire[61] ».
Il y a enfin ce que l’on pourrait appeler l’oubli du tragique de l’histoire : la fragilité essentielle de la trame historique, l’absence de progrès linéaire et cumulatif, la faible part que jouent les droits des individus face à la toute-puissance de l’événement. « L’histoire s’impose à tous, qu’on le sache ou non et que cela plaise ou pas.[62] » L’incapacité du libéralisme à envisager la possibilité de son échec, et ainsi à comprendre sa propre histoire, qui est toujours une lutte à l’issue incertaine, est un thème important chez Roth – comme du reste chez Orwell. La foi naïve que la culture libérale entretient dans son nécessaire succès historique (par exemple « la conviction mystique qu’un régime fondé sur l’esclavage doit s’effondrer[63] ») est aussi ce qui explique son incapacité à se doter d’un horizon politique véritable[64]. C’est tout cela que vient souligner le recours à l’uchronie.
Souvent imprudemment rapprochées l’une de l’autre, sinon confondues[65], anticipation contre-utopique et uchronie expriment pourtant la contingence de l’histoire sous deux aspects différents. Les utopies classiques (More, Bacon, Campanella) et à leur suite les contre-utopies du XXe s. (Zamiatine, Huxley, Orwell) exprimaient une prise de conscience du caractère contingent des formes historiques[66]. Néanmoins, dans la contre-utopie, le pire était prévisible, sa forme était identifiable et pouvait être décrite[67]. L’uchronie en revanche souligne la contingence de la trame même de l’histoire –- la « tyrannie de la contingence[68] ». Nulle mise en garde, nulle clairvoyance ne prémunit contre elle, puisque « les catastrophes frappent toujours sans prévenir[69] ». L’uchronie rothienne ne repose pas, comme les livres de Lewis ou d’Orwell, sur l’idée de signe avant-coureur à interpréter, car l’histoire se précipite toujours[70].
Certaines réminiscences de 1984 ont néanmoins joué un rôle dans la composition du Complot. Pour susciter le sentiment d’oppression sinon de cauchemar, la contre-utopie construit l’image d’un monde déséquilibré, dont on aurait pour ainsi dire retiré l’une des prémisses –- d’une terre dont on aurait fait tomber l’un des piliers. C’était la liberté chez Zamiatine, un certain sens de la profondeur tragique chez Huxley, mais ce peut être l’émotion, le plaisir, ou encore l’humour – tout élément dénotant une prise de distance avec le monde et une résistance possible à l’ordre social. Chez Orwell, c’est essentiellement la confiance qui est retirée, exposant le héros à un perpétuel désarroi : la confiance non seulement dans les autres, mais dans le résultat probable de nos actes, confiance qui constitue la première garantie de sûreté[71] et permet seule de mesurer l’écart entre ce qui est et ce qui pourrait être. Roth décrit lui aussi un monde de désarroi – le thème littéraire par excellence[72] –, à hauteur d’enfant. « La dernière des petites choses qui font de l’Amérique ce qu’elle est[73] », c’est l’album de timbres de Philip, qui symbolise la trahison engendrée par l’élection de Lindbergh. La prémisse du Complot est ainsi la suivante : imaginons un timbre à l’effigie de Lindbergh président ; imaginons la sécurité de l’enfance, une collection de timbres, atteinte en son cœur ; imaginons la sécurité se retirant du monde, la perte d’un monde[74].
Le « Et si… » qui forme la structure de l’uchronie[75] n’a ainsi pas le même objet que dans la contre-utopie. L’avertissement, on l’a dit, n’y est pas spécifiquement dirigé vers l’avenir : il porte sur une histoire qui aurait pu se produire, et qui pourtant ne s’est pas produite (l’élection d’un président fasciste aux États-Unis) au moment qui aurait été le plus favorable[76]. Roth pense au genre de peur rétrospective qui nous saisit lorsque nous nous repassons le fil d’un événement qui aurait pu mal tourner – d’une marche d’escalier manquée par exemple. Mais pourquoi ne pas avoir plus simplement imaginé une victoire militaire de l’Allemagne nazie et du Japon, comme d’autres romanciers l’ont fait ? La trilogie américaine évoquait « le spectre du terrorisme qui avait remplacé celui du communisme[77] », l’activisme contestataire de la fin des années 1960 et la tendance à « l’indignation[78] » sinon à l’hystérie ou au fanatisme[79] : mais pourquoi avoir choisi de prendre au sérieux le spectre du fascisme des années 30 ? Peut-être parce que, pour reprendre le terme à l’origine des malheurs de Coleman Silk dans La tache (« spook »), le spectre n’est pas seulement un fantôme de l’imagination, mais un revenant, la subsistance dans le présent de ce qui est censé être mort : c’est en ce sens du mot qu’on peut parler de spectre de l’antisémitisme.
Le Complot met ainsi en question la « rhétorique nationale[80] » américaine en montrant pourquoi ce que l’histoire a fait, elle peut le défaire aussi bien. Il fait jouer l’une contre l’autre ces deux propriétés de l’histoire : le passé qui persiste et dont on hérite[81], et celui qui s’évanouit dans les choix présents[82], qui conduisent à un avenir imprévisible[83]. « Nous comptions bien sur cette histoire de l’Amérique pour nous protéger de Lindbergh[84] », confesse le jeune Philip : la famille de Roth entretient l’idée naïve que le devenir démocratique du pays est gravé dans sa Constitution, et garanti par la Cour suprême et les juges libéraux[85]. Mais cette superstructure juridique libérale occulte la subsistance dans la culture de forces hostiles à la démocratie : tout juste obligerait-elle un gouvernement fasciste à procéder de façon plus sournoise[86].
Ainsi, l’idée d’une « menace fasciste » planant sur les États-Unis est tout autre chose que ce lieu commun libéral qui fait de « la figure du fasciste […] celle du méchant primordial[87] ». Il reste que, comme chez Orwell, la menace fasciste conserve chez Roth une dimension de vague qui contribue à son caractère horrifique, là où le romancier donne au contraire une image plus précise et nuancée de l’engagement politique de gauche à travers les portraits croisés d’Ira Ringold et de Johnny O’Day[88] – asymétrie bien compréhensible de la part d’auteurs pour qui, tandis qu’il n’existe aucune bonne raison d’être fasciste, il en existe certainement d’être communiste, même si les mauvaises raisons de l’être (et les bonnes raisons de ne pas l’être) n’apparaissent pas toujours au premier coup d’œil.
Enfin, on doit aussi souligner que Roth partage l’arrière-plan et les présupposés libéraux des Huxley et Orwell (« Au centre se trouve le conflit entre la société utopique oppressive et les valeurs irréductibles de l’individualité[89] ») : l’histoire peut bien s’employer à détruire l’individu, elle ne peut supprimer l’individualité elle-même, précisément dans la mesure où une « catastrophe authentique » est avant tout une « affaire personnelle[90] ». Souvenons-nous de la dernière phrase de It can’t happen here : « Un Doremus Jessup ne peut jamais mourir.[91] » C’est vrai aussi pour Roth, parce que l’histoire aura toujours besoin d’un Doremus Jessup, ou d’un innocent Seymour Levov, à faire souffrir ; c’est là son essence.
Concluons que si l’uchronie paraît moins ambitieuse que le récit d’anticipation (à la différence d’Huxley ou d’Orwell, Roth n’a pas pris le risque de se tromper), c’est qu’en réalité elle vise à affronter plus directement le point sur lequel l’histoire et la politique entrent en conflit : la question de la contingence.
III. « L’invraisemblable et irréfutable réalité[92] »
At some point history becomes like topography :
there is no why to it, only a here and a there.
John Updike[93]
La conséquence directe de ce qui précède est que l’uchronie rothienne devait paraître vraisemblable[94], mais pas trop[95] – un point sur lequel Roth n’a d’ailleurs jamais été aussi clair qu’on aurait pu l’espérer. Il peut être intéressant à ce titre de citer un passage dans lequel Roth évoque Orwell :
Je n’avais aucun modèle littéraire pour me guider dans le chamboulement du passé attesté. J’avais bien lu quelques livres qui se projetaient dans un avenir historique imaginaire, notamment 1984. […] Orwell postule qu’il se produit un énorme bouleversement historique à la suite duquel son monde devient méconnaissable.[96]
En réalité, à aucun moment il n’est question dans le texte d’Orwell d’un « énorme bouleversement historique » – Winston peine à se souvenir de son enfance, de la vie d’avant Océania, et il n’est jamais fait mention des circonstances de l’accession au pouvoir du Parti. O’Brien dit bien, comme le rappelle Roth, que l’Angsoc a trouvé une partie de son inspiration dans les régimes totalitaires du XXe s., mais, en application de la double-pensée, il affirme aussi que le Parti est là de toute éternité. Le problème de l’histoire pour Orwell est celui de la connaissance historique et de la mémoire, bien davantage que celui de la causalité et des processus historiques. Roth ajoute :
Qu’Orwell imagine un monde aussi monstrueusement différent du nôtre que l’est celui de 1984 était effectivement assez invraisemblable et il le savait.[97]
Sa lecture d’Orwell révèle le véritable enjeu du roman de Roth : comment quelque chose d’invraisemblable peut-il néanmoins se produire ? Il faut ici distinguer trois niveaux de contingence ou de vraisemblance: métaphysiquement parlant rien, si peu probable cela soit-il, n’est impossible. Roth évoque une « vague de l’histoire » au mouvement aussi « invraisemblable » qu’« irréfutable »[98], avec une tonalité nettement existentielle qui rappelle ce que dit Imre Kertész de la nuit de son arrestation : « Le simple mystère de ce qui m’était donné dans l’univers : n’importe où, n’importe quand, je peux être tué[99] ». Iris Murdoch notait à ce titre : « On pourrait dire que la contingence est en réalité une subdivision de la mort.[100] » Il ne s’agit toutefois pas seulement dans le Complot de décrire les effets des grandes catastrophes historiques sur les destins individuels[101], car « l’histoire, ce n’est pas la toile de fond, c’est la scène ![102] ».
À un second niveau, la contingence est liée à l’ignorance dans laquelle nous nous trouvons des vastes mécanismes qui régissent l’histoire[103], comme des raisons d’agir d’autrui et de nos propres mobiles[104]. Roth, commentant Kundera, souligne que dans son œuvre « l’événement politique est régi par les mêmes lois que les affaires privées[105] » – quelque chose que Pascal, à nouveau, disait déjà[106]. Pourtant il ne me paraît pas du tout évident que ce soit là l’objet essentiel du Complot, où l’invraisemblance est moins envisagée de façon causale que phénoménale voire épiphanique : c’est le sens de la formule pléonastique de « révélation de l’imprévu[107] ». Dans Pastorale américaine, Seymour Levov ne cesse de se demander pourquoi sa fille Merry a commis un attentat, question vouée à demeurer sans réponse ; mais dans le Complot, le père de Philip s’offusque et s’inquiète bien davantage qu’il ne s’interroge sur les causes de la montée du fascisme. C’est de l’impuissance davantage que de l’incompréhension qu’il exprime, ce qui rappelle le beau roman d’Orwell Un peu d’air frais (1939) :
Quand la guerre ne vous tuait pas, elle ne pouvait que vous donner à réfléchir. Après ce gâchis innommable, il n’était plus possible de voir dans la société quelque chose d’immuable et d’éternel – comme les pyramides. On savait que ce n’était qu’un foutoir[108].
« Réfléchir », pour ainsi dire sans objet précis – non pas tellement réfléchir aux causes circonstancielles du conflit, mais plutôt rester perplexe devant la faible résistance que les sociétés offrent au chaos de l’histoire, ou devant la soudaine « transformation d’une société libre en État policier[109] ».
C’est donc plutôt à un troisième niveau, celui des acteurs et témoins de l’histoire en train de se faire, qu’intervient « l’invraisemblance » : l’incapacité à admettre ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux mêmes[110]. Les personnages du Complot ne cessent de rechercher et d’interpréter des signes de changement, sans être jamais entièrement certains que le régime est devenu fasciste[111]. Les émeutes antisémites qui se déclenchent à partir du moment où Winchell entre en campagne ne semblent pas fomentées par le régime. Pour Roth, c’est l’incertitude et l’incrédulité de ses adversaires qui rend si irrésistible l’ascension d’un Lindbergh.
IV. Roth et Orwell : Les vertus politiques de l’homme ordinaire
L’histoire, on n’est pas obligé de la faire comme le mécanicien fabrique une voiture : on peut très bien y jouer un rôle sans qu’il soit flagrant, même pour soi.[112]
L’invraisemblance du Complot fait écho à l’expérience de l’auteur qui, évoquant le cas de Nixon, écrivait :
Personnage de roman satirique, [Nixon] eût pu paraître « vraisemblable » ; mais sur l’écran de télévision, mon esprit refusait de croire à la réalité de cet homme public, de ce fait politique. […] La lecture de nos journaux quotidiens nous remplit donc de stupeur (est-ce possible ? est-ce vrai?), mais aussi d’un dégoût accablé.[113]
Or, c’est une chose que le lecteur remarque d’emblée, Lindbergh n’a nullement besoin pour emporter l’élection de la verve démagogique d’un Buzz Windrip, l’apprenti dictateur de Sinclair Lewis, ni même d’ailleurs de tenir de véritables discours[114], parce que son récit familial s’est déjà imposé au public. Dans nos cultures où une partie de l’éducation politique a été faite par Platon, on oublie un peu vite qu’il y a bien pire, politiquement, que l’abus du discours : l’absence de discours. Dans le Complot, Roth raille certes les paroles creuses du rabbin Bengelsdorf[115], le principal soutien de Lindbergh dans la communauté juive, mais ce ne sont précisément pas là des discours, seulement des formules. C’est ce même phénomène qu’illustrait sous une forme violente la fille bègue de Levov, Merry, qui faute de pouvoir discourir et dialoguer se répandait en slogans et en récits plus ou moins délirants[116]. Dans le Complot, Roth ne s’appesantit pas sur les stigmatisations publiques qui jouaient un rôle si important dans les œuvres précédentes[117], et ne fait même pas de la rhétorique antisémite de Lindbergh le moteur de sa victoire (c’est par ses slogans pacifistes qu’il s’impose). Il épingle en revanche notre tendance contemporaine au récit, que celui-ci prenne la forme du storytelling familial, du ressassement victimaire[118] ou du « grand récit » libéral auquel est acquise la classe moyenne et supérieure américaine. Roth veut montrer que là où les livres d’histoire retiennent surtout les discours, dans le temps politique ce sont plutôt les récits qui font et défont les carrières[119]. Loin du lieu commun qui accuse les pouvoirs (forcément manipulateurs) de la parole, il suggère qu’un gouvernement qui parle est le signe d’une société en bonne santé[120]. Lindbergh met d’ailleurs en œuvre, a contrario, la terrible maxime de Saint-Just qui ouvre Le zéro et l’infini de Kœstler: « On ne peut gouverner sans laconisme. »
La tradition littéraire américaine a, au moins depuis le Willie Stark de Robert Penn Warren[121], plutôt de l’affection pour la figure du tribun. Lindbergh, on l’a dit, n’est pas un avatar de Tricard Dixon – il n’a pas même l’heur de nous divertir à ses dépens ; il n’est pas drôle[122], et s’il ne pouvait l’être, ce n’est pas parce que le véritable Lindbergh était un raciste fanatique, mais d’abord parce que le personnage de roman « Charles Lindbergh » est le produit d’une époque, la nôtre, qui a elle-même largement perdu le sens de l’humour[123] en s’abîmant dans le cynisme – comme si la satire y était devenue le régime normal de rapport au politique. Quand tout tourne à la farce, le sens de l’humour est bien plus menacé que l’esprit de sérieux.
On comprend alors pourquoi c’est « la normalité élevée à des proportions héroïques » de Lindbergh, sa « décence » même, qui en font un homme si dangereux[124]. Dans un monde où tout et tout le monde peut être tourné en dérision (et Roth lui-même ne s’en est pas privé, qui a décrit le président George W. Bush comme « d’un homme incapable d’assurer la bonne marche d’une quincaillerie[125] »), l’héroïque simplicité de Lindbergh, son caractère ordinaire, voilà le vrai danger. L’homme politique le plus dangereux n’est pas nécessairement celui qui excite le vieux fond mauvais de l’être humain, mais celui qui sait flatter la culture dominante dans le sens de la représentation qu’elle se fait d’elle-même : aujourd’hui, une culture de l’héroïsme ordinaire, du quotidien, du care, des « papas Pampers[126] », de l’irénisme et du tabou de la violence politique.
Une clef de lecture utile me semble être la figure de « l’homme ordinaire », thème récurrent chez Roth[127], et son corrélat politique, la vertu de « décence commune » qu’Orwell présente comme le meilleur rempart contre les dérives autoritaires[128]. Dans Pastorale américaine, les déboires de Seymour Levov, « l’Américain ordinaire » tel qu’il se baptise lui-même[129], lui qui « lorsqu’il ne saisit pas les tenants et les aboutissants d’un état de fait se rabat sur une attitude tolérante et charitable[130] », illustrent l’impuissance de la vertu ordinaire et de la vigilance civique à résister à la vague de l’histoire, cette « puissance devenue folle[131] », à « l’irrationalité » ou au « chaos » du réel[132]. Le sain scepticisme de Levov, qui est aussi celui de l’auteur et qui contraste avec les vaines tentatives de reconstruction et de « rationalisation » de l’histoire auxquelles se livrent sa fille Merry et son frère Jerry[133], ne le protège pas pour autant de l’illusion de sa propre sécurité. Roth n’est pas non plus opposé à l’idée, partagée par des auteurs comme Orwell ou Christopher Lasch, que la vertu ordinaire représente une force structurante de la société et des désirs individuels[134]. Ce qu’il conteste en revanche, c’est qu’elle soit une garantie contre la violence et l’autorité discrétionnaire de l’histoire. Dans le Complot, il oppose ainsi à la « populace aveugle et destructrice manipulée par le complot pro-nazi », qu’on suppose minoritaire[135], « les Américains conformistes des classes moyennes » qui tout en ayant voté pour Lindbergh s’indignent des émeutes antisémites[136]. Mais le manque de clairvoyance des acteurs, de la tante Evelyn et des rabbins libéraux en particulier, n’est pas seul en cause. Contrairement à ce qu’affirme la tradition républicaine de Montesquieu à Tocqueville, être un bon citoyen ne protège pas la démocratie : non seulement la vertu civique individuelle[137] ne peut rien contre les forces antidémocratiques, mais une trop bonne éducation, et dans le cas des immigrés juifs une assimilation trop bien réussie, entraînent une confiance aveugle dans son propre destin et une baisse de la vigilance démocratique[138]. Loin de la veine caustique d’un Sinclair Lewis, Roth n’en vise pas moins le bon citoyen des démocraties modernes, qui quoique libre des « illusions flagrantes » de la religion et de l’idéologie, et pas nécessairement aussi caricaturalement « standardisé » que ce Babbitt moral jusque dans l’immoralité[139], reste « tributaire du mythe de sa propre bonté[140] ». Il faut enfin souligner la propension de la « décence commune » à se muer au mieux en un « libéralisme châtié », au pire en une « tyrannie des convenances[141] ». Orwell avait certainement sous-estimé le poids du conservatisme culturel dans la vie politique[142], ainsi que la tendance moralisatrice[143] et anti-politique[144] du seul bon sens.
Ce qu’Orwell (et London avant lui) ont vu en revanche, et que Roth a laissé de côté, ce sont les séductions propres au fascisme. C’est en quelque sorte un effet de théorie : en insistant sur l’imprévisibilité de l’histoire, il était voué à reprendre à son compte l’idée formulée par Dorothy Thompson selon laquelle « aucun peuple n’a jamais reconnu son dictateur à l’avance[145] ». Pourtant, comme le notait Orwell, une bonne partie du peuple et plus encore des intellectuels est tout à fait capable de reconnaître l’immoralité et de s’y complaire :
Toute théorie qui est évidemment malhonnête et immorale (« réaliste » est un mot qui a beaucoup de succès en ce moment) aura ses défenseurs qui l’accepteront précisément pour cette raison.[146]
Conclusion : « Cette inévitable composante de la vie, la trahison[147] »
Qu’apprend-on d’une uchronie ? Le lot commun de la contre-utopie et de l’uchronie est la tendance sinon l’obstination de la plupart des lecteurs à établir des rapprochements avec les événements contemporains, comme si là résidait la justification ou la vérité de ces textes[148]. En réalité, autant de romans, autant d’enseignements, autant de choses accomplies[149]. Dans le cas du Complot, fait intimement partie du texte qu’il s’agisse d’une fiction, que ce qui est raconté soit tout simplement faux, parce que c’est en cela qu’il exprime deux questions fondamentales et teintées d’une angoissante culpabilité : une énigme existentielle – pourquoi l’enfant nommé Philip Roth a-t-il échappé au déchaînement fanatique de l’histoire qui a assassiné tant d’enfants de son âge[150] ? ; une énigme politique – pourquoi le fascisme a-t-il épargné l’Amérique ? La thèse de Roth est qu’aucune de ces deux authentiques questions ne saurait admettre de réponse satisfaisante, pas davantage que la question de savoir pourquoi une épidémie meurtrière se déclare soudain[151]. Si Roth s’adresse bien à ses contemporains, il le fait en se tournant vers le passé, et c’est pourquoi on peut attribuer au roman, qui tient la corde raide entre le « trivial » et le « tragique »[152], deux contrepoints littéraires : Impossible ici de Lewis, bien entendu, mais aussi Le jardin des Finzi-Contini de Bassani, dont la mélancolie stupéfaite n’est pas absente du roman de notre auteur.
On a souvent souligné l’importance du thème de la trahison dans l’œuvre tardive de Roth[153]. Mais là où d’autres de ses romans analysent la trahison, par un personnage, des valeurs héritées ou des valeurs qu’il revendique comme les siennes[154], le Complot est le récit d’un autre genre de trahison : d’abord bien sûr la confiance trahie d’un enfant dans les valeurs d’une nation à laquelle il a été demandé à ses parents de s’assimiler. Mais aussi la trahison de valeurs et de modèles qui naît, paradoxalement, de leur observation trop scrupuleuse. Dans le Complot, Roth ne vise pas celui qui s’élève contre l’histoire, comme Coleman Silk[155], ou contre la maladie et la « peur » qui « avilit »[156], comme Bucky Cantor, l’athlète « invincible[157] » qui sera pourtant vaincu par le grand « À quoi ça rime, tout ça, bordel ?[158] ». Il vise l’homme de la classe moyenne américaine, l’homme de bonne volonté[159], le citoyen ordinaire vivant dans le « mythe national bénin[160] » de la supériorité démocratique de son pays, oublieux du passé, aveugle par conséquent aux virtualités les plus dangereuses qu’il contient et que le présent contient peut-être encore.
Le propos peut paraître simple, mais c’est le sens même d’un devoir de vigilance : ce qu’on a à nous dire n’a pas besoin d’être bien compliqué pour qu’il soit important qu’on nous le répète. Souvenons-nous de la plus belle phrase de 1984 : « Les meilleurs livres sont ceux qui racontent ce que l’on sait déjà.[161] » – à quoi Saramago répliquait : « Il faut répéter les vérités plusieurs fois afin qu’elles ne tombent pas dans l’oubli, les pauvres.[162] » Parmi ces vérités, il y a que les conséquences politiques n’ont pas besoin d’être désastreuses pour être réellement catastrophiques, et c’est justement une partie de ce que montre Roth en se plaçant à hauteur d’enfant.
Bibliographie
1. Œuvres de Philip Roth [Abréviations]
Goodbye, Columbus, tr. fr. Céline Zins, Paris, Gallimard, « Folio », 1962 [GC]
Tricard Dixon et ses copains, tr. fr. Jean-René Major, Paris, Gallimard, « Du Monde entier », 1971 [TDSC]
The Great American Novel, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1973 [GAN]
Opération Shylock. Une confession, tr. fr. Lazare Bitoun, Paris, Gallimard, « Folio », 1997 [OS]
Pastorale américaine, tr. fr. Josée Kamoun, Paris, Gallimard, « Folio », 2001 [PA]
J’ai épousé un communiste, tr. fr. Josée Kamoun, Paris, Gallimard, « Folio », 2001 [JEC]
La tache, tr. fr. Josée Kamoun, Paris, Gallimard, « Folio », 2002 [LT]
La contrevie, tr. fr. Josée Kamoun, Paris, Gallimard, « Folio », 2004 [LCV]
The Plot Against America, Londres, Vintage, 2005
Le complot contre l’Amérique, tr. fr. Josée Kamoun, Paris, Gallimard, « Folio », 2006 [CCA]
Indignation, tr. fr. Marie-Claire Pasquier, Paris, Gallimard, « Folio », 2006 [IND]
Némésis, tr. fr. Marie-Claire Pasquier, Paris, Gallimard, « Du monde entier », 2012 [NEM]
Pourquoi écrire ?, tr. fr. Michel et Philippe Jaworski, Josée Kamoun et Lazare Bitoun, Paris, Gallimard, « Folio », 2019 [PE]
2. Autres œuvres
Giorgio Bassani, Le jardin des Finzi-contini, tr. fr. Michel Arnaud, Paris, Gallimard, 1964
Walter Benjamin, « Le conteur », in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000
Joseph Heller, Catch 22, tr. fr. Brice Matthieussent, Paris, Grasset, 1985
Axel Honneth, L’Idée du socialisme, tr. fr. Pierre Rusch,Paris, Gallimard, 2015
Imre Kertész, Le Dossier K, tr. fr. Charles Zaremba, Arles, Actes Sud, 2008
Arthur Kœstler, Le Zéro et l’infini, tr. fr. Jérôme Jenatton, Paris, Calmann-Levy, 1945,
Sinclair Lewis, Babbitt, tr. fr. Maurice Rémon, Paris, Stock, 2010
Sinclair Lewis, Impossible ici, tr. fr. Raymond Queneau, Paris, La Différence, 2016
Jack London, Le talon de fer, tr. fr. Jacques Parsons, Louis Postif et Jean-Louis Postif, Paris, Phébus, 2008
Jack London, Révolution suvi de Guerre des classes, tr. fr. Louis Postif, Paris, Phébus, 2003
Bernard Malamud, L’homme de Kiev, tr. fr. Gérard et Solange de Lalène, Paris, Rivages, 2015
Iris Murdoch, La souveraineté du Bien, tr. fr. Claude Pichevin, Combas, L’Éclat, 1994
Iris Murdoch, L’attention romanesque. Écrits sur la philosophie et la littérature,tr. fr. Denis-Armand Canal, Paris, La Table Ronde, 2005
George Orwell, 1984, tr. fr. Amélie Audiberti, Paris, Gallimard, 1977
George Orwell, Un peu d’air frais, tr. fr. Richard Prêtre, Paris, 10/18, 1983
George Orwell, Essais, articles, lettres, vol. I, tr. fr. Anne Krief et Michel Pétris, Paris, Ivréa, 1995
George Orwell, Essais, articles, lettres, vol. IV, tr. fr. Anne Krief, Bernard Pecheur et Jaime Semprún, Paris, Ivrea, 2001
George Orwell, Dans le ventre de la baleine et autres essais, tr. fr., Paris, Ivrea, 2005
George Orwell, Écrits politiques, tr. fr. Bernard Hoepffner, Marseille, Agone, 2009
Blaise Pascal, Pensées, éd. Lafuma, Paris, Seuil, 1962
René Rémond, « Le siècle de la contingence ? », Vingtième siècle, 1984, n°1, p. 97-103
José Saramago, La Lucidité, tr. fr. Geneviève Leibrich, Paris, Seuil, 2006
Nathalie Sarraute, L’Ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956
ohn Updike, Memories of the Ford Administration, New York, Random House, 2014
Robert Penn Warren, Les fous du roi, tr. f. Pierre Singer, Paris, Phébus, 1998
Bernard Williams, Vérité et véracité, tr. fr. Marie-Anne Lescourret, Paris, Gallimard, 2006
Georg Henrik von Wright, Le mythe du progrès, tr. fr. Philippe Quesne, Paris, L’Arche, 2000
3. Littérature secondaire
Stefanie Boese, « »Those Two Years » : Alternate History and Autobiography in Philip Roth’s The Plot Against America », Studies in American Fiction, vol. 41, n°2, 2014, p. 271-292
Claudia Franziska Brühwiler, Political Initiation in the Novels of Philip Roth, New York, Bloomsbury, 2013
James Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité, tr. fr. Jean-Jacques Rosat, Marseille, Agone, 2012
Christopher Eagle, « »Angry Because She Stutters » : Stuttering, Violence, and the Politics of Voice in American Pastoral and Sorry », Philip Roth Studies, vol. 8, n°1, 2012, p. 17-29
Steven Fink, « Fact, Fiction, and History in Philip Roth’s “Eli, the Fanatic” », Multi-Ethnic Literature of the United States, 2014, p. 89-111
Gérard Genette, « Vraisemblance et motivation », Figures II, Paris, Seuil, 1969
Ginevra Geraci, « The Sense of an Ending : Alternative History in Philip Roth’s The Plot Against America », Philip Roth Studies, vol. 7, n°2, 2011, p. 187-204
Trevor Austin Graham, « On the Possibility of an American Holocaust: Philip Roth’s The Plot Against America », Arizona Quarterly : A Journal of American Literature, Culture, and Theory, vol. 63, n°3, 2007, p. 119-149
Brittany Hirth, « »An Independant Destiny fo America » : « Roth’s Vision of American Exceptionalism », Philip Roth Studies, vol. 14, n°1, 2018, p. 70-93
Christopher Hitchens, Dans la tête d’Orwell. La vérité sur l’auteur de 1984, tr. fr. Bernard Cohen, Paris, Saint-Simon, 2019
Anthony Hutchison, « ‘Purity is Petrefaction’ : Liberalism and Betrayal in Philip Roth’s I Married a Communist », Rethinking History, vol. 9, n°2/3, 2005, p. 315-327
Steven G. Kellman, « It Is Happening Here : The Plot Against America and the Political Moment », Philip Roth Studies, vol. 4, n°2, 2008, p. 113-123
Michael Kimmage, In History’s Grip : Philip Roth’s Newark Trilogy, Stanford, Stanford University Press, 2012
Sandra Kumamoto Stanley, « Mourning the « Greatest Generation »: Myth and History in Philip Roth’s « American Pastoral » », Twentieth Century Literature, vol. 51, N°1, Spring 2005, p. 1-24
Kevin Ladd, « De quoi l’utopie est-elle la connaissance ? Peine, règle et langage (autour de George Orwell) », Peine et Utopie. Représentations de la sanction dans les oeuvres utopiques. Colloque international de Nice, Déc. 2017 [en ligne sur HAL, 2019]
Philipp Loeffler, « From Cold War Politics to Post-Cold War Fiction : Philip Roth’s I Married a Communist and the Problem of Cultural Pluralism », College Literature : A Journal of Critical Literary Studies, vol. 42, n°4, 2015, p. 597-618
Brian J. McDonald, « Philip Roth’s Mock Lincoln », Canadian Review of American Studies, vol. 44, n°3, 2014, p. 389-401
Thomas Pavel, La pensée du roman, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2014
Matthew Shipe, « After the Fall : The Terror of History in Philip Roth’s Indignation », Philip Roth Studies, vol. 14, n°1, 2018, pp. 1-24
Sorin Radu-Cucu, « »The Spirit of the Common Man » : Populism and the Rhetoric of Betrayal in Philip Roth’s I Married a Communist », Philip Roth Studies, vol. 4, n°2, 2008, p. 171-186
Jason Siegel, « The Plot Against America : Philip Roth’s Counter-Plot to American History », Multi-Ethnic Literature of the U.S., vol. 37, n°1, Spring 2012, p. 131-154
Jennifer A. Slivka, « History and the ‘I’ Trapped in the Middle : Negotiating the Past in Roth’s The Ghost Writer and The Plot Against America », Philip Roth Studies, vol. 8, n°2, 2012, p. 127-144
Christopher Vials, « What Can Happen Here ? : Philip Roth, Sinclair Lewis, and the Lessons of Fascism in the American Liberal Imagination », Philip Roth Studies, vol. 7, n°1, 2011, p. 9-26
[1]Giorgio Bassani, Le jardin des Finzi-contini, tr. fr. Michel Arnaud, Paris, Gallimard, 1964, p. 285.
[2]PE p. 482. (La liste des abréviations se trouve sous le titre 1 de la bibliographie.)
[3]PE p. 479.
[4]PE p. 427.
[5]LCV p. 292. La formule s’applique à la fiction en général. Le deuxième chapitre de La contrevie annonce à certains égards le programme du Complot.
[6]CCA p. 11.
[7]Voir David Brauner, « ‘What was not supposed to happen had happen and what was supposed to happen had not happen’ : Subverting History in American Pastoral », in Debra Shostak (dir.), Philip Roth. American Pastoral. The Humain Stain. The Plot Against America, Londres, Continuum Books, 2011, p. 19-32. Michael Kimmage, In History’s Grip : Philip Roth’s Newark Trilogy, Stanford, Stanford University Press, 2012.
[8]Voir « Eli le fanatique » (GC p. 331).
[9]IND p. 111 ; NEM p. 105. Voir aussi Bernard Malamud, L’homme de Kiev, tr. fr. Gérard et Solange de Lalène, Paris, Rivages, 2015, p. 331.
[10]PA p. 126 et 128. Voir Georg Henrik von Wright, Le mythe du progrès, tr. fr. Philippe Quesne, Paris, L’Arche, 2000, p. 49.
[11]Voir Jason Siegel, « The Plot Against America : Philip Roth’s Counter-Plot to American History », Multi-Ethnic Literature of the U.S., vol. 37, n°1, Spring 2012, p. 131-154. Voir aussi Steven Fink, « Fact, Fiction, and History in Philip Roth’s “Eli, the Fanatic” », Multi-Ethnic Literature of the United States, 2014, p. 89.
[12]Voir le premier chapitre de Pastorale américaine, en particulier p. 59-64.
[13]Nathalie Sarraute, L’Ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956.
[14]OS p. 48.
[15]Voir PE p. 478 sq.
[16]Lorsqu’il l’est, dans Opération Shylock, c’est par inadvertance, et non aux États-Unis mais en Israël.
[17]GC p. 257.
[18]C’est le cas du jeune Zuckerman de J’ai épousé un communiste et de Marcus Messner dans Indignation (voir IND p. 110 sq.).
[19]« La conversion des Juifs », GC p. 188. Il eût été plus naturel d’éviter l’anglicisme et de traduire par « scolaire » ou « théorique ».
[20]Voir la fin du chap. III, p. 256 sq. Voir aussi John Updike, Memories of the Ford Administration, New York, Random House, 2014, p. 37.
[21]Voir Philipp Loeffler, « From Cold War Politics to Post-Cold War Fiction : Philip Roth’s I Married a Communist and the Problem of Cultural Pluralism », College Literature : A Journal of Critical Literary Studies, vol. 42, n°4, 2015, p. 609.
[22]Voir OS p. 347 et 641. Voir Jacques Bouveresse, Nietzsche contre Foucault, Marseile, Agone, 2016.
[23]Voir Claudia Franziska Brühwiler, Political Initiation in the Novels of Philip Roth, New York, Bloomsbury, 2013, p. 35.
[24]Voir OS p. 122. Voir Stefanie Boese, « »Those Two Years » : Alternate History and Autobiography in Philip Roth’s The Plot Against America », Studies in American Fiction, vol. 41, n°2, 2014, p. 287.
[25]Voir GAN p. 90 ; PE p. 96.Voir Sandra Kumamoto Stanley, « Mourning the « Greatest Generation »: Myth and History in Philip Roth’s « American Pastoral » », Twentieth Century Literature, vol. 51, N°1, Spring 2005, p. 1-24.
[26]Voir PE p. 75. La référence à Orwell est récurrente chez Roth, qui cite en épigraphe de Tricard Dixon et ses copains (TDSC p. 9), un passage du célèbre article « La politique et la langue anglaise » (Essais, articles, lettres, vol. IV, tr. fr. Anne Krief, Bernard Pecheur et Jaime Semprún, Paris, Ivrea, 2001, p. 158-173). Roth compare par ailleurs le Complot à 1984 dans un petit texte intitulé « Mon uchronie » (PE p. 472-487) que je commente plus bas.
[27]Orwell l’a inlassablement répété : il n’y a de sens à parler de mythe et de mystification que si l’on consent à l’idée de vérité historique et de réalité politique objective. Voir James Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité, tr. fr. Jean-Jacques Rosat, Marseille, Agone, 2012.
[28]JEC p. 413. Voir aussi LT p. 211.
[29]PA p. 394. Le Complot évoque par ailleurs la journaliste Dorothy Thompson, qui fut la femme de Sinclair Lewis.
[30]Voir PE p. 66 sq.
[31]Voir LT p. 438 et PE p. 67.
[32]Le terme « aventurier » a la même connotation politique péjorative en anglais qu’en français.
[33]Comment Roth pouvait-il écrire son personnage après Chaplin (PE p. 68), après Orwell, après les « romans du dictateur » latino-américains (Asturias, Garcia Marquez, Carpentier, …), sinon en le faisant en quelque sorte disparaître ? Sa disparition finale, sur laquelle tous les interprètes s’interrogent, n’est-elle pas l’aboutissement naturel d’une présence tout à fait marginale dans le récit ? Voir infra, partie I.
[34]« La peur préside à ces mémoires » (CCA p. 12) comme Lindbergh préside aux destinées du pays.
[35]JEC p. 360.
[36]JEC p. 308 et 439.
[37]LTp. 234.
[38]JEC p. 62.
[39]Voir OS p. 622 ; LCV p. 220. Voir Iris Murdoch, L’attention romanesque. Écrits sur la philosophie et la littérature,tr. fr. Denis-Armand Canal, Paris, La Table Ronde, 2005, p. 29-30.
[40]JEC p. 57 et p. 326 sq. (fin du chap. 6) ; CCA p. 335 (« Je n’avais que faire de l’histoire. »)
[41]OS p. 265.
[42]Voir la longue tirade de Leo Glucksman (JEC p. 308-310) et a contrario la profession de foi de l’écrivain marxiste (p. 373).
[43]JEC p. 15-16. Voir Matthew Shipe, « After the Fall : The Terror of History in Philip Roth’s Indignation », Philip Roth Studies, vol. 14, n°1, 2018, pp. 1-24.
[44]Voir Gérard Genette, « Vraisemblance et motivation », Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 82.
[45]René Rémond, « Le siècle de la contingence ? », Vingtième siècle, 1984, n°1, p. 98.
[46]CCA p. 168. C’est le passage le plus fréquemment cité du Complot. Roth le reprend in extenso dans « Mon uchronie » (PE p. 486).
[47]Voir PE p. 284-285. L’influence d’Aharon Appelfeld semble avoir été déterminante sur ce point.
[48]JEC p. 418.
[49]Blaise Pascal, Pensées, Lafuma 750. Voir IND p. 235 et JEC p. 200-201. Il est un peu surprenant de lire que l’enjeu de la « trilogie américaine » serait de « donner du sens à l’histoire » et au « présent » (Ph. Loeffler, « From Cold War Politics to Post-Cold War Fiction », article cité p. 599).
[50]PE p. 481.
[51]Sinclair Lewis, Babbitt, tr. fr. Maurice Rémon, Paris, Stock, 2010, p. 120.
[52]Bernard Williams, Vérité et véracité, tr. fr. Marie-Anne Lescourret, Paris, Gallimard, 2006, p. 247.
[53]Voir LT p 430, au sujet de la ségrégation dans les écoles du New Jersey. Voir Jennifer A. Slivka, « History and the ‘I’ Trapped in the Middle : Negotiating the Past in Roth’s The Ghost Writer and The Plot Against America », Philip Roth Studies, vol. 8, n°2, 2012, p. 136.
[54]PE p. 477. Voir la très bonne formule de J. Siegel (article cité, p. 131) : « Roth demonstrates that the identity of a nation cannot be encapsulated in a chronicle of actuals events, etc. » Les conclusions que tire ensuite l’auteur sont en revanche erronées : on ne saurait fonder l’écriture d’une « histoire alternative » et le « pluralisme historique » sur l’idée que la vérité objective n’existe pas !
[55]PE p. 482.
[56]PE p. 483.
[57]PE p. 478.
[58]CCA p. 12.
[59]Cf. OS p. 593. Plus encore que « l’effarement congénital [des Européens] devant tout ce qui est américain » (LT p. 257), cela explique pourquoi la littérature d’anticipation consacrée au fascisme (London, Lewis) n’a guère fait recette en Europe, en comparaison de la dénonciation du totalitarisme soviétique (Kœstler, Orwell) : la même Europe de l’ouestquia littéralement créé les régimes fascistes s’est persuadée que le danger venait du communisme.
[60]PE p. 481-482.
[61]LCV p. 199.
[62]PE p. 485 :
[63]George Orwell, Dans le ventre de la baleine et autres essais, tr. fr., Paris, Ivrea, 2005, p. 310
[64]Voir la formule Sinclair Lewis : « Vous êtes un libéral centriste, dit le docteur Yavitch, et vous n’avez pas la moindre idée de ce que vous voulez. Moi, qui suis un révolutionnaire, je sais exactement ce que je veux.» (Babbitt, op. cit., p. 147.)
[65]Voir par exemple Paul Ricœur, Temps et récit, t. 3, Paris, Seuil, 1985, p. 307.
[66]Voir Axel Honneth, L’Idée du socialisme, tr. fr. Pierre Rusch, Paris Gallimard, 2017, p. 21.
[67]George Orwell, Écrits politiques, tr. fr. Bernard Hoepffner, Marseille, Agone, 2009, pp. 356-358. Voir mon article consacré à Orwell, « De quoi l’utopie est-elle la connaissance ? » (HAL, 2019).
[68]NEM p. 197.
[69]CCA p. 299.
[70]PA p. 128 : : « On se représente toujours l’histoire comme un processus à long terme, mais, en réalité, c’est un agent très soudain. »
[71]George Orwell, 1984, tr. fr. Amélie Audiberti, Paris, Gallimard, 1977, p. 17 : « Rien n’était illégal, puisqu’il n’y avait plus de lois. »
[72]Voir par exemple IND p. 149 et PA p. 61. Voir Walter Benjamin, « Le conteur », in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 121. Voir aussi Thomas Pavel, La pensée du roman, Paris, Gallimard, 2014, p. 42.
[73]PE p. 560.
[74]PE p. 479 : « La terrible irruption de l’histoire dans son Amérique qui se défait. »
[75]PE p. 473 et 482.
[76]PE p. 481-482.
[77]LT p. 12 (le terme « spectre » est appelé par la traduction).
[78]CCA p. 19 ; la thématique de l’indignation, sincère ou affectée (« sanctimony », « calculated frenzy », voir LT p. 12-13), et généralement sans contenu politique réel, occupe une place importante dans l’œuvre tardive de Roth.
[79]« L’idéalisme sadique » du personnage de Rita évoque irrésistiblement O’Brien (PA p. 197).
[80]Ginevra Giraci, article cité, p. 190.
[81]LT p. 210.
[82]LT p. 198-199 et p. 448.
[83]PA, p. 126 : « Il est mis à feu et à sang, le bel avenir américain qui semblait promis, celui qui devait naître en toute logique du solide passé américain, issu d’un processus sans rupture. »
[84]CCA p. 90.
[85]CCA p. 87-88 et 286.
[86]Voir CCA p. 291 et début du chap. 6. Voir aussi JEC p. 74 : « Ça prendrait un peu plus longtemps, à cause du côté démocratique de notre société, mais on finirait quand même fascistes, avec un dictateur et tout et tout. »
[87]Christopher Vials, « What Can Happen Here ? : Philip Roth, Sinclair Lewis, and the Lessons of Fascism in the American Liberal Imagination », Philip Roth Studies, vol. 7, n°1, 2011, p. 10. Voir aussi Orwell, « La politique et la langue anglaise », op. cit., p. 164 : « Le mot fascisme a désormais perdu toute signification et désigne simplement « quelque chose d’indésirable ». »
[88]JEC p. 320-323.
[89]Bronislaw Bazcko, « Lumières et utopie. Programme de recherche », article cité, p. 370.
[90]JEC p. 15 (et aussi p. 57 : « Je n’avais aucune importance, moi, aucune, et pourtant le fanatisme anticommuniste était arrivé jusqu’à moi. »)
[91]Lewis, Impossible ici, op. cit., p. 377.
[92]CCA, p. 291.
[93]John Updike, Memories of the Ford Administration, op. cit., p. 282.
[94]PE p. 476-477.
[95]PA, p. 574 : « La naissance, la succession, les générations, l’histoire –- invraisemblables au plus haut point. »
[96]PE p. 475.
[97]PE p. 477.
[98]CCA p. 291.
[99]Imre Kertész, Le Dossier K, tr. fr. Charles Zaremba, Arles, Actes Sud, 2008, p. 18-19.
[100]Iris Murdoch, La souveraineté du Bien, tr. fr. Claude Pichevin, Combas, L’Éclat, 1994, p. 119-120.
[101]Voir Steven G. Kellman, « It Is Happening Here : The Plot Against America and the Political Moment », Philip Roth Studies, vol. 4, n°2, 2008, p. 114.
[102]IND p. 225.
[103]Voir LT p. 232, l’image de la société des corneilles : « Il y a une organisation puissante là-haut. Mais est-ce qu’elles savent elles-mêmes ce que c’est, j’en ai pas la moindre idée. »
[104]Voir PA, p. 59-60 ; LT p. 282-283.
[105]PE p. 365.
[106]Pascal, Pensées, Lafuma 413.
[107]CCA p. 168.
[108]UPAF p. 165.
[109]CCA p. 504.
[110]CCA p. 291 : « Les invraisemblances dont les caméras affirmaient l’irréfutable réalité. »
[111]CCA p. 351 : « Les gens vivaient sans jamais savoir s’ils devaient s’attendre au pire. »Voir aussi l’épisode du cauchemar de Philip (CCA p. 67-70).
[112]LCV p. 206.
[113]« Figures du romancier américain » (PE p. 145). Voir aussi OS p. 169.
[114] CCA p. 53, 85, etc.
[115]CCA p. 58-59.
[116]PA p. 341 et 365. Voir Christopher Eagle, « »Angry Because She Stutters » : Stuttering, Violence, and the Politics of Voice in American Pastoral and Sorry », Philip Roth Studies, vol. 8, n°1, 2012, p. 17-29.
[117]Voir PE p. 540.
[118]LT p. 260 sq.
[119]La même analyse pourrait être conduite au sujet de Babbitt.
[120]Il faudrait en réalité distinguer un niveau où le pouvoir se manifeste par son laconisme (tout en haut, à la pointe de la pyramide, chez Big Brother comme chez Lindbergh), et un niveau où le pouvoir cherche au contraire à subjuguer par « la logique de l’immoralité », celui d’O’Brien ou des généraux de Catch 22 (dont la formule qui précède est extraite : Joseph Heller, Catch 22, tr. fr. Brice Matthieussent, Paris, Grasset, 1985, p. 489).
[121]Robert Penn Warren, Les fous du roi, tr. f. Pierre Singer, Paris, Phébus, 1998.
[122]Il ne l’est qu’au travers d’un écrivain en résidence qui se grime en Lindbergh (LT p. 358).
[123]Le tout dernier personnage imaginé par Roth, Bucky Cantor, est dépeint comme quasi dépourvu d’humour et incapable de détachement (NEM p. 220).
[124]CCA p. 84 et p. 436. Voir aussi PE p. 480-481.
[125]PE p. 486.
[126]LT p. 357.
[127]Voir notamment OS p. 533-535 et JEC, 1er chapitre.
[128]Notion qu’il met toutefois en question de façon radicale dans 1984. Voir Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité, op. cit., p. 89.
[129]PA p. 393.
[130]PA p. 467.
[131]PA p. 355.
[132]PA p. 388.
[133]PA p. 341 et 388. Voir aussi JEC p. 418.
[134]Voir PA p. 54. Voir Sorin Radu-Cucu, « »The Spirit of the Common Man » : Populism and the Rhetoric of Betrayal in Philip Roth’s I Married a Communist », Philip Roth Studies, vol. 4, n°2, 2008, p. 171-186.
[135]CCA p. 385.
[136]CCA p. 381.
[137]Voir la visite de Washington au chapitre 2 de CCA. Voir aussi NEM p. 106, et le portrait de ce grand-père « pour qui le devoir était une religion plutôt que le contraire ».
[138]PE p. 289-290 (entretien avec Aharon Appelfeld).
[139]S. Lewis, Babbitt, op. cit., p. 146-147 : « Les vrais coupables dans l’affaire, ce sont les pères de famille propres, braves et industrieux, qui ont recours à tous les procédés connus de fourberie et de cruauté pour assurer le bien-être de leurs petits. »
[140]JEC p. 435.
[141]LT p. 210. Voir aussi PE p. 71, au sujet de la satire. Voir Anthony Hutchison, « ‘Purity is Petrefaction’ : Liberalism and Betrayal in Philip Roth’s I Married a Communist », Rethinking History, vol. 9, n°2/3, 2005, p. 315-327.
[142]Christopher Hitchens, Dans la tête d’Orwell. La vérité sur l’auteur de 1984, Paris, Éditions Saint-Simon, 2019, chap. 5.
[143]LT p. 177.
[144]LT p. 171.
[145]Sinclair Lewis, Impossible ici, Préface, op. cit., p. 17.
[146]George Orwell, Écrits politiques, op. cit., pp. 236-237. Voir J. London, Le talon de fer, op. cit., p. 272. Voir S. Lewis, Impossible ici, op. cit., p. 244-245.
[147]PEp. 521.
[148]Voir Steven G. Kellman, « It Is Happening Here : The Plot Against America and the Political Moment », Philip Roth Studies, vol. 4, n°2, 2008, p. 113-123. Ginevra Geraci, « The Sense of an Ending : Alternative History in Philip Roth’s The Plot Against America », Philip Roth Studies, vol. 7, n°2, 2011, p. 188. John Rodden, « Donald and Winston at the Ministry of Alternative Facts », Society, vol. 54, n°3, pp. 215-217. Brittany Hirth, « »An Independant Destiny fo America » : « Roth’s Vision of American Exceptionalism », Philip Roth Studies, vol. 14, n°1, 2018.
[149]Voir Iris Murdoch, L’Attention romanesque, op. cit., p. 26.
[150]OS p. 177.
[151]NEM p. 66-67. Le présent article a été rédigé au printemps 2020.
[152]PE p. 480.
[153]Voir notamment A. Hutchison, « ‘Purity is Petrefaction’ », article cité.
[154]NEM p. 144.
[155]LT p. 448.
[156]NEM p. 90.
[157]Ce sont là les derniers mots de Némésis, dernier roman publié par Roth : « Il nous paraissait invincible. » (NEM p. 226) Point de vue de l’enfance rassemblé dans un « nous » qui se donne un même modèle de virilité masculine (qui peut être Bucky Cantor ou bien Murray Ringold dans J’ai épousé un communiste) destiné à déchoir depuis le paradis des illusions (« il nous paraissait », imparfait).
[158]NEM p. 67.
[159]NEM p. 46.
[160]GAN p. 90.
[161]G. Orwell, 1984, op. cit., p. 241. Voir aussi Essais, articles, lettres, vol. I, Paris, Ivréa, 1995, p. 471.
[162]José Saramago, La Lucidité, tr. fr. Geneviève Leibrich, Paris, Seuil, 2006, p. 286.














