La raison, le sujet, l’histoire.
L’enjeu d’un dialogue entre le poststructuralisme et l’École de Francfort
Jean-Baptiste Vuillerod. Ancien élève de l’ENS Lyon, agrégé de philosophie, rédige actuellement une thèse sur « L’anti-hégélianisme de la philosophie française des années 1960 » sous la direction d’Emmanuel Renault à l’Université Paris Nanterre (laboratoire Sophiapol).
 La critique virulente des notions de raison, de sujet et d’histoire dans le structuralisme et dans le poststructuralisme français – on écrira dorénavant (post)structuralisme[1] – pourrait faire croire que ces grandes catégories de la modernité philosophique sont périmées et ne sont plus des concepts adéquats pour la pensée contemporaine. Le plus souvent, on s’accorde sur l’unilatéralité de la critique de ces catégories par le (post)structuralisme, tant chez ceux qui défendent ce « moment philosophique » que chez ceux qui le rejettent au nom d’une « pensée 68[2] » qui coïnciderait à peu de chose près avec la fin de la philosophie. L’hypothèse que nous défendrons est tout autre. Elle consiste à dire, d’un côté, que la critique des conceptions traditionnelles de la raison, du sujet et de l’histoire fut légitime, et qu’en aucun cas on ne saurait revenir dessus pour réhabiliter de manière réactionnaire ces catégories, mais d’un autre côté, elle affirme qu’une pensée renouvelée de la rationalité, de la subjectivité et de l’historicité est nécessaire en philosophie actuellement. Nous souhaiterions ici démontrer la pertinence de cette hypothèse par deux biais. Il s’agira, d’une part, de montrer qu’au sein même du (post)structuralisme français ces notions n’ont jamais été abandonnées et qu’elles ont, malgré l’entretien d’une certaine ambiguïté, continué à faire problème au sein même de la philosophie française des années 1960 et 1970. D’autre part, nous chercherons dans la théorie critique de l’École de Francfort un rapport aux catégories de raison, de sujet et d’histoire qui assume sans ambiguïté la nécessité de critiquer ces notions sans pour autant les abandonner. Comme il ne sera pas possible d’étudier ici l’ensemble des courants de l’École de Francfort, profondément différenciés et divergents[3], nous nous concentrons essentiellement sur la philosophie de T. W. Adorno. Non seulement parce que Stiegler insiste sur son travail commun avec Horkheimer, mais parce que la philosophie adornienne est révélatrice d’une réflexion dialectique sur le sujet, la raison et l’histoire.
La critique virulente des notions de raison, de sujet et d’histoire dans le structuralisme et dans le poststructuralisme français – on écrira dorénavant (post)structuralisme[1] – pourrait faire croire que ces grandes catégories de la modernité philosophique sont périmées et ne sont plus des concepts adéquats pour la pensée contemporaine. Le plus souvent, on s’accorde sur l’unilatéralité de la critique de ces catégories par le (post)structuralisme, tant chez ceux qui défendent ce « moment philosophique » que chez ceux qui le rejettent au nom d’une « pensée 68[2] » qui coïnciderait à peu de chose près avec la fin de la philosophie. L’hypothèse que nous défendrons est tout autre. Elle consiste à dire, d’un côté, que la critique des conceptions traditionnelles de la raison, du sujet et de l’histoire fut légitime, et qu’en aucun cas on ne saurait revenir dessus pour réhabiliter de manière réactionnaire ces catégories, mais d’un autre côté, elle affirme qu’une pensée renouvelée de la rationalité, de la subjectivité et de l’historicité est nécessaire en philosophie actuellement. Nous souhaiterions ici démontrer la pertinence de cette hypothèse par deux biais. Il s’agira, d’une part, de montrer qu’au sein même du (post)structuralisme français ces notions n’ont jamais été abandonnées et qu’elles ont, malgré l’entretien d’une certaine ambiguïté, continué à faire problème au sein même de la philosophie française des années 1960 et 1970. D’autre part, nous chercherons dans la théorie critique de l’École de Francfort un rapport aux catégories de raison, de sujet et d’histoire qui assume sans ambiguïté la nécessité de critiquer ces notions sans pour autant les abandonner. Comme il ne sera pas possible d’étudier ici l’ensemble des courants de l’École de Francfort, profondément différenciés et divergents[3], nous nous concentrons essentiellement sur la philosophie de T. W. Adorno. Non seulement parce que Stiegler insiste sur son travail commun avec Horkheimer, mais parce que la philosophie adornienne est révélatrice d’une réflexion dialectique sur le sujet, la raison et l’histoire.
L’objectif d’un tel parcours est de montrer la pertinence du geste de Bernard Stiegler dans États de choc qui, selon nous, pour repenser à nouveaux frais la rationalité, la subjectivité et l’historicité, a ouvert un espace de communication entre le poststructuralisme et la théorie critique. Cette communication n’a rien d’une discussion à l’amiable qui viserait à mettre d’accord ces deux courants philosophiques et à affirmer, in fine, qu’ils ont pensé la même chose. Il s’agirait plutôt d’une explication – au sens de « on va s’expliquer maintenant ! » – qui cherche à les confronter de manière fructueuse plutôt que de poursuivre l’ignorance et l’indifférence réciproque qui animent le plus souvent les partisans de ces courants et en font deux parallèles qui, des deux côtés du Rhin, poursuivent leur route à l’infini sans jamais se croiser. À partir de la thèse selon laquelle la philosophie francfortoise, du moins celle d’Adorno et de Horkheimer, serait parvenue à penser de manière univoque ce qui, dans la philosophie française, serait resté ambigu, Stiegler pose les bases d’un travail à poursuivre, celui d’une communication et d’un dialogue à établir entre ces deux espaces de pensée.
Une critique ambigüe
Il est certain que le (post)structuralisme a rompu la conception traditionnelle du sujet, tant dans sa conception cartésienne que dans sa conception anthropologique. Le sujet cartésien, défini comme conscience de soi, identique et transparente à elle-même, fut définitivement congédié. Deleuze, dans Nietzsche et la philosophie, écrit : « Rappeler la conscience à sa modestie nécessaire, c’est la prendre pour ce qu’elle est : un symptôme, rien que le symptôme d’une transformation plus profonde et de l’activité de forces d’un tout autre ordre que spirituel[4]. » Le sujet conscient n’est plus qu’un effet de mécanismes historiques, sociaux, inconscients, langagiers, vitaux, etc. plus profonds qui en sont les causes réelles. Dans un beau texte sur Valéry, Derrida parle de « cet hétérogène surcroît d’altérité[5] » qui sépare toujours le sujet de lui-même et qui l’empêche d’être absolument présent à lui-même. Et Lacan mentionne cette « ligne de fiction[6] » par laquelle l’unité du moi se constitue à travers la médiation d’une image spéculaire. Bien que les conceptions cartésienne et anthropologique du sujet ne se recoupent pas totalement – dans Les mots et les choses, Foucault distingue bien l’âge classique, auquel appartient Descartes, de l’époque anthropologique et humaniste qui est propre au XIXe siècle –, la critique du sujet traditionnel implique une critique de l’anthropologie et de l’humanisme. C’est le thème de la mort de l’homme chez Foucault[7]. C’est aussi la « définition de l’humanisme comme idéologie[8] » chez Althusser. L’homme aurait été, à partir du XIXe siècle, un prolongement des apories de la conception classique du sujet.
Par la critique du sujet, c’est toute la modernité philosophique qui se voit ébranlée en sa notion la plus centrale. Pour autant, contrairement à ce qui est dit parfois, il n’est pas vrai qu’une telle critique soit unilatérale et sans reste. Le sujet, à différents niveaux, a continué à être une catégorie effective dans le (post)structuralisme[9]. Cela est évident chez le dernier Foucault qui relit toute son œuvre à l’aune de la question de la subjectivation[10], ainsi que chez le dernier Deleuze[11]. Mais cela n’en est pas moins vrai dès les années 1960 lorsque Deleuze parlait de « sujets larvaires[12] » et lorsqu’il écrivait, dans un texte consacré justement au structuralisme : « Le structuralisme n’est pas du tout une pensée qui supprime le sujet, mais une pensée qui l’émiette et le distribue systématiquement, qui conteste l’identité du sujet, qui le dissipe et le fait passer de place en place, sujet toujours nomade, fait d’individuations, mais impersonnelles, ou de singularités, mais pré-individuelles[13]. » L’importance que Foucault accordait à l’expérience-limite dans son Histoire de la folie, en 1960, pourrait aussi être comprise comme un signe de l’importance accordée à la subjectivation dès les années 1960. Il s’agit donc moins d’abolir le sujet que de le penser autrement, de le penser sans aucune identité, qu’elle soit celle de la conscience ou de l’essence humaine. Il est vrai que ce sauvetage a été moins mis en avant par les (post)structuralistes que la critique radicale du sujet traditionnel. De là l’ambiguïté de leur critique qui, d’un côté, a prétendu rompre totalement avec la catégorie de sujet et, d’un autre, a bien été obligée de reconnaître la non-pertinence d’une telle rupture.
On observe le même mouvement pour la question de l’histoire, bien que les lignes de partage au sein du (post)structuralisme soient ici plus tranchées. On sait que Deleuze a opposé l’événement et le devenir à l’histoire[14] pour faire valoir les expérimentations purement créatrices qui échappent à toute causalité passée et à toute réinscription à venir rétablissant après coup un sens et une totalisation harmonieuse des faits. Et ce que reproche Derrida à Foucault, dans « Cogito et histoire de la folie », c’est précisément de continuer à écrire une histoire plutôt que de s’interroger sur la constitution du temps et de l’historicité par la différance : « Que toute histoire ne puisse être, en dernière instance, que l’histoire du sens, c’est-à-dire de la Raison en général, c’est ce que Foucault ne pouvait pas ne pas éprouver (…). Il faut donc, il est peut-être temps de revenir à l’anhistorique en un sens radicalement opposé à celui de la philosophie classique[15] ». L’insistance de Derrida sur la notion d’événement s’inscrit, comme chez Deleuze, dans le droit fil de cette critique de l’histoire[16]. Toute une partie du (post)structuralisme a donc rejeté la catégorie même d’histoire, n’y voyant qu’une conception déterministe, téléologique, totalisatrice, c’est-à-dire rationaliste, de la temporalité qui est attribuée aux grandes philosophies de l’histoire, notamment celles de Hegel et du marxisme dans sa version stalinienne. Une autre partie du (post)structuralisme, cependant, a joint à cette critique de la conception traditionnelle de l’histoire une nouvelle conception de l’historicité qui fait droit à la fois à la processualité historique et à l’événementialité créatrice. Les œuvres d’Althusser et de Foucault sont, pour une grande part, consacrées à cela. Cette nouvelle conception de l’histoire fait valoir les ruptures, les rationalités éclatées, les surgissements inattendus contre toute tentative de réinstaurer de la continuité, de la totalité, du prévisible. C’est cela que veut exprimer Foucault avec la notion de discontinuité dans L’archéologie du savoir : « La discontinuité, c’était ce stigmate de l’éparpillement temporel que l’historien avait à charge de supprimer de l’histoire. Elle est devenue maintenant un des éléments fondamentaux de l’analyse historique[17]. » C’est une telle histoire « éparpillée » qui s’oppose aux philosophies de l’histoire.
L’affaire paraît donc simple en ce qui concerne l’histoire : une partie du (post)structuralisme aurait rejeté l’histoire pendant qu’une autre se serait contenté de la repenser. Il n’en est pourtant rien et l’ambiguïté reparaît, comme pour la question du sujet, puisque Deleuze, comme l’a bien souligné Guillaume Silbertin-Blanc[18], n’a jamais autant séparé l’histoire et le devenir que certains textes le laissent penser et a toujours pensé l’intrication des deux. Et Derrida, en pensant l’événement comme « possibilité impossible[19] », a lui aussi refusé, à sa manière, que l’on ait affaire à l’événement en tant que tel, que l’on puisse avoir affaire à sa présence hors de l’histoire. Ainsi, même la partie du (post)structuralisme qui est la plus critique à l’encontre de l’histoire ne parvient pas à se débarrasser complètement de l’historicité et exige au contraire de la penser d’une manière nouvelle, comme s’y sont essayés Foucault et Althusser.
Nous en arrivons maintenant à la rationalité qui, elle non plus, n’a pas été épargnée par la critique. Foucault, dans son Histoire de la folie à l’âge classique, notamment dans la première préface de ce livre[20], fait reposer son argumentation sur une opposition entre la raison et la folie qui serait survenue en Europe au début du XVIIe siècle et prend clairement parti pour la folie d’un Hölderlin ou d’un Artaud contre la tradition rationaliste. Dans Différence et répétition, Deleuze se propose de critiquer « l’élément de la représentation comme « raison »[21] », et l’on sait que Deleuze a toujours prétendu avoir exécré la tradition rationaliste[22]. Ce qui est reproché à la raison, c’est sa tendance épistémologique à valoriser l’identité contre la différence ainsi que la tendance politique qui en découle et qui consiste à être une instance de pouvoir et de domination qui exclut ou subordonne tout ce qui n’est pas conforme au modèle identitaire prôné. Il est vrai que le scientisme d’Althusser le fait bien sûr échapper à une telle critique radicale de la rationalité, cette critique étant incompatible avec sa préoccupation d’élever le marxisme au rang de science. Il bataille cependant pour promouvoir une nouvelle forme de rationalité qu’il estime devoir rompre avec la rationalité hégélienne[23]. Mais par là, il ne fait que dire à voix haute ce que les autres pensent tout bas : il ne s’agit pas d’abandonner totalement la raison, mais simplement d’élaborer une nouvelle forme de rationalité. Jamais le logos n’a été désaffecté dans le (post)structuralisme. Ainsi, Deleuze a écrit une Logique du sens et une Logique de la sensation. Foucault a élaboré une archéologie et une généalogie. La critique de la raison souffre donc d’une grande ambiguïté chez ces auteurs qui critiquent d’un côté ce qu’ils réhabilitent d’un autre mais sans le dire, ou du moins en y insistant peu. Une phrase de la Grammatologie illustre parfaitement cet embarras du (post)structuralisme avec la raison : « La « rationalité » – mais il faudrait peut-être abandonner ce mot pour la raison qui apparaîtra à la fin de cette phrase – qui commande l’écriture ainsi élargie et radicalisée, n’est plus issue d’un logos et elle inaugure la destruction, non pas la démolition mais la dé-sédimentation, la dé-construction de toutes les significations qui ont leur source dans celle de logos. En particulier la signification de vérité [24]. » Il y a donc, selon Derrida, une rationalité qui n’est pas rationnelle, un logos qui n’est plus du logos. C’est que la déconstruction est une nouvelle logique qui défait la logique traditionnelle et révèle toute l’ambiguïté de la critique (post)structuraliste de la raison.
Ce bref parcours au travers des catégories de sujet, d’histoire et de raison chez les auteurs (post)structuralistes visait simplement à montrer, d’une part, que ces catégories ne font pas l’objet d’une critique unilatérale chez ces auteurs mais d’un réinvestissement nécessaire et fécond, et, d’autre part, à souligner l’ambiguïté de ce réinvestissement qui, la plupart du temps, n’est pas assumé comme tel. C’est en raison de cette ambiguïté que nous nous tournons maintenant vers l’École de Francfort pour y trouver une critique de la rationalité, de la subjectivité et de l’historicité qui n’est plus ambigüe mais dialectique. Comme il nous est impossible, dans le cadre de ce travail, de mener une réflexion approfondie sur l’ensemble de l’école francfortoise, nous nous tournerons vers la philosophie d’Adorno. C’est elle, en partie, que discute Stiegler, puisqu’il se tourne essentiellement vers La dialectique de la raison, co-écrite avec Horkheimer. Mais c’est elle, surtout, qui va le plus loin l’élaboration d’une nouvelle pensée du sujet, de la raison et de l’histoire, prenant acte de leur critique, mais refusant tout rejet unilatéral.
Une critique dialectique
La force de l’École de Francfort a été de produire une critique de la raison, du sujet et de l’histoire qui a refusé d’emblée, et sans ambiguïtés, l’unilatéralité d’une critique sans reste. Il s’est agi dès le départ de critiquer les conceptions traditionnelles de la rationalité, de la subjectivité et de l’historicité pour repenser ces notions à nouveaux frais. Bien que ce geste diffère selon les générations qui se sont succédées à la tête de l’École de Francfort, cela reste vrai pour les représentants contemporains de la Théorie critique, au premier rang desquels Jürgen Habermas et Axel Honneth, mais cela l’est d’autant plus pour ses fondateurs que sont Adorno et Horkheimer[25]. Pour éclairer les mérites de cette démarche, nous proposerons une lecture du texte d’Adorno « Le contenu de l’expérience », qui appartient aux Trois études sur Hegel. La thèse que nous développerons est que ce texte peut être lu comme l’articulation, par Adorno, d’une dialectique de la raison, d’une dialectique du sujet et d’une dialectique de l’histoire[26].
Adorno, dans « Le contenu de l’expérience », propose une lecture de la Phénoménologie de l’esprit qui s’oppose à l’interprétation ontologique que Heidegger en avait donné dans les Holzwege[27]. Contre l’idée de Heidegger selon laquelle Hegel aurait été le penseur de la conception moderne de l’être comme sujet, Adorno recentre la problématique de la Phénoménologie sur ce qui constitue le cœur de l’ouvrage : l’expérience[28]. L’expérience, telle que la pense Hegel, ne dévoile pas l’être, elle est bien plutôt l’épreuve de la contradiction : « ce sur quoi porte à chaque fois l’expérience chez Hegel est la contradiction qui met en mouvement une telle vérité absolue[29]. » En insistant sur le rôle de la contradiction, Adorno entend insister sur la dimension dialectique, et non ontologique, de l’expérience chez Hegel, fidèle en cela à l’introduction de la Phénoménologie de l’esprit : « Ce mouvement dialectique que la conscience pratique à même elle-même, aussi bien à même son savoir qu’à même son objet, dans la mesure où, pour elle, le nouvel objet vrai en surgit, est proprement ce que l’on nomme expérience[30]. » L’expérience, chez Hegel, désigne l’épreuve que fait la conscience de l’insuffisance de son savoir du fait des contradictions qu’elle rencontre au sein même de l’objet ainsi qu’entre le savoir qu’elle a de l’objet et l’objet lui-même. Adorno retient de Hegel cette conception de l’expérience comme expérience de la contradiction. Ce qui l’intéresse, dans la Phénoménologie de l’esprit, ce n’est pas le savoir absolu en lequel le sujet et l’objet s’identifient l’un à l’autre, autrement dit ce n’est pas le moment de la synthèse. C’est bien plutôt le moment lors duquel les opposés passent l’un dans l’autre pour entrer en contradiction et non pour s’identifier l’un l’autre. La Dialectique négative est parfaitement claire sur ce point : « En s’éprouvant comme non-identique à soi-même et mû en lui-même, le concept conduit, n’étant plus simplement lui-même, à son autre selon la terminologie hégélienne, sans l’absorber[31]. » Jamais, par conséquent, la synthèse positive ne vient surpasser le mouvement de négativité qui fait passer l’un dans l’autre les opposés sans pour autant les identifier : « La négation de la négation ne résilie pas cette négation mais révèle qu’elle n’était pas assez négative[32] ». Plutôt que de réaliser la synthèse, il s’agit d’opérer ce que la Théorie esthétique nomme un « passage aux extrêmes[33] ». En appelant ce moment « dialectique », Adorno n’est en aucune façon infidèle à Hegel. Ce dernier, dans l’Encyclopédie, avait précisément nommé « moment dialectique » le passage des déterminations finies « dans leurs opposés[34] ». Mais il avait dépassé ce moment dialectique pour un moment « spéculatif ou positivement-rationnel [35] » qui « appréhende l’unité des déterminations dans leur opposition », c’est-à-dire qui fait triompher l’identité sur la différence, la réconciliation synthétique sur la contradiction. Adorno propose de ne retenir de Hegel que le moment dialectique de sa philosophie et d’écarter le moment spéculatif [36]. Et ce geste, il le trouve chez Hegel lui-même lorsque ce dernier s’attache à décrire l’expérience dans la Phénoménologie de l’esprit[37]. On comprend donc que « Le contenu de l’expérience » soit consacré au texte de 1807. Non pas qu’Adorno cherche à commenter le texte hégélien sous toutes ces facettes, mais il cherche à actualiser la conception hégélienne de l’expérience. Cette actualisation, il est possible de la comprendre comme la mise en évidence de trois dialectiques : une dialectique de la subjectivité, une dialectique de la rationalité, et une dialectique de l’historicité.
La première dialectique mentionnée par Adorno est la dialectique du sujet et de l’objet. Conformément au sens que nous venons de mentionner de la dialectique, il s’agit pour Adorno d’analyser dans quelle mesure l’objet passe dans le sujet et le sujet passe dans l’objet, sans pour autant que les deux s’identifient. Commençons par aborder la question depuis l’objet. Que l’objet entre dans une dialectique avec le sujet signifie que l’objet n’est pas quelque chose qui serait indépendant du sujet et qu’on pourrait saisir pour lui-même. À l’idée selon laquelle « l’expérience désignerait ce qui est immédiatement là, ce qui est immédiatement donné[38] », Adorno oppose le fait qu’il n’y a pas d’expérience pure de ce qui est et qu’il est impossible d’avoir accès au réel sans la médiation de la pensée : « Selon Hegel, il n’y a rien ni au ciel ni sur terre qui ne soit « médiatisé », rien qui ne contienne par conséquent, en tant qu’il est déterminé comme ce qui est simplement là, un moment spirituel[39] ». L’objet n’est donc pas quelque chose de subsistant par lui-même, il passe dans son opposé, dans le sujet : « elle [= l’immédiateté] a toujours déjà en elle son autre, la subjectivité sans laquelle elle ne serait absolument pas « donnée », et n’est pas en tant que telle objectivité[40]. » Hegel va ici plus loin que Kant puisque, d’une part, il refuse de limiter la médiation conceptuelle aux seules formes de l’entendement, aux catégories, pour l’appliquer aussi aux contenus sensibles[41], et, d’autre part, il a maintenu la possibilité de connaître la réalité et pas seulement le phénomène[42]. On aurait tort aussi de penser que la médiation du sujet et de l’objet est quelque chose de paisible. Le fait qu’il s’agisse d’une médiation dialectique implique le surgissement de la contradiction et la remise en mouvement perpétuelle des deux pôles[43]. Le sujet, en effet, par l’épreuve qu’il fait de l’objet, ne cesse de faire l’expérience de l’insuffisance de son savoir et est ainsi contraint de remettre sa connaissance de l’objet en question. La médiation subjective n’implique donc pas que le sujet plaque sur l’objet ses catégories de façon arbitraire, elle est bien plutôt l’occasion de ce qu’Adorno nomme le « primat de l’objet[44] » par lequel le sujet se voue à l’expérience singulière de l’objectivité pour remettre en question le savoir préconçu qu’il en a.
Qu’en est-il maintenant en sens inverse, depuis le sujet ? De même que l’objet s’est révélé non autonome du fait de sa médiation par le sujet, le sujet se révèle non autonome du fait qu’il est médiatisé par l’objet. Penser une telle dialectique, c’est refuser la conception traditionnelle, cartésienne du sujet, pour laquelle le sujet est conscient de lui-même, identique à lui-même et transparent à lui-même. La présence de l’objectivité dans le sujet fait du sujet lui-même un objet et met à mal la pleine conscience que le sujet a de lui-même comme pure subjectivité : « La conscience personnelle de l’individu, dont la théorie traditionnelle de la connaissance analyse la structure, peut être mise à nu dans son caractère illusoire. Son détenteur non seulement doit son existence et la reproduction de sa vie à la société ; mais tout ce par quoi il se constitue comme spécifiquement connaissant, c’est-à-dire la généralité logique, qui domine sa pensée, est aussi, comme l’a surtout montré l’école de Durkheim, toujours de nature sociale[45]. » La médiation du sujet par l’objectivité introduit ainsi tout un ensemble de déterminations sociales inconscientes dans la constitution de la subjectivité. Le seul moyen de prendre conscience de ces déterminations sociales, et de les critiquer lorsqu’elles servent la domination, c’est de faire une expérience singulière de l’objectivité. C’est là que le premier processus, qui allait de l’objet vers le sujet, rebondit sur le second processus, qui va du sujet vers l’objet. Car le sujet ne peut prendre conscience de ses déterminations objectives que s’il fait une expérience de l’objectivité qui lui révèle ces déterminations objectives. Dans la Dialectique négative, Adorno soulignera notamment l’importance de l’expérience de la souffrance dans cette prise de conscience de la détermination sociale du sujet et de son caractère injuste, la souffrance étant l’occasion d’un questionnement généralisé de l’objectivité comme cause de cette souffrance[46]. La critique de la conception traditionnelle du sujet ne se fait donc pas au prix d’un abandon de la subjectivité. Au contraire, Adorno se sert de cette critique pour comprendre, d’une part, que le sujet est construit socialement, et, d’autre part, qu’il est néanmoins possible d’atteindre une expérience subjective critique qui permette une prise de distance critique vis-à-vis de cette détermination sociale. Loin d’abandonner la subjectivité, c’est à sa refonte conceptuelle que travaille Adorno.
La seconde dialectique est celle qui s’installe entre la raison et le mythe. Cette seconde dialectique enchaîne immédiatement sur la première. Nous avons vu qu’il s’agissait, pour le sujet, de parvenir à une expérience de l’objet qui permette une prise de distance critique par rapport aux déterminations sociales qui servent la domination. Cette prise de distance critique exige une nouvelle pensée de la rationalité. Dans la modernité, la rationalité a été pensée, d’abord, comme connaissance scientifique puis, de manière proprement philosophique chez Kant, comme réflexion sur le savoir scientifique afin de le légitimer : « La philosophie théorique en tout cas avait encore chez Kant son canon dans les sciences positives, dans l’examen de leur validité, dans la question donc de savoir comment une connaissance scientifique est possible[47]. » Une telle conception de la raison s’avère problématique. En effet, la réflexion critique de la philosophie de l’Aufklärung n’est parvenue qu’à fonder les sciences positives, or ces dernières fonctionnent en imposant de force une forme générale, le concept, à un contenu particulier. Les sciences et la philosophie qui les légitiment ont ainsi creusé un « fossé » entre « l’impénétrabilité du contenu » et « l’immutabilité des formes »[48], elles ont pensé la soumission violente du contenu à la forme, sans respect pour le contenu lui-même. C’est cette violence qui fait basculer la raison dans le mythe. Pour le comprendre, il convient de nous rapporter à la Dialectique de la raison, un texte qu’Adorno a co-écrit avec Horkheimer. Les auteurs s’y opposent à l’idée selon laquelle l’Aufklärung, « au sens le plus large de pensée en progrès[49] », ou de raison, serait dans un rapport de stricte adversité par rapport au mythe. Entre la raison et le mythe, une dialectique s’installe. Le mythe, pour sa part, a déjà des aspects rationnels puisqu’il cherche à expliquer la nature : « Mais les mythes, victimes de l’Aufklärung, étaient eux-mêmes déjà des produits de celle-ci. […] Le mythe prétendait informer, dénommer, narrer les origines : mais par là même il prétendait aussi représenter, confirmer, expliquer[50]. » Parce qu’il tend à la connaissance, le mythe annonce la raison et il est illusoire de vouloir les dissocier totalement. Mais de même que le mythe est déjà raison, la raison est encore mythique : « En tant que souverains de la nature, le dieu créateur et la raison organisatrice se ressemblent. L’homme ressemble à Dieu par sa souveraineté sur l’existence, par son regard qui est celui d’un maître, par le commandement qu’il exerce[51]. » De même que le mythe met en scène la domination, la science se comporte à l’égard de la nature comme une domination qui soumet les objets à des concepts préconçus qui sont destinés non pas à les connaître, mais à les utiliser de manière technique[52]. La domination mythique se retrouve donc dans la raison scientifique. Raison et mythe passent l’un dans l’autre dans un tournoiement dialectique qui, loin de les identifier, fait entrer chaque terme en contradiction avec lui-même. Le projet de la Dialectique de la raison est ainsi de critiquer la rationalité scientifique moderne qui ne parvient pas à une connaissance adéquate de ses objets et qui est soumise à des impératifs techniques d’origine sociale.
« Le contenu de l’expérience » fait fond sur le texte co-écrit avec Horkheimer pour critiquer la rationalité scientifique qui plaque avec violence l’identité du concept sur des objets singuliers. Mais Adorno refuse de verser dans une critique unilatérale de la raison. Selon lui, c’est la grandeur de Hegel que d’avoir évité l’irrationalisme dans lequel, à ses yeux, est tombé Bergson : « Hegel savait que toute critique de la conscience réifiante, morcelante et aliénante est impuissante lorsqu’elle se borne à lui opposer de l’extérieur une autre source de connaissance. Il savait qu’une conception de la ratio qui déborde la ratio doit irrémédiablement succomber à son tour aux propres critères de celle-ci. C’est pour cette raison que Hegel a fait de la contradiction entre l’esprit scientifique et la critique de la science, contradiction qui est patente chez Bergson, le principe même de la philosophie. La pensée de la réflexion ne se dépasse que par la réflexion : la contradiction, que condamne la logique, devient le médium de la pensée, la vérité du logos[53]. » Il ne s’agit donc pas d’abandonner les exigences de la raison, mais de réfléchir de manière rationnelle sur les errances de la raison et sur ce qui pousse la raison à la domination mythique. Autrement dit, il faut substituer à une réflexion de premier degré, de nature kantienne, une réflexion de second degré qui se voudrait « réflexion de la réflexion[54] ». Alors que Kant pensait que la réflexion critique devait avoir pour seul but de fonder les sciences, Adorno voit dans la philosophie hégélienne la possibilité d’une réflexion critique sur les sciences et par conséquent sur la réflexion kantienne elle-même. Seule cette réflexion au carré ne reproduirait pas la domination que la science impose à ses objets et pourrait ainsi parvenir « à l’intelligence des contenus essentiels par une autoréflexion critique précisément de la philosophie critique des Lumières et de la méthode de la science, au lieu de se contenter de l’examen propédeutique des possibilités épistémologiques[55]. » C’est uniquement en méditant rationnellement les limites de la raison scientifique qu’un meilleur savoir de l’objet peut advenir. Pour ce faire, la raison ne doit ni être conçue comme une connaissance scientifique qui plaque ses concepts sur les choses, ni comme une réflexion première qui viendrait fonder la connaissance scientifique. Elle doit au contraire revendiquer une réflexion seconde qui porte la critique sur ces conceptions de la rationalité traditionnellement admises, et cela pour obtenir, par réflexion, une meilleure connaissance des choses par une rationalité qui n’est plus de nature scientifique. Cette réflexion seconde, c’est précisément celle qui trouve sa source dans l’expérience de la souffrance que nous avons mentionnée en analysant la dialectique de la subjectivité[56]. Pour bien saisir ce point, il nous faut comprendre que la raison dominatrice a une dimension sociale. Cette question est au cœur de la troisième dialectique traitée par Adorno.
La troisième et dernière dialectique est celle de la processualité historique et de l’événement. De même que la dialectique de la rationalité s’enchaînait logiquement avec la dialectique de la subjectivité, de même la dialectique de l’historicité s’enchaîne logiquement avec la dialectique de la rationalité. En effet, la scientificité dominatrice s’étend à l’organisation du monde social et produit une domination qui n’est plus de nature épistémologique mais sociologique, politique et économique. C’est de cette application de la rationalité dominatrice à l’échelle sociale dont parle Adorno lorsqu’il mentionne cette « société réifiée et rationalisée de l’époque bourgeoise, dans laquelle s’est accomplie la Raison dominatrice de la nature[57] ». La rationalité dominatrice étendue à toute la société produit une « totalité antagoniste[58] », c’est-à-dire une société caractérisée par des contradictions (entre l’individu et le tout, entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas)[59]. C’est précisément cette scission de la société avec elle-même, cette contradiction interne qui explique la dialectique entre la processualité historique et l’événement. En effet, les lectures orthodoxes de Marx, au premier rang desquelles la diamat stalinienne, ont insisté sur la processualité historique du capitalisme qui, compte tenu des contradictions qui lui sont inhérentes, devrait s’effondrer de manière nécessaire et mener téléologiquement à la société communiste. À l’inverse, des pensées de l’événement se sont profondément opposées à ce marxisme orthodoxe et ont valorisé la fracture événementielle, le saut hors de l’historicité par lequel, comme l’écrit Benjamin, « les classes révolutionnaires, au moment de l’action, ont conscience de faire éclater le continuum de l’histoire[60]. » Adorno, pour sa part, refuse de choisir entre les deux termes de l’alternative. Il considère que l’histoire est effectivement un processus continu doté de sens, à ceci près que le sens de l’histoire, pour Adorno, est la catastrophe : « Les contradictions, seule véritable ontologie de l’histoire, sont en même temps la loi formelle de l’histoire qui n’avance elle-même que par la contradiction, dans des souffrances ineffables[61]. » Mais c’est précisément ce caractère catastrophique de l’histoire qui appelle, en creux, l’événement libérateur. La société se révèle tellement saturée de contradictions que le mal qui en résulte appelle le salut, bien que celui-ci ne puisse être appréhendé sous l’angle de la nécessité. La processualité historique, dès lors, appelle l’événement et l’événement, de même, malgré son absence de nécessité, a pour condition le processus catastrophique de l’histoire. C’est ce qu’exprime Adorno en affirmant ensemble les deux termes de l’alternatives : « Ou bien la totalité accède à elle-même en se réconciliant, supprime par conséquent, en menant à leur terme ses contradictions, sa propre nature contradictoire et cesse d’être une totalité, ou bien l’ancien non-vrai persiste jusqu’à la catastrophe Le tout de la société tend, de par sa nature contradictoire, à son propre dépassement[62]. » Ou bien le salut, ou bien la catastrophe, mais Adorno ne livre aucune réponse, il affirme au contraire en même temps les deux options parce que chacune passe dans l’autre dont elle est pleinement dépendante, car c’est en tant que le processus historique de la société est contradictoire que l’événement salutaire est exigé, sans aucune garantie qu’il se produise. C’est pourquoi la non-vérité du tout est aussi le lieu de révélation de « l’utopie[63] ». La Dialectique négative exprime merveilleusement cela en affirmant que l’histoire est « Ruine » et que « l’éternité n’apparaît pas en tant que telle, mais brisée au travers des choses les plus éphémères[64]. » Par conséquent, loin de congédier l’histoire au profit d’une événementialité messianique qui nous ferait sortir de l’histoire, Adorno choisit de penser dialectiquement l’événementialité et la processualité historique, ce qui lui permet de continuer à penser l’histoire comme catastrophe appelant sa libération.
Nous voici parvenu au terme du « Contenu de l’expérience ». Il s’est agi pour nous de tracer dans ce texte un parcours qui le rende lisible autour de la problématique de la raison, du sujet et de l’histoire. Il en résulte qu’Adorno, à la différence des critiques (post)structuralistes de ces catégories, a opéré une critique sans ambiguïtés qui, grâce à la méthode dialectique, lui permet de critiquer la raison, le sujet et l’histoire, sans jamais les abandonner totalement, mais toujours en renversant ces notions dans leur autre et en les retournant contre elles-mêmes afin de les repenser de manière originale. Dans les notes préparatoires à la Dialectique de la raison, on trouve ces mots qui résument parfaitement la fécondité actuelle de la démarche dialectique : « dans la pensée dialectique la signification du concept elle-même se voit attaquée. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut la jeter aux orties pour autant[65]. »
Conclusion
On comprend maintenant le geste de Bernard Stiegler dans États de choc qui consiste à faire s’expliquer le (post)structuralisme et la première théorie critique de l’École de Francfort. Relu au travers de la problématique de la rationalité, de la subjectivité et de l’historicité, ce geste apparaît comme une nécessité pour qui voudrait maintenir la critique légitime qui a été produite des conceptions traditionnelles de la raison, du sujet et de l’histoire, tout en affirmant en même temps la nécessité de les repenser autrement à l’aune des exigences contemporaines. L’École de Francfort apporte à la critique (post)structuraliste une saisie dialectique des problèmes à laquelle celle-ci s’est opposée et qu’elle paye par une certaine ambiguïté de son propos. C’est la raison pour laquelle Stiegler nous invite à parcourir de nouveau ces philosophies, à les parcourir ensemble et cela jusque dans leurs limites. Il ouvre ainsi un programme de recherche qui doit passer à la fois par son texte et par les textes du (post)structuralisme et de la Théorie critique qu’il analyse. Dans le cas présent, c’est autour d’une même thématique traitée de manière plus ou moins explicite par les deux espaces de pensée – avec des conséquences importantes – que s’est nouée la discussion. Mais il s’agit d’un programme ouvert, dont Stiegler lui-même n’a pas approfondi tous les aspects et qui mériterait sans doute d’être poursuivi à l’avenir.
[1] La distinction entre un moment structuraliste (Lacan, Lévi-Strauss, Althusser, le Foucault des Mots et les choses) et un moment poststructuraliste (Deleuze, Derrida, Foucault, Lyotard) dans la philosophie française est peu pertinente. D’une part, de nombreuses lignes de continuité existent entre ces deux moments. D’autre part, les différences à tracer entre les auteurs passent par d’autres distinctions. Sur la non-pertinence de ces catégories, cf. É. Balibar, « Le structuralisme : une destitution du sujet ? », in Revue de Métaphysique et de Morale, n° 45, janvier-mars 2005 (http://www.jstor.org/stable/40904028) ; E. de Ipola, Althusser, l’adieu infini, Paris, PUF, 2012, chap. II.
[2] L. Ferry, A. Renaut, La pensée 68, Paris, Gallimard, 1988.
[3] La première période, marquée par les philosophies d’Adorno, de Horkheimer, de Marcuse et de Benjamin, a peu de choses à voir avec la philosophie de Harbermas, dont la première partie de l’œuvre d’Axel Honneth se démarque également.
[4] G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie (1962), Paris, PUF, 2005, p. 44.
[5] J. Derrida, « Qual quelle », in Marges. De la philosophie, Paris, Minuit, 1972, p. 355
[6] J. Lacan, « Le stade du miroir », in Écrits I, Paris, Seuil, 1999, p. 93.
[7] M. Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 398.
[8] L. Althusser, Pour Marx (1965), Paris, La Découverte, 2005, p. 233.
[9] Comme l’a bien remarqué Balibar, cf. « Le structuralisme : une destitution du sujet ? », art. cit., p. 14-15.
[10] M. Foucault, « Le sujet et le pouvoir » (1982), in Dits et écrits I, Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2001, n°306, p. 1041-1042 : « Je voudrais dire d’abord quel a été le but de mon travail ces vingt dernières années. Il n’a pas été d’analyser les phénomènes de pouvoir ni de jeter les bases d’une telle analyse. J’ai cherché plutôt à produire une histoire des différents modes de subjectivation de l’être humain dans notre culture (…). » Sur la conception foucaldienne de la subjectivation, cf. J. Revel, Foucault avec Merleau-Ponty. Ontologie politique, présentisme et histoire, Paris, Vrin, 2015, première partie.
[11] G. Deleuze, « Contrôle et devenir » (1990), in Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 238 : « On peut en effet parler de processus de subjectivation quand on considère les diverses manières dont les individus ou des collectivités se constituent comme sujets : de tels processus ne valent que dans la mesure où, quand ils se font, ils échappent à la fois aux savoirs constitués et aux pouvoirs dominants. Même si par la suite ils engendrent de nouveaux pouvoirs ou repassent dans de nouveaux savoirs. Mais, sur le moment, ils ont bien une spontanéité rebelle. Il n’y a là nul retour au « sujet », c’est-à-dire à une instance douée de devoirs, de pouvoir et de savoir. »
[12] G. Deleuze, Différence et répétition (1968), Paris, PUF, 2011, p. 155.
[13] G. Deleuze, « À quoi reconnaît-on le structuralisme ? » (1972), in L’île déserte, Paris, Minuit, 2002, p. 267.
[14] G. Deleuze, F. Guattari, « Mai 68 n’a pas eu lieu » (1984), in G. Deleuze, Deux régimes de fous, Paris, Minuit, 2003, p. 215 : « Dans les phénomènes historiques comme la Révolution de 1789, la Commune, la Révolution de 1917, il y a toujours une part d’événement, irréductible aux déterminismes sociaux, aux séries causales. Les historiens n’aiment pas bien cet aspect : ils restaurent des causalités par-après. Mais l’événement lui-même est en décrochage ou en rupture avec les causalités : c’est une bifurcation, une déviation par rapport aux lois, un état instable qui ouvre un nouveau champ de possibles. » Voir aussi G. Deleuze, « Contrôle et devenir », art. cit., p. 231 : « Ce que l’histoire saisit de l’événement, c’est son effectuation dans des états de choses, mais l’événement dans son devenir échappe à l’histoire. L’histoire n’est pas l’expérimentation, elle est seulement l’ensemble des conditions presque négatives qui rendent possible l’expérimentation de quelque chose qui échappe à l’histoire. Sans l’histoire, l’expérimentation resterait indéterminée, inconditionnée, mais l’expérimentation n’est pas historique. »
[15] J. Derrida, « Cogito et histoire de la folie », in L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 54-55, note 1..
[16] Cf. J. Derrida, « Une certaine possibilité impossible de dire l’événement », in J. Derrida, G. Soussana, A. Nouss, Dire l’événement, est-ce possible ?, Paris, L’Harmattan, 2001.
[17] M. Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 17. Sur la notion de discontinuité chez Foucault, cf. J. Revel, Foucault, une pensée du discontinu, Paris, Fayard, 2010.
[18] G. Silbertin-Blanc, « Les impensables de l’histoire. Pour une problématisation vitaliste, noétique et politique de l’anti-historicisme chez Gilles Deleuze », in Le Philosophoire, 2003/1, n° 19 (http://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2003-1-page-119.htm).
[19] J. Derrida, « Une certaine possibilité impossible de dire l’événement », art. cit. Voir aussi J. Derrida, Positions, Paris, Minuit, 1972, p. 78 : « Cela explique que, tout en formulant des réserves à l’égard du concept « métaphysique » d’histoire, je me serve très souvent du mot « histoire » pour en réinscrire la portée et produire un autre concept ou une autre chaîne conceptuelle de l » »histoire » (…). »
[20] M. Foucault, « Préface », in Dits et écrits I, op. cit., n°4.
[21] G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 44.
[22] G. Deleuze, « Lettre à un critique sévère », in Pourparlers, op. cit., p. 14. Pour une lecture anti-rationaliste de G. Deleuze, on pourra lire I. Krtolica, Gilles Deleuze, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2015.
[23] Cf. Pour Marx, op. cit., « Contradiction et surdétermination » et « Sur la dialectique matérialiste ».
[24] J. Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 21.
[25] On pourrait nuancer et montrer que la théorie critique contemporaine de Habermas et de Honneth, bien que suivant un tel programme, régresse en quelque sorte en deçà de la première théorie critique d’Adorno et de Horkheimer, au sens où chez Habermas et chez Honneth on retrouve certains présupposés liés à la conception traditionnelle de la rationalité, de la subjectivité et de l’historicité : une conception pacificatrice et synthétique de la raison, la croyance en un grand récit de la modernité et une anthropologie sous-jacente. Il est certain, en tout cas, que le sauvetage des catégories philosophiques traditionnelles n’a absolument pas le même sens chez tous les penseurs de la Théorie critique.
[26] Que ce texte et d’autres (au premier rang desquels la Dialectique négative) puissent être compris à partir de ces trois dialectiques ne signifie pas que la dialectique constitue la « pierre angulaire » de l’œuvre adornienne (M.-A. Ricard, « La dialectique de T. W. Adorno », in Laval théologique et philosophique, vol. 55, n° 2, 1999). Et cela parce que la dialectique, pour Adorno, n’est pas un principe ou une méthode que l’on applique à un objet mais « une structure déterminante de la chose » (T. W. Adorno, Einführung in die Dialektik, Berlin, Suhrkamp, 2010, p. 9). Il y a donc bien des dialectiques concrètes chez Adorno, mais en aucun cas une dialectique érigée en premier principe. De là le fait que le recours à la dialectique, s’il peut tracer dans certains cas un chemin cohérent dans l’œuvre, se révèle aussi souvent insuffisant pour expliquer les gestes théoriques d’Adorno.
[27] M. Heidegger, « Hegel et son concept d’expérience », in Chemins qui ne mènent nulle part (1949), Paris, Gallimard, 1962, tr. fr. W. Brokmeier.
[28] T. W. Adorno, « Le contenu de l’expérience », in Trois études sur Hegel (1957), Paris, Payot, 2003, tr. fr. É. Blondel et al, p. 57.
[29] Ibid.
[30] G. W. F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Paris, Vrin, 2006, tr. fr. B. Bourgeois, p. 127.
[31] T. W. Adorno, Dialectique négative, Paris, Payot, tr. fr. Collège de ¨Philosophie, 2003, p. 193.
[32] Ibid., p. 197.
[33] T. W. Adorno, Théorie esthétique, Paris Klincksieck, 2011, tr. fr. M. Jimenez, p. 72 : « Mais ce qui fut fructueux dans l’art moderne, ce fut le passage aux extrêmes, non pas ce qui restait entre les deux. Quiconque s’efforce de réaliser la synthèse n’aboutit qu’à un consensus équivoque. La dialectique de ces moments ressemble à la dialectique logique en ce que l’autre se réalise dans l’un et non dans une moyenne. »
[34] G. W. F. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, Paris, Vrin, 2012, tr. fr. B. Bourgeois, §81, p. 168.
[35] Ibid., §82, p. 169.
[36] Il est vrai que, dans les Principes de la philosophie du droit (§31, remarque), Hegel qualifie de dialectique l’ensemble du procès logique, tant le moment de la contradiction que le moment de la réconciliation. Mais il n’est pas toujours fidèle à cette conceptualisation, comme le prouve l’Encyclopédie. Sur ce point, cf. A. Stanguennec, « Le dialectique, la dialectique, les dialectiques chez Hegel », in O. Tinland, Lectures de Hegel, Paris, Librairie Générale Française, 2005, p. 86-112.
[37] T. W. Adorno, Dialectique négative, op. cit., p. 193 : « Il arrive presque à la conscience de l’essence négative de la logique dialectique développée par lui et ceci dès l’Introduction à la phénoménologie. »
[38] T. W. Adorno, « Le contenu de l’expérience », art. cit., p. 60.
[39] Ibid., p. 60-61.
[40] Ibid., p. 62.
[41] Ibid., p. 61 : « Alors que la philosophie kantienne, que Hegel présuppose dans toute polémique, a tenté de dégager des formes de l’esprit comme constituants de toute connaissance valide, Hegel a interprété tout ce qui existe comme participant en même temps de l’esprit pour éliminer la séparation kantienne de la forme et du contenu. »
[42] Ibid., p. 70 : « Elle [= la philosophie selon Hegel] ne veut pas se laisser intimider ni renoncer à l’espoir de connaître quand même la totalité du réel et de son contenu, que l’entreprise scientifique lui masque au nom d’acquis sûrs et inattaquables. Hegel a senti la part de régression et de violence que comportait la soumission kantienne et il s’est insurgé contre la phrase célèbre par laquelle la raison, chez Kant, trouvait grâce auprès de l’obscurantisme. »
[43] Ibid. : « Mais les deux moments ne sont pas davantage chez lui fixés dans leur opposition. Ils se produisent et se reproduisent l’un l’autre, se reconstituent à chaque étape et ils ne doivent disparaître que réconciliés dans l’unité du tout. »
[44] T. W. Adorno, Dialectique négative, op. cit., p. 224.
[45] T. W. Adorno, « Le contenu de l’expérience », art. cit., p. 66.
[46] T. W. Adorno, Dialectique négative, op. cit., p. 29 : « Le besoin de faire s’exprimer la souffrance est condition de toute vérité. Car la souffrance est une objectivité qui pèse sur le sujet ; ce qu’il éprouve comme ce qui lui est le plus subjectif, son expression, est médiatisé objectivement. »
[47] T. W. Adorno, « Le contenu de l’expérience », art. cit., p. 67.
[48] Ibid., p. 69.
[49] M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialectique de la raison (1944), Paris, Gallimard, 1974, É. Kaufholz, p. 20
[50] Ibid., p. 25-26.
[51] Ibid., p. 27.
[52] Ibid. : « Le mythe devient Raison et la nature pure objectivité. Les hommes paient l’accroissement de leur pouvoir en devenant étrangers à ce sur quoi ils l’exercent. La Raison se comporte à l’égard des choses comme un dictateur à l’égard des hommes : il les connaît dans la mesure où il peut les manipuler. »
[53] T. W. Adorno, « Le contenu de l’expérience », art. cit., p. 74-75.
[54] Ibid., p. 74.
[55] Ibid., p. 68.
[56] Ibid., p. 76 : « La conscience hégélienne a souffert comme aucune autre conscience philosophique avant elle de l’aliénation entre le sujet et l’objet, entre la conscience et la réalité. Mais sa philosophie avait la force de ne pas fuir cette souffrance pour se réfugier dans les chimères d’un monde et d’un sujet de pure immédiateté. Elle maintenait fermement que l’irrationalité d’une raison purement particulière, qui sert simplement l’intérêt particulier, ne pouvait disparaître que par la vérité réalisée du Tout. Cela compte bien plus dans sa réflexion de la réflexion que les comportements irrationnels auxquels il s’est parfois laissé entraîner quand il cherchait désespérément à sauver la vérité d’une société qui l’avait déjà perdue. »
[57] Ibid., p. 76.
[58] Ibid., p. 79.
[59] Ibid., p. 80 : « La théorie logique et métaphysique de la totalité comme somme de toutes les contradictions signifie, en langage non chiffré, que la société, loin d’être simplement traversée et ébranlée par des contradictions et des disproportions, n’est pas une totalité à la manière d’un tout pacifié mais ne le devient que par le mouvement même de ses contradictions. L’intégration totale de la société, sa réunion en un tout qui ressemble en fait davantage au système qu’à l’organisme – confirmant en cela Hegel – a résulté jusqu’à présent du principe de domination : de la scission elle-même, et elle la perpétue. Ce n’est que par la division en intérêts contradictoires, les intérêts de ceux qui possèdent et les intérêts de ceux qui produisent, que la société s’est maintenue en vie, qu’elle s’est reproduite et élargie, qu’elle a déployé ses forces. »
[60] W. Benjamin, « Sur le concept d’histoire », in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, tr. fr. M. de Gandillac, P. Rusch, R. Rochlitz, p. 440.
[61] T. W. Adorno, « Le contenu de l’expérience », art. cit., p. 83.
[62] Ibid., p. 80.
[63] Ibid., p. 88 : « Le rayon qui révèle le Tout dans tous ses moments comme le non-vrai n’est autre que l’utopie, l’utopie de la vérité entière, encore à réaliser. »
[64] T. W. Adorno, Dialectique négative, op. cit., p. 436.
[65] M. Horkheimer, T. W. Adorno, Le Laboratoire de la Dialectique de la raison. Discussions, notes et fragments inédits, Paris, Éditions de la maison des sciences de l’homme, 2013, p. 208.












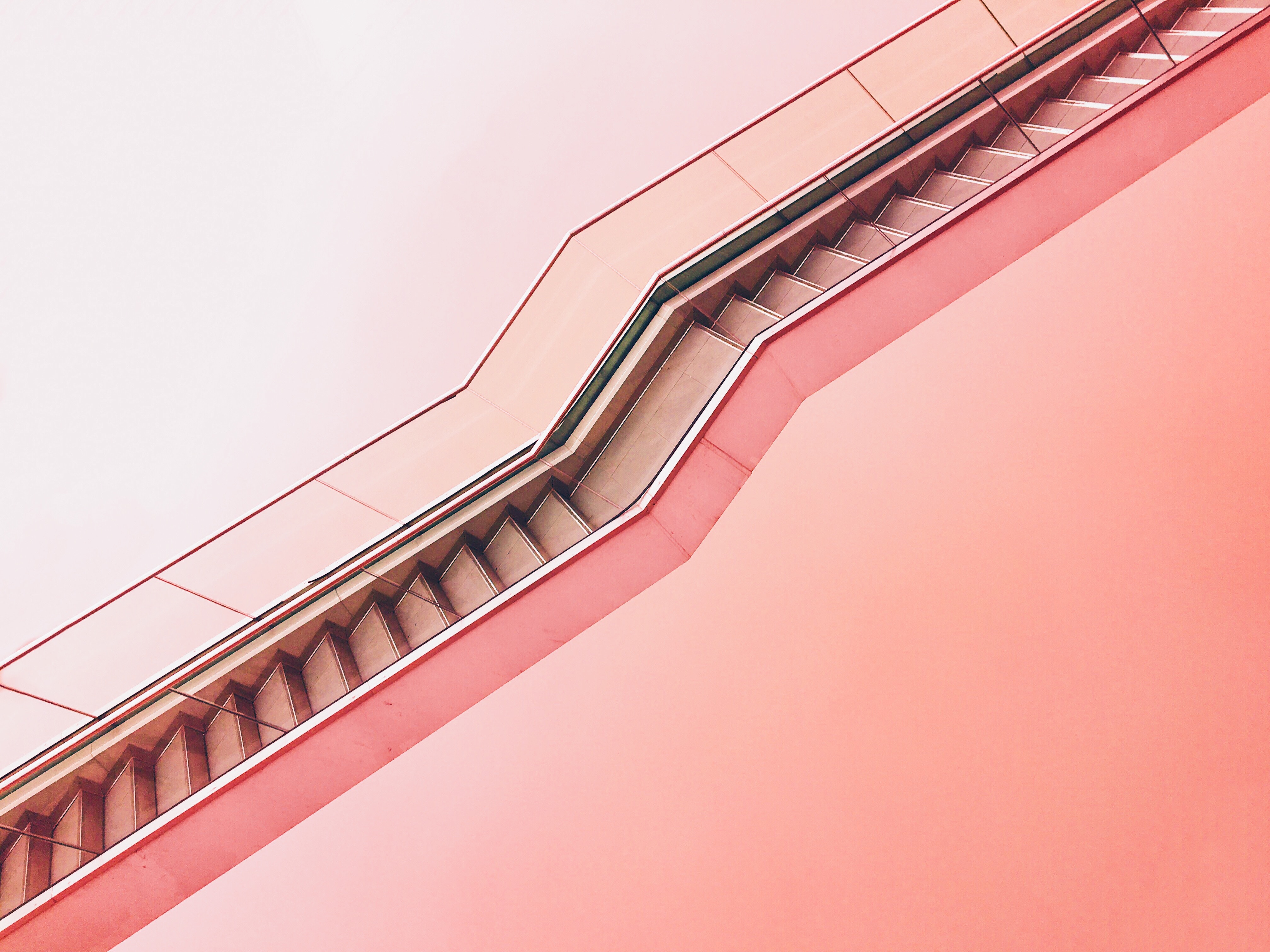


Bonjour,
Peut-être ceci pourrait-il vous intéresser…
https://www.youtube.com/watch?v=kBCDU_PnavQ
Cordialement