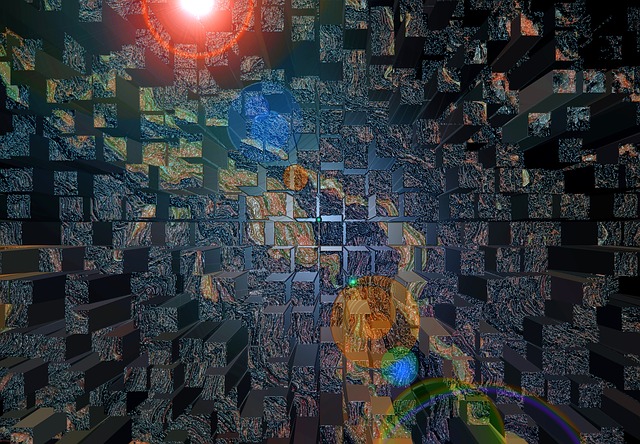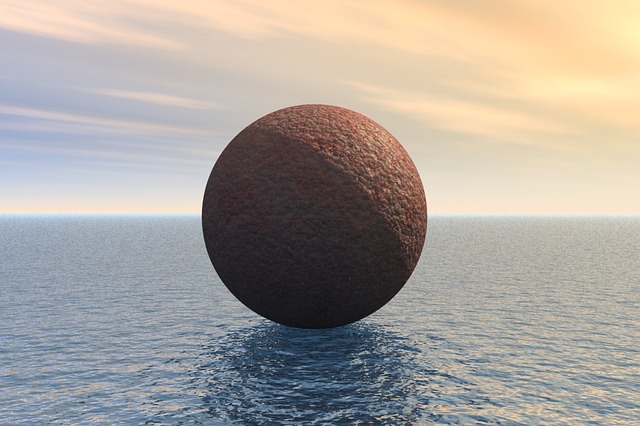La psychologie de l’expertise et l’avenir de l’éthique de la vertu
Alberto Masala « Sciences, Normes et Décisions », Université Paris IV-Sorbonne
Résumé : L’éthique de la vertu néo-aristotélicienne défend une conception dépolitisée de l’éducation morale conçue comme un phénomène universel qui concernerait la vie éthique ordinaire. A l’aune d’arguments issus de la psychologie de l’expertise, je montre que cette tentative de démocratiser Aristote est vouée à l’échec. Cultiver la vertu et la sagesse est un processus fragile qui nécessite d’un milieu social et politique adéquat. Par conséquent, j’avance le projet d’une éthique de la vertu différente : aujourd’hui, les sciences cognitives de l’apprentissage permettent de défendre un aristotélisme politiquement ambitieux, centré sur les réformes des institutions nécessaires pour favoriser plus de sagesse et d’autonomie morale des individus. Abstract : Neo-Aristotelian virtue ethics is committed to a depoliticized conception of moral education, understood as a universal phenomenon at work in everyday moral life. Drawing on data from the psychology of expertise, I will show that this attempt at making Aristotle more democratic ultimately fails. The process of cultivating virtue and wisdom is fragile and requires institutional support. Therefore, we should pursue a different type of virtue ethics. Nowadays, cognitive sciences of learning show us the way to an ambitious political reading of Aristotelian moral psychology, focused on the institutional reforms needed to foster wisdom and moral autonomy.
L’Ethique de la vertu, l’une des principales approches en éthique normative contemporaine, traverse aujourd’hui une crise profonde suite à une confrontation aussi virulente qu’inattendue avec la philosophie dite empiriquement informée et expérimentale.
La possibilité même d’un apprentissage moral par l’expérience de vie tel que cette tradition l’envisage – qui nous rendrait plus généreux, juste, et sage – est mise en question par une série de résultats en psychologie sociale, en psychologie de l’expertise et en sciences cognitives de l’apprentissage. La question centrale est la suivante : le processus d’amélioration morale préconisé par Aristote est-il à la porté de l’homme ordinaire ? Il semblerait que non, à en croire les défenseurs d’une conception dite « situationniste » de la personnalité humaine, selon laquelle le comportement serait influencé par toutes sortes de facteurs contextuels, ce qui exclut l’existence de traits de personnalité stables. Dans une vision si fragmentée de la personnalité, l’aspiration à cultiver des vertus se verrait réduite à une simple utopie[1].
Je vais montrer que l’éthique de la vertu contemporaine mérite de succomber à l’attaque situationniste, car elle souscrit à une version hétérodoxe et trop optimiste de la psychologie morale d’Aristote. L’Ethique à Nicomaque décrit avec une finesse psychologique inégalée l’éducation morale des élites des cités grecques. Mais il s’agit tout autant d’un traité de psychologie morale que de politique institutionnelle, car, d’après Aristote, le processus qui mène à la sagesse est fragile et nécessite un contexte socio-politique adapté. Or, à l’exception notable d’Alasdair MacIntyre dans Après la vertu, les théoriciens de la vertu contemporains ont abandonné cette dimension politique, dissuadés par l’élitisme implicite dans la recherche d’institutions idéales, en soutenant que la psychologie morale d’Aristote décrirait des phénomènes universels de la vie éthique ordinaire. Le situationnisme montre la faiblesse de cette approche, qui se révèle une mauvaise tentative de démocratiser Aristote.
Je commencerai par dévoiler la motivation ultime de l’éthique de la vertu contemporaine, celle de bâtir une éthique du monde ordinaire. Ensuite, je présenterai la structure de l’apprentissage moral chez Aristote, calquée sur l’analogie entre compétences acquises et morales, et j’en critiquerai l’interprétation apolitique sur la base d’arguments issus de la psychologie contemporaine de l’expertise. Dans la dernière section, je défendrai un aristotélisme institutionnaliste orthodoxe. Je montrerai comment les ressources de la psychologie empirique et des sciences cognitives de l’apprentissage peuvent aider l’éthique de la vertu à renaître de ses cendres, dans une version qui aspire à être plus viable. Il s’agira d’un aristotélisme politiquement ambitieux centré sur les réformes des institutions nécessaires pour favoriser la sagesse et l’autonomie morale des individus.
L’éthique des vertus ordinaires
Pourquoi des philosophes inspirés par la psychologie empirique s’en prennent-ils à Aristote, qui semble, sur des questions éthiques, être le champion du sens commun le plus plausible qui soit ? Si nous n’apprenons pas par l’expérience et par l’exemple dans la « vraie vie », un thème central dans l’Ethique à Nicomaque, comment donc progressons-nous ? Serait-ce en nous référant froidement et techniquement aux droits et devoirs qui habitent le langage éthique moderne ?
En réalité, la vraie cible de l’attaque situationniste est la motivation ultime de l’éthique de la vertu contemporaine, issue d’une sensibilité égalitaire et antihéroïque qui vise à anoblir le citoyen ordinaire et son quotidien. Il s’agit d’une des plus fortes « passions démocratiques » des sociétés occidentales, qui se manifeste bien au-delà des sciences humaines, dans les arts, le cinéma et la littérature. En éthique, elle prend la forme d’un retour à l’ordinaire partagé par des approches telles que l’éthique du care, le perfectionnisme et de nombreuses approches de l’éthique appliquée. Le but est, pour ainsi dire, de « remonter le moral » de l’homme ordinaire, antihéros aux nombreuses capacités insoupçonnées, qui soutient le tissu de la vie relationnelle et sociale de nos sociétés démocratiques.
En effet, la pensée éthique moderne a été trop longtemps ailleurs, dans un monde de normes et d’idéaux : elle a déserté la vie commune et le quotidien des relations. Nous connaissons nos droits, nous luttons pour de nouvelles lois qui les défendent encore mieux, mais, entretemps, nous ne comprenons pas vraiment nos proches. Cet oubli de la dimension concrète et humaine s’étend bien au-delà de la sphère des relations intimes, nous empêchant d’élaborer les interactions complexes avec notre médecin, notre avocat, ou notre collègue, qui ne se résument pas au cadre fixé de façon froide par les droits et les devoirs.
Or, Aristote nous parle de qualités humaines que nous rencontrons dans la « vraie vie » : générosité, courage, sagesse. Sa théorie des vertus a été recrutée pour réinjecter une visée éthique dans notre compréhension de la vie commune, pour faire, comme le dit Sarah Brodie, de « l’éthique avec Aristote »[2].
Toutefois, la célébration de l’antihéros ordinaire ne fait pas consensus. Il s’agit d’une conception problématique et peut-être instable des mérites de l’individu. On peut y déceler deux sortes d’hypocrisie, selon le niveau de ressources psychologiques et d’autonomie qu’on veut attribuer au citoyen moderne. D’un côté, les qualités de l’homme commun, sa force et son autonomie peuvent paraître exagérées : la société n’est pas soutenue par une armée d’antihéros ; ce sont au contraire les normes sociales qui préservent un voile de décence morale, lequel tomberait aussitôt la pression sociale levée. Dans cette perspective, la décence morale de l’individu serait stabilisée par la société. C’est la voie suivie par les situationnistes, qui ont recours aux données empiriques pour attaquer l’aristotélisme modeste des vertus ordinaires afin d’écarter complétement l’individu en tant qu’agent autonome, et le remplacer par une conception de la personnalité stabilisée par un réseau d’influences sociales et contextuelles[3].
Inversement, le courage ordinaire d’un médecin ou la sagesse d’une grand-mère peuvent paraître insuffisants, car vidés de toute visée politique. En ce sens, la tendance à un « retour à la vie ordinaire » constituerait plutôt un retranchement dans la vie personnelle et relationnelle, et cela sous prétexte que, pour bien élever des enfants et avoir un travail, il faut déjà être un héros. Cette attitude apolitique cacherait une mentalité de dominés, d’imbéciles heureux exploités par le système.
C’est bien une bataille sur le niveau d’autonomie morale à accorder à l’individu qui se joue aujourd’hui autour de la psychologie morale d’Aristote, dans le débat qui oppose l’éthique de la vertu contemporaine et la philosophie expérimentale. Dans ce qui suit, je vais attaquer l’éthique de la vertu sur le flanc opposé, pour défendre la possibilité d’une conception forte de l’autonomie dans le cadre d’un aristotélisme institutionnaliste orthodoxe.
Aristote : les vertus et la sagesse comme des expertises acquises
Pour Aristote, l’apprentissage moral est nécessaire car les tendances morales innées, les « vertus naturelles », sont insuffisantes, imprécises, non fiables et en conflit potentiel entre elles. Il n’y a pas d’organes moraux innés qui nécessiteraient tout au plus un léger calibrage par la culture et l’environnement. Une aptitude naturelle au chant n’est pas suffisante pour devenir un bon chanteur à l’âge adulte : de la même façon, les propensions spontanées au courage, à la générosité ou à la justice demandent à être raffinées.
Il faut donc une éducation morale, qu’Aristote conçoit sur le modèle de l’acquisition de plusieurs compétences pratiques, qui sont ensuite intégrées au fil d’un processus dont les phases convergent vers l’idéal d’un jugement clair et d’une élimination des résistances internes à l’action. La compréhension strictement théorique et intellectuelle de ce qui est bien joue un rôle important, mais seulement dans un deuxième temps. Elle permet un perfectionnement à ceux qui sont déjà avancés dans l’apprentissage pratique. C’est d’ailleurs cette fonction qu’Aristote attribue à son traité, celle d’orienter une jeunesse déjà bien éduquée.
Sur un plan psychologique plus technique, la clé du modèle est la notion de compétence pratique employée par Aristote comme base de l’analogie avec la morale. Il s’agit d’une compétence pratique acquise, on l’a dit, mais aussi substantielle (non instrumentale) et spécialisée. Ces deux attributs sont essentiels pour comprendre la théorie de l’éducation morale présentée dans l’Ethique à Nicomaque.
Une compétence acquise est instrumentale si elle peut en principe être mise au service de n’importe quel but. La force musculaire ou la capacité de calcul peuvent être entrainées et puis déployées dans toute sorte de tâche. Par contre, la dextérité d’un violoniste est une capacité acquise substantielle, définie par les standards internes à la pratique du violon. Il serait absurde de conseiller au débutant d’entrainer sa « dextérité générale » pendant quelques années, pour ensuite appliquer cette capacité ou violon : mieux vaut commencer à jouer tout de suite, en développant progressivement le type spécifique de dextérité requise.
Il y a des capacités acquises et substantielles qui sont assez généralisables, notamment quand elles ne sont pas trop difficiles, et ne s’éloignent pas trop du répertoire naturel de l’homme. Par exemple, être à l’aise avec une manette pour jouer aux jeux vidéo est une forme de dextérité substantielle acquise qui s’étend assez facilement à d’autres jeux vidéo qui demandent des gestes différents (rotations à 360 degrés, usage de deux joysticks analogiques en même temps, etc.). Mais ce n’est pas le cas de la dextérité au violon, qui est fortement spécialisée et difficilement généralisables à d’autres instruments.
Lorsqu’une compétence est en même temps acquise, substantielle et spécialisée elle ne peut être apprise que par la pratique prolongée de l’activée elle-même et elle requiert la formation progressive d’habitudes spécialisées.
D’ailleurs, comme le montre l’exemple du violon, il n’est pas possible de tout apprendre en même temps (le staccato, les doubles cordes, le pizzicato, etc.) : le macro-processus d’apprentissage se décompose dans l’apprentissage de sous-compétences qui sont ensuite intégrées.
L’apprentissage passe par des étapes prévisibles : d’abord, on n’arrive pas à imiter le bon geste ; ensuite, par le biais d’une exposition répétée à des modèles d’action à imiter, en bénéficiant de leur conseils et corrections, on y parvient de façon imparfaite, avec des résistances internes ; enfin, ces résistances sont dépassées dans le geste fluide d’un musicien affirmé[4].
Aristote applique ce modèle de compétence acquise à la morale : le manque de préparation naturelle rend nécessaire l’acquisition d’un ensemble de compétences morales substantielles et spécialisées. Elles sont acquises sur le tas, dans des situations de vies concrètes, grâce à l’exemple et aux corrections de modèles d’action. Toutes les expériences de vie ne transmettent pas les mêmes leçons : on aura l’opportunité de développer tantôt sa générosité, tantôt son courage ou son sens de la justice. Globalement et au fil du temps, on parvient à fusionner ces capacités dans une sagesse morale plus générale.
Aristote manifeste une sensibilité psychologique très fine et inégalée à la difficulté de l’apprentissage moral. Son rejet de la possibilité de vertus instrumentales applicables à différents contextes comme la discipline ou la capacité à garder le sang froid est motivé par un fort réalisme psychologique : il serait facile de pouvoir apprendre à se maîtriser en général pour ensuite en bénéficier dans les différents domaines de la vie. C’est là une conception très populaire des vertus, prise très au sérieux de l’antiquité jusqu’à la psychologie contemporaine. Mais, d’après Aristote, elle est trop optimiste : la maîtrise de soi est très difficile à cultiver et se généralise aussi peu que la dextérité générale. Il est nécessaire de pratiquer la morale dans plusieurs contextes de vie concrets.
Toutefois, en psychologie morale, le pessimisme sur la nature humaine n’est qu’une question de degré : on peut accuser Aristote d’être encore trop optimiste dans son idéal d’intégration des compétences morales substantielles. Certes, le sang froid doit se pratiquer séparément à la guerre, dans la vie politique et dans la vie personnelle, mais qui nous garantit que ces apprentissages pratiques ne vont pas stagner?
La psychologie de l’expertise contre Aristote : la résistance à la complexité
La résistance à la complexité est une notion que j’introduis pour résumer une série de résultats en psychologie de l’expertise montrant les limites de l’apprentissage par l’expérience. Il semblerait que notre système cognitif ne soit pas conçu pour intégrer toute l’information disponible dans l’environnement. Au contraire, il serait paresseux : il dépenserait des énergies limitées uniquement pour apprendre ce qu’il considère comme strictement nécessaire, et cela, malgré la confrontation avec toutes sortes de situations nouvelles, riches en informations pertinentes.
C’est un phénomène inverse à la « pauvreté du stimulus ». Les linguistes Chomskyens soutiennent que le langage ne peut pas être appris par l’expérience car les exemples d’usages linguistiques auxquels les enfants sont confrontés sont limités et ne contiennent pas suffisamment d’information pour en dériver la structure de la grammaire. Ici, par contre, la limitation des coûts bioénergétiques de mise à jour de nos modèles mentaux impose d’ignorer une richesse informationnelle mise à disposition par l’environnement.
Plusieurs résultats classiques en psychologie de l’expertise convergent vers une telle conclusion. L’apprentissage par la pratique s’arrête à des plateaux très difficiles à dépasser. Les années d’expériences ne nous améliorent pas forcément : dans des tests de compétence, les médecins expérimentés n’ont pas forcément plus de succès que les jeunes diplômés. Ce résultat a été reproduit dans un grand nombre de professions et disciplines : par exemple, Ericsson a longuement étudié la stagnation des joueurs d’échec, des musiciens et des dactylographes par des tests objectifs reconnus dans ces domaines[5].
Mais comment ces plateaux se créent-ils ? La stratégie cognitive, connue sous le nom d’ « apprentissage assimilatif », est souvent à l’œuvre[6]. Il s’agit de la tentative de reformuler de nouveaux défis en termes de vieux problèmes que l’on sait déjà résoudre, au lieu de les utiliser comme une opportunité pour complexifier nos modèles mentaux.
Des études mettent en évidence la tendance de certains médecins à ramener machinalement et sans hésitation un diagnostic de radiographie ambigu au cas de figure connu le plus proche, en ignorant les petites incohérences. Sommés d’adapter une pièce de percussion pour le piano, une majorité de pianistes choisissent le style qui s’y prête le plus parmi ceux qu’ils maîtrisent déjà, sans explorer d’autres pistes plus créatives[7]. Cette rigidité expose à des pièges dus à la familiarité, connus sous le nom d’effet Einstellung (effet de mécanisation) en psychologie de l’expertise[8]. Equivalents aux faux amis pour les langues étrangères, il s’agit de cas dans lesquels une situation inédite se présente sous un faux semblant de familiarité, poussant le connaisseur à l’erreur, alors que le débutant, qui n’a pas acquis de routine statique, s’en sort mieux. Le phénomène a été étudié de façon approfondie dans le jeu d’échecs et il est vraisemblablement la cause d’accidents graves (par exemple nucléaires) dans lesquels des signaux d’alertes ne sont pas reconnus par les surveillants. Les débutants semblent mieux s’adapter à un subtil changement de règles dans un jeu de table, alors que la routine du praticien expérimenté s’en trouve déroutée[9].
Enfin, concernant l’intégration de compétences différentes, en psychologie de l’apprentissage, il est désormais établi qu’il n’existe qu’un très faible transfert entre compétences spécialisées acquises : apprendre le latin n’aide pas vraiment pour l’informatique[10].
Pour résumer, l’apprentissage pratique local, déjà limité par des plateaux, ne se transfère et ne s’intègre pas facilement avec d’autres compétences. Dans l’analogie qu’Aristote établit entre expertise acquise et morale, cela se révèle catastrophique. L’homme ordinaire apprend quelques leçons de vie ici et là, mais beaucoup moins qu’on pourrait imaginer : surtout, les liens ne sont pas faits et ces leçons ne s’intègrent pas dans une vision globale plus riche, une sorte de sagesse générale. Il semblerait que la psychologie morale d’Aristote ne puisse pas être mobilisée pour défendre l’apprentissage moral de l’homme ordinaire.
On pourrait objecter que la connaissance intellectuelle du bien, qu’Aristote considère comme un perfectionnement de l’apprentissage pratique, pourrait bien résoudre les difficultés inhérentes à ce dernier. Il semblerait d’ailleurs que ce soit son but. Mais cette parade intellectualiste ne fonctionne pas. Aristote est loin de penser que la lecture de l’Ethique à Nicomaque pourrait redresser un parcours d’éducation morale mal entamé. Ce serait très flatteur pour les philosophes, mais, malheureusement, il faut être engagé sur la bonne voie pour que la théorie serve à quoi que ce soit.
Le retour aux sources : pour une éthique de la vertu politiquement ambitieuse
Il y a pourtant de l’espoir pour une nouvelle forme d’éthique de la vertu. Dans l’Ethique à Nicomaque, Aristote ne soutient pas du tout que la sagesse serait accessible à l’homme ordinaire : au contraire, il défend une conception très élitiste et aristocratique de la vertu. En ce sens, l’éthique de la vertu contemporaine est un aristotélisme pratique très hétérodoxe, qui renverse l’héroïsme humain et politique qu’on retrouve chez Aristote au profit d’un anti-héroïsme ordinaire et égalitaire.
L’élitisme d’Aristote est répugnant pour la sensibilité éthique contemporaine, mais pouvons-nous mobiliser une psychologie morale aristotélicienne sans en payer le prix ? A bien voir, il semblerait que oui : techniquement, Aristote défend la nécessité de conditions politiques et institutionnelles bien précises pour le développement de la sagesse. Dans le monde ancien, ces conditions ne pouvaient être réunies que pour l’aristocratie, la disparition de l’esclavage ou de la soumission des femmes n’étant pas imaginable. Cela laisse ouverte la voie d’un aristotélisme ambitieux mais recevable aujourd’hui, qui se concentrerait sur la création d’institutions favorisant l’apprentissage par l’expérience, ce processus étant cette fois en mesure de concerner le plus grand nombre, à condition, bien évidemment, que ces institutions soient créées.
S’agit-il d’une simple utopie ? Rien n’est moins sûr. Pour des raisons qui n’ont pas grand-chose à voir avec un sauvetage de l’éthique d’Aristote, plusieurs courants en psychologie de l’expertise et en sciences cognitives de l’apprentissage se sont penchés sur le problème posé par les compétences locales routinières qui stagnent et ne s’intègrent pas. La résistance à la complexité entrave le progrès dans tous les domaines d’excellence comme les sciences ou le sport, où l’on vise un développement continuel et indéfini, sans limites précises.
Mais la difficulté à dépasser des plateaux de stagnation ne se pose pas qu’à haut niveau, pour le passage du stade de connaisseur confirmé à celui de maître. A l’école, la plupart des étudiants stagnent à un niveau de compréhension des sujets étudié très bas, à peine suffisant pour passer les examens, qui ne permet pas l’intégration opérationnelle des connaissances dans sa propre vision du monde et l’application à d’autres domaines. Pour preuve, des études montrent que les étudiants gardent toutes sortes de mécompréhensions concernant des notions scientifiques élémentaires. Ils ont des conceptions fausses sur le fonctionnement du système digestif, sur l’explication correcte des éclipses, sur la gravitation, etc.[11]
Si une partie des solutions proposées, moins pertinentes pour notre propos, concerne des techniques et stratagèmes d’apprentissage à l’usage de l’individu, on retrouve une réflexion assez riche sur le type d’environnement institutionnel qui serait apte à favoriser le développement d’une compréhension profonde, évolutive et intégrée.
Le fil conducteur semble être la nécessité d’établir un véritable éthos de la recherche de la compréhension. La culture est souvent un correctif des limites de la nature : le conservatisme cognitif étant profond, il faut que la recherche d’une compréhension de plus en plus riche soit « socialisée » sous forme de normes implicites et comme modus vivendi d’une communauté de praticiens dans laquelle les novices sont progressivement intégrés. C’est là exactement ce qui se produit dans les communautés de scientifiques, comme les travaux de Merton portant sur l’éthique de la science l’ont mis en évidence[12]. La pratique scientifique suppose un éthos de « communisme épistémique participatif », basé sur des valeurs partagées d’honnêteté intellectuelle et de recherche de plus en plus poussée de la vérité. Merton est arrivé à cette conclusion par une étude sociologique des communautés scientifiques, mais on aurait pu y arriver de façon normative : étant donné le conservatisme épistémique inscrit par défaut dans notre architecture cognitive, la seule façon de promouvoir la recherche de la compréhension est d’instaurer un éthos épistémique qui vise ce but de façon explicite.
Ainsi, Bereiter & Scardamalia proposent d’étendre à l’école l’éthos de la recherche[13]. L’école d’aujourd’hui est bâtie sur un modèle de performance. On prépare les étudiants pour qu’ils passent des tests et des examens de la façon la plus efficace possible. Malgré la rhétorique déployée par l’instruction publique, ceci est incompatible avec une transmission de l’amour de la connaissance. A force d’étudier le minimum nécessaire pour passer le test de mathématique ou d’histoire, l’étudiant finit par acquérir un ensemble de micro-compétences isolées et stagnantes.
Afin de résoudre ce problème, Bereiter & Scardamalia suggèrent de concevoir les classes sur le modèle de petites communautés scientifiques (knowledge building communities). Mais comment faire en sorte que les enfants deviennent de petits scientifiques, s’ils doivent d’abord acquérir des notions basiques ? On peut imaginer que les enfants fassent de la science « à un plus bas niveau », comme s’ils jouaient en deuxième ou en troisième division, par rapport à la première ligue des vrais scientifiques[14]. Les enfants sont amenés à formuler, élaborer et discuter leurs propres explications intuitives avant que les théories scientifiques acceptées ne soient évoquées par l’enseignant. Les résultats de leurs travaux sont enregistrés dans le système informatique de l’école, l’équivalent d’une « publication scientifique » à leur échelle, et transmis à d’autres classes.
Car il ne s’agit pas d’un jeu ou d’une mise en scène dont la motivation sous-jacente serait de passer l’examen d’admission avec de bonnes notes. La chose doit être prise au sérieux. Les enfants intègrent l’éthos scientifique dès le plus jeune d’âge, dans un écosystème institutionnel qui lutte contre le conservatisme cognitif et favorise la recherche de la compréhension et l’intégration des connaissances.
Quel lien y a-t-il entre une recherche communautaire de la compréhension en physique et la morale ? Il y a un lien direct : l’éthique de la recherche permet de pratiquer de nombreuses vertus intellectuelles et pratiques comme le courage intellectuel et l’honnêteté. Mais la science ne permet pas de cultiver toutes les vertus. Le point essentiel est qu’un éthos basé sur la « recherche de la compréhension » favorise le développement et l’intégration des capacités, y compris morales, dépassant notre conservatisme cognitif. Il faut réfléchir à une extension de cet éthos à d’autres domaines institutionnels, pour diffuser et diluer le plus possible l’apprentissage moral. Nous ne pouvons nous améliorer que suite à une expérience de vie prolongée dans un grand nombre de contextes différents.
Au lieu d’anoblir l’homme ordinaire, l’éthique de la vertu devrait s’inspirer de ces travaux en sciences de l’apprentissage pour concevoir des écosystèmes institutionnels où l’apprentissage par l’expérience, dans la vraie vie, ne nous ferait pas stagner mais, au contraire, avancer vers une forme de sagesse pratique plus intégrée[15]. Cela peut paraître très ambitieux, mais il s’agit en réalité d’un retour aux sources. En deux mille ans d’histoire, dans des contextes aussi différents que le néoplatonisme de l’antiquité tardive, les grandes traditions monothéistes chrétienne, arabe et juive, ou encore l’humanisme de la renaissance, l’aristotélisme éthique a eu un très grand succès en tant que psychologie morale de l’activisme éthico-politique. Même dans des cadres métaphysiques, mystiques et religieux c’était, pour ainsi dire, le « module » de l’engagement ici-bas. C’est une histoire intellectuelle qui peut se prolonger grâce aux ressources des sciences cognitives de l’apprentissage et de la psychologie de l’expertise.
[1]Quelques références : D. Fleming, The Character of Virtue: Answering the Situationist Challenge to virtue ethics, Ratio vol. 19, n° 1, , 2006, pp. 24–42 ; R. Kamtekar, Situationism and Virtue Ethics on the Content of Our Character, Ethics: An International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy, vol. 114, n° 3, 2004, pp. 458–91 ; J. Webber, Virtue, Character and Situation, Journal of Moral Philosophy, vol. 3, n° 2, 2006, pp. 195–216 ; C. L. Upton, Virtue Ethics and Moral Psychology: The Situationism Debate, The Journal of Ethics, vol. 13, n° 2–3, 2009, pp. 103–15.
[2] S. Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford University Press, 1991.
[3] M. Alfano, Character as Moral Fiction, Cambridge University Press, 2013
[4] L’existence de ces phases, décrites à ce niveau de généralité, est admise par plusieurs théories de l’acquisition de l’expertise. Les différences émergent sur des points plus spécifiques. Voir : S. E. Dreyfus & H. L. Dreyfus, A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition, California Univ Berkeley Operations Research Center, 1980. K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, et al. (éd.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance, Cambridge University Press, 2006.
[5] K. A. Ericsson, The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of Superior Expert Performance, in The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, New York, Cambridge University Press, 2006, pp. 683–703.
[6] C. Bereiter, M. Scardamalia, Surpassing Ourselves, Illinois, Open Court, 1993.
[7] C. Bereiter, M. Scardamalia, Surpassing Ourselves, op. cit., pp. 156-159.
[8] M. Bilalic, P. McLeod, & F. Gobet, Inflexibility of experts—Reality or Myth? Quantifying the Einstellung Effect in Chess Masters, Cognitive Psychology, vol. 56, n° 2, 2008, pp. 73–102 ; A. S. Luchins, Mechanization in Problem Solving : The Effect of Einstellung, Psychological Monographs, vol. 54, n° 6, 1942.
[9] P. A. Frensch & R. J. Sternberg, Skill-Related Differences in Game Playing, in P. A. Frensch & R. J. Sternberg, Hillsdale (éd.), Complex Problem Solving: Principles and Mechanisms, Lawrence Erlbaum Associates, 1991, pp. 343–81.
[10] J. D. Bransford & L. Schwartz, Rethinking Transfer: A Simple Proposal with Multiple Implications, Review of Research in Education, vol. 24, 1999, pp. 61-100.
[11] X. Li & Y. Li, Research on Students’ Misconceptions to Improve Teaching and Learning in School Mathematics and Science, School Science and Mathematics, vol. 108, n° 1, 2008, pp. 4-7.
[12] R. K. Merton, Science and Democratic Social Structure. Social Theory and Social Structure, 1968, pp. 604-615.
[13] C. Bereiter & M. Scardamalia, Surpassing Ourselves, op. cit.
[14] Pour un développement de cette conception des « divisions scientifiques » appliquée à l’école voir A. Masala, Mastering Wisdom, In J. Webber & A. Masala (éd.), From Personality to Virtue: Essays on the Philosophy of Character, Oxford University Press, à paraître.
[15] Ibid.