La psychanalyse questionnée par l’autisme. (3/3)
Une lecture richirienne
Jean-Sébastien Philippart – Conférencier à l’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles
L’autisme du point de vue phénoménologique
Nous devons à Yasuhiko Murakami, élève de M. Richir[1], une remarquable étude sur l’autisme.[2] Le phénoménologue y distingue quatre dimensions que nous avons déjà évoquées. Les deux premières s’inscrivent au registre du phénoménologique : les « phénomènes-de-monde » et l’« affectivité ». Les deux suivantes relèvent de l’ordre symbolique : la « sensation » et l’« intentionnalité » (perceptive).
La sensation, nous venons de le voir, est une transposition de l’affectivité : l’ipséité du sens se faisant se retourne en la naissance (d’ores et déjà prise d’une soudaine maturité) d’un soi, la présence inassignable (dont les horizons sont vides) se retourne en présent (sans horizons externes) — insituable également puisqu’il constitue le fait même que l’instant ait « lieu », indéfiniment. La sensation ne connaît en elle-même ni rétention ni protention (horizons externes) : le clignotement de l’instant est un rapport entre soi et soi. Le regard qui découvre l’écart est l’écart même : « le ‘‘tout’’ décollant du ‘‘tout’’ »[3]. (Et le regard de se refléter contre l’emblème qui l’épingle.) Mais le déphasage de l’instant — qui ne tient pas de lui-même sa différenciation mais de l’élément phénoménologique — peut servir de base à l’ordre de l’intentionnalité. Au niveau de celle-ci, la sensation est transposée en « matière » animée par une « conscience » pour en faire une expérience d’« objet » sensible. Du point de vue de l’intentionnalité, la sensation se présente comme un moment de la perception, comme la « partie » d’un « tout » qui se profile à travers cette partie précisément. La perception aperçoit de la matière sensible en lui conférant une forme par quoi quelque chose se profile. Du point de vue de l’intentionnalité, le reflet instantané du décollement (du tout par rapport à soi) prend la forme d’une apparence perspective provenant d’un fond qui, imprésentable, ne la quitte pas. Et le fait que la chose se donne par esquisses (ou plutôt par pré-esquisses) à la conscience constitue une expérience temporelle pourvue de rétentions et de protentions. Autrement dit, si la sensation est l’événement de la nomination et ne désigne à ce titre aucun contenu identifiable, la perception — c’est-à-dire la sensation éclatée en « conscience » et en « objet » sensible — est institution de l’identité, le fait que quelque chose soit aperçu comme identique, comme porteur d’un nom (quelque chose se présente en tant que ceci ou cela), dans l’unité temporelle. (Attention : la perception dont il est question ici ne consiste pas en un acte qui vise une identité en vue d’une représentation intentionnelle de celle-ci. Plus originairement, l’identité est identification d’impressions qui s’enchaînent et constituent à ce titre autant de facettes discernées d’un même objet sensible : dans cet enchaînement, la cohésion se fait sans concept.) Mais ce qui est essentiel au registre de la présence (le sens se faisant) demeure essentiel au niveau perceptif : pour que l’expérience de l’unité temporelle ne sombre pas dans la répétition, il faut un écart minimal entre le contenu de la sensation présente et celui de la sensation retenue. Si au niveau de l’unité perceptive, le présent est vécu comme une protention qui vient juste de passer et sera retenue comme présent à peine passé pour laisser la place au présent qui se profile dans une nouvelle protention, une différence entre le contenu du présent et celui de la rétention signifiera un écart entre ce qui est attendu et ce qui arrive. Un écart où se possibilise l’expérience de la déception ou de la surprise pour une conscience : « malgré la protention qui pré-esquisse l’impression à venir, ce qui vient prochainement n’est pas totalement déterminé. »[4] Ce qui se montre peut venir à l’encontre de ce qui se préfigurait : au-delà de la structure partie/tout, la protention possède un horizon vide — l’absence du futur — qui l’expose à la variabilité. C’est dire que les réminiscences et les prémonitions (vides) transposées au niveau de la sensation mais conservant leur caractère et constituant ainsi la différenciation propre à l’instant, rejaillissent en écho en trouant d’absences l’intentionnalité. Le présent apercevant la qualité sensible d’une chose, en tant que clin d’œil entre rétentions et protentions, en tant qu’écart récapitulant d’un coup rétentions et protentions, trouve lieu dans l’écart ouvert par le vide de ce qui a été manqué dans la phase de présence. La prise de conscience (perceptive) dans le fait même de conférer une forme aux sensations est toujours déjà en retard ou en avance par rapport à elle-même : la prise ne peut avoir lieu qu’à même la surprise.
Or, si dans le comportement sain, l’expérience est expérience du présent qui accueille telle ou telle sensation variable (non seulement compatible ou incompatible avec les qualités déjà perçues de l’objet sensible mais dont la conscience est corrélative à la particularité), le caractère répétitif du comportement autiste implique pour le phénoménologue un effondrement de la cohésion intentionnelle. Chez les autistes, le comportement répétitif signifie l’absence d’écart minimal entre le contenu de la sensation présente et celui de la sensation retenue : ce qui est vécu maintenant est déjà su. Absence ayant d’ores et déjà entraîné un manque d’horizon pour toute protention. « Nous devons rappeler l’étroitesse de leur perspective, ou le manque de la structure partie/tout : ils se concentrent sur une partie de l’ ‘‘objet’’ et ils ne ‘‘perçoivent’’ rien que cette partie. Il n’y a pas d’horizon externe dans leur perception. »[5] Le manque d’horizon externe qui prive la « perception » de son intentionnalité explique dès lors le fait que les autistes « prennent », selon les termes de la psychanalyse, « le réel à la lettre ». Car la structure métaphorique de la langue s’appuie phénoménologiquement sur la structure partie/tout pourvue de l’horizon corrélatif de la conscience (elle-même corrélative de l’instant où la partie est prise pour le tout). Elle est une transposition de l’aventure de la perception interrompue et éclatée de la sorte en une constellation de mots, telle que chaque mot — qui correspond à l’abstraction (représentation intentionnelle) d’une identité saisie comme telle et prélevée sur l’unité temporelle indéfinie — clignote avec une multitude de mots potentiels dans le jeu interminable des jeux de mots.[6] Dans le comportement stéréotypé de l’autiste donc, puisque « ce qui est anticipé dans la protention est déjà pré-esquissé dans la rétention »[7], il n’y a pas, à proprement parler, de conscience corrélative de l’écart entre passé et avenir, mais court-circuit de la protention et de la rétention plongeant le « sujet » dans « un Présent éternel »[8]. L’effondrement de l’intentionnalité est effondrement et enfermement dans la sensibilité : le flux des sensations ou de l’instant qui se répète indéfiniment. Cependant, bien que le Présent éternel du comportement autiste ait la même forme que celle du comportement sain — l’instant sans cesse renaissant et ne se rapportant qu’au même instant —, nous y appréhendons une différence de « contenu ».
C’est que la « sensibilité » autistique constitue une « hypersensibilité ». « Ce qui me terrifiait, commente une autiste, c’était qu’on pût me contraindre à faire ce que je ne voulais pas, à m’empêcher d’être moi-même et à me refuser la liberté de me réfugier dans ma propre prison, certes bien solitaire, mais tellement sûre »[9]. À première vue, on pourrait dire qu’il est impossible pour le comportement stéréotypé, en vertu du manque de variabilité de la chose à laquelle le « sujet » est attaché, d’accepter quelque chose qui dépasserait le manque d’horizon protentionnel. Ainsi, tout ce qui survient « hors » du cadre habituel de l’autiste survient sans distance dans la terreur, la panique, la rage ou l’angoisse. Mais, à y regarder de plus près, il n’y a pas d’une part, un comportement prisonnier de la répétition, d’autre part, un comportement tombant dans la panique dans la survenue de l’imprévu. L’appréhension de ce qui ne correspondrait pas à sa « volonté » et le ferait paniquer dans l’insupportable incertitude est d’ores et déjà terrifiante. Autrement dit, « la crainte […] de l’effondrement est la crainte d’un effondrement qui a déjà été éprouvé »[10] : l’autiste éprouve une expérience qui s’est produite dans le passé mais dont il n’a pas fait l’expérience (qui n’a pas fait l’objet d’une perception). Pour soutenir le paradoxe, il convient de plonger du regard dans les profondeurs phénoménologiques. C’est dans cet abîme que se joue l’origine de l’altération autiste de la sensibilité en hypersensibilité.
Le caractère imprévisible de l’événement ne relève pas en effet de la sensibilité mais s’enracine dans les phénomènes-de-monde dont il faut dire qu’ils sont « transpossibles » pour reprendre la terminologie d’Henri Maldiney. « Dans l’ouverture […] l’événement n’est pas de l’ordre des possibles. Au regard de tout système a priori de possibles, il est, il est précisément… l’impossible. Le réel [scil. l’événement] est toujours ce qu’on n’attendait pas et qu’il n’y a pas lieu d’attendre. L’événement est un trans-possible… »[11] Et toujours dans les termes d’H. Maldiney, accueillir l’événement, y avoir ouverture, requiert d’y être « transpassible ». « L’événement, le véritable événement-avènement qui nous expose au risque de devenir autre, est imprévisible. Il est une rencontre avec l’altérité dont la signifiance insignifiable révèle la nôtre. Il est de soi transformateur. »[12] Entrer en contact avec l’événement n’est pas intérioriser quelque chose, mais subir une transformation qui est avènement de soi, éveil à soi-même, éveil du rapport à soi soi-même insignifiable. L’éveil de soi à soi n’est pas ici rapport à soi à partir de soi, c’est-à-dire la sensation, mais l’éveil de soi à soi à partir de rien ; rien c’est-à-dire l’absence constitutive des phénomènes-de-monde. « La transpassabilité consiste à n’être passible de rien qui puisse se faire annoncer comme réel ou possible. »[13] Nous pouvons reconnaître dans la « transpassabilité » opérante à l’événement, la « formation » du sens se faisant. Lorsque la transpassabilité fonctionne, l’événement « est l’origine de notre créativité, parce qu’il nous procure une chose totalement inouïe. »[14] Par contre, lorsque la transpassibilité ne fonctionne pas en ce « sens » que la transformation n’a pas lieu, lorsque l’accueil de l’événement ne se fait pas parce qu’il surgit sans distance, lorsque donc s’opère un court-circuit de la transpossibilité et de la transpassabilité, « l’affection du réel [scil. de l’événement] devient traumatique »[15].
« Si la transformation n’a pas lieu, écrit H. Maldiney, l’événement surgit dans la béance : elle est le fond sans fond de l’être-là en perte de son là. »[16] Dans les termes de M. Richir : l’affectivité où ne se fait plus le sens se faisant éclate dans son « atmosphérisation »[17], telle que l’ipséité ou la conscience (phénoménologique) défaillante, en perte de soi, ne se « retrouve » qu’en étant « située » partout et nulle part : la conscience ne s’éprouve plus comme écart qui a lieu de s’écarter du fond sans fond des phénomènes-de-monde. L’affectivité s’altère en affectivité fantomatique où la conscience en perte de soi « se retrouve » enfermée dans l’illocalisation — c’est-à-dire dans une affectivité s’abîmant également en l’absence de contact (phénoménologique) avec une autre conscience située en son ipséité. L’incapacité à accueillir l’événement, à devenir soi-même comme un autre, surgit en même temps comme incapacité à accueillir autrui[18]. Dans la catastrophe traumatique, il n’y a de conscience que « par l’affectivité indifférenciée qui y fait retour, en étant encore ressentie comme une indicible souffrance et une indicible angoisse. »[19] L’affectivité fantomatique où l’autre s’ouvre vertigineusement comme perte de soi — perte du contact de soi à soi dans l’envahissement de l’absence et perte du contact avec autrui comme un autre contact de soi à soi — explique de la sorte l’expérience du solipsisme autistique où, telle la figure infigurable du fantôme, ne cesse de revenir ce qui passe de ne pas se passer. Indifférenciation solipsiste — c’est-à-dire affectivité privée de l’harmonie entre les « signes » ou les formations phénoménologiques et leurs lacunes — qui explique par ailleurs le manque d’écart conférant à la protension le caractère du futur (son horizon externe) en écho aux lacunes du sens se faisant. À ce niveau de profondeur de la description où l’absence d’autrui incarné par la mère ne fait pas retour en tant que cause du phénomène, le caractère énigmatique du court-circuit de la transpossibilité et de la transpassabilité comme défaillance elle-même transpossible de la liberté ne provient pas non plus d’un bricolage théorique qui voudrait malgré tout éviter dans son explication le recours à l’idée de « cause » (de la maladie). Profondeurs dans la profondeur (inconscient et conscience phénoménologiques) qui nous arrachent ainsi à la conception (problématique) d’une liberté « qui intériorise le destin de l’être dans une légitimité qu’il ignore, et qui se subroge à l’arbitraire aveugle de sa pure extériorité. »[20] Dans les termes de notre situation : un liberté qui assumerait en s’y substituant le mécanisme aveugle du destin symbolique et ne pourrait être étrangement, comme dans la tragédie classique, que la prise de conscience se dessinant à même la chute du héros.
Encore faut-il rendre compte de ce qui « se » passe au niveau de la sensation. Qu’est-ce à dire que l’atmosphérisation de l’affectivité en affectivité fantomatique se condense (se transpose) en Présent éternel ? Celui-ci n’est-il pas, comme nous venons de le rappeler plus haut, le destin qui échoit à toute sensation ? En réalité, l’instant en lequel « se retrouve » l’affectivité volatilisée est un instant qui ne se remplit pas de soi. Il n’est plus que l’écart de l’évanescence exposée à sa disparition. Il n’est plus que l’écart de l’imminence de la disparition. Il n’est plus que la répétition indéfinie du clignotement de ce qui surgit comme évidement de soi sans s’anéantir, jamais accompli. Il n’est plus que le revirement de l’évanescence non accomplie dans son surgissement et du surgissement non accompli dans son évanescence. Instant vide, regard vide qui n’est plus que sur le point de disparaître, au bord de l’évanouissement comme l’écorce de l’affectivité fantomatique. Autrement dit, dans le comportement sain, l’instant n’a de sens qu’à être lui-même le pôle d’un clignotement plus large — celui de l’affect où le regard (l’« auto-différenciation »[21]) s’accroche à l’emblème (le signifiant) et est accroché par elle. Dans le comportement autistique, du fait de l’indifférenciation de l’affectivité fantomatique, le clignotement ne clignote plus entre un clignotement et son emblème, il se raccourcit en sa radicale répétition — celle de l’instant menaçant comme transposition (symbolique) de l’effondrement phénoménologique, où quelque chose passe de ne pas se passer, en donnée potentielle. La potententialité signifiant que l’instant menaçant n’est pas susceptible de donner une figure à l’intentionnalité qui le vise. L’effondrement de l’intentionnalité en hypersensibilité est de la sorte corrélatif du caractère infigurable de la donnée en tant qu’instant vide ou vide de l’instant. Le comportement autistique envisage ainsi « un ‘‘trou noir’’ innommable et non-figurable sans aucune médiation qui atténue son étrangeté. »[22] D’où le fantasme d’un corps troué sur base du fantasme « originaire ».
Avec la structure de la déstructuration de l’affectivité en affectivité fantomatique « comme transpossible un instant mué (transposé architectoniquement) en possible illocalisé, atmosphérique, imminent ou menaçant »[23], nous pensons tenir là le noyau phénoménologique de l’expérience autistique. À cet égard, ce que la psychanalyse subsume sous le concept de « défenses » ne peut apparaître que secondaire. Les défenses psychiques ne peuvent apparaître qu’en tant que tentative échouant d’ores et déjà pour l’être-là en perte de son là à se circonscrire comme être-situé face à la menace possible de l’effondrement. Par ailleurs, s’est esquissée ici la différence entre comportement sain et comportement pathologique. Tandis que dans l’expérience saine, l’ipséité, l’accueil de l’événement et les lacunes qui s’ouvrent (en affectivité fantomatique) au sein de la formation du sens « jouent ensemble »[24], l’expérience pathologique est rupture, dans un énigmatique (transpossible) court-circuit, de l’harmonicité constituant le rythme du sens recherché. Mais encore faudrait-il distinguer l’effondrement dans la répétition pathologique du comportement « normal » où l’on fonctionne habituellement sans créativité tout en demeurant capable de faire face à un événement. Enfin, nous pourrions nous risquer ici à une hypothèse. La structure de l’expérience solipsiste de l’autisme, d’une solitude absolue en proie à la menace, ne serait-elle pas, en son indifférenciation, le noyau de toute psychose ? N’y aurait-il pas au fond (sans fond) de toute psychose, dans le sens où toute psychose serait susceptible d’éclater en délire, un noyau autistique ? Mais alors, qu’est-ce qui ferait que le noyau éclate lui-même en psychose ? Quelle différence entre psychose blanche et autisme ? Qu’est-ce qui ferait par conséquent aussi la différence entre telle ou telle figure psychotique ? Autant de questions où s’ouvre à nouveau un vaste champ d’exploration phénoménologique…
5. Sclérose institutionnelle, pensée-réflexe et pensée vivante (se faisant)
Nous voilà donc en mesure de mieux comprendre le déphasage qui travaille l’institution psychanalytique — et qui constitue en réalité un double déphasage.
Déphasage, d’une part, interne au discours théorique qui tente indéfiniment de s’ajuster à soi, de se rattraper soi-même et dont le recours à la notion d’inconscient (l’inconscient symbolique dans sa version éclatée : réel/symbolique/imaginaire, laquelle, du coup, s’embarrasse de la conscience comme d’une donnée commune de l’expérience « qui ne se peut ni expliquer ni décrire »[25]) — pour en combler les lacunes précisément — ne fait que renforcer le blocage se donnant ainsi dans l’illusion d’un système ou d’un discours approprié au traitement du sujet. Le jugement du psychanalyste parlant au nom de l’institution est en effet sans appel :
La méthode ABA [Applied Behavior Analysis] se borne pour l’essentiel à l’approche des comportements qu’elle s’emploie à normer sans chercher à pénétrer leurs fonctions et sans se préoccuper de la vie affective. En revanche, le programme TEACCH [Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren] s’appuie sur une fine connaissance du fonctionnement cognitif de l’autiste, et met en place des techniques qui en tiennent compte, mais dans cette perspective, la vie affective et le travail de protection contre l’angoisse restent impénétrables. L’approche psychanalytique de l’autiste est plus heuristique parce qu’elle ne fait l’impasse sur aucun domaine de fonctionnement de l’être humain : elle est la seule capable de proposer une compréhension, non seulement du fonctionnement affectif, mais aussi des conséquences de celui-ci sur le cognitif.[26]
Notons par ailleurs que toute tentative, comme celle, en particulier, des travaux de Bernard Golse[27], d’imaginer des corrélations entre les processus psychiques et les processus cérébraux en vue de passer outre le différend entre psychanalyse et cognitivisme et ce, en s’appuyant sur le « jeu » interne à l’une et l’autre vision, ne peut aboutir elle-même qu’à une nouvelle construction où se reproduit fatalement le déphasage. Les propos du psychiatre trahissent la problématique :
Le programme ‘‘PILE’’ (Programme International pour le Langage de l’Enfant) implanté à l’hôpital Necker-Enfants Malades de Paris […] apporte des arguments qui nous permettent de penser que [les] dysfonctionnements temporaux peuvent être à la fois cause et conséquence de l’organisation autistique. La pathologie autistique, de l’avis de tous, psychopathologues comme neuroscientifiques, apparaît aujourd’hui comme fondamentalement hétérogène et composite […].[28]
On ne peut en effet se saisir à la fois d’éléments déjà identifiés comme tels, tout en les dénaturant (en ignorant l’attribution causale) en vue de les adapter par avance à des éléments d’une autre nature. Au mieux le bricolage aboutit-il à un parallélisme ou un occasionnalisme (métaphysiques).
En réalité, en porte-à-faux avec la dimension symbolique qui tend à porter le destin de l’être à son comble, la phénoménologie nous révèle qu’il y va, dans la répétition infernale d’un sujet pour le moins névrotique, de quelque chose d’autre qui aurait pu se faire et dont l’aventure signifiante demeure suspendue à sa reprise.
Déphasage, d’autre part, entre la théorie et la pratique analytiques, entre une conception du sujet dont le projet avorté (au niveau de l’inconscient symbolique où sont transposées dans le non-sens les lacunes du langage phénoménologique) se retrouve renforcé par la fixation spéculative du discours et le désir de lui être attentif à travers une cure en vue de libérer sa parole. Mais qu’est-ce qui anime le désir de prendre soin du sujet ? L’écart entre le symptôme (somatique) et la maladie. Tout symptôme (psychopathologique) est latéral en ce sens qu’il est porteur d’une exigence d’interprétation qui n’est précisément pas « traduction » automatique. Tout symptôme est symptôme d’un corps-objet — c’est-à-dire d’un corps inhabité, un « en-soi » déserté par l’intentionnalité — qui porte la trace de l’affectivité. L’« en-soi » « porte en lui l’imminence de la désincarnation, d’un corps séparé de l’esprit, […] donc il recèle toujours en lui-même la ‘‘puissance’’ d’une chair ou d’une phénoménalité [affectivité] qui n’y paraît ‘‘enfermée’’ […] que dans la mesure où le corps paraît s’en séparer dans la choséité. »[29] L’évanouissement de l’affectivité (et ses transpositions) n’est jamais complet. Sans cette affectivité qui y paraît « en puissance », le travail d’interprétation de l’analyste éclaterait en un délire interprétatif corrélatif d’une prolifération de données potentielles (l’affectivité fantomatique muée en instants vides ou « esprits » désincarnés) non arrimées au reste d’une unité vivante. Dans l’écart entre le solipsisme absolu de l’affectivité fantomatique (« monstre » qui ne se montrera jamais comme tel) et le symptôme, se fait entendre la défaillance du sens se faisant sous la forme d’une exigence de sa reprise qui éveille ainsi le désir thérapeutique, où la possibilité (en son fond transpossible) d’un avenir, en creux de la déficience, se laisse entrevoir : la personne autiste n’est pas absorbée par l’éternité de sa structure transcendantale de façon absolue. Le désir thérapeutique s’éveille à soi comme travail d’interprétation dans sa rencontre avec un autre (autrui) comme affectivité déficiente qui, touchée à distance, émerge à soi en puissance de soi dans l’écart symptomatique où « se » trahit l’incessant retour de ce qui ne « se » fait pas. Autrement dit, les termes de l’attention pressante du thérapeute doivent être eux-mêmes replacés dans leur jour phénoménologique.
C’est l’urgence absolue et la première grande difficulté : alors que l’Autre ne peut être connu que par la relation, apparaît un premier point clinique et pratique fondamental : toute tentative de relation avec l’autiste va être vécue de son point de vue comme la réitération d’un cataclysme. Comment avoir une attitude thérapeutique avec quelqu’un qui vit la relation comme une catastrophe ? Le problème posé suggère la solution, puisqu’il suffit de ne pas avoir de relation pour que la relation réapparaisse ! Ce paradoxe apparent peut se gérer par l’utilisation de logiques différentes, logiques de cadre et de contenu. Il convient alors de mettre en place un cadre dans lequel la relation a un statut particulier. L’enfant est amené par sa famille dans un lieu où quelqu’un l’attend. Là évidemment c’est le désir de l’autre sur l’enfant qui s’applique. Mais à l’intérieur de ce cadre, de ce désir de l’autre, une autre logique va fonctionner : celle du psychanalyste, position absolument, totalement non désirante. […] Dit autrement, il convient que le thérapeute fasse preuve d’une espèce d’autisme méthodologique de façon à ce que son patient puisse faire émerger un désir. […] Cela veut dire ne pas le regarder s’il ne nous regarde pas, ne pas lui parler s’il n’émet pas de son, ne pas aller vers lui s’il ne vient pas vers nous, etc.[30]
Que signifie cet autisme « méthodologique » qui se joue dans son déphasage avec le cadre ? Car il est entendu que « ni le monde extérieur ne doit être introduit dans le monde pathologique du malade, ni le monde du malade dans le monde extérieur. La première méthode ‘‘pathologise’’ le normal, la seconde normalise le pathologique… »[31] Ne pas regarder, ne pas parler, ne pas se déplacer, etc., correspondent chez l’analyste à la mise en œuvre de ce qui constitue celui-ci « en foyer normal du monde pathologique du patient. »[32] En deçà du monde en tant que corrélat de l’intentionnalité et en deçà même de l’inconscient (symbolique), l’analyste, nous explique H. Maldiney, se fait le « répondant » de l’expression défaillante du patient jusqu’à ce que celui-ci « devienne lui-même son propre répondant » [33]. En d’autres termes, l’analyste s’ouvre à sa tâche d’analyste, fût-elle sans parole, dans la transpassabilité à la transpossibilité de l’affectivité où l’ipséité est suspendue à l’événement dans la béance. La tâche se forme soi-même dans l’accueil à distance (non sans lacunes) comme espoir de l’inespéré, comme accueil de l’autre (le patient) susceptible ainsi, grâce à cet accueil, d’amorcer une ipséité tentant de répondre de soi, sous la forme de proto-signes (phénoménologiques)[34] mués un instant en bribes de langage qui retiendront l’attention de l’analyste à titre de proto-métaphores ou de proto-métonymies. Cela signifie qu’en son fond la tâche de l’analyste est mise en branle de soi, comme mise en question de soi, au contact d’un ébranlement transpossible que le psychopathologue peut comprendre parce que nous autres les hommes le partageons entre tous. En bref, la « différence » entre le « cadre » et le « contenu » s’avère efficiente parce que le psychanalyste travaille, sans le savoir, avec l’élément phénoménologique assurant précisément l’écart entre les deux « logiques ». (Redoublement du déphasage au sein de la pratique elle-même.)
Le discours théorique de la psychanalyse — en tant que sur-codage de la structure signifiante où le sujet « se retrouve » bloqué et sur-codage qui tend à dégénérer en système, c’est-à-dire en « machin » marchant tout seul, « sans qu’on sache très bien comment »[35], dans la mesure où il se prend « pour le tout de ce qu’il y a » comme « si le ‘‘machin’’ réglait d’avance le jeu des questions et des réponses »[36] (toute forme de résistance à la psychanalyse serait une manifestation inconsciente) — en vertu de son déphasage avec un discours qui pratiquement ne se confond pas avec le machinal, est donc susceptible de re-coder l’expression du patient n’adhérant pas à la théorie, comme il est susceptible de muer en un discours qui se remet en question, « ouvert en abîme par le champ phénoménologique »[37]. Il ne s’agit pas ici pour le discours de s’abîmer dans les profondeurs du sens se faisant, mais de s’ouvrir dans « l’ouverture d’horizons symboliques sous lesquels la pensée, pouvant s’orienter, est capable de s’interroger sur ses propres contingences »[38]. Les horizons symboliques tiennent du sens se faisant sur lesquels ils s’articulent leur caractère d’horizon de pensée et leur dimension d’inaccessibilité motive ainsi une pensée confrontée au renouvellement, face à ses opacités (déterminations inconscientes) qui paraissent interrogées quant à leur sens à la lumière même du recul de la pensée (ouvert précisément par ses horizons). Sous l’horizon symbolique de sens, la part obscure d’indétermination (trace phénoménologique) qui joue au sein de toute détermination s’éveille à soi dans une mise en question. Sous l’horizon symbolique de sens, le psychanalyste comprend ce qu’il cherche et la variabilité des intuitions qui animent sa pensée ne tend plus en sa radicalité à s’accentuer dans la monotonie formelle de la répétition que la pensée répéterait mais exige de celle-ci souplesse et inventivité. Autrement dit, toute pensée humaine, c’est-à-dire amenée à la créativité, se tient entre le symbolique et le phénoménologique. C’est par conséquent dire aussi que la liberté phénoménologique se doit d’être « tempérée » par la dimension symbolique. Il y a en effet quelque chose de vertigineux dans l’abandon, sans retenue, de la « conscience plongeant dans les abîmes de son ipséité. »[39] La liberté phénoménologique, c’est-à-dire « sauvage », ne se fixant pas, oubliant toute version précédente en l’altérant dans une nouvelle formation de soi[40], en rencontrant phénoménologiquement l’institution symbolique retourne celle-ci en une pensée qui n’est plus une réflexion déterminante, absorbée par la platitude du concept où elle s’achève — et se transpose comme réflexion contre (appui en écart et écart en appui) les choses d’ores et déjà envisagées comme telles ou telles. La liberté humaine qui bénéficie de l’« appui » d’un sol est en ce sens réflexion qui revient sur des pas, sur lesquels on marche habituellement pour accéder aux choses, en ne les emboîtant pas dans une sorte de dé-concertation réarticulant du sens en vue de sa propre énigme. Mais justement, la rencontre phénoménologique entre le sens se faisant et l’institution symbolique est corrélative de la rencontre phénoménologique d’autrui. Celle-ci, par sa singularité, m’introduit à du contrepoint — les lacunes du sens se faisant du côté d’autrui — qui s’introduit entre les lacunes (de sens) codifiées et sur-codifiées lesquelles, du coup, ne se distribuent plus selon un même plan (sans profondeur) mais, la « structure de vides se laminant elle-même »[41], se réarticulent comme articulation d’un sens qui se cherche entre les lignes et les mots. Encore faut-il qu’en vue de moi-même, j’accepte un peu de me perdre, accepte d’épouser ce lâcher-prise où se défait la saisie des choses qui me retiennent.[42] Sans quoi, la voix de l’autre, errant entre les mots inhabités d’un discours ignoré, paraîtra fantomatique, menaçant l’intérieur de l’enceinte en laquelle, en proie à la crainte, je me suis retiré sans donc pouvoir l’habiter : « la voix de l’autre sera la voix de l’Autre, venue de nulle part en moi, sans distance, comme la voix d’un pur ‘‘esprit’’, d’une ‘‘âme’’ fantomatique sans corps. »[43]
Nous voulons dire par là que le discours institutionnel de la psychanalyse est bien trop souvent, en cette époque de disséminations des savoirs, celui d’une enceinte où l’on tente d’étouffer et de conjurer dans l’indignation la crainte d’un discours autre pris pour dévastateur. Le maniérisme de l’indignation étant de la sorte compris comme la « reproduction caricaturale d’un Leib [affectivité] en imminence de disparition »[44] « dans la répétition inlassable de la spécularistion du moi dans l’image reflétée d’un type de comportement déterminé »[45]. Indignation qui, à son tour, ne « touche » que des convaincus associé à l’establishment intellectualisant. « Ce serait une dangereuse illusion d’optique […] de penser que le machinal-opératoire se met en jeu uniquement dans la science et la technique. »[46] Illusion mortifère pour soi-même dans l’indifférence aux autres. (De la même manière, il conviendrait maintenant de montrer comment les approches neuro-cognitivistes, de par leur inventivité, ne se réduisent pas à de la pensée machinale s’anticipant dans son objet machinal.[47]) Toutefois, il arrive qu’une voix en porte-à-faux avec les cercles fermés, à travers l’accueil d’autres discours que le sien, interroge le discours dont pourtant il se réclame. Écoutons ainsi le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron dont le propos nous paraît finement inspiré, comme en écho à une véritable prise en compte de l’élément phénoménologique :
Le fait que la psychanalyse soit instituée en « science de l’inconscient » a conduit beaucoup de psychanalystes à penser que la seule méthode d’investigation appropriée à son avancement était le traitement psychanalytique des patients, tandis que ces traitements étaient le seul moyen de faire progresser leur science. Cette façon de tourner en rond a conduit à une dégradation partielle de la psychanalyse en idéologie. C’est ainsi que les psychanalystes se sont révélés très en retard dans la capacité à prendre en compte les travaux sur l’attachement et les traumatismes, et qu’ils continuent à témoigner d’un retard considérable dans l’approche […] de l’impact des technologies numériques qu’ils envisagent souvent comme une menace pour la symbolisation et la civilisation.
Du coup, ils ont ignoré, pour ne pas dire dévalorisé, tout ce qui relève d’autres fonctions du psychisme, précisément de celles que Freud avait attribuées au pré-conscient et au conscient, comme les processus d’apprentissage et les capacités d’attention et de concentration.
Bref, autour de l’autisme, il n’y a pas eu de « bons » et de « mauvais » psychanalystes, mais des praticiens confrontés à l’impossibilité de penser en dehors des clous de leurs écoles respectives. C’est pourquoi, plutôt que de s’apitoyer sur la décision de la HAS, celle-ci doit être l’occasion pour les psychanalystes d’engager des renouveaux théoriques.
Freud n’avait pas tout prévu.[48]
C’est précisément grâce à la marginalité dont témoignent des professionnels comme Serge Tisseron que la dégradation de la psychanalyse en pensée sectaire demeure partielle et que peut s’opérer dans les institutions mêmes, nous l’espérons, une véritable rencontre de l’autre « incarné » par la personne autiste, en mesure ainsi, dans la relation à un analyste, de témoigner de « soi » à l’écart de sa fixation en une figure psychopathologique donnée. Même s’il est vrai que l’accueil du singulier aura d’ores et déjà tendance à se transposer en l’étude d’un cas particulier, lequel tendra lui-même à se transposer en cas d’école…
[1] Et AUTEUR du très remarquable : Lévinas phénoménologue, Grenoble, Millon, 2002, 335 p. — L’ouvrage libère en effet Levinas de la paraphrase dont il fait trop fréquemment l’objet, en direction d’une psychopathologie lévinassienne.
[2] Cf. Yasuhiko MURAKAMI, « Temporalité chez les autistes — À travers la théorie du sens chez Marc Richir », in L’œuvre du phénomène, pp. 161-181.
[3] E. LEVINAS, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Le Livre de Poche, 1996, p. 51.
[4] Y. MURAKAMI, Op. cit., p. 165.
[5] Ibid., p. 166.
[6] Cela veut dire que le discours théorique de la psychanalyse procède d’un court-circuit entre le niveau de la sensation et le niveau de la représentation (intentionnelle) en faisant, au mieux, du jeu de mots une modalité du jeu du signifiant et en refoulant du même coup le niveau de la conscience (perceptive). Refoulement qui fait paraître étrangement le soi (de la sensation) comme un moi sans consistance (l’imaginaire qui ne se profile pas).
[7] Y. MURAKAMI, Op.cit., p. 177.
[8] Ibid.
[9] Donna WILLIAMS citée par J.-C. MALEVAL, in Op. cit.
[10] M. RICHIR citant Donald W. WINNICOTT, in Phantasia, imagination, affectivité, p. 329.
[11] Henri MALDINEY, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 1997, p. 143.
[12] Ibid., p. 419.
[13] Ibid., p. 421.
[14] Y. MURAKAMI, Op. cit., p. 170.
[15] Ibid.
[16] H. MALDINEY, Op. cit., p. 419.
[17] M. RICHIR, « Leiblichkeit et phantasia », in Mareike WOLF-FEDIDA (sous la direction de), Psychothérapie phénoménologique, Paris, MJW Fédition, 2006, p. 41.
[18] Ce qui ne veut pas dire qu’autrui se réduise à un phénomène-de-monde. L’imprévisibilité d’autrui provient des phénomènes-de-monde dont la rencontre autre que la « mienne » constitue précisément le phénomène d’autrui. Rencontrer autrui, c’est ainsi rencontrer une autre rencontre qui élargit le déploiement de « mon » ipséité.
[19] M. RICHIR, Op. cit., p. 42.
[20] H. MALDINEY, Op. cit.
[21] L’instant qui se donne et paraît comme « auto-différenciation », comme impression « originaire », ne doit pas nous faire perdre de vue qu’il n’est pas l’ultime réalité, sous peine de voir la phénoménologie se fermer en une ontologie où l’on bricole avec un destin dont on tente d’en couper le fil et avec une fraîcheur juvénile que l’on tente de rendre décisisve.
[22] Y. MURAKAMI, Op. cit., p. 169.
[23] M. RICHIR, Phantasia, imagination, affectivité, p. 332.
[24] Idem, « Leiblichkeit et phantasia », p. 43.
[25] Sigmund FREUD cité par Jean LAPLANCHE et Jean-Bernard PONTALIS, « Conscience (psychologique) », in Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 2004, p. 95.
[26] J.-C. MALEVAL, Op. cit. Nous soulignons.
[27] Cf. B. GOLSE et L. ROBEL, Op. cit., pp. 45-51. Nous soulignons.
[28] Ibid., p. 49.
[29] M. RICHIR, « Altérité et incarnation. Phénoménologie de Husserl », in Revue de Médecine Psychosomatique, n° 30/31, 1992, p. 70.
[30] Michel S. LEVY, « Autisme », in Inventionpsychanalyse.com, Site Internet, Disponible sur : http://www.inventionpsychanalyse.com/autisme.php (consulté le 18/07/2013) — Nous soulignons.
[31] H. MALDINEY, « Comprendre », in Regard, Parole, Espace, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1994, p. 50.
[32] Ibid., p. 53.
[33] Ibid., p. 54.
[34] Il conviendrait de se pencher sur ce niveau des « proto-signes » qui ouvre ici un champ d’exploration phénoménologique inouï entre les phénomènes-de-monde et l’affectivité.
[35] M. RICHIR, « Science et Monde de la Vie », p. 18.
[36] Ibid., p. 22.
[37] Idem, « Merleau-Ponty : un tout nouveau rapport à la psychanalyse », p. 187.
[38] Idem, « Science et Monde de la Vie », p. 24.
[39] Idem, « Sauvagerie et utopie métaphysique », p. 29.
[40] Cf. Y. MURAKAMI, Op. cit., p. 181.
[41] M. RICHIR, Phénoménologie et institution symbolique, p. 292.
[42] Se pose alors la redoutable question de la place et de la signification de la « volonté » dans l’édifice en mouvement.
[43] M. RICHIR, « Le problème de l’incarnation en phénoménologie », p. 177.
[44] Idem, Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations, Grenoble, Millon, 2000, p. 386.
[45] Idem, Phantasia, imagination, affectivité, p. 390.
[46] Idem, « Science et Monde de la Vie », p. 21.
[47] A titre d’exemple, Bernadette Roge, formée depuis près de trente ans à l’ABA, Professeur des universités à Toulouse Le Mirail : « On sait aujourd’hui que les enfants autistes ne généralisent pas bien. Si on leur fait répéter indéfiniment une même situation, ces enfants feront certes des acquisitions mais ils ne pourront les reproduire que dans cette situation donnée. Ils ne la transposeront pas à une situation similaire. L’apprentissage alors n’est pas intéressant car ce que l’on veut c’est que, globalement, l’enfant soit davantage adapté au monde qui l’entoure. Cette approche a donc évolué en tenant compte de la dimension cognitive. J’ai ainsi été formée aussi au Teacch chez Eric Schopler, où, pour le dire vite, on adapte l’environnement pour favoriser les apprentissages de l’enfant. J’ai ainsi infléchi mon approche de l’ABA en tenant compte des particularités de ces enfants. » (in Sophie DUFAU, « Autisme : l’ABA trouble l’université de Lille », in Mediapart, Site Internet, 14 mai 2012, Disponible sur : http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=3563 — Nous soulignons.
[48] Serge TISSERON, « Autisme : la psychanalyse (enfin) contrainte à évoluer, in Libération, Site Internet, 22 février 2012, Disponible sur : http://www.liberation.fr/societe/01012391368-autisme-la-psychanalyse-enfin-contrainte-a-evoluer











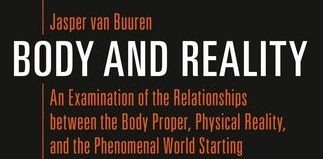




Je découvre aujourd’hui ce site. Psychiatre ayant exercé la psychanalyse je me suis tourné vers la phénoménologie, de man!ère autodidacte, c’était il y a 20 ans… Et j’ai développé la technique du paking pour traiter l’autisme infantile.
J’aime beaucoup l’ensemble de votre conception de la psychanalyse aux prises avec l’histoire récente et tout particulièrement avec l’autisme. Votre « concept » de maniérisme de l’indignation me semble très pertinent. Je vais lire Murakami.
Merci pour votre contribution à l’évolution de la pensée sur ce sujet.
Bien à vous
Alain Gillis