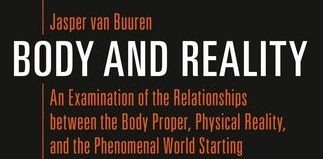La psychanalyse questionnée par l’autisme. (2/3)
Une lecture richirienne
Jean-Sébastien Philippart – Conférencier à l’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles
4. Une mise en question — phénoménologique — de la conception psychanalytique
Ce compte-rendu de la maladie par la psychanalyse ne manque pas d’être séduisant. Cependant, avec un peu de recul, la logique du discours ne va pas elle-même sans un certain malaise : confronté au découpage théorique en « imaginaire », « réel » et « symbolique », lesquels absorbent le psychanalyste, on ne peut que ressentir une certaine instabilité des termes. L’imaginaire semble en effet occuper en soi une fonction tout en étant déterminé par le symbolique : il passe alors au second plan en ce qu’il n’est pas déterminant tandis que sa défaillance le met gravement en cause dans l’autisme. D’un côté, le manque d’incorporation primaire (introduisant au symbolique) explique le manque d’incorporation seconde. De l’autre, c’est l’inverse : le manque d’incorporation seconde explique la défaillance symbolique. Ce qui paraît structurellement absurde. Ce que nous avons appelé « incorporation primaire » — le refoulement, la « mise à distance » du réel (la voix, l’objet réel assimilé au cri) par le symbolique — suppose étrangement une opération qu’elle détermine. (D’où la difficulté dans le champ de la psychanalyse à trancher entre une conception de l’autisme qui l’assimile à la psychose et une conception qui y perçoit une structure à part entière. Mais est-t-il pertinent à ce niveau de différencier entre excès d’incorporation (psychose) et manque d’incorporation (autisme) ? Le manque creusant le désir, par exemple, n’est-il pas ce qui fait que le désir s’excède soi-même ?) L’imaginaire n’est pas en mesure d’apparaître comme une dimension s’appuyant contre ce qu’elle n’est pas : il n’a pas de consistance propre. Il n’apparaît (comme ce qu’il n’est pas) qu’à titre de résultat d’une opération symbolique. Laquelle est à son tour frappée d’ambivalence. Ledit symbolique refoule en effet le réel tout en habillant un « reste » qui pourtant lui échappe. On nous répondra que l’oubli (le voilement) n’est pas oubli de l’oubli. Mais s’il appartient au symbolique de rendre la voix « inouïe », cela ne signifie-t-il pas que le réel n’est pas de soi impossible ou imperceptible[1] ? Corrélativement, dans une sorte de confusion avec le fantasme censé le dissimuler, le réel ne cesse de revenir tandis qu’il devrait être ce qui échappe absolument. Autrement dit, comment le réel peut-il redoubler en un reste de soi sans que cela ne produise une forme d’apparition qui contrevienne à la soi-disant imperceptibilité du réel ? Pour que quelque chose fasse signe en direction de l’absence de ce qui ne s’est pas manifesté et ne se manifestera pas, il faut que le « réel » — en tant que ce qui passe de ne pas se passer — passe originairement ailleurs que dans l’ordre analytique ou, si l’on veut, que la trace du réel se produise à un changement de niveau ou de champ — l’ordre analytique, d’une certaine manière, avant qu’il ne se découpe en « imaginaire », « réel » et symbolique ».
L’instabilité foncière du découpage trahit en réalité une contingence qui ne relève pas de l’ordre analytique.[2] Mais examinons de plus près la défense analytique de son point de vue sur l’autisme, ce qui nous amènera peu à peu à questionner plus attentivement les postulats d’une telle position.
Fonction maternelle, maladie et liberté : les difficultés
À la suite de Lacan, la psychanalyse peut invoquer aujourd’hui, en déliant la pathologie d’une position de la mère ou de qui en tient lieu, l’« insondable décision de l’être »[3] par laquelle l’autiste se dépendrait de l’attrait de l’identification primaire. Il faut comprendre cette décision à quoi rien ne supplée non comme le fruit d’une réflexion mais comme la subjectivation même du sujet tranchant à sa manière sur l’indifférence ontologique initiale (la confusion entre le cri infantile et la voix maternelle). Dans la situation qui nous préoccupe, cela voudrait dire que l’autiste s’est originairement posé en tant que tel parce qu’il aurait préféré le risque de la liberté à la dialectique imparable de l’identification. La subjectivation autistique se caractériserait par un refus de subjectivation : le refus d’assumer la voix dont l’assomption le conduirait de l’être invoqué au sujet invoquant et donc désirant. L’autiste aurait choisi de rester sourd à l’institution du point sourd. D’où l’insupportable liberté : en choisissant de ne pas assumer la position de sujet invoqué par la voix dont la parole l’inscrit au champ du discours, le sujet ne peut pas répondre de sa position autistique. Cependant, quelle place exacte occupe la décision ontologique dans l’économie générale de l’être ? Comment le sujet peut-il être simultanément effet du signifiant produit au lieu de l’Autre et advenir par assomption dans l’instant décisif ? On nous répondra que l’assomption est acceptation ou refus singulier de la cause du sujet. Mais alors quelle transformation s’opère-t-il réellement entre la fonction de signification qui remplit son office symbolique en produisant le refoulement — et l’infans qui conquiert un point de surdité par une répulsion originaire en cessant d’entendre la voix dans l’acceptation de la parole ? La décision effective ne se voit-elle pas cantonner ainsi au tranchant du refus tel que la pulsion, l’instant d’un recul, se déclenche à vide en se prenant elle-même pour objet et, dans un second moment, étant donné le caractère tyrannique et destructeur d’une charge pulsionnelle diffuse et non localisable (dévoilement de l’être dans l’angoisse), cherche un investissement en s’appuyant sur un objet-double ? La décision ne serait-elle par conséquent que l’apanage du pathologique dans une prise de distance à l’égard du « ça marche (tout seul) » dialectique ? Dès lors encore, au vu de l’ambivalence du concept de « décision ontologique », le professionnel n’est-il pas contraint, s’il désire motiver subjectivement la situation, d’admettre que plutôt que d’avoir pris une décision, le sujet a été pris par une décision — la décision de l’autre qui retentit en lui ? Autrement dit, n’est-il pas renvoyé à ses classiques ? À savoir une approche de l’autisme comme réaction massive d’évitement de la perte, à cause d’une mère séparée de son enfant à un stade de la dynamique affective qui ne lui donnait pas les moyens d’assumer la perte. Comme la voix de la mère ne répond pas, la parole devient une inquiétante étrangeté dans laquelle on n’a pas à s’apercevoir.
Au sujet, toujours, de la mise en cause de la mère ou de ce qui en tient lieu et au-delà du problème de la décision ontologique, le psychanalyste nous rappellera encore qu’il ne faut pas oublier une règle élémentaire : « les concepts ne doivent jamais se transformer en jugements à l’emporte-pièce ou en diagnostics foudroyants. Un concept n’aboie pas. »[4] En admettant que « la-mère-pas-assez-bonne » puisse se constituer à titre de concept situé hors du champ de la morale et subsumant une situation inconsciente (la place que l’enfant occupe dans le fantasme maternel liée à contexte socio-économique imperceptiblement déterminant), l’ambivalence du concept d’« inconscient », lequel s’appuie sur l’instance de la conscience (en tant que pouvoir se représenter) dont il est l’exacte conséquence[5], ne met toutefois pas le(s) parent(s) à l’abri de quelque culpabilisation. Nul besoin d’aboyer au lieu du concept pour qu’une mère s’en veuille de ne pas avoir su ce qu’elle (ne) faisait (pas). Si la conscience doit apparaître comme une illusion reposant sur l’ignorance des causes qui poussent le sujet à agir, il reste que, pour le sens commun, la nature de la cause (dite « seconde » nature) ne peut pas être radicalement coupée de la nature de ses effets.
En réalité, le caractère énigmatique de la maladie ne relève pas du matériel analytique : il relève d’une profondeur où se joue, en deçà de l’ambivalence d’une décision ontologique, le paradoxe de la liberté ou de la conscience au sens phénoménologique. Puisque l’approche de la maladie désireuse de se délier de l’idée de « cause » soulève le problème de la liberté, nous devons affronter ce dernier.
Le « monde » anonyme des pulsions
Mais venons-en au cheval de bataille des psychanalystes : la clinique neurologique en ignorant la spécificité du psychisme passe à côté du trouble affectif qu’elle croit pourtant cerner. Faire de l’angoisse autistique une conséquence d’un déficit des facultés de communication dont la cause hypothétique se trouverait entre neurones et gènes, revient à effacer le sujet au profit d’un organisme œuvrant au maintien de la vie — une vie anonyme. Ce qui ne signifie pas que la biologie n’aurait aux yeux de la clinique psychopathologique aucune pertinence propre, mais qu’elle est par méthode incapable de rendre compte des troubles affectifs dont il arrive qu’ils ont pourtant lieu en l’absence de lésion cérébrale et constituent ainsi la manifestation d’une subjectivité à laquelle seule la psychanalyse s’avère attentive (pense s’avérer attentive). De son côté, faute de lésion cérébrale « sérieuse » démontrée comme dans le cas de l’autisme, la neuropsychologie étend son objet d’étude à des perturbations « fonctionnelles », persistant par là à vouloir mettre en adéquation le modèle cognitif avec le modèle du fonctionnement cérébral. De fait, tandis que le cerveau semble intact, l’imagerie cérébrale permet aujourd’hui de visualiser des dysfonctionnements qui laissent penser que l’autisme n’est pas généré par un trouble affectif mais par une incapacité à traiter l’information de son environnement. « Tout se passe comme si l’enfant qui souffre d’autisme, incapable de filtrer les messages de l’extérieur, était bombardé de stimuli ingérables, inexplicables et donc terrifiants. Voilà pourquoi, sans doute, il se réfugie dans le monde sécurisant de la répétition et des objets. »[6] Ainsi, la neuropsychologie peut-elle mettre en cause le lobe temporal supérieur comme lieu d’un mécanisme intermédiaire ou comme lieu même de l’inscription d’une déstructuration cognitive expliquant le phénomène. Ladite zone cérébrale est « effectivement impliquée dans un certain nombre de fonctions spécifiques qui semblent en difficulté dans de nombreux cas d’autisme »[7], en particulier « la co-modalisation des différents flux sensoriels »[8]. Ce processus permet à l’enfant de rassembler les différentes stimulations sensorielles et de les appréhender par là même comme provenant d’une source commune qui lui apparaît extérieure. L’absence de « mantèlement » des sensations qui se jouerait au niveau du lobe temporal supérieur expliquerait donc la non-émergence autistique de la relation intersubjective. Mais par quelle magie, dans tout ce processus objectif, émergerait une « subjectivité » ?, interroge alors le psychanalyste. Conformément à ce que nous apprend l’épistémologie moderne, poursuit-il, seul le regard analytique qui ouvre d’une manière spécifique le champ exploré s’avère révélateur de données cliniques dont la complexité du traitement n’est envisageable qu’au sein de l’ouverture conceptuelle instituée par ledit regard. (Le phénoménologue appréciera au passage la circularité du regard.) De fait, si le concept de « pulsion » comporte une dimension quantitative en ce qu’elle se définit comme un processus de décharge, « celui-ci est accompagné dans le même temps d’une perception interne qui donne le ton fondamental de l’état affectif et en constitue sa dimension qualitative. »[9] En se liant, déliant et reliant aux représentations-choses, la pulsion révélée par la psychanalyse fait montre de toute la variété d’un travail de l’affect digne d’une vie authentiquement individuelle où se figure un « moi » à travers l’écho que lui renvoie de lui-même la voix de l’autre (en l’Autre) dont il va user. Elle se pose comme témoin et actrice d’une activité psychique qu’ignore l’activité cérébrale.
Le cœur de la défense analytique dans sa contre-attaque n’est pourtant pas imprenable. La psychanalyse en héraut d’une subjectivité née des cendres du cogito ne voit pas vraiment qu’elle consiste, pour parler comme M. Richir, en un « re-codage » d’une « discordance interne à l’institution symbolique du sujet »[10].
Afin d’éviter toute confusion, précisons dès l’abord que la dimension du « symbolique » chez M. Richir déborde ce que la psychanalyse appréhende comme tel puisqu’elle recouvre tout codage fixant dans le comportement humain (individuel, social ou politique) ce qui paraît toujours déjà comme « allant de soi ».
Or la psychanalyse n’interroge précisément pas ce qu’elle tient pour une individualité close ou une unité discrète coupée du signifié, à savoir le signifiant, dont l’effet de sens avec un autre signifiant se produit généralement comme jeu de mots au sein d’un code (pré)institué. Elle ne s’inquiète pas de l’origine (non « symbolique », au sens richirien) du signifiant qui paraît en guise d’unité élémentaire d’un discours tenu au lieu de l’Autre — et qui paraît du coup receler étrangement dans sa clôture même, dans l’impossibilité de quelque analogie avec le signifié, la possibilité de s’ouvrir à de l’autre par association. Il convient donc d’appréhender en guise de « signifiant » quelque chose d’autre que son codage structuraliste. Quelque chose d’autre qu’une unité participant soi-disant à une chaîne signifiante et produite par un « Autre » donnant l’illusion de fonctionner comme un ordre autonome, de marcher tout seul. Car au bout du compte, la prétendue subjectivité qu’entend défendre l’institution analytique relève davantage de la particularité « d’une réponse insensée »[11] que de la singularité d’une ipséité. La question du sujet en question — provoquée par l’attention maternelle : « Que veux-tu que je veuille pour toi ? » — ne surgit que dans son effacement, dans son élision, au profit d’« un codage aveugle de sa réponse »[12]. Dans l’inconscient, le sujet n’est pas celui qui pense, mais celui qu’un Autre engage à dire des bêtises : il ne peut dire que ce qu’il ne veut pas dire. Et en raison de cette structure métonymique du sujet qui ne peut désirer qu’autre chose que ce qu’il désire et ne prendre forme qu’en prenant dans son ignorance cet autre chose pour le tout, le sujet s’abîme dans l’automatisme de la répétition. La figure métonymique, où le désir souligne la connexion d’un signifiant à un autre signifiant en investissant une trace et donc une absence de jouissance, rend compte de la « variété » des représentations-choses se liant, déliant et reliant, mais cette « variation » n’est jamais que la discontinuité d’instants où se rejoue à chaque fois — dans l’impossibilité d’un projet s’étalant dans le temps — la répétition systématique de tout le mécanisme signifiant, tel qu’un signifiant n’existe qu’articulé à un autre signifiant, lui-même n’existant qu’articulé à un autre signifiant, lui-même… Plus précisément, si tout signifiant n’existe que référé à un système de signifiants, plutôt que d’envisager la structure métonymique comme un rapport « temporel » (succession) entre un signifiant et un autre signifiant qui fait retour vers le premier et confère ainsi une signification à l’expression, il convient d’appréhender la répétition comme instantanée : celle d’un « tout » déphasé par rapport à soi, toujours déjà en retard (ou en avance) par rapport à soi et dont la « réflexion » est doublée instantanément par le signifiant. Nous y reviendrons. En bref, le désir ou l’institution du sujet présente l’étrange structure d’un déphasage qui n’a ni le temps ni l’espace de se faire mais se donne comme un problème insoluble constitué d’une pulsion qui ne « cherche » à s’assimiler que ce que sa capacité recèle par avance — l’ordre symbolique créant le manque et déterminant l’« objet » qui y répond en supportant le manque, le non-sens — et est poussée sans répit de poussée en poussée comme glissement incessant de signifiant en signifiant.
Le premier enseignement du phénoménologue qui relativise la position analytique est alors le suivant. L’ordre symbolique de l’Autre qui semble fonctionner tout seul « en machinant l’articulation signifiante, dans l’automatisme de répétition »[13] institue un comportement formellement du même type que le comportementalisme, en ce « sens » que le comportement apparaît comme le siège de mécanismes de déclenchement, mais de nature langagière dans un cas et de nature biologique dans l’autre. La subjectivité à laquelle la psychanalyse assigne une place particulière n’est pas en réalité plus « personnelle » que les niveaux de conscience et les modalités de représentation dont parlent les neurocognitivistes. Du point de vue phénoménologique, le psychisme dont traite la psychanalyse consiste bien en un appareil psychique où circulent et s’échangent des signaux et leurs réponses. D’où l’extrême difficulté pour l’« imaginaire » par quoi un « moi » prendrait consistance de se positionner dans le système. Pour ne pas sombrer dans la monotonie du fonctionnement, le « moi » perceptif en effet, nous le découvrirons, doit être, au sein même de sa cohésion, creusé d’intervalles par lesquels, de manière provisoire et contingente, les données sensibles se répondent les unes aux autres dans le rapprochement ou l’éloignement. L’instabilité de ces intervalles doit ainsi trouver son origine ailleurs que dans une sémiotique structurale. Par ailleurs, quant au problème de la « mienneté » qu’implique la perception interne, la réduction phénoménologique se doit de mettre entre parenthèses tout système dialectique — qui est toujours l’effet d’un corps étranger à l’expérience, corrélatif du défaut de mienneté qui ne sommeille nulle part — afin d’exhiber le mouvement propre à toute répétition. C’est que la description de toute substantivation d’un sujet qui se réfère à soi[14], de toute apparition d’un domaine privé, de toute nomination ou appellation, doit être reconduite à la stance de ladite consistance (ontologique), à la distorsion « originaire »[15] d’un soi qui prend sur soi, d’un effort d’être qui dans sa tâche même accomplit un recul déterminant l’assomption en tant que telle — et dont l’« arrêt », le repli ou l’hésitation tranche ainsi sur le glissement métonymique d’une « perception » d’ores et déjà désaxée par l’autre. Autrement dit, le stade du miroir ou son équivalent invocatoire (le sujet qui s’assimile à l’écho) suppose étrangement ce qui n’a pas lieu d’être : la transparence d’une conscience (le cogito) que la dialectique du soi émergeant contre un autre mettrait en cause. Du point de vue phénoménologique, ce que la psychanalyse appelle un peu vite le « stade du miroir » (que nous appellerons, quant à nous, « conscience perceptive » et dont la réflexion au stade du miroir apparaîtra comme une déformation dialectique conférant l’illusion d’une succession signifiante) s’institue plutôt sur base de la sensation comme écart entre soi et soi, comme effort qui accomplit « un choc en retour, écrit Levinas, dans la simplicité de son coup. »[16] L’effort en question est effort d’être de l’être qui se lève et se soulève à l’existence de soi. Relation de soi à soi comme charge s’éprouvant soi-même qui ne dure pas : l’existence de l’existant a du poids, pèse sur lui, en ce que la conquête de soi est totale. Elle n’a pas lieu dans le temps par quoi l’effort serait reporté. La distorsion « originaire » est donc celle de l’« instant » qui n’existe qu’à se tenir entre le surgissement et l’évanouissement. « L’évanescence du présent [scil. de l’instant] ne détruit pas le définitif et l’infini actuel de l’accomplissement de l’être qui constitue la fonction même du présent [scil. de l’instant]. L’évanescence le conditionne : par elle, l’être n’est jamais hérité, mais toujours conquis de haute lutte. »[17] Mais attention : puisqu’elle paraît coupée du devenir, puisque sa réflexion ne se découvre pas sous l’horizon d’un passé où elle n’a jamais été et d’un futur où elle ne sera jamais, l’instantanéité de la genèse du soi n’est pas déjà ici la liberté créatrice de la conscience que nous allons maintenant décrire grâce à M. Richir. Elle correspond encore une fois au niveau de la « sensation » et non de ce que l’on peut appeler l’« affectivité » (comme déploiement de l’ipséité de ce que M. Richir appelle le « sens se faisant »).
Résumons-nous. La perception interne à l’appareil psychique où le moi aurait idée d’un corps (étranger) comme de soi implique en réalité un mouvement de répétition qui n’a pas la singularité du vivant. D’autre part, ce mouvement de répétition, où clignote bien un « soi » mais coupé de sa vivacité, n’est pas non plus d’abord le fait d’un mouvement dialectique en quoi l’on bricole avec des éléments obtenus par précipitation (dans le sens quasiment chimique du terme).
Liberté phénoménologique et origine du signifiant
Afin de comprendre ce qui est en jeu dans cette discordance interne à l’institution analytique — telle qu’une investigation thérapeutique se justifie eu égard à un sujet en souffrance, lequel ne demeure pas ainsi livré au seul destin (le fait d’être figé dans son devenir) révélé par le regard théorique —, il convient de se pencher sur la conscience dans un sens phénoménologique, car « à force de porter son attention sur l’articulation symbolique de l’inconscient, la théorie psychanalytique en vient à ne plus comprendre ce qu’est la conscience. »[18]
Il n’y a pas de liberté ex nihilo : la conscience se détache d’un fond (sans fond), d’un passé « qui, pour n’avoir jamais été présent dans la présence réfléchie d’une conscience, n’en est pas moins un passé où il s’est passé des choses, mais aveuglément, sans réflexivité »[19]. Le temps du devenir que « reprend » la liberté est « un ‘‘temps’’ inconscient ou innocent où les choses passent plutôt qu’elles ne se passent »[20] . La conscience ne peut donc « reprendre » le passé qui est passé sans elle qu’en y revenant « comme d’un lieu qu’elle habite, mais surtout qui l’habite en absence. »[21]Autrement dit, la conscience ne peut s’éveiller à elle-même que dans la réminiscence d’un passé « qui lui apparaît rétrospectivement comme le passé de son absence. »[22] Mais si l’apparaître-à-soi — la présence — ne s’amorce que contre un autre — l’absence —, si « la présence ne se réfléchit comme telle que sous l’horizon d’un passé transcendantal où elle n’a jamais été (présente) »[23], si elle ne se découvre donc qu’en tant qu’elle ne se découvre pas comme toujours déjà faite, elle s’éprouve également sous l’horizon d’un futur à jamais futur : ce qui est passé sans elle restera à jamais dérobé et constitue un futur transcendantal saisi par une prémonition qui (n’)est prémonition de « rien » (de présent). Réminiscence et prémonition sont caractérisées par un enchevêtrement mutuel. Ce qui ne revient précisément pas à confondre le passé et le futur transcendantaux comme si le présent était le lieu où il était offert au futur d’être sans reste afin de glisser au passé, comme si le passé n’était jamais que le futur qui venait d’être confirmé par le présent. Dans cette perspective illusoire du temps qui s’écoule, le présent ne fait jamais que se succéder étrangement à lui-même : il est un avenir qui vient juste de passer et sera retenu comme présent à peine passé pour laisser la place au présent qui se profile dans l’avenir. Mais comment penser l’idée même de passage au sein d’un écoulement, d’un processus sans faille ? Bien au contraire, le « présent » ne peut constituer un passage qu’en tant qu’il dessine le mouvement même d’une conscience en train de se faire dans l’écart, l’abîme, entre le passé et le futur (transcendantaux) à l’écart du présent (ou plutôt de la « présence » où résonne l’ipséité de ce qui est en train de se passer) : la liberté authentique, comme la pense Jean-François Marquet, ne retenant rien de soi « qui serait nécessaire pour réfléchir sur son action, la prévoir, l’envisager comme possible »[24] et se surprenant ainsi soi-même. De cette manière, la liberté est celle du « sens se faisant » — c’est-à-dire une mise en forme, une expression, une réflexion qui n’a lieu que de ne pas se boucler « sous l’horizon d’un sens indéfiniment à faire »[25]. Présence donc, inassignable cependant, car elle n’a lieu que de s’insinuer dans l’écart entre réminiscence et prémonition.
La conscience est conscience de ce qu’elle cherche à dire dans un projet qui revire aussitôt en une réminiscence ouverte sur une prémonition dans la mesure où la conscience tient aussi en amont à l’exigence de ce qui est encore à dire. Mais réminiscence et prémonition, avons-nous insisté, n’ont de sens à se croiser et se recroiser qu’en tant qu’elles ne reviennent pas au même. Ce que je tente de dire (bien que la conscience en question, la liberté phénoménologique, ne s’assimile pas à un « je ») ne se déduit pas simplement de ce qui s’est déjà dit. De sorte que si la conscience constitue la mise forme d’un sens en vue de lui-même dans une réflexion à la fois projective et rétrojective, dans un temps qui a de l’espace (le sens à dire tout à la fois là-bas dans l’avenir et là-bas dans le passé), il y a « quelque chose » dans l’aventure du sens lui-même qui lui échappe et empêche précisément cette aventure de se boucler en adéquation du sens à soi-même où tout serait révolu ou accompli. Mais si l’aventure du sens implique une réminiscence et une prémonition qui ne le soient de quoi que ce soit de présent, l’écart interne à la conscience (impossible à combler) implique intrinsèquement un écart externe par rapport à soi. Dire qu’il n’y a pas de création ex nihilo, ce n’est pas seulement dire que la conscience est toujours déjà rétrojective (et donc projective), c’est dire aussi que le sens qui se cherche est sens d’autre chose que soi : « le sens ne peut trouver son amorce qu’en amont de lui-même, dans ce qui, pas encore en amorce de sens en question, est déjà amorce de sens pluriels, et amorce de sens pluriels indéfinis tout en ‘‘potentialité’’ »[26]. La présence renvoie de la sorte à un passé plus passé que le passé de la réminiscence constituant son écart interne et à un futur plus futur que le futur de la prémonition constituant également son écart interne. La conscience se réfère à l’enchevêtrement de réminiscences et de prémonitions dépouillées de toute orientation, elle se réfère à une réflexivité aveugle, une réflexivité inconsciente.
Autrement dit, la conscience « qui est présence du sens à lui-même, est trouée d’absences, d’horizons ou de rayons de monde où vient à jouer et à vivre la dimension sauvage de l’inconscient phénoménologique. »[27] Il y a donc bien des lacunes ou des failles dans la phase de conscience mais ce qu’elle ne réalise pas ne renvoie pas à l’inconscient tel que la psychanalyse le conçoit. L’inconscient phénoménologique est le lieu des phénomènes-de-monde — dont la conscience s’écarte par temporalisation et spatialisation — indéfiniment ouverts à d’autres phénomènes-de-monde dans une association sans concept ni réflexion :
[…] les phénomènes-de-monde étant indéterminés et inidentifiables, il n’y en a aucun qui soit indivis : leur non-identité à soi fait qu’il n’y a pas d’atome phénoménal de phénomène, mais que, dans leur phénoménalisation, ils sont tout autant toujours en voie de se diviser que toujours en voie de se multiplier, selon une prolifération infinie […] où l’individuation phénoménologique est toujours radicalement provisoire et contingente.[28]
Le lieu de l’inconscient ouvre un abîme où des formations clignotent sans fin entre l’union et la dispersion et c’est de ce fond sans fond ou de ce silence qui n’est pas absence de rien (néant) que se détache un sens qui tente de se dire. La présence ou la conscience n’est rien d’autre que le passage de l’amorce des formations plurielles « au sens singulier en amorce »[29]. Un passage qui habite son faire.
Mais l’ipséité de la conscience rétro-projective, tout autant retrait en soi (amorçant un dedans) qu’avancée vers soi (amorçant un dehors) du sens se faisant, est également corrélative de la rencontre avec une autre conscience. « Ma » vie et la vie de l’autre s’entrecroisent sans se confondre. Entrer en contact avec l’autre à la manière d’une conscience incarnée, c’est accueillir à distance un dehors qui s’ébauche (il n’est pas saisi comme un objet) et va agir en soi à titre de dedans d’un autre amorçant ainsi l’ipséité à elle-même en tant qu’elle se sent en écart et par écart de l’autre. De la même manière l’autre que « je » sens passer en « moi » sent que « je » passe en lui en l’éveillant à soi (le soi qui s’ébauche en vue de soi) en écart et par écart. On l’aura compris, si cette esthétique élémentaire fonde la possibilité d’une compréhension humaine réciproque, elle ne s’ébauche pas sans lacunes. « Il y a quelque chose de la vie d’autrui qui m’échappera toujours, à jamais, de même que c’est par autrui que j’en viens à comprendre qu’il y a quelque chose de ma vie propre qui m’échappera toujours, à jamais »[30].
Dans la situation qui nous préoccupe, cela signifie qu’une mère qui s’adresse à son enfant n’engage pas d’abord un autre qui tiendrait lieu de l’Autre. Une description attentive y verra d’abord le travail d’une conscience (celle de l’enfant) qui, en contact avec la conscience maternelle, s’éveille à soi en cherchant à comprendre ce qui se dit entre les mots, à travers les mimiques ou les gestes de l’autre (« sa » mère). Ce qui se dit du côté de la mère — et dont le sens (phénoménologique) est ici irréductible à un sens codifié — va être accueilli par l’enfant dans l’exigence d’une mise en forme qui constitue tout à la fois l’espacement entre soi et l’autre (autrui) et l’espacement interne au soi. Du coup, la « réception » du « message » ne se fera pas sans lacunes au sein même de la formation du sens : « quelque chose » de ce qui s’est passé en lui est passé « sans se passer »[31]. Et surtout, c’est eu égard à ces lacunes du sens dans le sens que l’on peut rendre compte de l’origine (phénoménologique) du signifiant. Ce que le psychanalyste nomme « inconscient » se situe en réalité dans le saut entre la dynamique phénoménologique et ce que M. Richir appelle l’« institution symbolique ». Celle-ci va opérer en redistribuant ou en réarticulant à son niveau les lacunes en « un système d’écarts signifiants »[32]. Le sens se faisant — composition de « signes » phénoménologiques —, dépassé par ce qui passe et a lieu en lui de ne pas avoir lieu, se voit transposé au niveau symbolique en éclatant en morceaux de (pseudo)langage — les signifiants —, en représentations-choses qui ne paraissent qu’en tant qu’« emblèmes d’un sens avorté »[33] et constituent les objets-supports de la pulsion. Le signifiant ne forme pas ainsi originairement une unité linguistique : il se donne en tant que pôle stimulant un autre pôle, le désir en tant que « projet » d’ores et déjà avorté. Encore une fois, ce n’est qu’eu égard aux « blancs » dans la phase de présence que l’on peut comprendre l’errance ou le glissement du signifiant comme langage du non-sens, signe d’un manque de sens. Avant d’être recodés par la linguistique dont la réification du signifiant a pour corollaires les concepts d’« imaginaire » et de « réel », le signifiant et la pulsion qui s’y accroche recouvrent une phase de présence qui se perd dans son aventure et dont la perte de ce qui est manqué au niveau de la rencontre, provoque la transposition symbolique du refoulement par quoi s’institue un apparaître éclaté en une prolifération de pulsions déterminant l’inconscient.
Deuxième enseignement du phénoménologue donc : le signifiant n’est pas un langage tenu au lieu d’un Autre qui le produirait en chaîne (successivement), mais ce que l’institution symbolique investit de l’aventure phénoménologique à titre de morceau circulant, errant entre d’autres morceaux errants, du fait du vide que la même institution symbolique condense en un désir qui s’y (au signifiant) accroche. Les concepts de « réel », « symbolique » et « imaginaire » ne peuvent être saisis comme tels qu’en tant qu’ils se prélèvent sur cette prolifération signifiante, laquelle fait écho à la contingence des phénomènes-de-monde qui perce dans la phase de présence. Et l’espace de la prolifération n’est rien d’autre que le milieu originaire de l’« instant » comme émergence du rapport de soi à soi-même. Le pôle de l’emblème et le pôle du non-sens constituent les pôles du scintillement ou clignotement de tout instant qui a lieu entre le surgissement et l’évanouissement. Ainsi, le désir n’est ouvert qu’au signifiant qui le déclenche, lequel est ouvert par le désir correspondant. Il y a revirement entre le désir (le manque) et le signifiant qui empêche le manquement de se fixer sur de l’avorté et le remplissement de s’arrêter en du rempli. Ce qui veut dire que l’on doit se garder de vouloir appréhender, comme son nom l’indique, la prolifération — qui est prolifération d’instants — dans un espace d’ores et déjà constitué où chaque partie apparaît en co-appartenance avec d’autres. Il n’y a pas succession mais discontinuité d’instants, « tout instant étant sans précédent et sans suivant »[34]. L’instant ne se situe pas sur une ligne (du temps), il fait espace lui-même en un écart interne entre surgissement et évanouissement (en termes lévinassiens : un accomplissement de soi qui est tout autant un recul en soi) qui le rend insaisissable et du même coup en détermine la prolifération sans « avant » ni « après », puisque l’idée d’« arrêt » de la « production » impliquerait l’idée de « fixité », laquelle contrevient à l’ambivalence de l’instant. Il faut voir que « les instants ne sont pas toujours déjà mutuellement spatialisés […], mais sont en quelque sorte […], en cours in-fini de spatialisation, à chaque instant clignotant […] et ce parce que l’écart interne au clignotement, entre surgissement et évanouissement, ne fait que jamais rapporter tel instant (surgi au hasard) au même instant. »[35] Autrement dit, la prolifération de l’instant est répétition indéfinie de l’instant (comme rapport de soi à soi-même). Répétition aveugle, qui se « donne comme toujours déjà faite » et « comme se faisant encore toujours »[36], mais dont le clignotement au « point » (insaisissable) de l’instant, en tant qu’écart, est une trace de l’élément phénoménologique dans l’institution symbolique. Plus précisément, le clignotement de l’instant en un surgissement « qui advient sans s’accomplir en se remplissant de lui-même, et dans son évanouissement qui l’évide sans s’annuler purement et simplement »[37] est caractérisé par le passage au niveau symbolique de réminiscences et de prémonitions (qui se croisent et se recroisent) n’ayant eu ni le temps ni l’espace de se déployer dans la phase de présence et se déformant en pseudo-phénomène d’un reflet doublant le sens se faisant.
La « voix-fantôme » comme « signifiant », représentation-chose surgie de nulle part, soumettant à la vocifération de ses terribles injonctions un sujet qui vacille dans l’angoisse et est « exclu comme sujet empirique, comme conscience »[38] n’est donc pas originairement l’incompréhensible retour dans le fantasme de ce qui aurait fait l’objet d’un meurtre — la chose (en soi) toujours déjà insaisissable (le chant mythique des sirènes) —, mais le pôle d’une répétition où ce qui est déclenché n’est rien d’autre que le codage symbolique de ce qui n’est pas arrivé à se temporaliser et se spatialiser dans la phase de présence.[39]
[1] Dire que le réel « ek-siste » au symbolique en tant que dehors du symbolique ne change rien à l’affaire.
[2] Le cadre de notre article ne se prête évidemment pas à toute l’ampleur de la tâche, nous nous contenterons d’évoquer quelques questions. Nous renvoyons le lecteur aux travaux précurseurs et fondateurs de M. RICHIR, en particulier à la deuxième partie de son ouvrage : Phénoménologie et institution symbolique, Millon, Grenoble, 1988, 383 p. : « La dimension phénoménologique de l’institution symbolique », pp. 91-285. — Notre lecture est également redevable du remarquable travail de Joëlle MESNIL : « La pulsion chez Marc Richir », in Eikasia, n° 47, Site Internet, 2013, pp. 527-572, Disponible sur : http://www.revistadefilosofia.com/
[3] Cf. J.-C. MALEVAL, Op cit. et Luis SOLANO, « Le psychotique, que peut-il attendre de la psychanalyse ? », in Le Pont Freudien, Disponible sur : http://pontfreudien.org/content/luis-solano-le-psychotique-que-peut-il-attendre-de-la-psychanalyse (consulté le 23/01/2013)
[4] Elisabeth ROUDINESCO, « Psychanalyse et autisme : la polémique », in Le Huffington Post, Site Internet, 30 janvier 2012, Disponible sur : http://www.huffingtonpost.fr/elisabeth-roudinesco/psychanalyse-autisme-polemique_b_1241992.html
[5] Cf. Michel HENRY, Généalogie de la psychanalyse, Paris, PUF, 1985, 398 p. — « L’inconscient n’a donc d’existence théorique que celle-ci : être le seul principe d’explication possible du matériel pathologique, de telle manière toutefois que la légitimation ne tient pas ultimement à la pertinence du principe explicatif mais au matériel pathologique lui-même en tant que tel, en tant que donné incontestable. En quoi le matériel analytique est-il un donné incontestable ? En tant qu’il apparaît. On peut rejeter verbalement une philosophie de la conscience, c’est sur l’essence préalablement déployée de la conscience elle-même que repose toute la problématique psychanalytique qu’on prétend lui opposer. » (Ibid., p. 344) Toute la problématique analytique tient ainsi dans le fait que la conscience, en tant que lieu de l’apparaître, apparaît dans un donné lacunaire tel que la cure entend « recoller les morceaux ». Mais la problématique paraît extrêmement ambivalente au niveau théorique : pourquoi vouloir convertir l’inconscient dans le conscient ? Pourquoi se donner comme but ce qui constitue la condition même de son exercice, à savoir une révélation de l’inconscient à même la conscience ? La pratique analytique ne peut donc avoir de sens que si elle se soutient d’un paradoxe qu’il s’agit de penser : le travail d’interprétation n’est possible qu’en raison d’un déphasage interne à l’institution analytique, tel qu’elle ne se boucle pas en un système donnant l’illusion de marcher tout seul.
[6] Catherine BARTHELEMY, « Comprendre et soigner autrement : à propos de l’autisme », in Catherine MAYER et al. (sous la direction de), Le livre noir de la psychanalyse, p. 690.
[7] Bernard GLOSE et Laurence ROBEL, « Pour une approche intégrative de l’autisme infantile », in Recherches en psychanalyse, n° 7, 2009, p. 48.
[8] Ibid.
[9] Claude SMADJA, « L’affect, entre psychanalyse et biologie », in Société psychanalytique de Paris, Site Internet, mars 2010, Disponible sur : http://www.societe-psychanalytique-de-paris.net/wp/laffect-entre-psychanalyse-et-biologie/
[10] M. RICHIR, « Merleau-Ponty : un tout nouveau rapport à la psychanalyse », in Les Cahiers de Philosophie, n° 7, 1989, p. 180.
[11] Ibid., p. 175.
[12] Ibid.
[13] Ibid., p. 176.
[14] C’est bien de la substantivation, c’est-à-dire de l’événement même du sujet, qu’il est ici question et non du sujet posé en substance, même s’il est vrai que l’événement finit par donner lieu à une certaine solidification (problématique) corrélative de l’essence se retournant et se distendant en intentionnalité : le corps comme « avoir » d’une conscience.
[15] Distorsion « originaire » par rapport au système analytique tel que nous venons de l’exposer, mais qui n’est pas encore la conscience au sens phénoménologique, parce que ladite distorsion est l’émergence et le scintillement de l’instant qui se pose et trouve lieu, mais n’a pas le temps. Nous nous trouvons ici au niveau ontologique en tant que transposition (symbolique) d’une base phénoménologique. Sur cette constitution de l’instantanéité, cf. le premier grand texte d’Emmanuel LEVINAS : De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, 1993, 173 p.
[16] Ibid., p. 116.
[17] Ibid., p. 132.
[18] M. RICHIR, Op. cit., p. 180.
[19] Idem, « Sauvagerie et utopie métaphysique », Préface à Friedrich Wilhelm Joseph von SCHELLING, Les Âges du monde – versions premières, 1811-1813, Editions Ousia, Bruxelles, 1988, p. 11.
[20] Ibid., p. 12.
[21] Ibid., p. 16.
[22] Ibid., p. 17.
[23] Ibid., p. 21.
[24] Jean-François MARQUET, « Liberté et commencement », in Pierre KERSZBERG, Antonino MAZZÙ et Alexander SCHNELL (sous la direction de), L’œuvre du phénomène, Mélanges de philosophie offerts à Marc Richir, Bruxelles, Ousia, 2009, p. 29.
[25] M. RICHIR, Op.cit.
[26] Idem, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, Grenoble, Millon, 2006, p. 23.
[27] Idem, « Merleau-Ponty : un tout nouveau rapport à la psychanalyse », p. 183.
[28] Idem, « Le problème de l’incarnation en phénoménologie », in Michel-Pierre HAROCHE (sous la direction de), L’âme et le corps, Philosophie et psychiatrie, Paris, Plon, 1990, p. 170.
[29] A. SCHNELL, « Temporalité et affectivité », in L’œuvre du phénomène, p. 143.
[30] M. RICHIR, « Communauté, société et Histoire chez le dernier Merleau-Ponty », in M. RICHIR et Etienne TASSIN (textes réunis par), Merleau-Ponty, Phénoménologie et expériences, Grenoble, Millon, 2008, pp. 13-14.
[31] Idem, « Merleau-Ponty : un tout nouveau rapport à la psychanalyse », p. 178.
[32] Idem, Phénoménologie et institution symbolique, p. 197.
[33] Ibid., p. 174.
[34] Idem, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, p. 114.
[35] Ibid., p. 115.
[36] Ibid., p. 117.
[37] Ibid., p. 125.
[38] Idem, « Merleau-Ponty : un tout nouveau rapport à la psychanalyse », p. 173.
[39] À ce niveau de description, le « regard » (épinglé par le signifiant), comme la « voix », peut servir de paradigme à l’élément de la sensation puisqu’il ne se situe pas en un monde objectal. Le regard ici n’est pas la vision.