La phosphorescence des choses
Frédéric Rambeau, Maître de conférences, Université Paris 8/LLCP
On peut lire, dans Mille Plateaux, une curieuse formule de Deleuze et Guattari : « Désubjectiver la conscience et la passion. »[1]. La dissociation du sujet d’avec la conscience joue ici en faveur de la conscience, d’une conscience qui serait plus large que le sujet. Et non l’inverse : un sujet plus vaste que la conscience et qui, ne s’y réduisant pas, pourrait l’englober, autrement dit, un « sujet de l’inconscient ». Aussi cette formule indique-t-elle une voie inverse à celle de Lacan et du champ freudien. Elle s’écarte de ce qu’on considère souvent comme un enjeu essentiel du « moment » de la philosophie française de la seconde moitié du XXe siècle : la recherche, comme l’indique par exemple Alain Badiou, d’une nouvelle figure du sujet, « un sujet moins étroit que le sujet conscient, quelque chose qui est comme une création ou une production concentrant en elle des forces plus vastes », et qui aurait conduit à considérer la psychanalyse, pour cette raison, comme un « interlocuteur essentiel »[2]. Il semble bien, à en croire cette formule de Mille Plateaux, que, dans le cas de Deleuze et Guattari, ce sujet moins étroit que la conscience soit, en réalité, une conscience plus large que le sujet. L’écart entre les deux reste en tout cas à élucider.
Deleuze a certes élaboré de nouveaux concepts de sujet, le « sujet-pli » notamment. L’analyse de la production inconsciente de subjectivité a bien été une ligne directrice des recherches de Guattari. La formule de Mille Plateaux, elle, met l’accent sur autre chose. Que serait une conscience désubjectivée, une conscience impersonnelle qui ne serait pas (ou plus) conscience de soi, parce qu’elle serait plus large que le sujet, comme élargie ou étendue au-delà de lui ?
Cette question engage la relation décisive de Deleuze à Sartre, souvent laissée dans l’ombre de sa critique de l’intentionnalité et des « philosophies de la conscience ». Car la désubjectivation de la conscience, ce fut d’abord le programme de Sartre. C’est par là qu’il a ouvert à Deleuze un chemin vers l’immanence « absolue », jouant un rôle essentiel dans l’impulsion de la philosophie deleuzienne vers un « empirisme transcendantal ». Certes, la désubjectivation du champ transcendantal, soit le programme de La transcendance de l’Ego, doit être menée plus loin, jusqu’au point où il ne peut plus être attribué à une conscience, même non-réfléchie : là où l’immanence n’est plus immanence à (la conscience) mais immanence de soi. Il n’en demeure pas moins que l’idée sartrienne des consciences impersonnelles, comme l’idée d’une intentionnalité ontologique et non plus égologique – que Merleau-Ponty prolongera ultimement et en dialogue avec Bergson dans l’idée d’une perception se faisant dans les choses – ressemble pour la philosophie deleuzienne à un point de départ.
La désubjectivation de la conscience nous porte, en tout cas, au cœur de la contre-effectuation deleuzienne de la révolution critique. La « conscience pure » est une conscience purifiée de tout sujet, parce qu’elle est tombée du côté de l’objet, passée dans les choses. C’est pourquoi elle est liée aux tentatives de Sartre, puis, ultimement, de Merleau Ponty de penser, en s’écartant de l’orientation kantienne de la phénoménologie husserlienne, un rapport à l’être qui se fasse de l’intérieur de l’être.
Aussi cette formule de Mille Plateaux vient-elle brouiller avec bonheur les partages un peu vite établis entre les pensées françaises contemporaines, quand on les considère sous l’angle des batailles conceptuelles qui les ont divisées autour de la notion de sujet. La désubjectivation deleuzo-guattarienne étire la conscience en un sens inverse au sujet de l’inconscient, vers une intentionnalité ontologique. Elle restitue aussi une passion pure, une contemplation créatrice, qui rapporte le mystère de la création passive à une force de la sensation, mais dissociée de la relation entre l’homme et le monde, et donc excentrée de la phénoménologie.
Ces deux opérations, qu’on peut voir à l’œuvre dans plusieurs motifs de l’ontologie deleuzienne, comme la « conscience pure », la conscience somnambulique, ou le « point de vue de la chose », deviendront finalement deux modes de la création, deux aspects du « cerveau monde », l’ultime concept de la philosophie deleuzo-guattarienne. Mais comment comprendre, alors, que cet Etre-Pensée, cette Pensée-Nature, que toute l’ontologie deleuzienne s’est employée à dissocier de la problématique du sujet, à « désubjectiver », soit finalement rapportée à une instance subjective : le « cerveau-sujet » ?
La conscience pure
La réduction transcendantale husserlienne rapporte le « vécu » à l’immanence absolue de la conscience à elle-même. Le noème perceptif ou « sens » de perception est le perçu comme tel (le perçu tel qu’il apparaît dans une perception). Cette « apparence » n’est ni un donné sensible, ni un fait psychique : elle est l’idéalité objective en quoi consiste l’intentionnalité même. La « conscience absolue » husserlienne en tant qu’horizon de tout apparaître ne peut donc être causée : elle se définit, selon cette idée qui fait le fond de toute phénoménologie, dans sa propre et pure immanence.
Aussi, comme le déclare Sartre, Husserl a t-il, dans les Recherches logiques, « ouvert le chemin »[3]. En distinguant l’être de la conscience et celui du Je qui est quelque chose pour la conscience (« une production synthétique et transcendante de la conscience »[4]), il dégage un champ d’immanence pure. C’est pourquoi, dans Logique du Sens, Deleuze peut s’appuyer sur le concept husserlien d’« expression » (la couche noématique) pour caractériser cette activité paradoxale du sens incorporel qui, comme le décrit Husserl, n’est pas productive ou « s’épuise dans l’exprimé »[5], et constitue la singularité de l’action noématique . « La phénoménologie serait-elle cette science rigoureuse des effets de surface ? »[6].
Mais quand il s’agit de rendre compte de la donation du sens en sa genèse et non plus seulement de son impassibilité incorporelle (l’idéalité noématique), Husserl révise, en 1913 dans les Ideen, les affirmations précédentes des Recherches qui refusaient à l’Ego le statut d’un principe originaire soutenant les vécus. Il maintient la transcendance d’un Moi pur, sans lequel l’investigation des vécus se verrait privée de contenus[7]. Subsiste donc une transcendance au sein de l’immanence de la conscience : un Moi supposé distinct de l’unité immanente des vécus, qui n’est pas objectivable parce qu’il en est la structure nécessaire[8]. Aucune réduction, affirme alors Husserl, n’a prise sur ce Moi pur dont émanent et vers lequel convergent « nécessairement » toutes les visées intentionnelles comme leur centre de référence. Autrement dit, la conscience husserlienne découvre le Moi, mais ne l’engendre pas.
« Il serait tentant, déclare Sartre, de constituer l’Ego en pôle-sujet comme ce pôle objet que Husserl place au centre du noyau noématique. Ce pôle objet est un X qui supporte les déterminations. »[9]. Le noyau noématique est bien un attribut, mais il est aussi un prédicat, conçu dans son rapport à l’objet x. Ce noyau, ce centre transcendantalement intime consiste en définitive dans la relation du noème à l’objet. Garantissant que le sens visé se dépasse bien dans un objet, la relation du noème à l’objet devient alors elle-même à constituer par le Je transcendantal, comme « ultime structure du noème »[10].
Les métaphores de noyau, dit Deleuze, sont inquiétantes, « elles enveloppent ce qu’il s’agit d’expliquer » (soit, la genèse du Moi pur et de la relation d’objet). La manière dont la phénoménologie husserlienne dépasse la démarche critique du simple conditionnement, la manière dont elle prend en charge la question de la genèse du sens, consiste en fait à présupposer dans une instance originaire, l’ego transcendant, qui retiendrait la forme pure de l’objectivité et la forme pure de la conscience, cela même qu’elle prétendait engendrer par une méthode transcendantale. Pour assurer que les conditions des objets réels de la connaissance sont les mêmes que celles de la connaissance, elle ne conçoit de singularités déterminables que déjà incluses dans un Moi pur ou un Je transcendantal. Elle décalque la condition transcendantale à partir d’une expérience qui ne se réalise effectivement qu’en étant saisie ou ressaisie dans la forme du Je, dans la structure de l’ipséité. Elle rapporte l’être du monde à l’unité intentionnelle de l’être au monde.
Dans Logique du Sens, Deleuze rend un bel hommage à Sartre : la donation du sens et l’engendrement qui s’ensuit des autres dimensions de la proposition ne peuvent se faire que « dans un champ transcendantal qui répondrait aux conditions que Sartre posait dans son article décisif de 1937 : un champ transcendantal impersonnel, n’ayant pas la forme d’une conscience personnelle synthétique ou d’une identité subjective – le sujet au contraire étant toujours constitué. »[11]. Dans Qu’est-ce que la philosophie?, Deleuze et Guattari, salueront en Sartre celui qui redonne ses droits à l’immanence. Grâce à l’idée d’un champ transcendantal impersonnel, il rompt avec cette manière moderne de sauver la transcendance, en la pensant non plus comme celle d’un « Quelque chose » ou d’un « Un supérieur à toute chose », mais à l’intérieur de l’immanent, sous la forme d’un Sujet transcendantal auquel le champ d’immanence s’attribue[12].
Sous cet angle, le programme sartrien de La Transcendance de l’Ego consonne avec celui de Deleuze : « Mais nous nous posons la question suivante : ce moi psychique et pycho-physique n’est-il pas suffisant ? Faut-il le doubler d’un Je transcendantal, structure de la conscience absolue ? On voit les conséquences de la réponse. Si elle est négative il en résulte : 1. Que le champ transcendantal devient impersonnel, ou, si l’on préfère « pré-personnel », il est sans Je (…) 2. Que le Je n’apparaît qu’au niveau de l’humanité et n’est qu’une face du Moi, la face active (…) 4. qu’il sera loisible de se demander si la personnalité (même la personnalité abstraite d’un Je) est un accompagnement nécessaire d’une conscience et si l’on peut concevoir des consciences absolument impersonnelles. »[13].
La conscience sartrienne est une visée sans objet, un déploiement sans dehors qui la circonscrive, ni contenu qui viendrait la remplir ou la vider, dissociée de la relation de transcendance de la chose à la conscience constituante. « Le champ transcendantal purifié de toute structure égologique n’est plus rien qui soit objet. », « La conscience absolue, lorsqu’elle est purifiée du Je, n’a plus rien d’un sujet. »[14]. La conscience transcendantale n’est pas non plus humaine, c’est l’Ego qui l’humanise. En elle-même, elle n’est ni humaine, ni mondaine.
Pourtant, malgré la désubjectivation radicale de la conscience que mène Sartre dans La Transcendance de l’Ego, il n’a pas tiré jusqu’au bout, déclare Deleuze, les conséquences de son affirmation, contre Kant, d’un champ transcendantal sans sujet. « Ce champ ne peut pas être déterminé comme celui d’une conscience : malgré la tentative de Sartre, on ne peut pas garder la conscience comme milieu tout en récusant la forme de la personne et le point de vue de l’individuation. Une conscience n’est rien sans synthèse d’unification, mais il n’y a pas de synthèse d’unification de conscience sans forme du Je ni point de vue du Moi. »[15]. En pensant (encore) le plan d’immanence comme un champ de conscience, Sartre s’empêche de penser l’immanence comme une immanence qui n’est qu’à soi-même.
La conscience sartrienne est pure non seulement parce qu’elle est purifiée du Sujet transcendantal, mais aussi parce qu’elle est parfaitement translucide, toujours présente à elle-même : « La conscience est nécessairement être conscient à chacune de ses phases. ». Autrement dit, la conséquence que Sartre, selon Deleuze, n’aura pas su tirer jusqu’au bout est que le champ transcendantal est en vérité inconscient. Pour ne pas dénaturer le plan d’immanence de la pensée, le champ transcendantal doit être défini comme l’inconscient de la pensée.
L’instance génétique du sens est certes synthétique (puisqu’elle est détermination de la pensée) mais cette synthèse est disjonctive. C’est à cette condition que la logique peut atteindre son vrai sens de genèse. Ce pourquoi le champ transcendantal doit être défini comme l’inconscient de la pensée : son mode de détermination et d’autoconstitution n’est pas le même que celui de l’unité immanente de la conscience. Il n’est synthétique qu’en étant aussi disjonctif. L’instance génétique n’est ni l’objet=x, ni la conscience constituante, mais l’élément paradoxal =x, le non-sens qui produit le sens en engendrant les séries divergentes. Parce qu’elle manque à sa propre identité, comme à sa propre origine, cette instance ne présuppose plus rien de ce qu’il faut engendrer. Son déplacement, dans la série signifiée comme élément surnuméraire et dans la série signifiante comme signifiant vide, rend possible entre les deux un rapport selon le non rapport mis en évidence par Lacan dans « L’instance de la lettre ».
La circulation de la case vide devient ainsi le principe mobile immanent d’auto-unification de la multiplicité des singularités impersonnelles qui peuplent le champ transcendantal de la pensée pure. Pure, c’est-à-dire affranchie des critères qualitatifs (aristotéliciens) de la pensée : non contradiction, tiers exclu, discursivité, négation, etc. une pensée non réflexive et non consciente, dont les formes d’intelligence ne sont pas celles du lien et de la médiation, mais de la coupure et de la disjonction. À l’aide des théories structuralistes, la conception deleuzienne du champ transcendantal convertit alors les questions phénoménologiques en questions épistémologiques. Elle est bien plus proche, sous cet angle, de la subversion lacanienne du Cogito cartésien, que des « philosophies de la conscience » : « là où ça pense Je ne suis pas, là où Je suis ça ne pense pas »
Toutefois, cet inconscient n’est pas pour autant « sujet de l’inconscient » justement. Certes, Deleuze reprend à son compte la substituabilité de la case vide. Revendiquant, en 69, la filiation « des auteurs que la coutume récente a nommé structuralistes », il en fait une des trois propriétés qui définissent une structure. Mais dans sa description de la « machinerie du sens », il ne prolonge qu’une partie de la théorie lacanienne de la structure et laisse de côté ce que Lacan aura ajouté de plus remarquable au paradigme structuraliste, soit précisément une nouvelle théorie du sujet. Car l’atopie de la case vide, sa capacité à venir occuper n’importe quelle place est justement chez Lacan celle du sujet du signifiant.
Si Deleuze reprend la première, sans tenir compte du second, c’est que le sujet du signifiant comme propriété de la structure quelconque (et rien d’autre) désigne aussi ce référentiel ou ce repère absolu qui vaut comme sujet de la science. Il est le mode de constitution du sujet que la coupure galiléenne a définitivement instauré en Occident, soit, précisément tout ce avec quoi l’ontologie deleuzienne cherche à rompre : par sa fonction référentielle, il rapporte l’exercice de la pensée à son paradigme scientifique.
En nommant « différenciant » cet élément mobile et atopique, qui correspond chez Lacan au détachement dans la chaîne signifiante d’un signifiant « représentant », Deleuze veut mettre en avant la distribution nomade du sens, son émission aléatoire. Il rapporte la pure chaîne signifiante et ses modes de détermination structuraux à des événements singuliers, des actes contingents qui fondent l’ordre structural du langage, et non l’inverse. Le « différenciant » met l’accent, dans l’épistémologie de la structure, sur le caractère aléatoire de la production des séries, sur la contingence de l’effet de sens, plutôt que sur la nécessité de (re)trouver une forme de synchronie, un référentiel absolu, ou encore un point de « capitonnage » entre les différents niveaux ou séries. Il subordonne l’ordre de la structure à l’effet de coupure ou de résonnance. Mais justement, ce « différenciant » dont Deleuze fait, dans Logique du sens, une propriété de la structure, ne devrait-il pas plutôt conduire à déborder le régime même de la structure et le type de détermination de la chaîne signifiante ?
C’est cette conséquence, restée inaperçue par Deleuze, que Guattari met en lumière dans « Machine et structure », le différenciant n’est pas l’effet d’une structure mais d’une machine[16]. Or c’est en faisant fond sur la théorie lacanienne du sujet (que Deleuze avait passée sous silence) que Guattari peut tirer le différenciant deleuzien du côté de la machine, et le dissocier finalement des propriétés de la structure dans laquelle Deleuze l’avait inclus. Le détachement, dans la chaine signifiante, d’un signifiant différenciant correspond à la production d’une subjectivité inconsciente ; sans elle la répétition d’une singularité ne pourrait pas être reconnue au principe, constitutif, de tel ou tel ordre structural.
Autrement dit, le déplacement de la structure à la machine, qu’on s’accorde à reconnaître comme un enclencheur de la philosophie de Deleuze-Guattari, n’a été possible qu’en définissant le « différenciant » de la structure, non seulement comme coupure, mais comme coupure subjective – ce qui veut dire : (re)partir, comme l’a fait Guattari, de la théorie lacanienne du sujet, en vue de détacher le sujet inconscient de son inclusion dans la structure (comme une de ses propriétés ou comme son propre décalage). Le sujet que Guattari fait valoir, à partir de Lacan, n’est donc pas le sujet du signifiant (le sujet inconscient n’étant rien d’autre alors qu’une propriété de la structure), mais le sujet considéré dans son rapport à l’objet a : ce réel résiduel qui fait du sujet autre chose qu’un pur signifiant et qui, chez Lacan, empêche le basculement du réel de la coupure subjective dans l’idéalité épistémologique de la structure. C’est dans un geste de reprise et de réélaboration de la théorie lacanienne du sujet que Guattari aura éloigné la logique deleuzienne du paradigme structuraliste, au profit d’un nouveau paradigme machinique.
Faut-il y voir l’indice d’une différence entre Deleuze et Guattari, qui reste indiscernable dans les livres qu’ils ont écrits ensemble ? L’élaboration d’une nouvelle conception de la subjectivité est dès le début pour Guattari une question essentielle, une tâche dont sa pratique analytique et politique lui montre l’urgence et la nécessité[17]. Deleuze, lui, jugeant les notions de sujet et de subjectivité trop inscrites dans cette histoire de la philosophie qui mène de Descartes à Hegel et dont il cherche à se dissocier, entretient plutôt à leur égard une forme d’indifférence, comme en témoigne la réponse très brève, très peu concernée en définitive, qu’il retourne à la question de Nancy « Après le sujet qui vient ? »[18].
« Nous autres, analystes, nous nous en tenons à la question de la subjectivation »[19]. Pour Lacan, la « subjectivation » définit le processus même de la cure comme l’advenue d’un sujet là où il n’était pas encore[20]. Le néologisme de « désubjectivation » dans Mille Plateaux vise cette consigne freudienne selon laquelle l’inconscient est ce dont le sujet a à prendre possession[21]. À l’inverse de cette « subjectivation » de l’inconscient selon laquelle, à travers l’analyse, le sujet gagne d’assumer de son propre chef son discours inconscient, advenant comme sujet d’un désir dont il n’était que l’objet, Wo es war, soll Ich werden, la désubjectivation deleuzo-guattrienne fait valoir une conscience minimale et élémentaire, dont la seule visée est de se fondre dans l’impersonnel. Il n’y a pas d’autre werden qu’un verdoyer impersonnel.
Alors que la subjectivation marque, selon Lacan, la « particularité » de la psychanalyse, qui n’a nullement la prétention de recouvrir le champ entier de l’expérience[22] (et donc son excentricité par rapport à ce que Lacan appelle parfois « l’(h)ontologie), l’ontologie deleuzienne porte, elle, sur l’individuation. Elle vise à rendre compte, dans l’immanence d’un seul et même plan de composition, de l’individuation de tous les êtres (elle peut désigner également une heure de la journée, une saison, une intensité de blanc, un degré de chaleur, un animal ou un être humain).
Or du point de vue de la question « ontologico-transcendantale » de l’individuation, la dualité conscience/inconscient n’est pas plus pertinente que l’affirmation husserlienne de Sartre selon laquelle « qui dit « conscience » dit toute la conscience »[23]. Ce qui aimante Deleuze, ce ne sont pas tant les formations de l’inconscient, (comme le rêve ou le mot d’esprit) que les différentes formes acéphales, les différents degrés « désubjectivés » de conscience.
Ainsi Jung lui semble-t-il plus proche de la vraie nature de l’inconscient. Il met en avant, contre la dualité des pulsions et la théorie du refoulement, les alliances entre la conscience et certaines couches de l’inconscient très différentes, d’origines, de valeurs inégales, qui suscitent des régressions différant en nature et des possibilités de progressions compensatrices. L’inconscient ne l’est plus alors qu’en un sens restreint : relativement à la pensée représentative. Il n’engage pas une division entre le sujet et la conscience, mais un élargissement de la conscience. La conscience désubjectivée est une psyché étendue, qui serait aussi bien une extension de l’âme qu’une spiritualisation de la matière, semblable à cette double détente bergsonienne, vers la matière et vers la mémoire, selon laquelle « en prenant les opposés dans leur différence extrême », comme disait Merleau Ponty, « l’intuition les voit se réunir »[24].
La conscience somnambulique
Le motif de la conscience somnambulique marque les premiers textes de Deleuze. Il fait jouer les théories très controversées de Bergson et de Jung, à propos du rapport entre l’instinct et la conscience, contre la psychanalyse freudienne et lacanienne du sujet de l’inconscient[25]. Il renvoie aussi à ces formes de vie qui fascinent Deleuze parce qu’elles sont comme fixées dans un mouvement en train de se faire. « C’est cela qui me semble intéressant dans les vies, les trous qu’elles comportent, les lacunes, parfois dramatiques, mais parfois même pas. Des catalepsies ou des espèces de somnambulismes sur plusieurs années, la plupart des vies en comportent. C’est peut-être dans ces trous que se fait le mouvement (…) Voilà deux choses intéressantes dans une vie, les amnésies et les hypermnésies. »[26]
Dans Instincts et Institutions, commandé en 1953 par Georges Canguilhem, Deleuze met en avant la théorie somnambulique de l’instinct, en particulier celle de Bergson, et reprend l’idée que c’est dans le monde des insectes que l’instinct apparaît le plus clairement. Le texte d’ouverture est celui où Cuvier décrit les animaux guidés par l’instinct comme des espèces somnambules : c’est une sorte de rêve ou de vision qui les poursuit toujours. L’instinct indique bien un type de conscience, mais qui ignore ses visées. Comme le somnambule, elle a conscience de ce qu’elle fait mais elle ignore pourquoi elle le fait.
Aussi, dit Bergson, « dans des phénomènes de sentiments, dans des sympathies et des antipathies irréfléchies, nous expérimentons en nous-mêmes, sous une forme bien plus vague, et trop pénétrée aussi d’intelligence, quelque chose de ce qui doit se passer dans la conscience d’un insecte agissant par instinct. »[27]. L’intuition est semblable à un instinct qui serait devenu désintéressé et qui nous conduirait à l’intérieur même de la vie, un instinct, écrit Bergson, « capable de réfléchir sur son objet et de l’élargir indéfiniment »[28]. La conscience somnambulique est une conscience dilatée.
L’Instinct discerne une situation du dedans et révèle une perspective de la nature vue de l’intérieur, une sorte de mémoire organique qui la traverserait toute entière, depuis les propriétés vitales des cellules jusqu’aux formes les plus achevées de l’instinct comme celui des guêpes. Le comportement instinctif se replace à l’intérieur de son objet, manifestant l’existence d’une autre faculté cognitive à côté de l’intelligence. Il fait apparaître le monde d’un sensible pur, soustrait à ses conditions humaines, où nous ne reconnaissons plus aucune des lois connues de la nature, et qui est comme une vision somnambulique du dedans de notre monde.
D’où l’affinité, dans la philosophie deleuzienne, entre ces formes éhtologiques voire physiologiques de conscience élémentaire et le transcendantalisme, entre la conscience pure et ces subjectivités larvaires, ces mois dissous dans l’immanence du monde des choses, qui sont « à la fois rêve et science, objet du rêve et objet de la science »[29]. La vie y est saisie de l’intérieur, de la même manière que l’être perçu est décrit dans Matière et Mémoire comme si ma vision des choses se faisait en elles plutôt qu’en moi.
La vie, écrit Merleau-Ponty, « ressemble moins à un esprit d’homme qu’à cette vision imminente ou éminente que Bergson entrevoyait dans les choses. »[30]. Le rôle que le dernier Merleau-Ponty accorde alors à Bergson (dans son texte de Signes et dans certaines de ses « Notes de Travail »), qui s’inscrit dans sa critique de l’idéalisme transcendantal husserlien, nous conduit ainsi au cœur du programme deleuzien de « l’empirisme transcendantal »[31]. C’est ce dont témoigne en particulier une des notes de Merleau-Ponty sur Sartre, en novembre 59 : « Il faut un rapport à l’être qui se fasse de l’intérieur de l’Etre – C’est au fond ce que Sartre cherchait. Mais comme, pour lui, il n’y a d’intérieur que moi, et tout autre est extériorité, l’Etre reste chez lui inentamé par cette décompression qui se fait en lui, il reste positivité pure, objet, et le Pour Soi n’y participe que par une sorte de folie. »[32].
La conscience pure, i.e dissociée de tout sujet qui serait distinct de la perception, s’égale au monde dont elle est un point de vue constituant. Du fait de cette transposition dans les choses, du champ d’immanence de la conscience pure, rendue possible par sa séparation d’avec l’ego prétendument constituant mais en réalité constitué, la description de l’être peut être incluse dans cet être même, dans sa genèse et dans son concept. C’est à cette condition que le champ transcendantal, entièrement désubjectivé, peut devenir celui d’un empirisme radical. La description de « l’être brut du monde perçu » (comme dit Merleau-Ponty à propos de Bergson[33]) s’opère chez Deleuze comme la restitution d’un sens pré-humain de l’être, en deçà de sa réduction à l’étant comme de sa réduction à quelque aspect de la constitution du sujet, dans l’auto-affection d’une différence intensive qui précèderait l’individuation de la perception.
La contre-effectuation deleuzienne de la Révolution critique adopte un mouvement inverse à celui de la subjectivation moderne ou kantienne de l’expérience (parce que nous sommes toujours intérieurs au langage et à la conscience, l’être extérieur ne peut être que relatif à nous-mêmes). L’immanence qui n’est plus immanence à mais immanence de soi, est « un dehors plus lointain que tout monde extérieur, parce qu’il est un dedans plus profond que tout monde intérieur »[34]. Le « transcendantal » ne désigne plus les conditions de la connaissance, mais l’élément génétique interne à la constitution de tous les étants. Il est l’intérieur de l’être : le même être, mais vu de l’intérieur, soit, précisément, tout ce à quoi le transcendantal kantien barre l’accès. Car les conditions de l’objectivité marquent aussi bien l’impossibilité qui est la nôtre d’accéder à l’intérieur des choses, à la profondeur de l’être. Nous sommes certes toujours déjà plongés dans l’extériorité (la « conscience de »), comme Sartre le rappelle la conscience n’a pas de dedans, elle n’est rien que le dehors d’elle-même (et le refus d’être substance[35]). Mais cette extériorité n’est que le dehors en tant qu’il est relatif à nous, c’est-à-dire le dehors vu de l’extérieur. Le transcendantal deleuzien, correspond, lui, au dehors tel qu’il serait vu de l’intérieur : l’intérieur du dehors.
Autrement dit, la conscience « pure » n’est pas du côté du sujet, mais du côté de l’objet. Comme s’il fallait, pour restituer les conditions de l’expérience réelle que l’intuition pure, après qu’elle a été distinguée par la philosophie transcendantale de l’intuition seulement empirique, tombe ou saute elle-même au dehors : qu’elle revienne, d’une certaine manière, mais sans cesser d’être a priori, dans les choses. Cela, effectivement, comme dit Kant à propos des anticipations de la perception, a toujours en soi quelque chose de choquant « pour un investigateur habitué à la réflexion transcendantale et devenu par là circonspect. »[36].
Le point de vue de la chose
Dans la seconde édition de la Critique de la Raison pure, Kant, conduit par son explication avec la matière de la sensation à la pointe du criticisme, affirmait que la grandeur intensive porte d’abord sur le réel et ensuite sur la sensation (« dans tous les phénomènes le réel, qui est un objet de la sensation a une grandeur intensive »)[37]. Les degrés ne sont plus la condition subjective de la sensation, (comme c’était le cas dans la première édition). L’intensité n’est plus un mode d’appréhension qui s’applique à un donné de l’extérieur (l’intensité de la sensation nous conduit à attribuer un degré de réel à l’objet qui lui correspond). Elle est l’engendrement simultané du réel et de la sensation. La grandeur intensive est devenue une instance appartenant au réel et non plus au sujet ; elle engendre en même temps et la sensation et l’objet de la sensation.
Kant, on le sait, rapporte finalement au savoir a priori du degré et donc à l’horizon du (sujet) transcendantal, ce qui se présentait dans la sensation comme l’autre irrécupérable du concept : l’intensité, la propriété qu’ont toutes les sensations d’avoir un degré, peut être connue a priori. Toute affection empirique est susceptible de se vider de son contenu jusqu’au point où seule reste la conscience pure d’un divers quelconque dans l’espace et dans le temps (le degré 0 de la sensation). Pour que la pensée puisse appréhender a priori la sensibilité, Kant transforme la conscience pure en une conscience purement formelle.
Si dans le Réel, et non plus le possible, on ne peut pas rejoindre, comme le présuppose Kant, la conscience empirique (le contenu de la sensation) à partir de la conscience pure, on peut tout de même saisir l’intensité en elle-même (indépendamment de l’étendue et de la qualité dans lesquelles elle se développe et s’efface en tant que telle) : quand la conscience percevante rejoint l’Intensité = 0. La conscience « pure » n’est plus alors une conscience purement formelle, ou seulement pensée, c’est une émotion primaire et matérielle, un « Je sens » disent Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe, qui précède le Je pense. Ce Je sens qui fait « la part profondément schizoïde » des anticipations kantiennes de la perception [38] est plus proche d’une conscience totalement désubjectivée que d’un cogito sensible. Le sentiment (« la relation de la représentation au sujet » comme disait Kant[39]) bascule dans le pressentiment, et la perception (dont l’origine intensive et discontinue, qui apparaît d’abord à la pensée comme un dehors inexplicable, pouvait finalement, selon Kant, être appréhendée a priori) dans l’hallucination, « L’hallucination pertinente du Dedans comme pur dehors »[40].
En un sens, la conscience est dissoute dans l’immanence. En un autre sens, ce sont les choses elles-mêmes qui prennent, du même coup, le caractère de ce que Kant considérait, dans la troisième Critique (à travers le libre jeu des facultés dans le sentiment du beau), comme le mode de manifestation privilégié de la subjectivité : l’écart essentiel qu’elle constitue par rapport à la règle d’une relation entre eux qui serait entièrement et seulement déterminée par le concept. Dans l’ontologie deleuzienne, cet écart est un « bougé », une oscillation objective dans les choses. Elles caractérisent le processus qui comprend en lui la puissance avec laquelle il agit. Elles sont inhérentes à la constitution dynamique de l’expérience.
Aussi faut-il dire pour l’espace la même chose que pour le temps : ce n’est pas lui qui nous est intérieur, c’est nous qui sommes intérieurs à lui, non pas au sens où nous serions « contenus » en lui, mais au sens de ce « glissement », de ce « flottement » qui constitue l’espace illimité, comme « un vertige, une oscillation » constitue le temps[41]. La conscience « cesse d’être une lumière sur les objets, pour devenir une pure phosphorescence des choses en soi. »[42]. Ces choses en soi appartiennent maintenant au régime de la constante variation où se forment « mille figures capricieuses élémentaires »[43].
C’est ce dont témoigne, dans Différence et Répétition, le motif énigmatique du point de vue de la chose. Pas plus que « l’intériorité » de l’instance génétique à la condition transcendantale n’est celle réflexive de la conscience, postulant l’identité du moi, le point de vue n’est celui du sujet « sur » les choses (la variabilité des perceptions subjectives) : il appartient à la chose elle-même. C’est elle qui désormais, comme le montre les « phénomènes à perspectives interne », ne cesse de varier dans un devenir identique au point de vue. Ses métamorphoses, ses transformations se substituent au vis à vis de l’objet, au « point de vue sur ». Contrairement à la multiplication des représentations (qui peuvent toujours finir par converger sur un même objet) ou à celle des points de vue (qui rapporte en définitive les différents moments aux propriétés d’un même moi), ce décentrement conduit, lui, à un immédiat « sub-représentatif » qui engendre simultanément, à partir d’un déséquilibre premier, l’en soi du représenté et le pour soi du représentant : « C’est déjà chaque représentation composante qui doit être déformée, déviée, arrachée à son centre. Il faut que chaque point de vue soit lui-même la chose ou que la chose appartienne au point de vue. »[44]
C’est dans Le Pli que Deleuze, lecteur de Leibniz, définira l’intériorité (non réflexive, i.e non cartésienne et non intentionnelle, i.e non husserlienne) comme ce qui advient dans l’occupation d’un point de vue[45]. « L’intériorité absolue qui s’égale au monde dont elle est un point de vue », comme l’écrivait Alain Badiou dans son compte rendu du Pli (p.29)[46]. Mais dans Différence et Répétition, déjà, ce que le perspectivisme nous montre est que le point de vue n’a pas à être défini comme une variation selon le sujet. Il n’est pas ce qui rend subjectif quelque chose en le constituant ou en lui donnant du sens dans sa relation à nous. C’est l’inverse. Le point de vue, dans l’occupation duquel un sujet advient, est celui de la chose elle-même, « L’observateur fait partie du simulacre lui-même qui se transforme et se déforme avec son point de vue. ».[47]
D’une certaine manière, Deleuze croise alors la question lacanienne de la subjectivation. Non pas comme aliénation primordiale au langage, assujettissement à la loi symbolique, mais comme dépendance au regard : l’objet a privilégié en ce qu’il vient déterminer, dans le visible, la division du sujet comme dissolution, évanouissement dans la chose. Car le motif du point de vue de la chose n’est pas seulement énigmatique, il est aussi fantasmatique : les choses me regardent avant que je les vois. Dans Logique du Sens et Différence et Répétition, Deleuze reconnaît au fantasme un rôle essentiel. Avec l’hallucination, il est une modalité privilégiée de la conscience désubjectivée : il précède la pensée rationnelle et l’organisation des significations (y compris sous la forme phénoménologique et totalisée des vécus), il en est l’origine. Autrement-dit, les conditions de l’expérience réelle ne sont pas rationnelles comme le sont celles de l’expérience possible, elles sont fantasmatiques.
Car la structure du fantasme est précisément celle qui fait passer le sujet dans l’objet : le sujet se fait objet[48]. Si Freud a pu rassembler le rêve, le fantasme, et l’hallucination, sans pouvoir vraiment différencier ces trois formations psychiques, sous le nom de « psychoses hallucinatoires de désir », c’est parce qu’elles sont toutes les trois, selon Lacan des formations de l’objet a : des formations dans lesquelles le sujet devient l’objet, devient lui-même une passion de l’objet.
L’individuation deleuzienne partage avec la subjectivation lacanienne une même dynamique dissolutive : ce processus par lequel on se fait en se défaisant, on se produit en se dissolvant. Ainsi la « subjectivation acéphale » de la pulsion montre-t-elle une forme minimale d’intentionnalité, et une forme élémentaire de réflexivité, qui viennent non pas après le sujet, mais avant lui, et selon lesquelles, tout en disparaissant dans la chose, on se fait (quelque chose) – comme, dans la « désubjectivation » de Deleuze et Guattari, on « se fait » un Corps sans Organes. L’individuation deleuzienne, elle aussi, s’effectue dans un mouvement de choir, de tomber hors de soi ; elle indique une même échéance que cet effet de chute, ce reste de l’avènement subjectif que Lacan décrit comme ce que le sujet devient sous la forme de l’objet petit a, à l’image du masochiste qui s’acharne à installer les conditions de sa propre échéance larvaire, de sa propre « objectivation ».
Il n’en reste pas moins que l’échéance deleuzienne, « cette détermination par cascade (…) ce suspens qui marque chaque moment de la différence, cette immobilisation qui marque chaque moment de la chute »[49] n’est pas celle par laquelle un sujet advient en tombant hors de lui-même. C’est l’échéance biologique de la différence intensive, celle des ralentissements et des précipitations qui marquent les durées de gestation de la différenciation temporelle des espèces. Elle est plus proche de ces formes embryonnaires transitoires dans lesquelles Deleuze reconnaît les drames de l’actualisation de l’Idée dans l’espace et dans le temps, et qui présentent les sujet dissous, les consciences impersonnelles et désubjectivées comme des formes virtuelles animant chaque entité émergente, en cours de différenciation. L’inconscient deleuzien est celui d’une Pensée Nature. Il tient plus d’une conscience cosmique que de l’inconscient freudien. C’est une conscience sans l’Homme ou, plus exactement, c’est l’Homme qui est dans la conscience, et non l’inverse.
Le cerveau-monde
Il peut sembler, alors, qu’à la formule de Mille Plateaux réponde, dans un étrange et puissant écho, l’ultime motif de la philosophie de Deleuze et Guattari : la définition de l’Etre-Pensée comme identité du monde et du cerveau. Dans la conclusion de Qu’est-ce que la philosophie ?, le cerveau, mais un cerveau inobjectivable, vient nouer ensemble les trois modes cérébraux, non spécifiquement humains, de la création (la forme, la force et la fonction). Le cerveau est l’âme qui s’étend au monde ou le monde qui se contracte en une multiplicité d’âmes : la passion désubjectivée comme force de la sensation. Il renvoie à un dehors et dedans topologiquement en contact[50]. Le cerveau est aussi l’esprit qui s’arrache aux règles associatives de la contiguïté, de la ressemblance et de la causalité : la conscience désubjectivée qui plonge dans des rapports aléatoires et des coupures irrationnelles[51]
Prolongeant, en philosophe, les nouvelles orientations de la connaissance scientifique du cerveau, Deleuze déplace son image classique (une organisation verticale de l’intégration-différenciation et une organisation horizontale de l’association) vers deux autres aspects qui rompent, au contraire, avec le modèle du tout comme intériorité de la pensée et avec le privilège de l’association. C’est à condition de mener les associations de l’esprit jusqu’à la coupure irrationnelle, et les intégrations/différenciations de l’âme jusqu’à l’éversion du dehors et du dedans, que le cerveau, « automate logique», peut devenir un « automate spirituel »[52].
Dans la conclusion de Qu’est-ce que la philosophie?, les trois modes de la création s’avèrent être trois modes de subjectivation du cerveau. Pour que ce soit le cerveau qui pense, et non pas l’homme, il faut que le cerveau dise Je. Ainsi, et ce n’est pas le moindre paradoxe de la philosophie deleuzienne, l’Etre-Pensée est finalement rapporté, dans le concept de cerveau sujet, à une instance subjective. « La philosophie, l’art, la science ne sont pas les objets mentaux d’un cerveau objectivé, mais les trois aspects sous lesquels le cerveau devient sujet. »[53].
Pour « se » donner un cerveau, comme disait Deleuze dans L’Image-Temps, il faut maintenant, dans Qu’est-ce que la philosophie?, que le cerveau lui-même devienne sujet. La « subjectivation » du cerveau serait le vrai tournant, non seulement par rapport à son objectivation comme une fonction déterminée, mais aussi par rapport à la phénoménologie qui ne rompt avec cette objectivation scientifique qu’en réduisant le cerveau à une fonction prélevée sur les rapports premiers de l’homme et du monde, sur la coappartenance des sensations de l’un et des excitations de l’autre. « C’est le cerveau qui pense et non l’homme, l’homme étant seulement une cristallisation cérébrale. On parlera du cerveau comme Cézanne du paysage : l’homme absent mais tout entier dans le cerveau. ». En quel sens alors le cerveau-monde doit-il être dit « sujet » ?
Les trois concepts d’« injet », de « superjet » et d’ « ejet » (nommant les trois modes de subjectivation du cerveau : Je sens, Je conçois, Je connais) font tomber le préfixe « sub », désignant la logique de la présupposition, inhérente à la notion ontologico-transcendantale du sujet (l’hupokeimenon), et la détermination d’un sens premier de l’être qui permet d’en maîtriser l’équivocité, la pluralité discursive. Conservant le « jet », ce mouvement de jeter, non pas dessous (comme le substrat qui permane sous les changements, l’identité à soi qui demeurent sous les variations) mais « dans » et « par-dessus » (l’injet et le superjet), ils mettent littéralement le sujet sens dessus dessous. Ce n’est pas la subjectivité qui est rapportée au cerveau (selon l’orientation d’un matérialisme réductionniste ou physicaliste) mais le cerveau, écarté de la subjectivité humaine, qui devient lui-même un sujet inobjectivable, de trois manières.
Le cerveau-monde est sujet parce qu’il est contraction des vibrations du monde (« la vibration contractée, devenue qualité, variété »). S’il est nommé âme ou force, ce n’est pas en tant qu’action, mais « passion pure », « mystère de la création passive, sensation. ». Dans le cerveau âme, le « il y a » naturel et sa puissance indéterminée de venue à l’être s’identifient à une faculté de sentir couvrant le champ entier de l’espèce, coexistant avec les tissus embryonnaires, et sans laquelle, selon Deleuze, la causalité resterait inintelligible, « comme si les fleurs se sentaient elles-mêmes en sentant ce qui les compose ». L’injet est le sujet projeté dans les choses, l’âme étendue dans la sensation du monde, à l’état naissant, in statu nascendi. Il n’est pas le sujet de la sensation, mais le sentir lui-même comme sujet.
En même temps que l’extension de l’âme est pensée comme spatium intensif (et donc genèse réelle de l’espace comme étendue géométrique), l’intentionnalité de l’esprit est pensée comme consistance, coprésence de la forme à toutes ses composantes intensives à la fois. En un second sens donc (selon les deux faces de la création, Nature et Pensée, Phùsis et Noũs), le cerveau est sujet parce qu’il est une forme « absolue », un auto déploiement immanent qui n’obéit pas à la règle de l’association i.e à des rapports d’extériorité entre les idées : « une forme en soi qui ne renvoie à aucun point de vue extérieur, pas plus que la rétine ou l’aire striée du cortex ne renvoie à une autre, une forme consistante absolue qui se survole indépendamment de toute dimension supplémentaire, qui ne fait donc appel à aucune transcendance, qui n’a qu’un seul côté quel que soit le nombre de ses dimensions, qui reste co-présente à toute ses déterminations sans proximité ou éloignement »[54].
L’esprit n’est pas le support des associations, ni même leur unité immanente, il est transport de la pensée. Le plan étant saisi en lui-même (i.e indépendamment du but ou du programme), le mode de présence immédiate de l’ensemble à chacun de ses éléments, individués et reliés, ne dépend plus de la formation réglée d’un sujet, ni d’un principe d’organisation, il s’effectue comme survol du champ tout entier. En ce sens, le sujet n’est plus « injet » mais « superjet ».
« Scopulosque superjacit unda spumeus », ainsi Virgile décrivait (Enéide, XI, 625) le chapeau d’écume qui coiffe la vague lorsqu’elle double l’écueil, jetant par-dessus les rochers son onde écumante, se retirant rapidement puis recouvrant de nouveau, bouillonnante, les pierres qu’elle a roulées. Quand la vague jaillit et se jette pardessus les rochers, quand la mer écumante couvre la pierre de ses flots agités, le rocher fait corps avec cette masse liquide. « Le plan d’immanence est la vague unique qui les enroule et les déroule »[55].
Si Deleuze peut reprendre le concept de Whitehead, le « sujet-superject », c’est que celui-ci réalisait dans Procès et Réalité une double opération. Il relativise le sens classique du sujet, en faisant valoir une autre racine du terme qui indique le mouvement inverse de ce qui est posé dessous : le super-jacio, le « jeter par-dessus », le « lancer vers ». Mais il ne réduit pas le rôle du subjectum sans, simultanément, étendre le sujet au-delà de l’ordre de la subjectivité (de sa clôture et de son autonomie supposées), à l’ensemble des entités actuelles saisies dans leur émergence. « Une entité actuelle est à la fois le sujet qui fait l’expérience et le superject de ses expériences. Elle est sujet-superject. »[56]
Deleuze détourne aussi, non sans humour, le concept de superject. Chez Whitehead il vient définir le sujet du processus d’individuation comme tendance, visée. Le sujet est engagé dans l’individuation comme une forme virtuelle d’existence. Une entité qui émerge tend à une plénitude qui ne la définit pas actuellement. Tous les processus (même les plus microscopiques) de l’individuation mettent en œuvre des tensions d’existence entre sujet et superject, actualité et tendance, efficience et visée, et c’est en ce sens qu’ils mobilisent nécessairement des sujets immanents. Le superject est cette « visée » qui anime l’entité émergente, son « principe d’inquiétude » dit aussi Whitehead[57]. Chez Deleuze et Guattari, la coprésence de la forme à ses composantes intensives ne consiste pas dans une tendance, un but subjectif immanent (le « self enjoyment »), mais dans sa vitesse. Le superject est plutôt un « superjet ». Alors que Whitehead soulignait, à propos du « sujet-superject », qu’« aucun de ces deux termes ne devait un seul instant être perdu de vue. »[58], le superjet deleuzo-guattarien n’en retient, lui, qu’un des deux.
Le superjet n’est rien d’autre que ce « revenir sur soi » qui accompagne nécessairement tous les mouvements du plan d’immanence : comme le flux et le reflux de la vague, son bruit continu mais renflé par intervalles. Cet aller-retour caractérise une vitesse sans limite ou infinie, qui n’est plus la succession du mouvement d’un point à un autre, d’une composante extensive à une autre, comme c’est le cas des vitesses seulement relative. Elle ne s’étend pas sans revenir simultanément sur elle-même. Dans son cas, l’aiguille est aussi le pôle. Alors, le superjet ressemble à ce « sujet solaire et déshumanisé » (qu’évoque Deleuze à propos du Robinson de Tournier), qui fait filer des lignes de fuite par où s’échappe la Terre entière : il est « moyen de transport ».
Ainsi chez Kleist, tout devient vitesse et lenteur « succession de catatonies, et de vitesse extrêmes, d’évanouissements et de flèches. Dormir sur son cheval et aller au galop. Sauter d’un agencement à un autre, à la faveur d’un évanouissement, en franchissant un vide. »[59]. Cette vitesse infinie qui caractérise le plan d’immanence, qui est la seule mesure possible de sa consistance, est aussi ce qui fait sa démesure et sa « fragilité », ou plutôt son risque permanent : le basculement dans le chaos sur lequel il est installé. « Un crâne explose, obsession de Kleist. »[60]. Car le chaos est ce qui défait toute consistance dans les vitesses infinies. Il est ce « faisceau embrouillé de lignes aberrantes »[61] qui rend impossible tout rapport entre deux déterminations, parce que les différences sont devenues indiscernables. « L’une apparaît comme évanouissante quand l’autre disparaît comme ébauche. »[62]. L’épreuve de la proximité du chaos est peut-être le sens du « subjectif » qui traverse, comme son propre pathos, toute la philosophie deleuzienne : l’épreuve de la proximité du chaos.
Ainsi dans Mille Plateaux, le territoire qui définit un « chez soi » se constitue dans la relation au chaos. C’est la fonction de la « ritournelle » dont le thème vient rythmer la constitution d’un premier territoire qui nous protège contre le chaos, jusqu’à sa rencontre avec les forces cosmiques du dehors qui le déterritorialisent.
Ce qui importe, dans la proximité du chaos, n’est pas tant sa présence destructrice ou dissolutive en elle-même, que les opérations créatrices qui témoignent de sa persistance. La manière dont le chaos chaotise infléchit la manière dont la pensée détermine l’indéterminé. Parce que les processus d’individuation n’actualisent pas sans risque d’être disloqués ou submergés, ils sont toujours des opérations de bifurcations. L’idée selon laquelle l’essentiel est de comprendre les bifurcations, les intermédiaires, les vides, est précisément ce qui dissocie le « Je connais » du cerveau de sa propre définition objectiviste comme objet ou fonction déterminée.
Aussi est-ce encore en un troisième et dernier sens que le cerveau doit être dit sujet : parce qu’il fonctionne par hiatus, intervalle, coupure. C’est précisément ce qui le rend, comme âme, inobjectivable, et c’est aussi le mode de déploiement de cette forme en soi, par laquelle il est esprit : ce qui échappe au pouvoir de définition objectif (le subjectif au sens kantien de la troisième Critique), là où selon le programme de l’empirisme transcendantal, les conditions d’une véritable critique et celles d’une véritable création deviennent les mêmes.
Est-ce ce que Deleuze veut dire quand il affirme, dans L’Image-Temps, que notre rapport vécu au cerveau a changé, non pas sous l’influence de la science, mais à l’inverse guidant obscurément la science vers ces nouvelles orientations de la connaissance du cerveau qui produisent, à la limite, un effet de rupture avec le modèle cérébral classique ? « Le cerveau devient notre problème ou notre maladie, notre passion, plutôt que notre maîtrise, notre solution ou décision. »[63]. C’est en tout cas ce qui l’amène à reconnaître, dans ce qu’il considère comme le cinéma du cerveau (chez Resnais notamment), non seulement cette structure topologique du dehors et du dedans (la subjectivation du cerveau comme âme) ainsi que les coupures qui se subordonnent toute association (la subjectivation du cerveau comme esprit), mais aussi, chez Téchiné et Benoist Jacquot, une « inspiration néo-psychanalytique » : « donnez-moi un lapsus, un acte manqué, et je reconstruirai le cerveau. »[64].
Le cerveau-sujet n’est pas sujet au sens de l’inconscient de la psychanalyse. Mais cette conscience cosmique, elle aussi, fonctionne par trébuchements, déraillements et bifurcations. Elle ne marche qu’en se détraquant : « les ratés font partie intégrante du plan ». Cette « super » conscience est toujours, en vérité, un entre deux consciences ; sa puissante intuition ne surgit que dans les clignotements de l’attention. Pour elle, comme pour le sujet de l’inconscient, les coupures importent plus que les associations. Parce que c’est dans les vides, les lacunes et les trous que comportent toutes les vies que se fait leur mouvement.
Bibliographie sélective
Alliez E., De l’Impossibilité de la phénoménologie, Paris, Vrin, 1995
Badiou A., L’aventure de la philosophie française depuis les années 60, La fabrique, 2012
Bergson H., L’Evolution Créatrice, in Œuvres, Edition du centenaire, Puf, 1959
Deleuze G. :
– Logique du sens, Paris, Minuit, 1969
– L’Image-Temps, Paris, Minuit, 1985
Deleuze et Guattari :
– Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980
– Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1991
Guattari F., « Machine et Structure », 1969, in Psychanalyse et Transversalité, Paris, Maspero, Paris, 1972/La Découverte, 2003
Husserl E., Idées directrices pour une phénoménologie, trad. P. Ricoeur, Paris, Gallimard, 1989
Kant E. :
– Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, Puf, 1944 (« Quadrige », 1993)
– Critique de la faculté de juger, éd. F. Alquié, Paris, Gallimard, 1985 (« folio essais », 1996)
Kerslake C., Deleuze and the Unconscious, Londres, Continuum, 2007
Lacan J. :
– Le Séminaire, X, « L’Angoisse », Paris, Seuil, 2004
– Le Séminaire, XI, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », Paris, Seuil, 1973/1990
Merleau-Ponty, M. :
– « Bergson se faisant », in Signes, Paris, Gallimard, 1960 (« folio essais », 2001)
– « Notes de travail », in Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964 (« Tel », 1997)
Sartre, J-P., La transcendance de l’Ego, 1936, Paris, Vrin 1996
Virgile, Enéide, Livre XI, Paris, Les Belles Lettres, 1960
Whitehead, A. N., Procès et Réalité, trad. Charles, Elie, Fuchs, Gautero, Janicaud, Sasso, Villani, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1995
[1] Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p.168
[2] Alain Badiou, L’aventure de la philosophie française depuis les années 60, La fabrique, 2012, pp.18-19
[3] L’Imagination, 1936, Paris, Puf, « Quadrige », p.128
[4] La transcendance de l’Ego, 1936, Paris, Vrin 1996, p.20
[5] Idées directrices pour une phénoménologie §124, trad. P. Ricoeur, Paris, Gallimard, « Tel », 1989
[6] Logique du sens (désormais abrégé LS), Paris, Minuit, 1969, p.34
[7] « La purification transcendantale ne peut signifier l’exclusion de toutes les transcendances sinon il resterait bien une conscience pure mais non plus la possibilité d’une science de la conscience pure. » Ideen I § 59, Ibid.
[8] Ibid. §57
[9] La transcendance de l’Ego, op.cit., p.55
[10] LS, p.118
[11] LS, p.120
[12] Qu’est-ce que la philosophie ? (désormais abrégé QP), Paris, Minuit, 1991, p.49
[13] Ibid., p.19
[14] Ibid., pp. 75 et 87
[15] LS, p.120
[16] « Machine et Structure », 1969, in Psychanalyse et Transversalité, Maspero, Paris, 1972/La Découverte, Paris, 2003, p.240
[17] Depuis ses premiers textes sur la subjectivité de groupe jusqu’à, dans Chaosmose, l’appel à un « décentrement de la question du sujet vers celle de la subjectivité », mettant en avant la « dimension de créativité processuelle » de cette dernière (Paris, Galilée, 1992, p.40).
[18] Cahiers Confrontation n°20, 1989, « Réponse à une question sur le sujet », in Deux Régimes de Fous, Minuit, 2003, p.326
[19] Le Séminaire, X, « L’Angoisse », Seuil, 2004, p.348
[20] Soit qu’il ait à assumer le mandat symbolique auquel il est assujetti (dans les années 50), soit, plus tard (dans Le Séminaire XI), qu’il ait à subjectiver le choix forcé par lequel il a lui-même opté, mais sans que ce lui-même soit encore un sujet, pour son aliénation symbolique.
[21] Le Séminaire, XI, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », Seuil, 1973/1990, p.85
[22] Ibid.
[23] La transcendance de l’Ego, op.cit., p. 23
[24] « Bergson se faisant », in Signes, Gallimard, 1960, « folio essais », 2001, p.301
[25] Sur le rapport entre Deleuze et Jung, cf. Christian Kerslake, Deleuze and the Unconscious, Continuum, Londres, 2007.
[26] « Sur la philosophie », entretien avec Raymond Bellour et François Ewald, Magazine littéraire, n°257, septembre 1988, in Pourparlers, Minuit, 1990, p.189
[27] L’Evolution Créatrice, in Œuvres, Edition du centenaire, Puf, 1959, p. 644
[28] Ibid., p. 645
[29] Différence et Répétition, Paris, Puf, 1968, p.283
[30] Signes, op.cit., p.304
[31] Ainsi Eric Alliez note-il que « là où le dernier Merleau-Ponty s’arrête, interrompu par la mort, Deleuze d’une certaine façon re-commence : en dialogue avec Bergson », De l’Impossibilité de la phénoménologie, Vrin, 1995, p.74
[32] « Notes de travail », in Le visible et l’invisible, Gallimard, 1964, « Tel », 1997, p.268
[33] Signes, op.cit., p.301
[34] Ibid., p.73
[35] Cf. Ideen I, §31 et 32
[36] Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, Puf, 1944/Quadrige 1993, p.173
[37] Ibid., p.167
[38] L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, p.26
[39] Critique de la faculté de juger, §9, éd. F. Alquié, Paris, Gallimard, 1985/1996 (folio essais), p.150
[40] Alain Badiou, « Gilles Deleuze. Sur le Pli. Leibniz et le baroque », in Les aventures de la philosophie française, op.cit., p.29
[41] Gilles Deleuze, « Sur quatre formules qui pourraient résumer la philosophie kantienne » in Critique et Clinique, Minuit, 1993, p.45
[42] LS, p.362
[43] LS, p.363
[44] Différence et Répétition, op.cit., p.78-79
[45] A travers le lien de l’âme et du corps, Leibniz a pensé une intériorité absolue dont le monde est la réversion, et qui fait du dehors la membrane du dedans, cf. Le Pli, Minuit, Paris, 1988, p.27
[46] In Les aventures de la philosophie française, op.cit., p.29
[47] LS, p.298
[48] La séparation de l’objet est simultanément une identification du sujet à l’objet : l’enfant non seulement perd le sein mais le devient, le voyeur non seulement regarde, mais se fait regard etc.
[49] LS, p.326.
[50] Comme l’a montré Simondon, la structure topologique du cerveau, manifestant un dedans et un dehors absolus, ne peut pas être représentée adéquatement de façon euclidienne, elle est la coprésence d’un dedans plus profond que tout milieu intérieur et d’un dehors plus lointain que tout milieu extérieur.
[51] Cf. le problème des synapses, qui introduit les mécanismes aléatoires dans la transmission d’un neurone à l’autre.
[52] Sans doute Deleuze a t-il pu trouver une sorte de confirmation, dans l’évolution de la connaissance scientifique sur le cerveau, de ce qu’il faisait valoir, de son côté, comme les propriétés d’une autre « image de la pensée ». Il y a eu en tout cas une « rencontre » entre les aspects topologiques et aléatoires, progressivement mis en évidence par l’étude scientifique du cerveau comme un système a-centré, et ceux de l’image deleuzienne de la pensée. Ainsi les transformations de l’image cérébrale permettent à Deleuze de reconnaître une nouvelle « image de la pensée » dans l’image cinématographique moderne survenue selon lui dans la rupture du lien sensori-moteur. Cf. L’Image-Temps, Paris, Minuit, 1985, pp.265 à 281
[53] QP, p.198
[54] QP, p.198
[55] QP, p.38
[56] Procès et Réalité, Gallimard, 1995, p.83
[57] Cf. Didier Debaise, Un empirisme spéculatif. Lecture de Procès et Réalité, Paris, Vrin, 2006
[58] Procès et Réalité, op.cit., p.83
[59] Mille Plateaux, op.cit., p.328
[60] Ibid.
[61] Ibid., p.383
[62] QP, p.44
[63] L’Image-Temps, op.cit., p.275
[64] Ibid., p.276













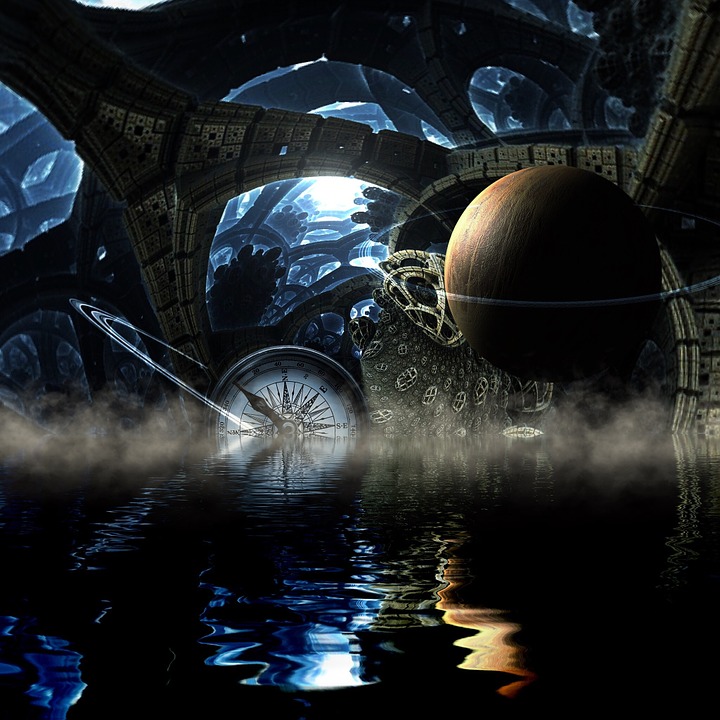

La conscience est une activité cérébrale, elle ne peut pas être plus pure que la bipédie ou la perception des couleurs, sauf à considérer les maladies. Elle nous permet comme pour les mammifères d’avoir conscience de nos mouvements, mais contrairement à eux d’avoir aussi conscience de nos pensées, de ce que nous pouvons exprimer par le langage. Les questions posées ne concernent pas la conscience mais la provenance de ces pensées, donc la connaissance individuelle. D’où proviennent nos pensées ? Lorsque je réponds cinq à la question deux plus trois, est-ce que je l’ai appris ou est-ce que cela provient de moi ? De même, lorsque je dis que tuer son prochain est mal, ou que vous écrivez cet article, est-ce que ce sont des connaissances acquises qui nous permettent de produire ces pensées ou est-ce que cela provient de nous ? Est-ce qu’il existe une connaissance « pure » qui serait d’essence divine, que nous n’aurions pas besoin d’apprendre ? Dit autrement, est-ce que nous sommes des êtres divins dotés d’une âme divine qui nous permet de distinguer sans l’apprendre, le bien et le mal ? La question est tranchée depuis longtemps par les biologistes mais pas par l’église catholique.
Lorsque nous apprenons quelque chose, une connaissance, nous ne lui associons pas toujours de pensées, je peux ne pas me souvenir d’avoir appris à compter, ni d’avoir appris à marcher. Pourtant, je sais le faire ! J’ai cette connaissance, mais je n’ai conscience que du résultat, je sais marcher et compter. C’est simplement parce que je n’ai pas associé de pensées à ces connaissances. Les pensées nous permettent de décrire nos connaissances, mais nous avons des connaissances « que nous ne connaissons pas » (dont nous n’avons pas conscience), car nous ne savons pas comment nous les avons apprises, pas parce qu’elles proviendraient d’un moi qui les contiendrait et pourrait me les fournir en l’interrogeant (réflexivement). L’inconscient n’est qu’un mot pour parler de ces connaissances qui ne sont pas conscientes au sens humain, dans le sens où nous ne leur avons pas associé de pensées.
Ce débat n’est donc pas philosophique mais théologique.