La leçon de Socrate – définition de l’homme
La leçon de Socrate (définition de l’homme), Jean-Pierre Emmanuel Jouard, Paris, Édition L’Harmattan, Collection Ouverture philosophique, 2009.
Il convient pour commencer de lever une ambiguïté relative au titre de l’ouvrage. Il ne s’agit pas ici de consacrer une étude de type universitaire à Socrate à 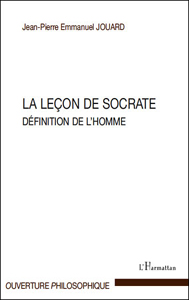 travers l’exégèse de dialogues platoniciens par exemple. Le Socrate dont il est question est le même que celui du syllogisme aristotélicien, un homme pris comme exemple parmi d’autres hommes, un Socrate anonyme en somme. De même, l’ambition d’une définition de l’homme n’engage pas une anthropologie ou un discours humaniste. Il s’agit de répondre à l’interrogation « qu’est ce que l’homme ? » selon une perspective ontologique et existentielle: l’homme ici est ce « berger de l’être » ou encore celui qui « habite en poète » pour reprendre les célèbres formules d’Heidegger.
travers l’exégèse de dialogues platoniciens par exemple. Le Socrate dont il est question est le même que celui du syllogisme aristotélicien, un homme pris comme exemple parmi d’autres hommes, un Socrate anonyme en somme. De même, l’ambition d’une définition de l’homme n’engage pas une anthropologie ou un discours humaniste. Il s’agit de répondre à l’interrogation « qu’est ce que l’homme ? » selon une perspective ontologique et existentielle: l’homme ici est ce « berger de l’être » ou encore celui qui « habite en poète » pour reprendre les célèbres formules d’Heidegger.
Cette option existentielle est présente dès le propos liminaire : déconstruire la notion moderne de sujet pour parvenir à « dire quelque chose de l’intensité de l’être (…) de l’existence –qui est la définition de l’homme ». Cinq leçons sont annoncées : la première leçon analyse la conscience comme intuition que la pensée a d’elle-même ; la deuxième se consacre au concept d’inconscient notamment chez Freud ; la troisième aborde l’identité subjective dans l’alternative entre conception substantielle et conception transcendantale ; la quatrième leçon fait une large place au rôle structurant de l’altérité dans la conscience du monde qui vient à soi ; la cinquième analyse le sentiment d’existence comme présence au monde et horizon de toute pensée.
La Première Leçon engage l’analyse de la conscience comme intuition (Descartes) et donnée immédiate (Bergson). Cette présentation classique porte déjà en elle la perspective existentielle et ontologique : la conscience n’est-elle pas d’emblée « quelque chose comme l’ouvert ou l’abri, comme ce qui protège l’abri » laissant ainsi « à l’être la possibilité d’être » ? Le parti pris phénoménologique est lui aussi vite explicité par « l’exigence descriptive d’un retour au concret, à la chose même, telle qu’elle se donne, puisque l’essence d’une chose n’est rien que la façon dont ce quelque chose se donne ». La thématique husserlienne de l’intentionnalité est convoquée pour dire la contemporanéité de la conscience de soi et de la conscience du monde, cette « advenir du soi et du monde l’un pour l’autre ». Mais c’est à condition de comprendre l’intentionnalité elle-même comme « ce qui m’assigne un lieu » ou donne un chez soi, « une certaine obscurité remise à la lumière », autant d’expressions qui sont plutôt d’ascendance heideggérienne. La prise en compte du rôle de la perception dans la conscience de soi ne dit pas autre chose : « la perception est découvrante (..) l’expérience perceptive est expérience de présence, elle est ouverture sur l’être, sur la transcendance de l’être ou sa différence d’avec l’étant ». La perception me situe dans un monde, ce que disent les termes de dasein (Heidegger) ou encore de chair (Levinas) auxquels s’ajoutera la notion d’espace intersubjectif. Si on passe en revue différents moments de la pensée de la perception, chez Spinoza, Leibniz ou Bergson par exemple, on trouve toujours la relation intime du percevoir et de l’affect, derrière laquelle se manifeste la transcendance de l’être, la « déchirure » ou la « fracture » qu’il est.
La Deuxième Leçon se propose de présenter l’importance de la révolution freudienne comme pensée de la discontinuité du sujet, voire de sa dénégation. Ici aussi, une relecture existentielle et phénoménologique est possible : la psychanalyse est ce souci du monde sous la forme d’un« soin de l’humain, là où une souffrance se dit, et donc une écoute de ce dire par rapport à l’inquiétude de ne pas être chez soi ». Le représentation topique dit d’ailleurs ce souci d’avoir un lieu : « il y a cette idée, qui n’est pas étrangère à Freud, que l’homme n’est pas au monde sans habiter quelque part ». Cette hypothèse est éprouvée par une étude généalogique du concept d’inconscient : les synthèses perceptives de Leibniz, le conatus spinoziste, l’élan vital nietzschéen. Ce que la psychanalyse apporte en propre par rapport à cette lignée, c’est la pensée de la relation entre langage et inconscient, toute pensée étant un désir qui cherche à investir un signifiant. Or, comment comprendre ce besoin d’être ou de se dire si ce n’est comme la preuve que le sujet porte en lui cet appel à l’être ? Au final, l’inconscient est « principalement un dire qui est aussi une manière de venir à l’être », « le désir d’un homme n'[étant] rien que ce qui l’expose au monde et pour l’Autre ».
La Troisième Leçon repart du cogito cartésien pour analyser la notion de sujet elle-même. Le moment fondateur pour la subjectivité moderne que constituent les Méditations Métaphysiques mérite une reconstitution détaillée: le doute hyperbolique, le caractère non syllogistique du « donc » dans le « je pense donc je suis », la réflexivité (« la pensée ne sort pas d’elle-même), le solipsisme, le malin génie, la subjectivité égologique (« qui veut que la conscience est déjà toute la pensée »), et finalement la preuve ontologique comme terme du doute méthodique. Sans qu’il y ait matière à s’en étonner, la mise en question du sujet cartésien s’effectue en deux temps : en premier lieu la critique empiriste du cogito substantialiste puisque « des pensées [qui] nous traversent sans que l’on puisse les référer à un sujet qui les pense », en second lieu la mise à jour du caractère transcendantal de la subjectivité, principe d’identité assurant la permanence dans le temps. Cette perspective transcendantale donne toute sa mesure si on la considère comme une disqualification de la métaphysique de la représentation : « la pensée critique n’est ni un réalisme, ni un formalisme du sujet (..) elle découvre plutôt la structure ontologique qui précède la position corrélative d’un sujet et d’un objet ». Dans la phénoménologie transcendantale bien comprise, le sujet de la pensée n’est pas une chose du monde, et l’être ouvert au monde est plus ancien que le rapport formel de la conscience à ses objets.
La Quatrième Leçon vise à établir le rôle décisif de l’altérité dans la présence existentielle au monde : « nous ne sommes jamais seuls si nous sommes au monde ». Etant défini ontologiquement par sa réceptivité à l’être, le sujet, (re)devenu homme, ne peut s’éprouver que dans sa finitude, faisant l’épreuve de l’illimitation que constitue autrui. Par ce dernier, je me trouve « toujours déjà accompli dans notre commune exposition à l’ouvert d’un monde ». N’est-ce pas cette présence au monde par autrui qui se manifeste dans des expériences aussi quotidiennes de l’altérité que sont les files d’attente ou les corps étendus sur la plage ? Elles nous font constater que le sentiment de la finitude s’oppose au solipsisme : c’est la présence d’autrui qui me renvoie à ma propre finitude. Levinas est le penseur par excellence de cette contemporanéité du sujet et du monde comme monde des autres déjà-là. Autrui donne au monde une solidité objective qu’il ne peut avoir tant que je n’ai sur lui que mon point de vue propre, lequel n’est qu’un fragment. Une chose n’existe pour moi que lorsque je prends aussi conscience qu’elle existe pour un autre. Autrui est donc contenu dans la conscience que je prends du monde, mieux : « autrui est bien fondamentalement structure d’être » et « le monde, dans son sens d’être, implique autrui ». Mais Levinas ajoute à l’intentionnalité comme perception –de l’autre- la perspective de la jouissance. Tout l’enjeu -éthique notamment- est de comprendre comment cette relation de jouissance à autrui peut être de subjectivation et non d’objectivation. Chez Sartre par exemple, l’autre me reconnaît sur un mode conflictuel et aliénant (il « m’assigne»). C’est l’analyse du respect qui permet cette compréhension de la relation à autrui comme subjectivation. Mais contrairement au respect formel kantien pour l’humanité désincarnée, le respect ne doit pas être exigé a priori, il doit être forcé par la conscience qui veut être reconnue. Et c’est pourquoi la reconnaissance repose elle-même sur la présentation: autrui se rend présent à moi. Le véritable sens du monde réside ainsi dans cette « conscience d’être embarqués dans le même monde ».
La Cinquième Leçon répond au projet – établi par le titre et le préambule – d’une définition de l’homme non comme une individualité mais par le fait d’exister. La modalité d’être de celui qui existe est l’apparaître, le fait d’être en soi hors de soi. En ce sens, il n’y a pas de discours sur l’être mais un dire puisque apprendre que quelqu’un existe ne nous apprend rien de lui. Ce qui revient à dire que non seulement l’existence n’est pas un prédicat, mais aussi qu’il n’y a pas de science de l’homme puisque l’existence n’est pas l’objet d’un savoir. S’il n’est pas une science ni même une technique, le questionnement philosophique sur l’homme comme ouverture à l’être n’est pas immédiatement accessible. Il est cet étonnement qui ne va pas de soi et affronte la difficulté de dire l’être sans dire quelque chose qui ne soit un verbiage puisque dire est toujours dire quelque chose de quelque chose. Mais justement, l’être advient à l’étant avec la parole : je ne parle qu’à partir de ce dont je parle et c’est bien pourquoi l’essence d’un homme est ce que c’est pour lui d’être. Exister n’est rien que cette ouverture à la précompréhension de l’être, « ce souci de constitution d’être selon laquelle, pour cet étant, l’homme, il y va de son être ». Dans cette dernière partie, où le propos est plus heideggérien que jamais, une place de plus en plus grande est faite au temps, lequel est « le sens d’être du souci ». Les prémisses de cette analyse ontologique du temps existe dans l’esthétique transcendantale de Kant: le temps comme forme a priori de la sensibilité, n’est-il pas la forme de notre ouverture au monde ? Le temps donne l’être comme différence ou comme passage. Le monde est ce qui passe et ce qui se passe à travers moi. L’être temporel est le contraire de l’identité substantielle, il est sans identité, sinon d’emprunt ou par simulacre, il est « l’être qui est (se) différant, et ainsi diffère des autres ». La musique dit exactement cette présence au temps sous la forme de la différence ou de la variation. La pensée du dasein surtout, manifeste cette « expérience de la non contemporanéité à soi, qu’on peut dire expérience du temps lui-même ou de la différence temps, dont la forme est celle de la disjonction incluse» .
On l’aura compris, la phénoménologie dans sa déclinaison heideggérienne règne en maître dans cet ouvrage. Mais on apprécie aussi le beau et riche parcours philosophique auquel nous convie l’auteur : Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Nietzsche, Husserl, et beaucoup d’autres encore, défilent et se font entendre, y compris en certaines digressions aussi précises qu’instructives. Ce n’est pas le moindre mérite de l’ouvrage que de faire entendre les auteurs, de leur laisser la place. En permanence, des citations et des commentaires reviennent et cherchent à en approfondir le sens. L’auteur, c’est une évidence, aime les philosophes. Et son amour est communicatif même s’il risque de se communiquer principalement à ceux qui le partagent déjà si on tient compte de la difficulté de nombreux passages, du caractère allusif d’autres, ou encore d’une intertextualité aussi dense que systématique .
On applaudit souvent la précision des exposés, la clarté, l’efficacité et même la finesse de nombreuses formules. Parmi d’autres : « perçue, la chose déclare silencieusement le monde », « l’éclat discret mais irréfutable de l’existence. » « la pensée se tient dans une fidélité discrète au vif de la blessure », « voir les choses comme elles sont les choses, c’est les voir dans l’ouverture, et, pour ainsi dire, la vibration d’un monde ». Toutes pour autant ne sont pas aussi heureuses : « il y a bien des façons pour un monde de se défaire dans l’immonde de l’immondialité », ou encore « nous partageons le partage lui-même ».
Si l’auteur ne se réclame pas d’une démarche académique, il vise par contre une forme de point de vue exhaustif ou englobant : « le cercle recueille le legs pensé et impensé, de la tradition de pensée philosophique, de Platon à Husserl, en passant par tous les autres qui furent grands. ». Ce n’est par un hasard si un motif récurrent anime le propos, celui de l’un et du multiple : « dans les choses innombrables, le monde se multiplie et demeure le monde unique ». Ce motif pour dire l’être contamine jusqu’à l’ouvrage dans sa forme, donnant l’impression de variation infinie sur le même thème : la relecture phénoménologique des auteurs classiques y est admise dès le premier chapitre, la déconstruction de la subjectivité moderne comme pensée de la représentation et l’ouverture ontologique de l’existant à l’être également. Ce motif récurrent de l’un et du multiple donne tout son sens à l’analogie proposée en préambule entre la leçon philosophique et les variations à partir d’une sonate au piano.
On peut parfois rester perplexe quant au parti-pris que ce motif implique. Si l’analyse peut aller d’un auteur à un autre en donnant le sentiment de la continuité et de la cohérence, donnant crédit à la perspective phénoménologique et existentielle, on est en droit de se demander jusqu’à quel prix. Descartes « fait de la phénoménologie sans le savoir », l’idée platonicienne assimile l’intelligibilité et « le paraissant », Spinoza « approche une pensée de l’existence, il y a « une pensée de l’être chez Locke » et une même nécessité chez Descartes, Kant et Nietzsche d’inventer « un langage pour dire de la pensée ce qui lui arrive d’être ». N’est ce pas que l’auteur a de toute façon décidé, à la suite d’Heidegger, que l’histoire de la philosophie était structurée par une occultation de l’être, les Modernes ayant oublié l’être tout en le faisant surgir malgré eux ? (Ou encore : l’être s’étant fait oublier des Modernes tout en animant leur pensée sous une forme souterraine ?) Sur ce point, l’auteur est clair: « je ne peux rien penser qui ne soit du réel, cette vérité –qu’on la trouve dans Parménide ou dans Spinoza, dans n’importe lequel des penseurs- est vérité première, ou transcendantale ». Mais s’il est vrai que toute philosophie présente ce qu’on pourrait appeler un souci du monde, on peut néanmoins s’étonner de trouver une pensée de l’être y compris dans les pensées critiques de la métaphysique comme celles de Kant, de Locke, ou encore de Nietzsche.
Il ne nous appartient pas de juger de la consistante d’une telle hypothèse, ce débat a déjà suffisamment agité les pro- et anti-heideggériens sans qu’un point final y puisse être mis. L’impression d’ensemble ici est finalement que tous les auteurs parlent différemment et tous pourtant disent la même chose. Ce qui n’a rien d’étonnant si on considère qu’ « il y a bien des manières de dire l’existence, mais qui reviennent toutes à la définition de l’existence comme entente de l’être». Cette hypothèse, largement déclinée, finit par donner le sentiment que tout est dans tout, tous les penseurs exprimant d’une manière ou d’une autre la transcendance de l’être. Discontinu et lancinant, éclaté et syncrétique, le propos fait des plis pour reprendre une image deleuzienne que l’auteur ne récuserait sans doute pas.
Au total, La leçon de Socrate de Jean-Pierre Emmanuel Jouard est une œuvre stimulante, très riche, à la lecture souvent agréable, mais dont certaines options stylistiques et surtout méthodologiques pourraient déplaire. L’ouvrage agacera les lecteurs déjà hostiles à la philosophie de l’existence de Heidegger, il ravira sans doute ceux qui en sont au contraire des partisans sans pour autant qu’ils n’en apprennent rien de vraiment nouveau. Quant à ceux qui ne sont ni l’un ni l’autre, ils trouveront sa lecture intéressante mais un peu fouillis et se défairont difficilement du sentiment que cette pensée se déclinant à l’infini à partir d’un même thème tourne principalement sur elle-même.
Il est à noter qu’on trouve, à la fin de l’œuvre, une annexe consistante et précieuse comportant un index des concepts, un autre des noms d’auteurs, ainsi qu’une bibliographie organisée.














