La fatigue
François Athané
Pour Marie
Pensant à Jean-Marc
Cet écrit est la version modifiée et augmentée d’un texte prononcé à Paris le 2 décembre 2015, à l’invitation de Jean-Claude Delgènes et Denis Maillard, et à destination des collaborateurs de Technologia et Inalyst, consultants en santé, sécurité et bien-être au travail. J’adresse mes remerciements à toutes et tous, pour la tenue de cette rencontre et pour les échanges auxquels elle a donné lieu. Pascal Charbonnat, Philippe Cornet, Sigrid Gérardin, Gérard Lambert, Guillaume Lecointre, Alban Lefranc et François Rondeleux m’ont aidé par leurs conseils, ou leurs avis sur des versions antérieures de cet écrit. Je leur exprime ici ma gratitude.
C’est un plaisir de venir parler avec vous de la fatigue, qui toutefois ne va pas sans quelque tension. Pourquoi les deux à la fois ? Cela tient, pour partie, au thème de notre rencontre. Il a été déterminé un peu intuitivement, lors d’une conversation avec Jean-Claude et Denis, parce que la fatigue est assurément une affaire importante, spécialement lorsqu’on s’occupe du travail. Mais, en y réfléchissant au cours des derniers mois, en cherchant des renseignements sur ce sujet, je me suis aperçu que ce sujet assurément important pour chacune et chacun de nous ne semble pas avoir beaucoup retenu l’attention.
Je parle d’abord des philosophes : on ne trouve qu’assez peu d’écrits philosophiques portant explicitement sur ce thème. Cela ne m’a pas étonné. Il y a peut-être un vice caché dans cette tradition philosophique, un vice ancien qu’elle commence toutefois à corriger, sciemment et consciemment, depuis une date qu’à mon avis l’on peut repérer assez précisément. Je veux parler du moment où des voix différentes, voix issues des mouvements féministes ont commencé de se faire entendre dans ce champ qu’on appelle « philosophie ». Ce vice caché qu’ont relevé les féministes serait la propension de cette tradition à laisser sous silence ce fait : notre vulnérabilité. Ce qui pourrait être, d’une certaine façon, la contrepartie négative du supposé désir de la sagesse, laquelle a peut-être trop souvent, trop unilatéralement été pensée comme maîtrise – de soi, de sa pensée, de son corps, de son action, au détriment de la réflexion sur notre commune vulnérabilité.
Mais, et cela est plus étonnant, la fatigue n’est pas vraiment beaucoup mieux, ou beaucoup plus abondamment traitée par ceux dont on pourrait croire qu’ils ont précisément des choses à dire sur elle : je veux parler des médecins.
Oui, cela est étonnant – et en même temps, non, cela n’est pas du tout étonnant.
La fatigue est banale parce qu’universelle. Tout le monde, chacune et chacun d’entre nous, est fatigué, à tel moment de l’année, de la semaine, de la journée. C’est une banalité. Et sans doute cette universalité est plus universelle encore, et nous déborde largement, nous les humains. Car il est probable que de nombreux animaux, eux aussi, éprouvent périodiquement la fatigue, ou quelque chose de tel. Mentionnons l’étymologie : la fatigue est originellement liée au sort si souvent odieux, abyssalement odieux, des animaux domestiques. Fatigare, en latin ? Littéralement : faire crever un animal. Fatis est la fente ou la crevasse. D’où affatim, qui veut dire jusqu’à éclater, jusqu’à crever, vider complètement. Cet élément suggère qu’en-deçà du travail de l’animal, le terme pourrait avoir son origine dans des contextes sacrificiels. Fessus est ce qui est fendu, lézardé ; fatisco, qui tombe en ruines. D’où fatigare a pris le sens d’accabler, vexer, humilier, harceler.
Et le fatigator est celui qui fatigue.
Ainsi, dans le poème de Virgile : « C’était la nuit et dans tout l’univers les corps las de travail prenaient l’apaisement du sommeil, les forêts et les mers farouches avaient trouvé leur repos, à l’heure où l’astre roule au sommet de sa course, quand toute terre se tait », Énée alors fait un rêve : l’image d’un dieu, semblable à Mercure, l’avertit qu’il est temps de s’éveiller et de lever l’ancre.
Tum vero Aeneas, subitis exterritus umbris,
corripit e somno corpus, sociosque fatigat:
Praecipites vigilate, viri, et considite transtris;
solvite vela citi.
« Alors Énée, effrayé de cette vision inattendue, arrache son corps au sommeil, presse et harcèle ses compagnons (sociosque fatigat) : Réveillez-vous, holà ! installez-vous sur vos bancs. Déployez les voiles, et vite ! » (Virgile, Énéide, IV, 522-525, puis IV, 571-574 ; je cite la traduction de Jacques Perret).
Énée est le fatigator de ses compagnons.
Revenons au banal. L’universalité de la fatigue – qui donc déborde notre humanité, de toutes parts – cette universalité fait en un sens obstacle à son intelligibilité, en particulier médicale. Il n’y a pratiquement pas une seule maladie, une seule lésion, même traumatique, qui ne donne lieu à de la fatigue – ou du moins à des expressions, des plaintes, des comptes rendus verbaux du patient tels que : « je suis fatigué ». Et tel est le cas même dans les pathologies qui se caractérisent par une infatigabilité anormale, ainsi la manie.
Il y aurait beaucoup à dire, à partir de là, sur l’apparente infatigabilité des puissants. Il faut, semble-t-il, qu’ils apparaissent comme infatigables. Et ils le savent ; ou plutôt, ils croient le savoir. Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est l’étymologie de ce mot, « fatiguer ». En effet, être puissant c’est par définition être doté, plus que les autres, du pouvoir de fatiguer, y compris au sens de fatigare, un certain nombre d’autres. Et de même, être puissant c’est par définition être protégé, ou avoir les moyens à sa disposition pour que personne ou presque ne puisse vous fatiguer, y compris au sens de fatigare. Pas de fatigue parce que, et seulement dans la mesure où, il n’y a pas de faille dans la muraille – pas de fente dans la cuirasse. Sans doute, l’on est invulnérable seulement dans la mesure où l’on peut faire crever, éclater, exploser, mieux : accabler la vulnérabilité d’autres que soi, sans possibilité de rétorsion de ces autres vers soi. Oui, apparaître comme infatigable semble un des attributs, peut-être une des contraintes invariantes de l’imperium – du pouvoir. Mais nous verrons plus loin ce qu’il en est exactement du lien entre la fatigue et l’apparaître.
Étant partout, partout tue, ou partout formulée ou déplorée, partout consécutive aux pathologies les plus diverses – « fatigué » s’emploie pour « malade », par euphémisme, en français de Savoie, d’Auvergne, de Provence – mais aussi à toutes sortes d’états qui n’ont rien de pathologique et constituent au contraire des activités saines et bonnes, la fatigue semble comme un point de convergence de toutes les choses de la vie. Il est donc logique que la recherche ait tenté de marquer des différences entre plusieurs modalités de la fatigue.
D’abord entre les fatigues normales et les autres, pathologiques. Ensuite en distinguant plusieurs composantes : tonus musculaire, vigilance, capacités réflexes, sensori-motrices, cognitives, communicationnelles ; coordination, co-variation et co-altération de ces différents paramètres, etc. Bref, comme souvent avec les choses importantes de la vie – la fatigue, le désir, la conscience, le pouvoir, la croyance, la confiance – pour l’étudier, et l’étudier sérieusement, il faut dissoudre la notion, et la chose avec la notion. Ou, plus exactement, la traduire, cette notion, la décliner, la différencier afin que le concept cesse d’être attrappe-tout, et que l’on sache de quoi l’on parle. Il faut rendre la notion opérationnelle en la subdivisant et en la reformulant, de telle sorte qu’elle porte sur un ensemble de faits qui soient eux-mêmes mesurables, et quantifiables, et donc différenciés.
La fatigue est partout, mais elle n’existe peut-être pas : ce qu’il y a quand on s’intéresse à la fatigue, ce n’est plus la fatigue, c’est la baisse de vigilance, le déficit attentionnel, le ralentissement moteur, le désinvestissement des interactions sociales, la procrastination, l’évitement, la dépression.
Et chacun de ces derniers termes peut lui-même être soumis au même soupçon : n’être pas suffisamment précis et opératoire par lui-même ; de sorte que chacun est lui-même justiciable de cette retraduction-dissolution, par laquelle on en vient à se dire que, peut-être, il n’y a pas la fatigue (ou la dépression, ou le pouvoir) mais un simple air de famille entre des faits divers que nous regroupons sous le même terme par un raccourci de langage, ce qui est très exactement le genre de chose que l’on doit éviter lorsqu’on essaie de connaître avec méthode. Et c’est aussi, malheureusement, ce que je vais faire aujourd’hui : je ne peux parler de toute la fatigue, je vais en parler sous un aspect.
Il s’agira principalement de son rapport au sommeil. J’envisagerai en second lieu la fatigue comme signal, avant d’en venir à soulever la question de l’origine de la fatigue. Bien sûr, elle nous vient du travail ; mais je ne soutiendrai pas cette position telle qu’elle est souvent partagée dans le sens commun. Selon celui-ci, en effet, certaines fatigues résultent du travail, mais non pas toutes. Au contraire, je voudrais envisager l’hypothèse que toute fatigue dans l’espèce humaine provient du travail. Enfin je dirai quelques mots sur l’épuisement.
Elle est partout, la fatigue, et elle n’est nulle part. Elle est ce vers quoi tout de nos vies converge, ce qui revient toujours, et qui pourtant n’est rien – rien quand on cherche à savoir exactement de quoi l’on parle. Telle est du moins l’impression que l’on pourrait avoir lorsqu’on cherche à s’informer sur ce que c’est que la fatigue – lorsqu’on cherche cette forme spécifique de savoir qui relève de la science, de la quantification, de la mesure, de l’objectivation.
Mais tout change lorsqu’on aborde les choses autrement. Qui parle de la fatigue ? Qui ne cesse pas d’en parler ?
D’une part : les gens, toujours, dans les conversations ordinaires du métro, du boulot et du bistrot. La presse aussi, qui abonde de conseils pour surmonter la fatigue.
D’autre part : les écrivains, les romanciers – et les peintres ou les photographes.
Voilà donc ce qui motivait mon propos de départ : grâce à vous, j’explore quelque chose que jamais dans mon travail je n’avais vraiment exploré, la fatigue, et que sans vous je n’aurais peut-être jamais exploré. Plaisir, donc, de vous parler de cette sorte de découverte, du moins pour moi ; mais aussi tension, pour la même raison : c’est une tentative que je vous propose, je risque, je ne sais pas. La fatigue a toujours été déjà là dans ma vie comme dans la vôtre, mais pour moi elle est neuve en tant que thème sur lequel travailler.
Fatigue, effort de ce monde, fatigue universelle. Je suis fatigué. J’ai envie de me retirer. J’ai envie de quitter le lieu où nous sommes, où nous agissons, parlons, interagissons, travaillons… vivons. Ce que nous appelons fatigue, être fatigué, ce sont ces cas où il semble qu’il n’y a plus aucune envie qui prédomine sur celle de se retirer, se mettre à l’écart, au calme. La fatigue se dit plus par l’optatif que par l’indicatif. Que les stimulations cessent. Que la lumière baisse. Qu’il n’y ait plus de bruit. Peut-être pas pour autant le silence, ou l’obscurité : un peu de musique éventuellement, moins de sollicitations, de stimulations, moins à faire, moins à penser, moins de lumière. Plus de calme. Qu’il y ait moins de mouvement. Qu’il ne soit plus nécessaire de faire, d’agir. Ne plus devoir, ne plus avoir à, ne plus répondre de, ou répondre à. Que les bouches se ferment. Que mes yeux se ferment, ou, du moins, que je puisse fermer les yeux.
La fatigue est séparatrice. Je lis cette formule sous la plume de Peter Handke, dans son bel Essai sur la fatigue ; je la retiens, pour que nous y revenions. Oui, ce qu’on appelle fatigue semble souvent cette nécessité de s’écarter, de se fermer, revenir à soi, dans le non agir et l’immobilité, le calme. Nous ne sommes jamais loin alors, dans ce « revenir à soi », jamais loin de revenir à : ne plus penser à soi, ses soucis, problèmes et responsabilités, ne plus penser – c’est-à-dire dormir.
Fatigue implique nécessairement, définitionnellement, dans ses usages ordinaires, besoin de repos, d’une manière ou d’une autre. Certes, le repos peut être le jeu, le délassement, le loisir – mais c’est tout de même avant tout le sommeil. Le sommeil est cette forme de repos qui rend possible les autres formes de repos. Le sommeil n’est pas nécessairement à lui seul la sortie de la fatigue, il n’est pas toujours suffisant. Après toute cette fatigue accumulée, il va falloir non seulement que je dorme, mais que je change d’air, que je me délasse, que je change d’activité, de fréquentations. Tu me fatigues, je veux voir d’autres visages. Tout cela – changer d’air, changer d’activité, ou de lieu, changer de têtes, changer de fatigue – tout cela peut être effectivement nécessaire pour sortir de la fatigue. Mais il n’en demeure pas moins que le sommeil est lui-même nécessaire à tout cela. Même s’il n’est pas toujours suffisant pour sortir de la fatigue, il est toujours nécessaire pour cette sortie de la fatigue.
Et nous pouvons donc dire ce qui suit. La fatigue est séparatrice. Elle m’incite à me retirer du monde parce qu’elle m’incite à revenir à moi, seulement moi sans rien, moi nu sans mes actions et interactions, œuvres et travaux, titres et responsabilités, obligations et relations diverses. La fatigue est négativité. Elle m’incite à ne plus être avec, ne plus être en relation, ou en prise sur, elle m’ôte l’envie d’exercer mes pouvoirs causaux, elle est ce fait négatif : cette envie atténuée, diminuée, passée au second plan d’une manière ou d’une autre, d’agir ou d’interagir, ou de produire des effets sur le monde – et tout autant : de laisser le monde exercer ses effets sur moi, ou du moins ce genre d’effets-là, qui me fatiguent.
Cette césure d’avec le monde semble ce retour à moi, moi seul, moi nu, sans mes attributs sociaux, causaux, mes responsabilités, mes titres, mes obligations. Mais ce point de convergence, dont nous avons vu qu’il est aussi point de fuite de tout – ce point c’est, en fin de compte, en fin de fuite : Rien, je ne pense plus, du moins je ne m’aperçois plus que je pense, ni que je suis ni que je souffre ou me soucie ou me projette ou me dois de – parce que je ne m’aperçois plus de « je ». Je dors.
La fatigue est donc séparatrice. Elle exprime et cause quelque chose comme le besoin, de temps en temps, d’être asocial. Et même plus, beaucoup plus : le besoin d’être acosmique, coupé du monde, hors du monde, sans relation avec le monde. Ce besoin, il faut qu’il soit satisfait pour que je sois – que je sois et persiste en ce monde-ci. Si je suis moi, c’est que de temps en temps je tombe dans ce noir. Je ne m’aperçois plus de rien. Plus rien ne m’apparaît. Par un emprunt à l’œuvre de Jacob Rogozinski, ce non apparaître, je le nommerai : aphanisis. Ce mot signifie : plus d’apparaître, plus de phaïnomenon, de phénomène (« phénomène » désigne d’abord ce qu’on voit, et plus généralement ce qui apparaît dans l’attention de quelqu’un). Aphanisis est la suppression de toutes les distinctions et de toutes les différenciations. Dormir, dormir profondément, Leibniz l’avait remarqué, ce n’est pas nécessairement ne plus percevoir, mais plus exactement c’est ne plus s’apercevoir – et, entre autres, ne plus s’apercevoir que, parfois, on perçoit en dormant. Ne plus s’apercevoir, par exemple, de la différence entre ceci et cela ; entre ceci, puis cela ; entre ceci, qui importe, et cela, qui n’importe pas. Aphanisis : rien ne m’apparaît, parce qu’il n’y a plus de « m’apercevoir » ; rien ne m’apparaît, même pas moi, ni la différence entre moi et ce qui n’est pas moi. De Jacob Rogozinski, lisez Le moi et la chair, ou bien Ils m’ont haï sans raison.
Voilà pour la description de ce dont la fatigue exprime si souvent le besoin : dormir. Et nous le savons, nous le constatons, pour que nous vivions, il importe par-dessus tout que nous passions de temps en temps, chaque nuit, par cette aphanisis transitoire qui s’appelle le sommeil.
Sans quoi la fatigue vire à l’épuisement. Il faut qu’il y ait satisfaction de ce besoin ; car oui, il y a un besoin d’aphanisis – où plus rien n’apparaît, plus rien n’est aperçu ni n’aperçoit, plus rien n’importe. Ce moi que je suis est du fait qu’il cesse d’être de temps en temps. Je suis, je ne suis pas mort, je suis dans ce cosmos du fait même que ce cosmos me permet de satisfaire régulièrement mon besoin de retrait acosmique. « Cosmos », en grec, signifie : ordre, cycle cosmique ; mais aussi : joyau, maquillage, cosmétique, beauté de l’apparaître du monde – à commencer par la beauté de la lumière, du soleil et des astres.
Je persiste en ce monde du fait que ce même monde me permet régulièrement de m’en absenter dans le noir – dans le « tout disparaît » du sommeil – et le désir de dormir est ce noir désir du noir : « tout disparaîtra ».
Mais qu’est-ce que je dis lorsque je dis « acosmique », « hors du monde » ? Est-ce que cela a un sens ? Je suggère de clarifier ce point en réfléchissant à cette expérience commune : voir dormir un être que nous chérissons. Quiconque a regardé dormir près de soi un être chéri – ce quiconque, c’est nous tous – a peut-être été effleuré par cette pensée, plausiblement vide : où vas-tu quand tu dors ? Et cela même si c’est un chien qu’on aime. C’est Baudelaire qui demande : Où vont les chiens ? Où vont les chiens, où vont les chevaux quand ils dorment ? Où vas-tu quand tu dors ? A quoi le dormeur pourrait, je crois, répondre par cet autre mot de Baudelaire : nulle part bien sûr, je vais non pas ailleurs mais nulle part – ou bien n’importe où, pourvu que ce soit hors du monde.
Par là une des interprétations possibles de ce que nous appelons « la fatigue », « être fatigué », peut se formuler grâce à la notion de signal. Signal interne : je me sens fatigué, j’ai besoin de repos. Mais aussi signal externe : clignement d’yeux, ralentissement moteur ; il est fatigué, il a besoin qu’on lui fiche la paix, qu’on le laisse tranquille pour se reposer. Par quoi la fatigue appelle l’aide et l’empathie, si ce n’est la sympathie, et même – le mot est digne d’attention – la compassion.
Signes de fatigue, dit-on : courbatures, maux de tête, clignement des paupières, baisse de la fréquence des mouvements oculaires. Mais ce que je propose ici d’envisager, c’est que la fatigue est tout entière elle-même signal que le temps est venu de l’aphanisis – dans l’ordre du temps biotique, lequel paraît, à nombre d’égards, lié au temps cosmique.
Ressentir la fatigue serait le signal qu’est venu le temps de l’effacement – l’aphanisis elle-même nécessaire à ce que ré-apparaissent, tout à l’heure, au réveil, et moi, et les autres, et moi parmi les autres, et moi m’apparaissant parmi ce monde et parmi ces autres, ayant à y œuvrer, plus ou moins vulnérable, mais toujours aussi plus ou moins capable, y œuvrer pour moi, pour les autres, pour le monde.
Et pourtant. Pourtant c’est dans ce monde-ci que nous dormons. C’est dans ce monde-ci que nous satisfaisons notre besoin acosmique, dans ce monde-ci que s’exprime et se dissipe la fatigue, dans ce monde-ci, et aucun autre, que nous satisfaisons notre besoin de cet any where out of the world, « n’importe où hors du monde ».
Il en résulte que ce besoin peut être satisfait – et il faut qu’il soit satisfait – seulement parce que sont remplies toute une série de conditions qui n’ont, elles, rien d’acosmique, et qui sont au contraire tout à fait ordinaires, empiriques, sociales, banales et socialement contraignantes.
Et nous allons donc maintenant revenir au savoir, à l’enquête, peut-être même à quelque chose comme la science. Comment se fait-il qu’il y ait la fatigue ? Si la fatigue est, au moins dans bon nombre de cas, signal du besoin de dormir – et si l’expérience subjective du sommeil, au moins du sommeil profond, est d’une manière ou d’une autre ce que j’en ai dit : aphanisis – alors répondre à la question : comment se fait-il qu’il y ait la fatigue ? suppose qu’on réponde à une autre question : comment se fait-il qu’il y ait le sommeil, et le besoin de sommeil ?
Je voudrais vous faire voir qu’il y a là une énigme. Et je voudrais ensuite vous faire comprendre pourquoi, à mon sens, il nous est nécessaire de repenser non seulement le travail, mais la relation de causalité entre la fatigue et le travail, pour tenter d’esquisser une réponse plausible à ces questions : comment se fait-il qu’il y ait la fatigue ? Comment se fait-il qu’il y ait le besoin de sommeil ? J’ajouterai ensuite quelques suggestions sur la différence entre le besoin et son contraire supposé, le luxe.
Si le sommeil et le besoin de sommeil sont, au moins par certains de leurs aspects fondamentaux, des événements biologiques – et ils le sont certainement – alors les expliquer de façon rationnelle, prendre au sérieux fatigue, sommeil et aphanisis du sommeil suppose qu’on les examine à la lumière de l’évolution. Comme l’a dit vigoureusement Theodosius Dobzhansky : rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la lumière de l’évolution.
Et par là nos questions se transforment. Comment se fait-il qu’il y ait la fatigue ? Comment se fait-il qu’il y ait le sommeil ? Ces questions peuvent être retraduites et pour partie ressaisies dans la formulation suivante : comment se fait-il que la sélection naturelle ait sélectionné le sommeil, et le besoin de sommeil ?
Passer cinq à huit heures par jour hors du monde ? Dans l’aphanisis ? Dans l’hypovigilance typique du sommeil ? Comment donc cela est-il possible ? Comment se fait-il que l’évolution des espèces ait sélectionné cela ? Il semble tout à fait manifeste en effet que passer six à huit heures par jour à dormir, c’est passer entre le quart et le tiers de sa vie en situation de vulnérabilité accrue.
Là gît l’énigme, sous nos yeux. Comment un tel surcroît de vulnérabilité a-t-il pu être sélectionné par la sélection naturelle ? La question se pose, de savoir comment il a pu se faire que les organismes qui dorment n’aient pas été simplement éliminés. Il paraît malaisé de comprendre comment les caractères : « dormir, besoin de dormir », et même : « plaisir à dormir », ont pu se perpétuer, se transmettre, et même se généraliser à des rameaux entiers de l’arbre de vie. Au premier abord, cela semble beaucoup plus difficile que si nous parlions, par exemple, du caractère « avoir des yeux ». Une fois que l’œil, ou quelque chose comme l’œil, est apparu, à la suite d’un quelconque alea génétique, on conçoit assez facilement qu’il y a eu un avantage adaptatif à avoir des yeux, percevoir la lumière, voir les couleurs ; et donc que ce caractère se soit transmis à la descendance et se soit diffusé dans un phylum d’animaux quelconque. (Un phylum est un ensemble d’organismes apparentés entre eux, du fait d’un ancêtre commun, plus ou moins loin dans le passé : par exemple, l’ensemble des mammifères constitue un phylum.)
Posons tout d’abord quelques remarques sur le sommeil dans d’autres espèces. Guillaume Lecointre, du Muséum National d’Histoire Naturelle, auquel j’écris à ce sujet, me répond, comme je m’y attendais, qu’« il n’y a pas un sommeil, mais des sommeils ». C’est par analogie qu’on appelle « sommeil » des formes variées de ralentissement de l’activité nerveuse. « Analogie » est ici à entendre au sens que revêt ce terme dans la théorie de l’évolution : on appelle « analogues » deux ou plusieurs structures présentes dans des organismes différents, et qui paraissent avoir des effets semblables, alors que ces organismes ne sont pas directement apparentés. Typiquement, les ailes des chauves-souris sont dites « analogues » à celles des oiseaux.
Ainsi, des formes similaires de sommeil sont apparues dans des organismes à déplacement continu qui ne sont pas directement apparentés. Ceci constitue un cas parmi beaucoup d’autres de convergence évolutive. Par exemple, diverses espèces de cétacés et d’oiseaux font dormir alternativement leur cerveau droit et leur cerveau gauche. Une moitié du cerveau dort, pendant que l’autre demeure à l’état de veille : ce que l’on appelle le sommeil monohémisphérique à ondes lentes.
Parmi beaucoup d’autres faits marquants relatifs aux sommeils des animaux non humains, je relève que les jeunes dauphins ne dorment pas pendant le premier mois de leur vie, et leur mère non plus. D’après Jerome Siegel, dont l’équipe de l’université de Californie a fait cette découverte, ce trait présenterait l’avantage de maintenir la température de l’organisme, tant que le petit dauphin n’a pas acquis la couche de graisse protectrice, laquelle permet aux plus âgés d’assurer cette fonction.
Mettons donc l’accent sur cette idée : le ralentissement de l’activité nerveuse a pris des formes très diverses parmi les animaux, parce que celui-ci se trouve généralement combiné à d’autres traits typiques, dont certains semblent avoir pour effet de diminuer la vulnérabilité de l’organisme dormeur au sein de son biotope. Tel paraît être le cas pour la graisse des dauphins, qui permet de conserver l’homéothermie ; et tout autant pour cette alternance cerveau gauche, cerveau droit, qui permet d’avoir à la fois la vigilance et le sommeil.
Aussi, pour répondre à ces deux questions liées : (i) D’où nous vient la fatigue ? (ii) Comment le besoin de sommeil a-t-il pu être sélectionné par la sélection naturelle ?, nous pouvons envisager, au moins provisoirement, l’hypothèse suivante.
Si la sélection naturelle a sélectionné le caractère : « sommeil, besoin de sommeil, plaisir au sommeil » chez certains organismes, lequel caractère accroît la vulnérabilité de l’organisme qui le possède, c’est plausiblement parce que la sélection naturelle a aussi, chez ces mêmes organismes, sélectionné au moins un autre caractère ou comportement, tel que ce dernier a atténué la vulnérabilité du dormeur lorsqu’il dort.
Et c’est apparemment ce qui a eu lieu, au moins dans un certain nombre d’espèces. La sélection naturelle a sélectionné l’hibernation, mais principalement voire seulement chez les organismes qui ont aussi d’autres caractères, tels qu’ils n’hibernent pas n’importe où, mais, par exemple, seulement dans leur terrier.
Dans d’autres phyla, la sélection naturelle a sélectionné le sommeil en même temps qu’elle a sélectionné aussi un autre caractère tel que, chez ces animaux, on dort ensemble. Et dormir les uns près des autres, c’est augmenter la probabilité qu’au moins un individu soit éveillé, ou se réveille, lorsqu’un danger advient, qu’il le détecte et réveille ses congénères. En d’autres termes : c’est augmenter la probabilité que, toujours, un seul veille sur le sommeil de tous.
Cette dernière remarque sur le sommeil chez certains animaux sociaux nous invite à renverser la question, pour en engendrer une autre, nouvelle. Non plus celle que je me posais tout à l’heure : où vas-tu quand tu dors ? Question qui, peut-être – mais rien n’est moins sûr – n’a ni de sens, ni de réponse possible, ni a fortiori de bonne réponse.
Mais la question a changé. La question est désormais : où vas-tu quand je dors ?
Or – nous le savons, nous le constatons – en général, à cette question, il y a une bonne réponse, et une seule : je ne vais nulle part. Je suis ici, je reste auprès de toi. Tu peux dormir. Je veille.
Je veille sur ton sommeil. En somme, et pour le dire vite, nous avons de bonnes raisons de penser que, si nous autres humains nous dormons, si nous avons besoin de dormir, et même : si nous avons du plaisir à dormir, c’est parce que, depuis très, très longtemps, « nous » nous organisons pour dormir – de telle façon, par exemple, que l’un d’entre nous au moins veille sur nous, lorsque nous dormons.
Et cela est toujours vrai. Quand nous dormons, il y a toujours quelqu’un qui veille sur notre sommeil. Que nous le sachions ou non, que nous sachions ou non qui est ce quelqu’un. Exprimons ce point de façon plus générale. Pour qu’il y ait le sommeil dans l’espèce humaine (et non seulement, de facto, il y a le sommeil dans l’espèce humaine, mais il y a beaucoup plus : la nécessité du sommeil, et le plaisir au sommeil) il faut nécessairement que les humains se dotent au préalable de bulles à l’intérieur desquelles ils peuvent dormir. Il faut, entre le corps infiniment vulnérable du dormeur et les périls du monde extérieur – les prédateurs, les intempéries – une zone tampon, quelque chose comme un human land, une bulle qui protège le sommeil. Et cette bulle est socialement construite. Cette bulle est un habitat. Cette bulle est le résultat d’un travail.
Oui, de telles bulles ont été nécessaires, selon toute apparence, pour que nos ancêtres dormeurs ne soient pas éliminés par la sélection naturelle – et par là nécessaires pour que nous puissions expliquer le double fait qu’il y a le sommeil et qu’il y a la fatigue.
Cabane, igloo, foyer, fossé, mur, toit, gardien, qu’il soit chien de garde ou veilleur, porte close, verrou, patrouille de police ; mais aussi couverture, berceau, berceuse, comptine, ronde de nuit ou prière, ou vœux de bonne nuit : autant de techniques, de travaux, de rituels, d’institutions qui perpétuent l’humble et immémoriale, l’infiniment contraignante nécessité de protéger le dormeur, à la fois des périls externes, mais aussi de la propre propension du dormeur à la peur du péril – qu’il soit réel ou rêvé. Car la peur du péril peut elle-même mettre le sommeil en péril.
Il résulte, du raisonnement évolutionniste assez élémentaire qui vient d’être exposé, que nous ne pouvons pas dire : c’est parce que nous dormons que ces techniques, fonctions, rituels, etc., ont été rendus nécessaires, et que, mutatis mutandis, ils sont universels à travers l’espèce humaine. Nous ne pouvons pas le dire, parce qu’il serait inexact de dire seulement cela. Il faut en effet ajouter : c’est parce qu’à quelque degré ces techniques, travaux, fonctions, rituels, etc., existaient plus ou moins déjà, que nous sommes devenus ceux qui dorment comme nous dormons. Si en effet tout cela n’avait pas existé à quelque degré, les dormeurs auraient été éliminés, et le sommeil, tout comme le besoin de sommeil, n’existeraient pas dans l’espèce humaine. Qui elle-même n’existerait pas non plus, d’ailleurs. Comme le suggère ce fait : nous ne pouvons nous faire à peu près aucune idée de ce que seraient des humains qui ne seraient pas aussi des dormeurs. Et lorsque Sartre s’y est essayé, dans Huis clos – dont les personnages ne peuvent ni dormir ni même clore leurs paupières – ce fut pour mettre l’enfer en scène.
Je crois donc que nous pouvons raisonnablement plaider en faveur de l’hypothèse d’une co-évolution des modalités du sommeil et de la fatigue d’une part, et des phénomènes tels que la coopération, les techniques, mêmes les rituels ou les institutions d’autre part. L’idée serait alors que les unes ont, pour partie, déterminé les autres, et réciproquement.
Partant de ce qui précède, nous pouvons dire et maintenir que la fatigue est séparatrice ; mais, si la fatigue est, au moins dans bon nombre de cas, le signal qu’il faut se séparer, aller dormir ; et si dormir est un besoin, un « il faut », seulement parce que nous autres humains avons su nous organiser pour veiller directement, en personne (c’est le veilleur ou la veilleuse) ou indirectement, par artefacts interposés (murs, foyer, fossé) ; alors il en résulte que ce sont l’union dans des « nous » coordonnés et coopératifs, le proto-travail et le travail communs, peut-être même l’institution, qui ont rendu possible notre fatigue. Ces éléments ont permis que l’espèce humaine soit, et se perpétue, alors même qu’elle est sujette à la fatigue et au sommeil.
Une remarque. Ces réflexions présupposent que nous acceptions d’envisager, ne serait-ce qu’à titre provisoire, une forme ou une autre de continuité entre les modalités de la coopération chez nos très lointains ancêtres non humains, et le travail proprement dit, si nous souhaitons réserver ce dernier terme aux seules sociétés humaines. Mais accepter qu’il puisse y avoir quelque chose comme une évolution allant d’un monde dépourvu d’humains à un monde où il existe des humains (et nous devons, certainement, l’accepter), implique qu’il nous faut aussi reconnaître qu’il y a dû y avoir une telle continuité, d’une manière ou d’une autre, des formes non humaines de la coopération jusqu’au travail à proprement parler.
Ce qui n’empêche certainement pas de chercher ce qui distingue le travail humain, tel que nous l’observons dans les temps historiques, des formes de la coopération chez les vivants non humains – sur ces caractères distinctifs, je reviendrai plus loin. Mais nous pouvons avoir besoin de penser une telle continuité ; aussi, faute d’avoir trouvé une meilleure locution, c’est en ce sens que je parle de « proto-travail ».
De ces arguments, il résulte ce qui suit. « Nous » est la condition nécessaire pour que « je » sois fatigué. C’est-à-dire ayant l’envie de me retirer du « nous », pour moi, en moi, en le rien que je suis, moi, lorsque je ne suis que moi, sans relation cognitive ou agissante avec le monde, dans l’aphanisis du sommeil.
Ainsi le travail, la coordination, la coopération, en somme les diverses formes de proto-travail collectif de nos très lointains ancêtres, humains ou non humains (si cette distinction a un sens, dans ce contexte) ont rendu possible que nous puissions nous payer ce luxe évolutif : passer hors du monde un quart voire un tiers de notre vie en ce monde. La fatigue est le signal qu’il est temps de s’adonner à ce luxe, qui n’est pas un luxe, mais un besoin.
Et sans doute la misère, c’est lorsqu’il n’y a plus personne qui veille sur mon sommeil.
Nous, humains, lorsque nous sommes les dormeurs, nous sommes hors du monde, dans le sommeil. Et même : les humains sont tels qu’ils ont besoin d’asocialité et d’acosmicité – cette aphanisis à la fois nécessaire, réparatrice, bienfaisante – mais aussi potentiellement terrifiante.
Quant à l’épuisement, c’est être crevé. L’épuisement connote la perte de toute ressource, il est privation. Privation de ce pouvoir : être moi, c’est-à-dire être un puits, ou une source, d’où jaillissent de nouveaux phénomènes, des actes, des œuvres, des possibilités d’agir et d’interagir. L’épuisement c’est ne plus pouvoir, n’en plus pouvoir ; mais c’est parce qu’on est crevé, mort, asséché. Or, l’étymologie que je citais tout à l’heure nous suggère qu’être crevé, c’est toujours avoir été crevé par quelqu’un. Quant à savoir si ce quelqu’un qui fait crever est nécessairement différent, ou s’il peut au contraire être le même que celui qui est crevé, la question reste ouverte. Ce qui toutefois est certain, c’est qu’il y a des cas où les deux sont effectivement distincts.
Qu’ils puissent être le même, cela doit être envisagé notamment dans la configuration suivante. Si la fatigue est un signal interne, il faut chez celui qui est fatigué quelque chose comme un récepteur ou un détecteur interne de ce signal. Or rien ne permet d’exclure a priori que certaines circonstances entraînent l’inhibition de cette faculté de réception interne du signal. Au contraire, cette description paraît plutôt adéquate à toute une série de cas.
Une difficulté cruciale est de déterminer s’il existe, ou non, des situations où il faut un fatigueur extérieur au fatigué. Ce point est assurément lié à une question éthique, savoir si le fatigueur, du fait même qu’il est tel, est nécessairement mauvais, en un sens ou un autre de ce dernier terme. Et si nous répondons positivement à ces deux questions, alors une troisième surgit : qui va prendre sur lui la faute d’être le fatigueur des autres ?
Quoi qu’il en soit de ces problèmes, la pire configuration de ce rapport social est, plausiblement, que le fatigueur se présente comme infatigable à celles et ceux qu’il fatigue. Car lui faire violence peut alors apparaître comme seul moyen de le ré-humaniser, et de recréer une égalité avec lui.
Mais nous y reviendrons, sur celui qui crève, au double sens – pour finir. L’important est maintenant de décrire l’épuisement, cette privation de mes propres pouvoirs d’être moi-même source de phénomènes – d’être celle ou celui qui cause, qui fait, qui est capable – qui participe, en somme, d’être de celles et ceux qui œuvrent au cosmos, à l’origine de l’apparition en ce monde de choses belles, utiles, neuves ou bonnes.
Peu importent ici les discussions possibles sur le sens que nous pourrions donner à chacun de ces derniers adjectifs. Disons plutôt l’évidence. L’épuisement, cette privation de tous mes pouvoirs propres est souvent, si ce n’est toujours, produit par une autre privation, qui la précède : la privation de mon droit ou de ma capacité à ne pas faire usage de mes pouvoirs causaux, privation de toute possibilité de cesser d’interagir avec le monde, de m’en retirer.
L’épuisement est toujours l’épuisement de quelque chose comme une source. Mais l’épuisement a lui-même une source, et celle-ci est la frustration du besoin acosmique. Autrement dit, l’épuisement a typiquement pour cause la privation d’aphanisis, c’est-à-dire la négation de notre besoin de négation, je veux dire notre besoin de sommeil, cette négation transitoire de tous les phénomènes.
Quant au lien entre la crise suicidaire et l’épuisement professionnel (expression qu’il faut décidément préférer à « burn out », dans ce contexte – l’image du puits et de la source y paraissant, réflexion faite, préférable à celle du combustible), peut-être ce lien pourrait-il faire l’objet, à l’occasion des présentes remarques, non pas d’éclaircissements nouveaux, mais de reformulations suggestives, notamment la suivante. La privation de l’aphanisis transitoire du sommeil séduit le sujet du côté de l’aphanisis définitive.
Deux fois, le travail a causé la fatigue. La première, dans notre phylogenèse : c’est le travail de créer les bulles habitables qui a permis que nous soyons celles et ceux qui ont besoin de dormir, et de dormir autant, et aussi profondément ; la fatigue étant le signal de ce besoin, et qu’il est temps de satisfaire ce besoin. La deuxième fois, dans l’ontogenèse, dans l’histoire de chacune et chacun d’entre nous : lorsque nous sommes fatigués, après le travail.
Peut-être pouvons-nous dire que le cœur de nos bulles est en feu. Le feu, le foyer, structure l’espace. Plausiblement, le foyer est ce par quoi un centre et une périphérie sont advenus dans le monde – monde désormais humain. Le foyer, que l’on entretient, pendant que d’autres vont au loin collecter des ressources, suppose nécessairement une division du travail. Mais il y a plus. Sans foyer – ce qu’on entretient, par le travail, ou dont on s’éloigne, pour travailler, et à quoi l’on revient, pour se reposer, ou pour travailler autrement – sans foyer il n’y a, en un sens, ni centre ni périphérie ; mais seulement l’espace, l’espace monotone, sans structure, sans axis mundi, sans même peut-être rien qui soit ni loin ni proche.
Ou bien, si l’on admet qu’il y a du loin et du proche dans un tel espace, il peut être sensé de dire que c’est par le foyer qu’est advenu le prochain, et le rapport au prochain. Sans foyer, ni hospitalité, ni hôte – au double sens : l’accueillant, l’accueilli –, ni hostis, lequel est tout aussi bien l’hostile, l’ennemi, et – mais ils peuvent être et sont parfois le même – l’étranger que nous devons recevoir, et recevoir bien.
En un sens, peut-être, rien n’a changé de nos jours. Travailler, c’est bien souvent encore, indéfiniment, travailler à protéger le sommeil des autres, à assurer leur sécurité sous tous ses aspects, à les rassurer, même les chérir.
Mais beaucoup a changé aussi. Car il y a eu aussi le grand renversement du travail, qui n’en a pas fini de s’opérer, mais dont il faudrait déjà faire l’histoire, un autre jour. Certes ce renversement se préparait depuis longtemps : et notamment dans la propension des humains à voir et aimer voir, dans notre amour pour la lumière. Ce que suggèrent les premières lignes de la Métaphysique d’Aristote : « Tous les humains ont par nature le désir de connaître. La preuve : le plaisir causé par les sensations, et, par-dessus tout, les sensations visuelles. Car, entre toutes les autres, ce sont celles qui nous révèlent le plus de différences ».
Oui, la vue semble toujours de nos sens celui qui nous abonde le plus en phénomènes. Peut-être le moment est-il venu de lire une page de Jean-Marie Pontévia. Il enseigna longtemps l’histoire de l’art et l’esthétique à Bordeaux. Nous trouvons le texte suivant dans son livre La peinture, masque et miroir, premier des trois tomes, tous posthumes, de ses Écrits sur l’art et pensées détachées :
Pourquoi a-t-on toujours privilégié ce qui brille par rapport à ce qui ne brille pas ? Pourquoi a-t-on vu dans la brillance, dans la splendeur, le signe même de l’être ?
Pourquoi l’éclat aura-t-il toujours fait signe ? Signe de rien en particulier, seulement qu’il y a (de) l’être. Mais pourquoi l’être devrait-il se révéler plus justement dans la fulgurance que dans l’hésitation, dans la réfringence que dans l’opacité, dans l’intensité plus que dans l’évanescence ?
Bien entendu, toute cette métaphorique de l’éclat renvoie au prestige métaphysique de la lumière (qui est peut-être autre chose qu’un prestige, mais le centre de fascination de toute existence héliotrope). Mais dans le registre précis de l’éclat, de la brillance, l’économie de la lumière prend un tour particulier. (p. 135 ; je souligne)
Lumière et couleurs, formes du voir, chaque jour nous réassurent que le soleil est revenu, et que persiste le cosmos – que nous y sommes. Voir semble l’antidote à l’aphanisis dans ce qu’elle peut receler de terrifiant.
Mais, chacun le sait, l’antidote à trop haute dose fait overdose. Le don de voir devient poison. Tel est, en substance, le grand renversement du travail que je mentionnais à l’instant. Travailler, travailler aujourd’hui, c’est souvent travailler à capter l’attention des autres, et les stimuler, ces autres, les restimuler et les surstimuler – travailler en somme à les dissuader de jamais se retirer de l’interaction sociale. Par exemple, en les persuadant de voir, même de payer pour voir quelque spectacle très oubliable, pendant le temps qu’ils auraient autrement dédié à leur sommeil. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de produire des contenus pour les écrans. Lesquels contenus peuvent alors être conçus pour créer du temps de cerveau humain disponible au bénéfice de telle marque de soda, que je ne nommerai pas. Je reprends ici les inoubliables mots d’un homme, que je ne nommerai pas, qui fut un infatigable ordonnateur de l’hyperproduction de l’oubliable – quelqu’un qui fut un puissant, et assurément aussi un fatiguant, un fatigueur. L’effet indésirable d’un tel travail sera bien sûr le suivant, ici ou là : ce même cerveau, préparé hier à être disponible pour tel soda, sera fatigué le lendemain ; et de ce fait sera indisponible pour toutes sortes d’autres choses, par exemple pour son travail ou bien, mais c’est la même chose, en pire, pour les apprentissages de l’enfance.
Travailler, aujourd’hui, dans toutes sortes de situations qui ne méritent peut-être pas d’être appelées des métiers, c’est travailler à produire des comportements incompatibles avec la satisfaction du besoin de se retirer, de fermer les yeux, de dormir. La production de tels comportements implique elle-même diverses techniques, en vue de la prolifération des phénomènes futiles – lesquels, tous, tendent à rendre impossible la satisfaction du besoin de l’aphanisis bienfaitrice, réparatrice et bonne du sommeil. Par là, il appert qu’il s’agit dans de telles activités de l’exact renversement de ces autres modalités du travail dont je disais à l’instant qu’elles œuvrent au cosmos.
Notre attirance pour la lumière et les couleurs semble profondément enracinée en nous. Elle tient pour une part, à l’évidence, à la constitution neurophysiologique de notre être humain, laquelle s’est faite, au moins partiellement, par l’évolution de l’espèce. Et l’attrait pour la lumière et les couleurs a plausiblement constitué une chance pour nos ancêtres. Mais cette joie prise à l’éclat semble elle-même devenir notre péril, du fait des biotopes que nous nous sommes créés.
Ici s’ouvre un vaste champ pour la réflexion. Il faudrait considérer tout ce qui, ayant été légué et incorporé à notre chair par l’évolution de l’espèce, tend à devenir notre propre empiègement, même notre poison, par telles ou telles transformations techniques et socio-économiques, et enfin par les mutations dans les conditions biotiques, banales, de notre quotidien. Celles-ci, pourtant – c’est le paradoxe, ou l’antinomie fondamentale – prennent toujours leur origine dans un nouvel usage de ce même legs dans notre chair, qui se trouve ainsi comme retournée contre elle-même. Elle se dévore, elle s’auto-intoxique, par un effet non désirable, et peut-être non désiré, d’une sollicitation nouvelle de ses pouvoirs propres. Tel est le cas lorsque l’attrait pour l’éclat et les couleurs tend à nous priver de sommeil, et à nous fatiguer encore plus. Les enfants français ont, dit-on, perdu en moyenne une heure trente de sommeil quotidien depuis 1980. Je ne sais plus où je l’ai lu, j’ai oublié ; il faudrait retrouver l’information et vérifier. Il faudrait travailler encore : recouper, comparer avec les données disponibles pour les autres pays ; savoir s’il y a en effet un lien, comme c’est plausiblement le cas, entre ce fait, si c’en est un, et la prolifération des écrans. Oui, il faudrait travailler encore. Mais ce sera pour plus tard. Pour l’instant je suis fatigué.
***
ANY WHERE OUT OF THE WORLD
N’IMPORTE OÙ HORS DU MONDE.
Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose, 1869.
Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu’il guérirait à côté de la fenêtre.
Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme.
« Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d’habiter Lisbonne ? Il doit y faire chaud, et tu t’y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l’eau ; on dit qu’elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal, qu’il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût ; un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir ! »
Mon âme ne répond pas.
« Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante ? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l’image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts, et les navires amarrés au pied des maisons ? »
Mon âme reste muette.
« Batavia te sourirait peut-être davantage ? Nous y trouverions d’ailleurs l’esprit de l’Europe marié à la beauté tropicale. »
Pas un mot. — Mon âme serait-elle morte ?
« En es-tu donc venue à ce point d’engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? S’il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la Mort. — Je tiens notre affaire, pauvre âme ! Nous ferons nos malles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l’extrême bout de la Baltique ; encore plus loin de la vie, si c’est possible ; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise qu’obliquement la terre, et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d’un feu d’artifice de l’Enfer ! »
Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie : « N’importe où ! n’importe où ! pourvu que ce soit hors de ce monde ! »
***
Pour aller plus loin
Aristote, Métaphysique, présentation et traduction par Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, éd. GF, 2008.
Isabelle Arnulf, « Le sommeil normal et pathologique », Annales Pharmaceutiques Françaises, 65/4, 2007, p. 239-250.
Charles Baudelaire, Le spleen de Paris. Petits poèmes en prose, présentation et notes de Jean-Luc Steinmetz, éd. Le livre de Poche, 2003.
Michel Billiard & Yves Dauvilliers (dir.), Les troubles du sommeil, éd. Elsevier Masson, 2011.
Byung-Chul Han, La Société de la fatigue, traduit de l’allemand par Julie Stroz, éd. Circé, 2014.
Peter Handke, Essai sur la fatigue, traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt, éd. Folio-Gallimard, 1991.
Michel Jouvet, Le sommeil et le rêve, éd. Odile Jacob, 1992, nouvelle édition augmentée 1998.
Oleg Lyamin, Julia Pryaslova, Valentine Lance & Jerome Siegel, « Animal behaviour: Continuous activity in cetaceans after birth », Nature, 2005, vol. 435, n° 7046, p. 1777-1778.
Jean-Marie Pontévia, Écrits sur l’art et pensées détachées, I. La peinture, masque et miroir, préface de Philippe Lacoue-Labarthe, éd. William Blake & Co., 1993 (première édition 1984).
Jacob Rogozinski, Le moi et la chair. Introduction à l’ego-analyse, éd. du Cerf, 2006.
Jacob Rogozinski, Ils m’ont haï sans raison, éd. du Cerf, 2015.
Pascal Rougé, Penser la fatigue, éd. Le temps qui passe, 2015.
Virgile, Énéide, texte présenté, traduit et annoté par Jacques Perret, éd. Les Belles Lettres, 1981-1989. Nouvelle édition (sans le texte latin) Folio-Gallimard, 1991.












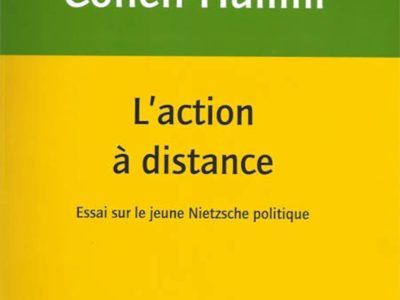



bravo! je crois que c’est bien vu