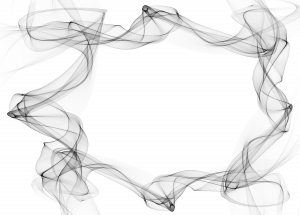La divergence sans la méfiance : confiance conformiste et confiance critique.
Cet article a été publié dans le dossier 2014 – la confiance.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des contributions du dossier
Jérôme Ravat – Chercheur associé au Curapp-ESS (CNRS-UMR 7319)- Université de Picardie Jules Verne
Introduction
La confiance est une dimension centrale de notre rapport au monde. Chaque jour, nous faisons confiance à des idées que nous n’avons pas vérifiées directement, à des personnes ayant observé ce dont nous n’avons pas été témoins, à des experts possédant un savoir que nous ne maîtrisons pas. Comment pourrait-il en être autrement ? S’il fallait vérifier par soi-même, en bon cartésien, chaque parcelle d’information qui nous est transmise, l’épuisement cognitif nous guetterait rapidement.
L’omniprésence de la relation de confiance, toutefois, ne peut manquer de soulever un certain nombre d’interrogations. Ces interrogations concernent en premier lieu les critères de légitimité de la confiance donnée ou prêtée. Pourquoi avons-nous raison de considérer telle ou telle source comme digne de confiance ? Et dans quelles situations, a contrario, notre confiance s’avère-t-elle excessive, disproportionnée, voire dangereuse ?
Le présent article vise à apporter des éléments de réponse à ces questions décisives en opérant une distinction entre deux types de confiance : la confiance conformiste et la confiance critique. Par « confiance conformiste », nous désignerons une confiance peu pourvue de réflexivité, et peu ouverte à la révision. Ceux qui font preuve de confiance conformiste s’en remettent ainsi de manière quasiment automatique aux directions empruntées par la majorité, ou aux figures d’autorité. La confiance critique, au contraire, est une confiance réflexive et révisable, ancrée dans le désaccord ou la possibilité du désaccord, Ceux qui font preuve de confiance critique peuvent faire confiance à autrui sans pour autant adhérer à ses valeurs et accepter sa vision du monde. Ils sont également en mesure d’être en désaccord avec eux-mêmes, et de réviser leurs croyances pour ne plus faire confiance. Enfin, adoptant une posture réflexive, ils peuvent évaluer leurs degrés de confiance. En bref, la confiance conformiste consiste à donner sa confiance, sans possibilité de changement épistémique. La confiance critique consiste à prêter sa confiance, en maintenant la possibilité de la retirer.
A partir de la distinction entre confiance conformiste et confiance critique, nous défendrons une position favorable à ce que l’on nomme le « conciliationisme » en épistémologie du désaccord, c’est-à-dire à l’idée selon laquelle la prise de conscience par des agents également informés et compétents d’un désaccord persistant, conduit ces derniers à mutuellement diminuer leurs degrés de confiance en eux-mêmes pour davantage faire confiance à autrui.
1. La confiance comme réduction de la complexité.
Pourquoi faire confiance ? D’abord parce que le monde physique et social est le lieu d’incertitudes fondamentales. Notre environnement n’est aucunement balisé par des principes inamovibles qu’il suffirait de suivre à la lettre, mécaniquement, pour trouver les bonnes solutions. Au contraire, il est parsemé d’incertitudes, de dilemmes, de désaccords plus ou moins radicaux. Face à ces incertitudes, la confiance s’impose comme une nécessité. La confiance, il importe de le rappeler, est d’abord un besoin, au même titre que le besoin de comprendre le monde environnant, de le contrôler, d’appartenir à un groupe, ou d’être reconnu. Impérieux, ce besoin de faire confiance dissipe le brouillard ontologique qui entoure toute vie sociale, et facilite les décisions pratiques qui s’y établissent.
La confiance, à ce titre, permet d’introduire un certain ordre et une certaine régularité dans un environnement qui n’en est pas immédiatement pourvu. Comme l’écrit le sociologue Luhman, elle permet de réduire la complexité du monde social[1]. Pour Luhman, la confiance est associée à la figure peu rassurante du risque. Faire confiance, c’est prendre le risque de faire un pari qui peut avoir des conséquences fâcheuses s’il est perdu. Toutefois, ce risque est nécessaire car il permet de libérer ceux qui font confiance. En faisant confiance à des personnes précises ou à des systèmes sociaux (par exemple les institutions gouvernementales ou juridiques), il s’agit de réduire la complexité du réel et la part d’incertitude qui l’accompagne, et ce dans la perspective de l’action. L’attribution de confiance rend possible l’anticipation, la connaissance orientée vers l’avenir. En ce sens, le sentiment de confiance irrigue de manière diffuse notre relation au monde social, et constitue une condition de possibilité de nos pratiques les plus élémentaires. Comme l’écrit Luhman, « Certes, l’homme a, en de nombreuses situations, le choix d’accorder ou non sa confiance à divers égards. Mais, s’il ne faisait pas confiance de manière courante, il n’arriverait même pas à quitter son lit le matin. Une angoisse indéterminée, une répulsion paralysante, l’assailliraient[2]. » Si la confiance est un risque, c’est donc, aux yeux de celui qui fait confiance, un bon risque, un risque qui vaut la peine d’être pris.
En tant que nécessité sociale, voire vitale, la confiance se déploie sous deux formes principales : la confiance conformiste et la confiance critique. Nous commencerons par analyser la confiance conformiste.
2. La confiance conformiste
Ce que nous appellerons ici « confiance conformiste » est une confiance qui se déploie pour l’essentiel sur le mode de la soumission et de l’obéissance. Sur le plan pratique, cette confiance conformiste consiste à suivre la majorité ou suivre une figure d’autorité sans adopter de distance critique à leur égard. Ceux qui font preuve de confiance conformiste font davantage confiance aux autres qu’à eux-mêmes.
Nous pouvons distinguer, dans la lignée des travaux pionniers du psychologue Kelman[3], trois figures du conformiste : le conformiste de « complaisance », d’ « identification », et d’ « intériorisation ». Le conformiste de complaisance cherche essentiellement l’évitement de la punition et l’obtention de l’approbation du groupe d’appartenance. Le conformiste d’identification, en revanche, se conforme à des modèles à qui il attribue une valeur, comme ceux qui symbolisent le bien ou l’autorité. Enfin, le conformiste d’intériorisation adhère aux principes de son groupe et se conforme sans subir de contraintes extérieures.
Le fait de suivre la trajectoire empruntée par la majorité est une des formes les plus répandues de la confiance conformiste. Nombre d’expériences conduites en psychologie sociale montrent que les individus ont tendance à faire confiance à la majorité environnante, y compris dans des contextes où ce que pense cette majorité semble hautement invraisemblable[4] Ainsi, dans une expérience pionnière conduite par le psychologue Salomon Asch[5], on présentait à des étudiants des lignes A, B, C, de longueurs différentes, et on leur demandait laquelle des trois lignes correspondait à la longueur d’une ligne étalon. Les participants, avant qu’on les laisse répondre, entendaient d’autres volontaires (en réalité des complices des expérimentateurs) donner des réponses. Les résultats indiquèrent que les étudiants donnaient des réponses erronées, alors qu’il n’y avait pas la moindre ambiguïté perceptive. Les participants voulaient ainsi éviter de porter des jugements allant à l’encontre du groupe. Dans l’expérience initiale conduite par Asch, 74 % des personnes interrogées donnaient ainsi des réponses erronées.
Conformisme de complaisance et conformisme d’identification peuvent également s’entremêler, comme le montre la très célèbre expérience sur la soumission conduite par Stanley Milgram à l’Université de Yale[6]. Il était demandé aux participants d’administrer un certain nombre de chocs électriques à des volontaires et ce, d’après les expérimentateurs, afin de prouver les bienfaits pédagogiques de la punition. Les « victimes » (qui étaient en réalité des acteurs) réagissaient à ces pseudo-électrochocs par des réactions de douleur simulées. Si les participants à l’expérience manifestaient des signes de désapprobation, les expérimentateurs se montraient insistants, mettant l’accent sur la nécessité des électrochocs pour la réussite de l’expérience. Le résultat obtenu dépassa toutes les attentes des expérimentateurs. A la surprise de Milgram lui-même, les sujets furent, dans la majorité des cas, favorables à l’administration des électrochocs, même lorsque ces derniers étaient censés provoquer des douleurs très intenses. En moyenne, 62,5 % d’entre eux allèrent jusqu’à faire subir l’intensité maximale à la victime, c’est-à-dire 450 volts[7]. Un mois après l’expérience, Milgram et ses collaborateurs demandèrent aux participants ayant infligé les électrochocs de justifier leurs actes. Les participants répondirent qu’ils avaient obéi de manière instinctive car ils faisaient confiance à l’autorité scientifique, qu’ils jugeaient légitime et crédible. Dans le cas de cette expérience, on peut dire que le comportement des exécutants était motivé (à des degrés divers) à la fois par le conformisme de complaisance, (dans la mesure où il s’agissait de susciter l’approbation des donneurs d’ordre), et par le conformisme d’intériorisation, dans la mesure où l’autorité symbolique de la science permettait de justifier les électrochocs. Dans un cas comme dans l’autre, nulle distance critique ne venait s’interposer entre les exécutants et leur geste.
Qu’elle repose sur la volonté de susciter l’approbation, l’adhésion à des valeurs, ou l’acceptation de principes, la confiance conformiste se caractérise d’abord par l’obéissance et l’adhésion (mentale ou comportementale) à l’égard des personnes ou des institutions suscitant la confiance. A ce titre, la confiance conformiste ne peut manquer de soulever un certain nombre de difficultés.,
3. De la confiance conformiste à la confiance critique
Les conséquences problématiques de la confiance conformiste sont connues. Accorder une confiance absolue à une autorité ou une majorité peut avoir maintes répercussions désastreuses. Les massacres de masse, les multiples formes du fanatisme politique et religieux indiquent clairement que la confiance aveugle en des systèmes idéologiques peut pousser à commettre les pires exactions. L’histoire des sociétés humaines, à cet égards, témoigne à plus d’un titre des ravages que peut provoquer une confiance peu ouverte à la réflexivité.
La confiance conformiste, en ce sens, peut être décrite comme un effacement de soi. Dans une situation de confiance conformiste, les individus renoncent à leur autonomie, au profit d’une soumission à l’autre, ou aux autres. Ils entrent alors dans ce que Milgram nommait « l’état agentique », ou ce que Michel Terestchenko appelle « l’absence à soi » : les agents font confiance à une volonté étrangère dont ils sont les dévoués et zélés serviteurs, et qu’ils ne remettent aucunement en cause[8]. Ils auront beau jeu, ensuite, d’affirmer qu’ils ne faisaient qu’obéir aux ordres, qu’ils ont agi en « bon fonctionnaire », et qu’ils n’ont, au fond, rien à se reprocher.
A la différence de la confiance conformiste, la confiance critique ne se caractérise aucunement par un effacement de soi, mais nécessite tout au contraire la présence d’une rationalité réflexive, capable de se remettre en question. Ce qui distingue la confiance conformiste et la confiance critique, pour l’essentiel, c’est la présence réelle ou potentielle du désaccord : accorder sa confiance sur le mode critique laisse ouverte la possibilité de suspendre sa confiance et de retirer sa voix. Ce que montre la notion de confiance critique, c’est que le désaccord n’est absolument pas une rupture de confiance, une absence totale de confiance en l’autre. Etre en désaccord, ce n’est pas nécessairement retirer toute confiance à l’autre, et s’installer dans la méfiance ou la défiance, mais simplement lui accorder une confiance limitée et révisable. C’est reconnaître par exemple que nous ne pouvons pas faire confiance à ses valeurs, à ses croyances, à ses principes comme il leur fait confiance. Cette confiance limitée et révisable n’est pas nécessairement problématique, tant s’en faut : elle permet également de libérer un espace au sein duquel nous pouvons davantage nous faire confiance, et construire notre identité morale.
4. Confiance critique et degrés de confiance
La confiance critique, par ailleurs, rend possible l’estimation de nos degrés de confiance. En effet, la confiance, en tant qu’état épistémique, ne saurait être réduite à des oppositions binaires. Elle ne s’oppose pas simplement à la méfiance ou à la défiance. La confiance, au contraire, se manifeste plutôt de manière graduelle : ainsi la confiance peut être indéfectible, forte mais révisable, modérée, faible, extrêmement faible, nulle, etc. L’intensité de notre confiance varie en fonction du contexte dans lequel cette confiance s’applique et du type d’objet vers lequel elle se dirige. Ces degrés de confiance imprègnent nos croyances, nos attitudes et nos actions.
Le fait de pouvoir prendre conscience de ses propres états de confiance a des répercussions fondamentales sur le plan pratique. Il permet d’abord de « rendre explicite », (pour reprendre la fameuse expression de Robert Brandom[9]) les procédures de justification et les engagements existentiels des agents. En effet, comprendre à quel point nous faisons confiance permet d’énumérer les raisons qui fondent nos croyances et nos valeurs, ainsi que les contextes d’action qui les accompagnent. Par exemple, une confiance totale implique qu’une ligne d’action est applicable à tous les contextes. Une confiance faible au contraire, implique que cette ligne d’action s’applique à peu de contextes. En bref, l’accès aux degrés de confiance conditionne l’articulation et la spécification des normes et des valeurs.
Par ailleurs, la connaissance des degrés de confiance permet d’envisager le rapport à l’autre, en particulier dans le contexte du désaccord. Comprendre que l’autre, comme nous, développe des degrés de confiance plus ou moins élevés et plus ou moins variables permet d’éviter l’émergence d’oppositions substantielles et irréconciliables. Décrire les désaccords en termes de degrés de confiance plutôt qu’en termes d’oppositions substantielles, c’est comprendre que la plupart de nos divergences se déploient sur fond de convergence : ils concernent un différentiel de gradation sur une échelle de valeurs commune, et non la confrontation entre valeurs hétérogènes.
5. Implications pratiques de la confiance critique
La distinction entre confiance conformiste et confiance critique a des implications majeures sur le plan social et politique. Ainsi, dans une société ouverte à la pluralité des voix morales, il est important d’envisager la possibilité d’une confiance dans le dissensus, soit une situation dans laquelle les citoyens peuvent se faire confiance, tout en étant en désaccord.
Le vrai problème, dans une démocratie pluraliste, n’est donc pas tant la limitation de la confiance que son absence. Effectivement, si autrui ne nous inspire aucune confiance, si le moindre de ses gestes, la moindre de ses positions suscite le rejet, le mépris, ou la haine, alors nous sommes plus sur le terrain du désaccord, mais sur celui du conflit. Nous sommes dans la relation ami/ennemi, naguère décrite par Schmitt[10], ou encore dans le « choc des civilisations », thématisé par Huntington[11]. Dans ce cadre, l’entente avec l’Autre, et la confiance qu’elle peut contenir, sont effacées au profit d’une relation frontale voire brutale entre les opposants moraux. Nulle possibilité d’entente n’est ici possible.
Comment éviter l’absence de confiance en l’autre, source de conflit, au profit d’une confiance limitée mais respectueuse, pivot du désaccord légitime ? La réponse à cette question, selon nous est claire : il faut laisser le désaccord s’exprimer. L’expression du désaccord est hautement préférable à sa dissimulation, ou à ses tentatives plus ou moins légitimes de neutralisation. Notre position rejoint ici la thèse conciliationiste défendue en épistémologie du désaccord par plusieurs auteurs[12]. Selon les partisans du conciliationisme, le fait de prendre conscience d’un désaccord avec un « pair épistémique » (c’est-à-dire avec un autre agent disposant de compétences cognitives et de connaissances similaires aux nôtres) modifie nos propres croyances dans le sens d’un ajustement des degrés de confiance en direction de l’autre. Si nous sommes conduits à penser, dans le cadre d’un désaccord, que l’autre semble avoir de bonnes raisons de défendre ses positions, que ses arguments sont cohérents, qu’il y adhère sincèrement, cela ne nous poussera pas pour autant à abandonner nos croyances, c’est-à-dire à leur ôter toute confiance. Mais cela peut nous conduire à avoir un peu moins confiance en nos croyances et un peu plus confiance en celles des autres.
En somme, la prise de conscience d’un désaccord entre pairs épistémiques conduit à ce que David Christensen nomme la « modestie épistémique[13] » : face à un interlocuteur que nous jugeons tout aussi raisonnable, censé et informé que nous, nos prétentions à détenir la vérité, à être dans le « bon camp » seront revues à la baisse, de manière plus ou moins significative. Cette situation d’ajustement épistémique est encore plus fréquente s’agissant du désaccord moral, au sujet duquel il n’existe pas, dans la très grande majorité des cas, de fait incontestable permettant de départager une fois pour toutes les positions hétérogènes. Bien entendu, l’alignement doxique et axiologique que décrit la thèse conciliationiste n’est pas toujours possible : des différences abyssales (idéologiques, politiques, religieuses) peuvent séparer les individus ou les groupes, et empêcher les rapprochements. Pour de nombreuses raisons, nous pouvons juger que nos interlocuteurs ne sont pas dignes de confiance, et refuser le moindre pas en leur direction. Il n’en reste pas moins vrai que dans le cadre d’un désaccord entre des êtres se jugeant comme mutuellement équivalents sur le plan épistémique, l’explicitation du désaccord semble à bien des égards préférable à sa dissimulation.
Conclusion
En conclusion, la distinction entre confiance conformiste et confiance critique nous conduit à souligner trois points fondamentaux, ayant des implications à la fois épistémologiques et pratiques :
-Premièrement, il importe de comprendre que la confiance se déploie de manière graduelle. Nous faisons plus ou moins confiance à une idée, à autrui, ou à nous-mêmes. Ce point permet d’éviter les dichotomies contestables (confiance/méfiance, confiance/défiance…) qui ne reflètent pas toute la richesse et les nuances de nos états de confiance.
-Deuxièmement, cette prise en compte de la gradualité de la confiance a des répercussions pratiques fondamentales : être en mesure d’estimer ses propres degrés de confiance permet de réviser ces derniers, dans le sens d’une confiance accrue ou au contraire dans le sens d’une confiance diminuée. D’autre part, l’estimation des degrés de confiance permet de ne pas radicaliser à outrance notre rapport à l’autre et de comprendre qu’une confiance limitée n’est pas nécessairement problématique.
-Troisièmement, la notion de « confiance critique » montre que la confiance peut parfaitement s’accommoder du désaccord. Le fait de faire confiance à autrui n’implique aucunement une convergence totale des opinions, des valeurs, et des modes de vie. Le sentiment de confiance, ici, fonctionne de manière analogue au sentiment de respect. Tout comme nous pouvons respecter autrui sans forcément souscrire à sa vision du monde, nous pouvons lui faire confiance tout en préservant une certaine distance (sociale, morale, politique) à son endroit. Dès lors, dans une société ouverte à la diversité axiologique, métaphysique, et épistémique, ce qu’il importe d’éviter n’est pas tant le désaccord que le conflit, c’est-à-dire la rupture de confiance, et l’hostilité qui l’accompagne. L’enjeu majeur de toute politique démocratique, au fond, est de préserver la confiance dans le dissensus, autrement dit d’œuvrer pour que la divergence ne soit pas synonyme de méfiance.
[1] N. Luhman, La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale, Paris, Economica, 2006.
[2] Ibid., p. 1.
[3] H.C. Kelman, « Compliance, Identification, and Internalization: three Processes of Attitude Change », Journal of Conflict Resolution, Vol 2, 1958, pp. 51-60.
[4] Voir par exemple M. Deutsch, H-B. Gérard,“A study of normative and informational social influences upon individual judgment”, Journal of abnormal psychology, 1955, 51 (3), pp. 629-636 ; M. Sherif, “A study of some social factors in perception”, Archives of Psychology, 27(187) 1935.
[5] S. Asch, “Opinions and social pressure”, Scientific American, 1955, 193(5).
[6] Voir S. Milgram, Soumission à l’autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1974. Cette expérience donna à lieu à célèbre film, « I comme Icare » et en France, elle fit l’objet d’un documentaire, (« Le jeu de la mort ») diffusé à une heure de grande écoute sur France 2.
[7] Lorsqu’on se penche de plus près sur les conditions de l’expérience conduite par Milgram, on s’aperçoit que les résultats varient selon la personnalisation des relations entre les participants à l’expérience. Plus précisément, ils varient selon deux paramètres fondamentaux :
1) la proximité entre celui chargé d’administrer les électrochocs et sa « victime », ou celle entre l’instructeur et l’exécuteur ;
2) la marge de liberté accordée aux exécuteurs.
[8] Voir M. Terstechenko, Un si fragile vernis d’humanité : banalité du mal, banalité du bien, Paris, La Découverte, collection « Recherches : Mauss », 2005
[9] Voir R. Brandom, Rendre explicite, I, Paris, éditions du Cerf, 2010 ; R. Brandom, Rendre explicite, II, Paris, éditions du Cerf, 2011.
[10] Voir C. Schmitt, La notion de politique, Flammarion, 2009.
[11] Voir S. Huntington, Le choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2007
[12] Voir D. Christensen, J. Lackey (dir.), The epistemology of disagreement, Oxford University Press, 2013.
[13] Voir D. Christensen, « Epistemic modesty defended » dans D. Christensen, J. Lackey (dir.), The epistemology of disagreement, Oxford University Press, 2013.