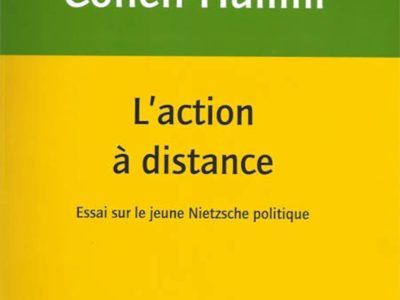La dépersonnalisation comme suspension de la liberté ?
Margaux Merand – Professeur de Philosophie. Doctorante (UMR Inserm U930 ; équipe « Troubles affectifs ») sur l’anorexie mentale dans une double direction de philosophie (Maël Lemoine) et de psychologie clinique (Rémy Potier).
Introduction
Dans cet article, nous faisons l’hypothèse que la conception sartrienne de la liberté permet de mettre en lumière certains des aspects d’une expérience psychologique atypique : la « dépersonnalisation ». Cette dernière est au carrefour de nombreuses pathologies psychiatriques, bien qu’elle soit le plus souvent située, par les descriptions historiques, « dans le cadre de la psychasthénie[1] et des psychoses »[2]. La dépersonnalisation peut néanmoins apparaître indépendamment de tout état pathologique caractérisé, généralement sous une forme « fugace, réversible et transitoire »[3]. Chez le sujet normal, le phénomène est ainsi épisodique et peut ne durer que quelques secondes.
La variété des conditions d’apparition du phénomène en rend difficile une définition cohérente et unifiée. La dépersonnalisation semble susceptible de modalités comme de contextes différents, et cet éclatement est encore complexifié par la difficulté qu’il y a à saisir le phénomène dans les mots – en témoignent les descriptions des patients qui recourent généralement à des expressions « métaphoriques et comparatives »[4] : « comme si… ». La dépersonnalisation est définie dans le DSM-IV[5] comme « une expérience prolongée ou récurrente d’un sentiment de détachement et d’une impression d’être devenu un observateur extérieur de son propre fonctionnement mental ou de son propre corps »[6]. Elle est fréquemment associée à une « déréalisation », définie comme « une altération de la perception vécue comme le sentiment que le monde extérieur est étrange ou irréel »[7].
Si la liberté revient bien, selon Sartre, à s’arracher aux « faits bruts » pour les mettre en perspective par rapport à nos « projets » ; nous pensons que la dépersonnalisation correspond à une suspension temporaire de cette capacité normale de projection qui est en même temps une donation de sens. Bien qu’elle engage des sentiments d’étrangeté et d’irréalité – une déréalisation –, la dépersonnalisation nous semble être paradoxalement un accès brutal à la réalité ou aux choses mêmes. Autrement dit, la dépersonnalisation peut être adéquatement décrite comme une coïncidence momentanée du sujet avec ce que Sartre appelle le « fait brut » : le fait sans la médiation ou le filtre habituel du projet existentiel. Si, dans cette altération de la conscience de soi, le sujet et les autres personnes perçues semblent frappés d’irréalité ; les choses, elles, gagnent une réalité qui s’impose dans sa matérialité brute.
I- La dépersonnalisation comme point de vue asubjectif
La dépersonnalisation est décrite, dans l’article « La dépersonnalisation : le doute d’exister ? » de Didier Lauru[8], comme « un trouble de la conscience de soi ». Nous l’avons vu, elle a différentes occurrences cliniques. Il est cependant possible d’en déterminer certaines constantes :
– Le sujet « sort de lui-même ». Il a le sentiment de ne plus coïncider avec lui-même, du point de vue psychique comme physique. Il est comme projeté « au-dessus » de son corps et de ses pensées qu’il continue à percevoir de l’extérieur, en observateur détaché.
– Ses pensées, ses gestes, qui ne laissent pas de se dérouler, ne lui semblent plus familiers et sont investis d’une étrangeté et d’une distance soudaines. Ils sont perçus comme s’ils étaient les pensées et les gestes d’un autre, dont le sujet est devenu le témoin passif. Il faut ici insister sur le fait que la dépersonnalisation n’est pas une simple forme d’auto-analyse. Il ne s’agit pas, pour le sujet, de se prendre lui-même pour objet de réflexion, comme cela se passe dans la conscience de soi dite « seconde » ou « réfléchie ». Didier Lauru précise en ce sens que « lorsqu’un sujet se perçoit comme objet, cela peut relever de l’auto-analyse, et pas forcément de la dépersonnalisation ». La différence spécifique est que dans l’auto-analyse, le sujet continue à éprouver les contenus psychologiques analysés comme siens. Ici, au contraire, de tels contenus sont observés et presque subis du dehors comme étrangers, dans un sentiment général d’incrédulité et de « perplexité anxieuse »[9]. Si le patient sait que les pensées et les gestes sont bien les siens, il ne les ressent pas tels.
– La dépersonnalisation est pour cette raison vécue comme un épisode dérangeant : le sujet n’est pas en mesure de revenir à lui-même, de faire à nouveau corps avec lui-même, et ne sait pas quand ni s’il pourra le faire. Il y a donc un sentiment d’impuissance, une conscience de l’anomalie de l’expérience doublée d’une attente passive du retour à la perception habituelle, et non altérée, des phénomènes.
– Mais ce qui complexifie encore la dépersonnalisation est que, tout en étant clairvoyant sur le caractère anormal du « point de vue » asubjectif qu’il semble expérimenter – ou point de vue de surplomb sur le sujet qu’il se sait être –, le patient pense confusément qu’il accède à une sorte de vérité. Comme si l’absurdité même de son existence se donnait à voir, dans un éclair de lucidité. Cela se traduit par la superposition de deux plans, de deux types de pensée, ou encore de deux voix. Il y a les pensées que le sujet avait avant même qu’intervienne l’épisode de dépersonnalisation, et qui continuent à se dérouler désormais sous ses yeux, douées d’une résonance inquiétante, tout à la fois « en sourdine », dilatées et éprouvées au ralenti. Et il y a la pensée qui émerge de la dépersonnalisation elle-même, qui semble un « commentaire » des premières pensées. Durant l’épisode, tout se passe comme si le sujet s’adressait ce discours, en apercevant son propre flux de conscience : « oui, je pense telle chose ; oui, je pense telle autre chose à présent ». Les pensées « premières » ou habituelles sont commentées par la « voix » de la dépersonnalisation, qui peut prendre une intonation railleuse ou surmoïque. Cette voix frappe tout ce qu’elle commente de petitesse, d’inanité et de ridicule. Notons en ce sens que le DSM-IV mentionne « différents types d’anesthésie sensitive, un manque de réaction affective, un sentiment de perte de contrôle de ses actes, notamment de ses propres paroles »[10]. C’est proprement la voix « seconde » de la dépersonnalisation qui est hors de contrôle, et revêt un cynisme que le sujet est impuissant à interrompre.
– Enfin, ce n’est pas seulement le flux de conscience qui se dilate, mais plus généralement l’ensemble des objets qui se donnent à voir depuis le point de vue que nous avons dit paradoxalement « asubjectif » de la dépersonnalisation.
II- La dépersonnalisation dans la continuité du trauma : mixte paradoxal de déréalisation et d’accès brutal au réel
Nous trouvons, dans l’épisode 16 de la saison 5 de la série Buffy the vampire slayer (1997-2003) de Joss Whedon, « The Body », une mise en scène particulièrement éloquente du phénomène de la dépersonnalisation. Il est manifeste que le personnage principal, Buffy Summers, en fait l’objet ; et il nous est rendu singulièrement sensible par différents ressorts visuels et auditifs. L’épisode relate la mort de Joyce Summers, la mère de Buffy. Une telle mort est inattendue, car si Joyce a bien eu dans un épisode précédent une tumeur au cerveau, nécessitant une opération d’ablation, les risques de rechute ont a priori été écartés à ce stade de la saison. Buffy pense avoir déjà vécu le pire, et rien ne permet d’anticiper l’événement. La mort de Joyce n’est d’ailleurs pas immédiatement un événement : elle « troue » la trame spatio-temporelle des événements auxquels il était légitimement possible de s’attendre. En ce sens, elle fonctionne réellement comme un trauma ; comme ce à quoi personne n’était préparé et qui n’est pas immédiatement investi de sens :
Le trauma psychologique est la souffrance de l’impuissance. Au moment du trauma, la victime est désarmée par une force qui la submerge. Quand cette force est celle de la nature, nous parlons de catastrophes. Quand cette force est celle d’autres individus humains, nous parlons d’atrocités. Les événements traumatiques noient les systèmes ordinaires d’attention qui donnent aux gens un sentiment de contrôle, de lien et de sens. [11]
Il s’agit bien là du trauma conçu par Freud comme une « effraction »[12] dans l’appareil psychique par suite de l’absence de préparation de ce dernier à l’accident. Le trauma relève de l’impensable, de l’impossible, de ce qui ne peut donc pas vraisemblablement avoir lieu. C’est un « non-événement » au sens où il excède tout horizon d’attente ; à ce titre, il constitue en fait « le Réel », défini par Lacan[13] comme « point de fuite de toute réalité possible à atteindre ». Il est inassimilable, irréductible à toute soudure, et se tient « au-delà du Symbolique » : il est même un trou « dans le tissu symbolique ». Tout l’enjeu de l’épisode est bien de mettre en scène les différentes étapes psychologiques par lesquelles l’événement est finalement accepté par Buffy comme tel, c’est-à-dire non plus déréalisé mais reconnu dans son caractère irréversible, dans le caractère de ce qui a eu lieu. Or c’est justement au moment où cesse le déni que commence l’épisode de dépersonnalisation.
Il faut alors reconnaître tout le statut paradoxal de la dépersonnalisation : consécutive de l’état de choc propre au trauma, elle se situe à la fois dans sa continuité et en rupture fondamentale avec lui. Elle est dans la continuité du trauma parce que l’événement n’est toujours pas investi de sens ; mais elle est en rupture avec l’état psychologique traumatique dans la mesure où elle suit de la reconnaissance de l’événement comme tel. Autrement dit, la dépersonnalisation est ici un stade psychologique transitoire entre le choc traumatique qui n’arrive pas à assimiler que l’événement en est un, qu’il a eu lieu ; et l’état d’acceptation qui non seulement admet la réalité et l’irréversibilité de l’événement mais est à même de lui conférer du sens. La dépersonnalisation présuppose la reconnaissance de la réalité de l’événement, mais elle est constitutivement une incapacité provisoire du sujet à se projeter dans le monde et à lui donner un sens. L’épisode de la série met en scène le passage du trauma à la dépersonnalisation.
Il s’ouvre sur l’arrivée de Buffy chez sa mère. Elle l’appelle mais n’obtient pas de réponse et ne tarde pas à découvrir Joyce étendue sur le canapé du salon, inanimée et le regard figé en direction du plafond. On devine immédiatement la mort du personnage, qui ne fait plus aucun doute lorsque survient le plan de son visage, dont les yeux sont exorbités et le teint cireux. Un flashback interrompt la scène quelques instants ; puis l’on revient subitement au visage de Joyce, inerte. Buffy va alors enchaîner une série de tentatives pour sauver sa mère : elle la secoue, hurle « Mom ! » pour qu’elle se réveille puis appelle les urgences avant de s’essayer elle-même à un massage cardiaque dans l’attente de l’ambulance. La tentative de réanimation est brutalement interrompue par un bruit net qui glace Buffy : celui d’une côte qu’elle a accidentellement cassée dans la cage thoracique. Reprenant le téléphone où le service des urgences est resté en ligne, elle explique qu’elle pense avoir cassé quelque chose, que sa mère ne respire toujours pas et qu’elle est « froide » :
Buffy: She’s cold.
911 Operator: (pause) The body is cold?
Buffy: No, my mum! Sh-should I make her warm?[14]
Une seconde plus tard, Buffy réalise que sa mère est morte. Elle relève les yeux du canapé et aperçoit l’ambulance. Son visage se fige dans une expression d’effroi, et elle ne semble plus regarder nulle part lorsqu’elle reprend pour la dernière fois le téléphone, indiquant qu’elle doit appeler quelqu’un. La dépersonnalisation commence, et elle est visuellement rendue par le procédé de la caméra subjective qui durera quelques minutes. Les objets apparaissent ainsi au spectateur tels que les perçoit Buffy, dont l’état psychologique se traduit par l’impassibilité impuissante propre à la dépersonnalisation. Un silence assourdissant a remplacé la détresse mêlée d’espoir des instants précédents. Il y a
[…] comme une densité d’atmosphère, comme une plénitude du vide ou comme le murmure du silence. Il y a […] quelque chose qui n’est ni sujet, ni substantif. […] c’est anonyme : il n’y a personne ni rien qui prenne cette existence sur lui. C’est impersonnel […].[15]
S’ouvre alors une série de plans vertigineux. Le premier objet perçu sous le prisme désorientant de la dépersonnalisation est le téléphone que Buffy manipule pour appeler son ami Giles. Tout à coup, il occupe l’ensemble du champ visuel, se « détache » sur fond de monde et devient un objet compact, qui nous happe et semble toujours plus grotesque, semblable à un jouet. Abasourdie et « à côté » d’elle-même, Buffy compose machinalement le numéro, et l’on voit les touches du téléphone s’enfoncer lentement, dans un ralentissement hypnotique caractéristique de la dépersonnalisation. Olivier Saladini et Jean-Pierre Luauté précisent que les altérations de la perception tiennent à la déréalisation engagée dans l’épisode de dépersonnalisation, et mentionnent notamment que « les objets perçus sont modifiés dans leurs dimensions »[16]. Après avoir demandé à Giles de se rendre sur les lieux et raccroché, Buffy accueille les secours qui ne parviendront pas à réanimer sa mère.
La scène des secours est, au demeurant, surprenante : elle inclut des tentatives psychologiques, chez le personnage de Buffy, de s’extraire de l’événement. Nous avions dit que la dépersonnalisation succédait directement à l’arrêt du déni, à la prise de conscience du caractère irréversible de la mort de Joyce. Et cependant, au moment où les secours tentent vainement de réanimer sa mère, Buffy s’extirpe mentalement de la situation en fantasmant une réanimation réussie. Le fantasme est rendu dans l’épisode par de rapides enchaînements imaginaires – sa mère se réveille, Buffy pleure de joie, tout le monde se retrouve à l’hôpital pour se réjouir de ce qui ne fut qu’un mauvais rêve, etc. Autrement dit, Buffy veut croire une dernière fois que sa mère n’est pas morte, dans une ultime tentative d’échappement à l’événement qui se traduit par le mécanisme du cinéma intérieur. Cette tentative se soldant par un échec et un retour brutal au fait, incontestable, de la mort de Joyce, l’épisode de dépersonnalisation redémarre. Ainsi, et bien qu’elle puisse être décrite comme un sentiment « d’irréalité »[17], la dépersonnalisation suit ici une deuxième fois de la reconnaissance de l’événement comme ayant eu lieu. Néanmoins, nous le disions, cette reconnaissance ne s’accompagne pas d’une donation de sens.
III- La dépersonnalisation, à la fois reconnaissance de la réalité et impossible donation de sens
Nous pensons que cette impossible donation de sens peut être adéquatement comprise par le détour de la conceptualité sartrienne. La liberté est en effet chez Sartre ce qui me permet d’échapper aux faits pour les mettre en perspective par rapport à mon projet. Ainsi, dans la section de L’être et le néant intitulée « Liberté et facticité : la situation », Sartre prend l’exemple d’un rocher qui n’est pas le même pour moi selon que mon projet est de l’escalader ou de le contempler en me promenant, alors qu’il est pourtant le même en tant qu’être brut :
Me voilà au pied de ce rocher qui m’apparaît comme « non escaladable ». Cela signifie que le rocher m’apparaît à la lumière d’une escalade projetée. […] Ainsi, le rocher se découpe sur fond de monde par l’effet du choix initial de ma liberté. Mais d’autre part, ce dont ma liberté ne peut décider, c’est si le rocher « à escalader » se prêtera ou non à l’escalade. Cela fait partie de l’être brut du rocher. Toutefois, le rocher ne peut manifester sa résistance à l’escalade que s’il est intégré par la liberté dans une « situation » dont le thème général est l’escalade. Pour le simple promeneur qui passe sur la route et dont le libre projet est une pure [appréciation] esthétique du paysage, le rocher ne se découvre ni comme escaladable, ni comme non-escaladable : il se manifeste seulement comme beau ou laid. Ainsi est-il impossible de déterminer en chaque particulier ce qui revient à la liberté et ce qui revient à l’être brut […]. Le donné en soi comme résistance ou comme aide ne se révèle jamais qu’à la lumière de la liberté […].
Le monde en lui-même est totalement étranger, indifférent. Comme ensemble de faits bruts, il est tout à fait neutre. Il n’a aucun sens, aucun mystère, il n’y a rien à y déchiffrer. La reconnaissance de cette indifférence de l’être provoque un sentiment profond : le sentiment d’angoisse. Les meilleurs films d’épouvante savent très bien jouer sur ce sentiment. Il y a, bien sûr, la terreur, qui est un sentiment ayant un objet précis, ciblé, identifié : le géant avec un masque blanc dans Halloween ; le requin blanc avec sa triple rangée de dents dans Jaws. Mais il y a aussi ce sentiment d’étrangeté, d’indifférence du décor. L’impression que quelque chose ne va pas alors que tout paraît normal : une plage sur laquelle des enfants jouent, une paisible banlieue pavillonnaire de l’Americana un soir d’octobre. Soudain, un sentiment nous saisit : le monde est indifférent, comme ce rocher, qui est un fait brut. Mais nous sommes des projets, nous n’existons que comme des libertés. Ce sont nos projets qui vont éclairer le monde, en faire surgir des propriétés, et des propriétés différentes selon nos projets. Ainsi un promeneur un peu rêveur, un artiste, verra le rocher comme beau ou laid ; un alpiniste le verra comme un obstacle qu’il pourra, ou non, escalader. Et alors, le monde s’enchante : les forêts deviennent enchantées ou maudites, les montagnes deviennent des défenses naturelles ou des murailles infranchissables.
Dans la dépersonnalisation, cependant, c’est précisément cette capacité de projection qui est suspendue. Si Buffy est à même de reconnaître l’événement de la mort de Joyce, et est en ce sens dans un état déjà postérieur à celui du choc traumatique ; elle est néanmoins confrontée à cette mort comme à un « fait brut ». Cette mort n’est pas investie de sens, et c’est le monde tout entier qui, par suite, en est momentanément privé. Ainsi la totalité des objets apparaît comme cet ensemble de faits bruts que nous évoquions. La dépersonnalisation est un accès anormal au fait qui est là, et qui se donne comme tel, sans être inscrit dans la relation qu’une conscience entretient normalement avec lui. Si donc il est question d’une perception altérée des phénomènes dans la dépersonnalisation, c’est justement parce qu’ils n’apparaissent plus comme tels, mais comme des faits bruts.
Lorsque Buffy se rend dans la cuisine pour y vomir, puis ouvrir la fenêtre et regarder au-dehors, c’est précisément ce qu’elle perçoit. Tout est banal mais frappé d’une étrangeté où chaque son, là où il est normalement perçu confusément et sans retenir l’attention, se détache distinctement et résonne dans une impression générale de vide existentiel. Parce que l’existence de Buffy est momentanément suspendue[18], elle ne parvient plus à synthétiser l’ensemble des détails auditifs et visuels en une totalité signifiante, et devient sensible à tout ce qui habituellement relève des « petites perceptions » leibniziennes. Chaque détail visuel, sonore, acquiert une autonomie sur fond d’un ensemble désintégré. Ainsi, « le détail domine et le malade a le sentiment de ne pas percevoir l’objet dans sa synthèse »[19]. Le bruit du vent qui secoue les branches des arbres, le klaxon lointain du bus scolaire qui passe chaque jour à la même heure, la musique d’un carillon dans le jardin ; tous ces sons prennent, tour à tour, toute la place. Ils sont là et retentissent dans un espace que Buffy a déserté, qu’elle n’habite plus. Ils sont comme le « rocher » qu’évoque Sartre, « brut » et non perçu de manière différenciée par le promeneur et l’alpiniste.
Si l’épisode s’intitule « The Body », c’est donc parce que le fait brut est au cœur du phénomène de la dépersonnalisation. C’est au moment où Buffy ne dit plus « my mum » – « ma mère » –, mais « the body » – « le corps » ou, dirions-nous, la chose –, que commence la suspension de projection et donc de sens. Buffy reconnaît que le corps n’est plus sa mère, mais appartient désormais au domaine des choses. Et c’est bien dans un tel domaine qu’elle reste elle-même suspendue aussi longtemps que dure la dépersonnalisation, dans un rapport que nous pourrions qualifier de « mimétique » à la mort de sa mère. Si le corps de Joyce est désormais inhabité, Buffy elle-même quitte momentanément son propre corps et devient le témoin d’un monde qui continue à se dérouler sans elle. Elle devient le témoin du monde avec l’œil du mort. C’est ainsi que nous pouvons mieux comprendre que la dépersonnalisation consiste, de manière radicale, à être parmi les choses, dans leur caractère anonyme et impersonnel, asubjectif. Ce caractère est le négatif exact de la liberté au sens sartrien.
[1] « La psychasthénie est une psychonévrose cliniquement caractérisée par l’apparition incoercible, dans la conscience restée intacte, de pensées, d’émotions ou d’impulsions parasites qui tendent à s’imposer au moi, évoluent à côté de lui et malgré lui sans altérer gravement le fonctionnement général du raisonnement, de la mémoire et du jugement, et finissent par déterminer une sorte de dissociation psychique dont le dernier terme est le dédoublement conscient de la personnalité ou le sentiment de la dépersonnalisation. », Pitres A. « La psychasthénie ». In: L’année psychologique. 1903 vol. 10. pp. 284-295.
[2] Saladini O et Luauté JP. Dépersonnalisation. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Psychiatrie, 37-125-A-10, 2003, 10 p.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] American Psychiatric Association, DSM-IV- Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (4e édition), Paris, Masson, 1996.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Didier Lauru, « La dépersonnalisation, le douter d’exister ? », Figures de la psychanalyse, 2004/1 (n°9) ; pp. 87-95.
[9] Ibid.
[10] American Psychiatric Association, DSM-IV, op. cit.
[11] Judith Lewis Herman, Trauma and Recovery, From Domestic Abuse to Political Terror, London, Pandora, 1992, 1997, p.33; nous traduisons.
[12] Freud, Au-delà du principe de plaisir, trad. fr. Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis in Essais de psychanalyse, Paris, Bayot, 1981.
[13] Lacan, Le séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973.
[14] « Elle est froide – le corps est froid ? – Non, ma mère ! Dois-je la réchauffer ? ».
[15] E. Levinas, Le temps et l’autre, 1979, Paris, puf, 1989, p. 26.
[16] Saladini O. et Luauté J.P., op. cit.
[17] Didier Lauru, op. cit., : « Il s’agit d’un état où le sujet se dit modifié de telle façon que sa propre personne comme le monde extérieur ne lui paraissent plus familiers. Il ressent un sentiment d’étrangeté, d’irréalité. ».
[18] Cela peut se traduire par une suspension temporelle : « Certains malades ont l’impression de ne plus percevoir l’écoulement du temps parfois avec un décalage entre temps présent et passé. » ; Saladini O et Luauté J.P. D, op. cit.
[19] Saladini O. et Luauté J.P., ibid.