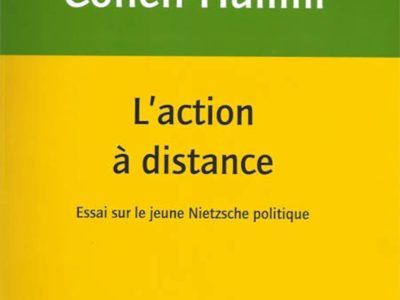La constitution des hiérarchies culturelles (2)
La base historique posée dans le précédent article, il nous semble maintenant urgent d’interroger le projet de démocratisation de la culture afin de déterminer s’il ne se traduit pas, pour ceux qui en sont les premiers « bénéficiaires » par une imposition de sens. Comment s’assurer que ce projet « démocratique » ne relève pas, pour reprendre le concept de Jacques Rancière, d’un partage du sensible contraire à toute politique démocratique comprise comme remise en cause des positions sociales assignées ? N’est pas le produit et le reflet d’un rapport instauré à l’art, qui, devenu légitime induit et impose un type de relation possible et exclusif aux œuvres ?
Ainsi à se tourner trop hâtivement vers des objectifs de démocratisation de la culture nous risquerions d’être aveugles au fait qu’ils s’ancrent dans une période historique et qu’ils représentent une configuration de sens toute particulière ; qu’ils s’enracinent dans une conception de l’art et de la culture, de ce qu’il convient d’ y puiser, de ce qu’il nous faut y ressentir, de la valeur qu’il convient de lui accorder. Levine est limpide sur ce sujet :
« La panoplie des créations, attitudes et rituels culturels que nous avons appris à appeler « haute culture » n’est pas le produit impérissable des âges mais le résultat de l’action d’un petit groupe particulier d’hommes et de femmes à un moment particulier de l’histoire.[1] »
Or que penser quand, de nos jours, « dans les orchestres et les musées locaux, dans les théâtre régionaux, l’art est taillé sur mesure pour plaire aux privilégiés, aux publics mondains et à la bourgeoisie locale » s’interroge Frédéric Martel, « il y a, poursuit-il, un risque que l’expérience artistique ne devienne rien de plus qu’un rituel social, à peine tempéré par un vague sentiment de culpabilité, sinon une forme de condescendance, qui explique les programmes éducatifs (…). [2]»
Programmes pourtant considérés comme importants par nos politiques, en France comme aux Etats-Unis. Voyons ce qu’il en est aujourd’hui de cette culture dans ces deux pays.
Si, à l’action étatique, les Etats-Unis préfèrent les initiatives issues de la société civile celles–ci résultent pour la plupart de riches mécènes philanthropes. Cela n’est pas sans poser une importante série de problèmes relatifs à la définition de la culture et aux modalités des rapports possibles avec elle. En effet comme le soutient Frédéric Martel :
« (…) l’art est soutenu, créé, exposé, grâce au soutien de philanthropes millionnaires, d’institutions élitistes et de mécènes, ce qui confirme la relation un peu étrange entre « hight culture » et aristocratie financière, lien qui est très visible grâce au rôle que joue l’Amérique fortunée dans les conseils d’administration. Qu’elle se rapproche de la France d’Ancien Régime ou de l’Italie des Médicis ne serait pas choquant si l’Amérique n’avait pas érigé la démocratisation culturelle en valeur absolue, pour se distinguer, justement de la culture aristocratique européenne. En même temps, par sa nature même, sa philanthropie et son élitisme, elle montre que la culture y est plus que partout ailleurs une question de classe et de statut social.[3] »
Levine ne dit rien d’autre. Si ce n’est qu’il donne à cette thèse une profondeur historique afin d’en montrer l’émergence :
« Si, comme je le crois, les hommes d’affaires qui géraient les nouvelles chaines de théâtres et les énormes agences de réservation appréhendaient leurs tâches avec une conception hiérarchique de la culture – ils étaient convaincus qu’un fossé infranchissable séparait les goûts et préférences des groupes socioéconomiques variés, et croyaient que Shakespeare faisait partie de la « culture d’en haut », n’avait guère d’intérêt pour les masses, et représentait par conséquent peu de profit potentiel pour les producteurs – nous aurions isolé un autre facteur décisif du passage de Shakespeare de la culture populaire à la culture d’élite.[4] »
A l’inverse, la France fut, et reste très attachée à l’action étatique en matière culturelle. Les mécènes philanthropes trouvent moins d’importance dans l’univers culturel français. Peut-on cependant noter des différences structurantes entre ces deux pays relativement à la question qui nous occupe : les hiérarchies culturelles ? Les objectifs étatiques en matière culturelle « imposent »-t-ils un rapport particulier à l’art ou à la culture ; sont-ils légitimistes ?
Lawrence Levine clos son étude par le propos suivant :
« Les plaidoyers permanents pour que le théâtre de Shakespeare, l’opéra ou la musique classique soient finalement étendus aux masses pour la première fois trahissent un manque de mémoire historique ou de compréhension des contours de la culture de l’Amérique du XIXe siècle[5]. »
Il y eu donc aux Etats-Unis, par le passé, une culture commune, partagée, regroupant ce qu’il est convenu d’appeler l’art légitime, savant, qui s’est vu approprié par quelques uns. Il en fut de même en France et plus généralement dans les sociétés européennes quelques siècles plus tôt. De nombreux historiens s’accordent pour replacer ce phénomène entre le XVI et le XVIIIe siècle[6].
Cette « mémoire historique » souhaitée par Levine nous permettrait-elle d’éviter les travers potentiels de choix politique dont le sens peut demeurer obscur : la démocratisation de la culture et la démocratie culturelle ?
Nous laisserons à la périphérie de notre étude la difficile question de la démocratie culturelle. Devenue en France, depuis le début des années 80, un nouvel objectif politique, cette démocratie culturelle engage à accorder une place à toutes les formes d’expressions culturelles, à les reconnaître comme chacune « légitimes » ; il peut être vu comme un correctif de la démocratisation de la culture jugée par certains trop élitiste et légitimiste. Cet objectif, présent également aux Etats-Unis, entrainent d’importantes modifications politiques et sociales engageant le sens du vivre ensemble. En effet qu’advient-il lorsque n’existe pas, ou plus, une culture commune, partagée entre les membres d’un même pays, lorsque chaque communauté voit sa culture érigée au même plan que n’importe quelle autre ?
Qu’advient-il, symétriquement, lorsque l’accès à cette culture autrefois partagée se voit « confisqué » par une catégorie sociale qui définit les modalités de ce rapport ; impossible démocratisation de la culture ?
Dans la première configuration (la démocratie culturelle) l’art « rassemble les individus d’une même communauté mais sépare et disperse les Américains » et cela se traduit par un manque « de représentation collective, d’éléments de langage communs, d’espace public, d’un cadre d’ensemble[7] » et d’une « dépendance accrue à l’égard des riches donateurs qui composent les conseils d’administration de ces institutions, souvent républicaine. » Le risque est alors de valoriser un certain type de culture (« légitime ») et, pourrions-nous ajouter, certaines modalités, certains rites, dans le rapport à celle-ci.
La deuxième configuration (démocratisation de la culture) nous intéresse davantage ; elle est plus directement présente dans l’ouvrage de Levine.
La démocratisation de la culture est devenue en France, depuis 1958, une mission incombant à l’Etat puis, depuis une vingtaine d’années, aux territoires. Elle a pour objectif de donner accès au plus grand nombre aux œuvres capitales de l’humanité -en un mot à la culture légitime -, ainsi que de soutenir la création. Nous l’entendrons avant tout comme un projet politique, et donc, en ce sens, porté par des individus ayant des intérêts convergents ou divergents, potentiellement incompatibles, mais partageant peut-être des représentations communes non explicitées, non questionnées.
Nous ne traiterons que marginalement du soutien à la création.
Que dire de cette culture dite légitime ? D’où provient cette catégorie de pensée ? Quels sont ses effets sociaux, politiques ? D’où vient que l’on oppose, en France ou plus largement en Europe, la culture populaire à la culture savante, lettrée ; qu’aux aux Etats-Unis l’on parle plutôt de culture « highbrow » (intellectuelle) « middlebrow » (moyen), et « lowbrow » (sans prétention intellectuelle). Les développements précédents apportent des réponses, certes incomplètes et lacunaires, à toutes ces questions. Mais d’où proviennent ces mots ? Rappeler leur origine, leur contexte d’émergence permet de mesurer les valeurs qu’ils transportent et les représentations qu’ils véhiculent.
En effet « highbrow » et « lowbrow, » utilisés pour la première fois à la fin du XIXe siècle pour « décrire », soit la supériorité intellectuelle ou esthétique, soit à l’inverse quelque chose de peu raffiné, de peu intellectuel , « sont dérivés des termes de phrénologie « dolicéphale » (highbrowed) et « brachycéphale » (lowbrowded), qui avaient une place importante dans la pratique, fréquente au XIXe siècle, consistant à déterminer les types de races et d’intelligences en mesurant les formes et contenances des crânes. »
Et Levine d’ajouter que « dès l’époque où elles ont été formulées, des catégories culturelles comme highbrow et lowbrow n’étaient pas vraiment censées être des termes descriptifs neutres. Elles étaient ouvertement associées à l’histoire culturelle et aux valeurs d’un groupe de personnes particulier dans un contexte historique spécifique, dans le but de les préserver, de les développer et de les diffuser.[8] »
Il est difficile d’effectuer des comparaisons avec la France ou l’Europe tant l’établissement des hiérarchies culturelles a dépendu d’un contexte historique particulier. Des points communs existent cependant et relèvent de l’opposition du corps à l’esprit :
« En Angleterre le terme « légitime » ou « régulier » distinguaient depuis longtemps les pièces avec du dialogue parlé de celles dans lesquelles le dialogue devait être accompagné de musique. En 1832, Douglas Jerrold contribua à redéfinir le terme quand il déclara à une commission parlementaire enquêtant sur l’état du théâtre qu’une pièce était légitime «quand l’intérêt de la pièce était mental plutôt que physique.[9] »
Double investissement du corps donc : devant être domestiqué, passif, afin de permettre une nette séparation entre la sphère publique et la sphère privée (processus de civilisation) rendant le rapport à la culture individuel et non plus collectif ; il se voit également devenir un critère permettant, non plus de distinguer un comportement légitime d’un autre ne l’étant pas, mais bien d’établir des hiérarchies entre les œuvres en fonction de leur complexité (supposée comme nous l’avons vu dans le cas de Shakespeare). Levine insiste beaucoup sur ce point.
Revenons un instant sur cette domestication des corps. Pierre Bourdieu a établi une importante théorie sociologique dont l’un des concepts centraux est l’habitus : « extériorisation de l’extérieur intériorisé » ou « extériorisation de l’intériorisation de l’extérieur » pour les formules rhétoriques, ce concept s’avère particulièrement efficace pour comprendre les problèmes qui nous occupent et leur conséquence en termes de démocratisation de la culture.
En effet la théorie de l’habitus explique que « les intérêts, les désirs et les compétences des individus se forment (…) à partir de leur expérience du monde social, de sorte que les pratiques manifestent l’intériorisation par les agents des structures objectives du monde social ». Les « structures objectives » devenant un rapport de plus en plus réglementé, codé, à l’art et de plus en plus distinguant ; les individus intériorisent alors ces structures et se trouvent exclus (plus justement auto-exclus) des institutions d’art et de culture.
Ainsi donc existe au delà « de la singularité irréductible des habitus individuels, une homogénéité entre habitus d’individus occupant des positions sociales proches[10] ». En conséquence de quoi lorsque votre rapport à l’art et à la culture devient normé, dicté par des individus dominants se distinguant et se reproduisant, les mêmes goutent les œuvres, selon leurs codes et leurs rites, et les mêmes restent exclus. Des obstacles symboliques sont alors présents et les hiérarchies culturelles deviennent une arme de ségrégation sociale.
Loin de vouloir remettre en cause ces obstacles symboliques il convient, si l’on veut lutter contre eux, de les contextualiser, de saisir leur contexte d’émergence ; ce que ne fait pas Bourdieu, ce que développe Levine. Ce travail permet, en plus d’éviter les effets sociaux indésirables occasionnés par la théorie bourdieusienne de l’habitus sur le projet de démocratisation de la culture (par une insistance forte sur les déterminants du rapport à la culture devenus alors des déterminismes) de repenser à nouveaux frais les moyens et objectifs de cette belle ambition.
En effet cette exclusion de certaines catégories sociales hors du champ de la culture n’est pas exclusivement imputable aux riches mécènes américains. La France, sous « l’influence » des thèses de Bourdieu soulignant l’influence des obstacles symboliques dans le rapport à la culture, a instauré une importante politique de médiation. Echappe-t-elle pour autant à la posture légitimiste (qui fut celle de Bourdieu) posant qu’un seul type de rapport aux grandes œuvres de l’esprit est possible ? Rien n’est moins sûr. Sa sociologie a aussi un défaut : elle ne parvient pas à penser le rapport à l’art autrement que sur le mode distinctif. Or, là encore il n’est pas certain que ces individus issus de classes populaires dont nous parle Lawrence Levine comprirent leur rapport à Shakespeare de la sorte. Sans doute n’ont ils rien à nous apprendre, nous dirait Bourdieu, tant ils se trouvent prisonniers de leur « pensée pratique » mais tout de même la proposition et les méthodes de Levine méritent qu’on l’écoute. Comme nous l’avons déjà évoqué, Shakespeare plaisait car il incarnait, du moins pour ceux qui le recevait, l’ethos d’une Amérique attachée à la responsabilité individuelle, mais il se voyait approprié de manière différenciée (les classes populaires eurent tendance, par exemple, à confondre la réalité et la fiction).
Mais là encore Bourdieu nous expliquerait que ces individus n’avaient pas accès à « la disposition esthétique » car celle-ci dépend de la détention d’un certain capital économique sans lequel « l’adoption d’un point de vue abstrait et universalisant[11] » s’avère impossible ; point de vue évidemment seul légitime en matière d’art. A quoi bon alors écouter leur voix.
A l’art populaire ses codes propres, son analyse sociale ; à l’art savant ses codes propres, son analyse savante et ses savants !
En effet comme le précise Levine :
« (…) l’adjectif « populaire » n’est pas utilisé uniquement pour rendre compte des œuvres issues de formes d’expression culturelle qui jouissaient d’un large public (…) mais aussi et surtout de celles dont le mérite artistique semblait discutable. C’est ainsi qu’on a inclus dans la catégorie populaire des pièces sans relief ou des romans d’amour mal écrits, même s’ils ne rencontraient pas un large public »
Permettons-nous ici une petite remarque digressive à caractères hypothétique et conclusif.
L’idée répandue de prétendues différences d’intelligence résonne particulièrement en nous, fait écho même. Et Bourdieu y participe.
Etablir de telles différences permet, c’est là une évidence, de diviser l’humanité en plusieurs catégories, ceux qui savent, qui sont aptes à agir, et ceux qui au contraire ne savent pas et se retrouvent inaptes à agir, condamnés à la passivité au nom de leur ignorance, dépossédés de leur parole comme de leur capacité d’action ; ils ont alors besoin de Bourdieu pour pouvoir agir et s’émanciper : problématiques perspectives lorsque l’on se sent attaché à la réalisation d’objectifs démocratiques en matière de culture.
Or, comme s’attache à le démontrer Jacques Rancière, sur la base de documents d’archives précis et éclairants, cette prétendue différence d’intelligence n’est que fiction. Efficace il est vrai quant à ses effets politiques, et quant à sa capacité à reconduire la domination, cependant erronée et dangereuse quant à sa réalité.
Dans cette perspective le savoir devient alors une position, non plus un ensemble de connaissances.
En effet « il n’y a pas deux sortes d’intelligence séparées par un gouffre. L’animal humain apprend toutes choses comme il a d’abord appris la langue maternelle, comme il a appris à s’aventurer dans la forêt des choses et des signes qui l’entourent afin de prendre place parmi les humains : en observant et en comparant une chose avec une autre, un signe avec un fait, un signe par un autre signe.[12] »
De cela découle le principe de non différence entre le maître et l’ignorant, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas ; non différence dans la mesure où :
« L’ignorant progresse en comparant ce qu’il découvre à ce qu’il sait déjà, selon le hasard des rencontres mais aussi selon la règle arithmétique, la règle démocratique qui fait de l’ignorance un moindre savoir. Il se préoccupe seulement de savoir plus, de savoir ce qu’il ignorait encore. Ce qui lui manque, ce qui manquera toujours à l’élève, à moins de devenir maître lui même, c’est la savoir de l’ignorance, la connaissance de la distance exacte qui sépare le savoir de l’ignorance.[13] »
Relativement à l’objectif politique de démocratisation de la culture ces thèses ouvrent de stimulantes pistes de réflexions :
Souligner l’importance de l’observation et de la comparaison dans la constitution lente et progressive du savoir permet d’insister, si l’on applique ces remarques aux champs culturels, sur la nécessité du contact répété avec les œuvres de culture ; les mêmes pièces de théâtre vus dans différentes mises en scènes, différente fréquentation de musée. Car, en observant et en comparant, un travail poétique de traduction se met en place chez l’individu lui permettant une appropriation de contenu. Celle-ci permet l’action.
Nous avons vu à quel point la notion de passivité et d’intellect de connaissance, furent des éléments structurants dans la constitution des hiérarchies culturelles ; l’opposition du voir et du faire, du regard et de l’action.
Or nous explique Rancière :
« L’émancipation (…) commence quand on remet en question l’opposition entre regarder et agir, quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports du dire, du voir et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la sujétion. Elle commence quand on comprend que regarder est aussi une action qui confirme ou transforme cette distribution des positions. Le spectateur aussi agit, comme l’élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il compare il interprète. Il lie ce qu’il voit à bien d’autres choses qu’il a vues sur d’autres scènes, en d’autres sortes de lieux. Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui.[14] »
Ce savoir de l’ignorance fut peut-être à l’origine de la mise en place de ces hiérarchies culturelles. Peut-être devint-il « outil » de mise en œuvre des objectifs d’éducation artistique et des stratégies de médiations ?
Ces hypothèses, au combien discutables et contestables mériteraient d’être démontrées. Nous les avons posées dans le seul objectif de provoquer discussions et réflexions sur les objectifs de la démocratisation de la culture et des politiques culturelles ; quel sens prend l’action politique, quelle est sa fonction … ?
Dans le but également de questionner la sociologie de la culture qui bien souvent opère, lorsqu’elle enquête au plus près des publics, d’importantes différences d’intelligences et présuppose qu’il existe un bon et un mauvais rapport à la lecture : une simple lecture des conclusions des enquêtes effectuées par Olivier Donnat suffit à s’en convaincre. Les univers culturels des français se voient séparés en sept catégories ; si certains français, « moyen » ont un rapport « spectaculaire » à la culture, d’autres en revanche ont la chance de développer « un rapport cultivé à la culture » qu’elle soit classique ou moderne. D’autres encore, et c’est regrettable, se trouvent « démunis ».
Légitimismes disions-nous, misérabilisme faudrait-il ajouter ; problématiques approches lorsqu’il s’agit de démocratisation de la culture ou de politiques culturelles. Problématiques approches lorsqu’on questionne les liens entre politique et culture ; lorsque l’on cherche à faire politique, sens commun, espace public, grâce à l’art et à la culture.
En effet la démocratisation de la culture n’est pas réductible à un projet d’élargissement du nombre de visiteurs ou de spectateurs ; pas non plus à une ambition d’ordre plus sociale visant à diversifier socialement les publics. Bien plus, elle doit prendre pour objectif la relation entre les individus (ou les groupes sociaux) et les œuvres ; ce que firent les riches mécènes américains mais dans un but inverse à celui que nous partageons.
François Carrière
[1] ibid., p.251.
[2] Martel Frédéric, De la culture en Amérique, p.549.
[3] ibid., p.531-532.
[4] Levine Lawrence, Culture d’en haut culture d’en bas, p.93.
[5] ibid., p.252.
[6] Comme le rappelle Roger Chartier dans sa préface : « Cette compréhension des trajectoires culturelles américaines est étrangement proche de celle que certains historiens ont proposé pour les sociétés européennes entre les XVIe et XVIIIe » p.7.
[7] Martel Frédéric, De la culture en Amérique, p.548.
[8] Culture d’en haut culture d’en bas, p.231.
[9] ibid., p.89.
[10] Nordmann Charlotte, Bourdieu/Rancière, p.21
[11] ibid., p.28.
[12] Rancière Jacques, Le spectateur émancipé, p.16
[13] ibid., p.15
[14] ibid., p.19