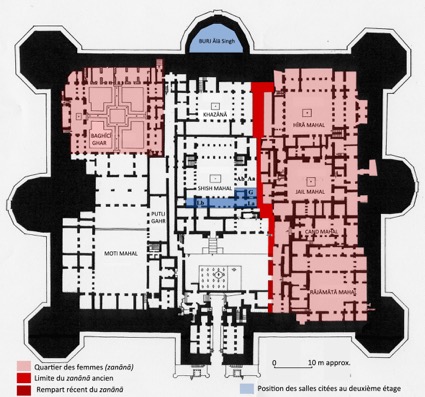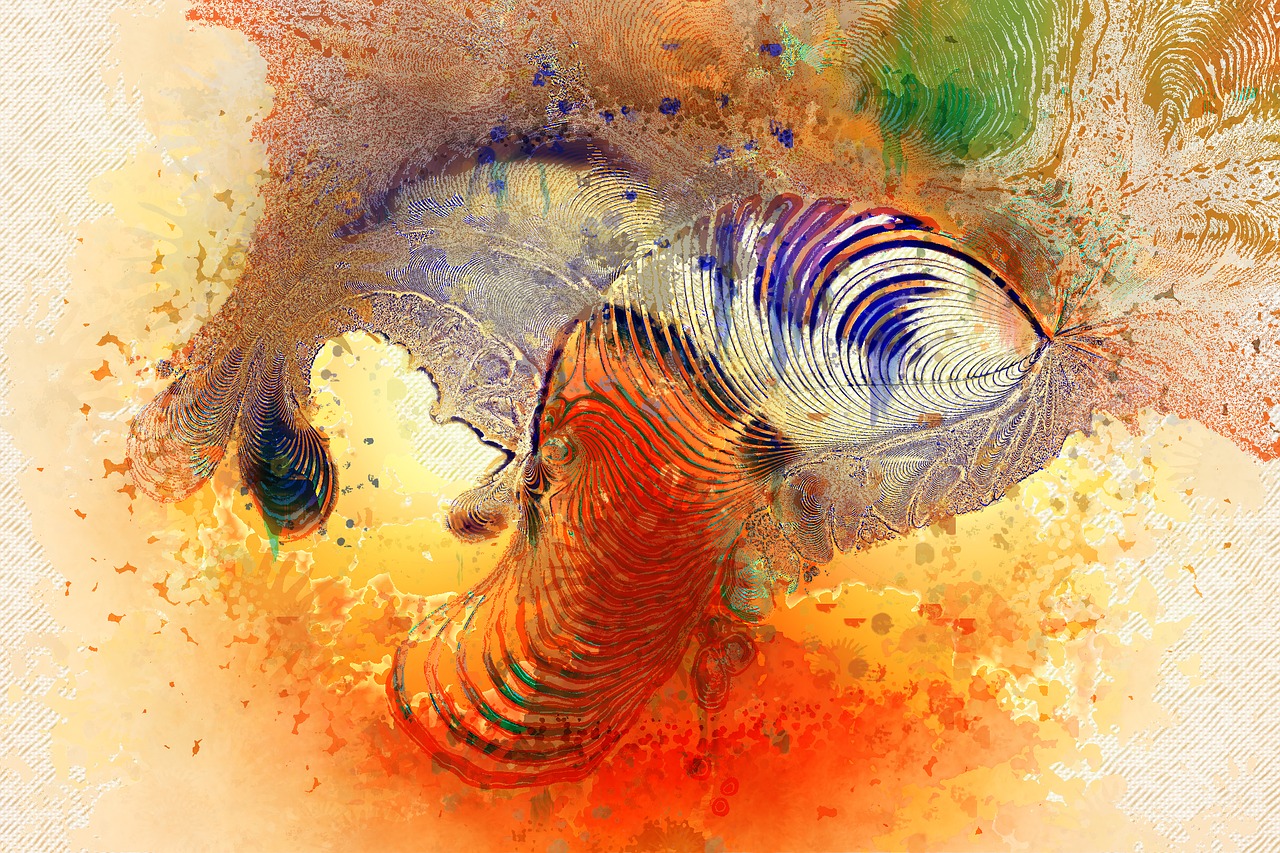Iran : un siècle d’art plastique et trois générations d’artistes féminines
Fery Malek-Madani-
Cet article doit être pris comme le témoignage d’une époque, pas si lointaine mais pleine de soubresauts et de changements (il y a trois ans déjà qu’il a été écrit et remis.
Entre temps, l’Iran a pu signer un accord sur son programme nucléaire avec les grandes puissances du monde, réintégrer doucement le concert des nations et sortir de son isolement. Désormais, le monde s’intéresse aussi à son art, à ses artistes, à sa société…
Wim Delvoye, le célèbre artiste contestataire belge, a exposé au Musée d’art contemporain de Téhéran en 2016, et le fameux trésor d’art contemporain occidental qui croupissait dans les caves du musée ainsi que les œuvres des grands maîtres iraniens vont être exposés à Berlin en cette année 2017.
Les résidences d’artistes se développent à Téhéran ainsi que dans quelques villes de province et des échanges sont en cours. Tout cela évidemment est prometteur et nous laisse croire à un avenir encore plus radieux.
Qu’il en soit ainsi.
Bruxelles, le 13 juillet 2017
www.artcantara.be
En novembre 2012, une exposition réunissant trois générations de femmes peintres s’est tenue dans la galerie Pardis à Téhéran. Peu de pays de la région peuvent se targuer d’avoir déjà trois générations de peintres dans leur histoire moderne. Si les artistes féminines iraniennes ont commencé avec la peinture, depuis les années 1990, elles sont nombreuses à faire de la photo et, aujourd’hui, elles sont également férues d’art conceptuel, baptisé en persan « honare jadid » (« nouvel art »), à savoir la vidéo, la performance et l’art sonore.
C’est sous la dynastie des Qadjars, en 1911, que Kamal-el-Molk, peintre à la Cour ayant étudié l’art en Europe, crée l’Ecole des Beaux-Arts à Téhéran. Il faudra attendre après la Deuxième guerre mondiale, en 1949, pour voir inaugurer à Téhéran la première galerie d’art moderne : « Apadana ». En 1958, l’École des Arts Décoratifs est inaugurée à Téhéran avec l’enseignement de nouvelles disciplines telles que le graphisme et l’illustration des livres.
De nombreux étudiants sortis de ces écoles poursuivent leurs études à l’étranger, particulièrement à Paris, Bruxelles et Rome, et retournent ensuite au pays influencés par les avant-gardes européennes et américaines. Ce développement est soutenu par le gouvernement : il organise la première Biennale de Téhéran qui connaîtra cinq éditions. La première génération de femmes peintres est issue de cette période. Parmi elles, Shokouh Riazi, Behjat Sadr, Massoumeh Seyhoune, Massoumeh Hosseini, Monir Shahroudy Farmanfarmaian.
Avec l’essor de la modernisation dans les années 1970 et l’enrichissement en pétrodollars, ce qui relève de la tradition est mis à l’écart. L’engouement « moderniste » inspiré par les écoles occidentales marginalise complètement la miniature, la calligraphie, les dessins de roses et de rossignols.
Une des peintres qui illustre bien ce rejet de la miniature pour y revenir quelques années plus tard est Farah Ossouli (1953). En fait, durant ses études, cette dernière avait appris la maîtrise parfaite de la miniature, dont les règles sont très rigoureuses. Mais justement à cause de l’atmosphère très occidentalisée de la société de cette époque, elle refuse de faire des miniatures. Au contraire, elle se lance dans les arts graphiques. Quelques années plus tard, c’est en illustrant les travaux de son mari cinéaste qu’elle redécouvre la miniature, qu’elle façonne alors à sa manière et qu’elle appelle « l’abstrait géométrique ». Chez elle, la miniature est un moment. Les couleurs sont assez foncées, à l’opposé des couleurs classiques. Ses sujets sont souvent inspirés par son imaginaire, son entourage, ses sensations du moment et, parfois, par les poésies qu’elle lit. Ce moment qu’elle raconte est inscrit dans un plan très dépouillé, à l’inverse de la miniature classique où il y a juxtaposition de scènes différentes. La femme est son héroïne favorite, et la scène se déroule toujours dans un monde irréel d’images, entre le rêve et la réalité. C’est une démarche philosophico-historico-sociale qui la ramène à ses origines et qu’elle retravaille avec un modernisme étonnant.
Dans l’entretien que j’ai eu avec elle en janvier 2011 dans le cadre de la préparation de l’exposition collective à Bruxelles « Dix femmes peintres d’Iran, dix ans après », elle expliquait comment la violence ambiante à la suite des manifestations réprimées après les élections contestées de 2009 avait marqué son imaginaire.
« À l’époque safavide, il arrivait qu’on enlumine les dessins avec des vers et des motifs. J’ai réalisé une œuvre que j’ai intitulée “Vincent, Reza et moi”, qui est une interprétation de l’œuvre de Reza Abbassi (l’immense miniaturiste iranien du XVIIe siècle) où un personnage se met du khôl. J’ai transformé l’étui du khôl en couteau. J’ai orné l’œuvre avec des motifs de revolvers. Au départ, lorsque vous regardez ce travail, vous ne voyez qu’une enluminure. Mais c’est un revolver qui a tué Van Gogh, ou beaucoup d’autres peintres, et qui en tuera encore d’autres. Mais c’est si joliment décoré et présenté… Comme si ce revolver était quelque chose de bien alors que ce n’est pas une bonne chose. En fait, ce sont des méthodes qui se sont ajoutées à mon travail et des paroles qui sont en accord avec mon humeur présente. Maintenant, j’ai envie de dire des choses, avec une apparence de manière à l’ancienne, qui retourne à l’époque safavide. J’ai envie de tromper les gens, de les appeler, de les faire s’approcher et réfléchir sur ce qu’ils voient.
Évidemment, j’ai été influencée par tous ces événements malheureux de ces dernières années, et tout cela heurte ma sensibilité d’artiste. Quand il y a cette douleur, elle ressort involontairement dans votre travail.
À travers cette série d’œuvres qui s’inspirent des grands chefs-d’œuvre du monde, j’ai aussi voulu avoir notre regard (le regard d’Iranien) sur ces artistes avec notre propre réaction. C’est un dialogue entre moi, et un artiste d’il y a 200 ans, qui a disparu, qui est parti dans un “non lieu”. Ce “non lieu” est le territoire de l’art, qui ne connaît pas de frontières et qui me fait sentir que je suis compatriote de Van Gogh. »
Elle me confiait aussi que, pour une exposition aux États-Unis, la commissaire lui avait demandé de lui envoyer les critiques parues sur elle dans la presse iranienne. À son grand désarroi, il n’y en avait pas. Aujourd’hui encore son œuvre n’inspire pas les critiques intérieures. C’est ce désintérêt qui fait dire au grand historien d’art moderne iranien Rouine Pakbaz : « Contrairement à leurs collègues occidentaux, les artistes iraniens ne se sont jamais adonnés à des discussions, c’est-à-dire que, si l’un d’entre eux arrive à un résultat quelconque, l’autre ne voudra pas ou ne pourra pas y répondre par ses propres expériences. C’est pourquoi le modernisme iranien, au cours de son histoire sexagénaire, n’a jamais connu d’école constituée. »
L’Impératrice Farah Pahlavi, grande amatrice d’art, lance la création du Musée d’Art Contemporain de Téhéran qui sera inaugurée en 1977, seulement deux ans avant l’avènement de la République islamique. Des émissaires sont envoyés dans le monde pour acheter les œuvres qui constituent – encore à ce jour – la plus grande collection d’art moderne et contemporain occidental hors de l’Europe et des États-Unis. Cette collection est conservée aujourd’hui dans les sous-sols du Musée et n’a été exposée qu’une seule fois en 33 ans au public, après une sélection ayant ôté les pièces trop osées ou avec des sujets dénudés, contraires au code de pudeur en vigueur dans le pays.
Un mouvement populaire détrône en 1979 Mohammad-Reza Pahlavi, le roi des rois de l’Iran, et met ainsi fin à un pouvoir autoritaire d’un monarque qui tissait un grand destin moderne pour l’avenir de son pays. La révolution est récupérée, ou diraient certains confisquée par les couches religieuses et le clergé chiite. Une République islamique est proclamée à l’issue d’un référendum.
Les premiers à subir les affres du nouveau régime sont les femmes et le monde artistique. Aussitôt au pouvoir, la loi sur la protection de la famille, qui octroyait une série de droits aux femmes, est abrogée et remplacée par un code juridique islamique. Le port du voile devient obligatoire pour les filles à partir de l’âge de la puberté.
C’est la révolution culturelle, un vrai cataclysme avec des conséquences incalculables, qui décide de la fermeture des universités pendant deux ans pour laisser le temps de repenser et refonder l’enseignement selon les préceptes islamiques et idéologiques de la nouvelle République.
Les galeries d’art sont inactives, beaucoup d’artistes s’exilent. Aux yeux du pouvoir, l’art de ces artistes n’a pas de lien avec le peuple. Beaucoup d’enseignants sont expulsés des facultés d’art. Ce seront eux ainsi que beaucoup d’autres peintres qui créeront des établissements privés dont les classes rencontreront beaucoup de succès auprès des jeunes. Curieusement, le nombre de filles dans ces classes sera bien supérieur à celui des garçons. Une étude de 2012 de l’Université de Téhéran révèle que les jeunes femmes représentent 70 % des places dans les facultés de peinture. Et 60 % des membres des associations des peintres sont féminins. L’étude conclut ainsi : « Cette augmentation a indéniablement changé l’image de la femme dans les œuvres. »
Pendant la préparation de l’exposition « Dix femmes peintres d’Iran » qui a eu lieu à Bruxelles en 2001, je découvrais avec étonnement que le sujet traité par ces peintres que je rencontrais était presque uniquement la femme. À ma question : « Pourquoi la femme iranienne est-elle le personnage central de vos œuvres ? », elles me répondaient :
« Parce qu’elle a été toujours peinte par les hommes, et aujourd’hui nous voulons avoir notre regard sur nous-mêmes », « Pour affirmer notre présence car elle a été oubliée trop longtemps peut-être ? ».
Leurs figures féminines n’étaient plus la femme chaste et pieuse, telle Fatemeh Zahra, la fille de Mahomet, l’archétype de la perfection faite mère et épouse, ou de Zeinab, la sœur de Hossein, la personnification du combat et du courage contre l’injustice au féminin. Mais bien la femme contemporaine, active, moderne, qui séduit et désire, qui conteste et se rebelle. Un regard nouveau, une autre vision de la femme se dévoilait dans leurs œuvres. Ce changement d’image de la femme est encore plus remarquable dans l’exposition « Unexposed » 2012-2013 dont je parlerai plus loin.
La guerre Iran-Irak éclate en 1980 et dure pendant huit ans avec son lot de morts, blessés et orphelins. C’est à cette époque que les murs des grandes villes deviennent l’atelier à ciel ouvert des artistes révolutionnaires, nourris au nationalisme religieux dans un style socio-réaliste. Ces fresques gigantesques ont pour thème la glorification du Guide de la révolution, des soldats tombés sur le front élevés au rang de martyrs, exaltant le sacrifice de leur vie identifiée à une envolée spirituelle et une renaissance dans l’au-delà. Ces fresques sont rehaussées par des slogans stylisés exécrant l’Occident, les arrogants, les incroyants.
Cette guerre reste un importante dans la représentation artistique et ce, à deux niveaux :
– comme support aux efforts de guerre et à la glorification de l’armée et les combattants durant les années 1980-88
– comme traumatisme dans l’imaginaire des artistes d’aujourd’hui qui ont vécu cette guerre durant leur enfance
Ce traumatisme est notamment présent dans l’œuvre « Fear of darkness » de Neda Moradi (1984), participante de l’exposition « Unexposed ». C’est une sculpture en forme de trou d’aération rectangulaire muni d’une grille d’où sortent des petits soldats. L’artiste présente son œuvre comme suit : « J’ai passé mon enfance durant la guerre Iran- Irak. Dans la peur. Avec un sentiment d’insécurité. Même dans ma chambre. Peur d’une attaque, surgissant de n’importe quelle issue, de n’importe quel trou. L’attaque des soldats armés. Des soldats armés dont l’un aurait pu être le père d’une enfant comme moi ! »
Bien que le premier appareil photo ait fait son apparition en Iran vers 1850 entre les mains du roi qadjar Nasseredin Shah et que ce rôle précurseur aurait pu destiner l’Iran à avoir une grande tradition photographique, c’est pendant la Révolution et la guerre Iran-Irak que les photographes ont connu leur âge d’or.
Beaucoup de photos prises à l’époque des Qadjars sont archivées aujourd’hui au Musée Golestan à Téhéran et sont un formidable outil de travail pour les chercheurs. Elles sont classées par métiers, objets, personnalités de l’époque,… et n’ont encore jamais été exposées pour le grand public.
Les grands photographes qui se sont révélés pendant la guerre, sur le front, ont formé les étudiants qui ont pu bénéficier de ces cours enseignés à partir de 1990 dans les facultés artistiques. Ces jeunes photographes se défendent plutôt bien sur le plan international, si on se réfère aux nombreux prix obtenus dans différentes compétitions à travers le monde.
Shadi Ghadirian (1974), artiste aujourd’hui mondialement connue, a débuté sa carrière avec une série nommée « Untitled from the Qadjar serie 1998-99 » dans laquelle elle photographie des femmes en costume de l’époque qadjare aux côtés d’objets du quotidien. Par exemple avec une radio ou une cannette de Coca. Pour l’anecdote, elle expliquait que : « Lors de ma première exposition en Europe, le public ne comprenait pas ma mise en scène et croyait que c’étaient les vraies images des femmes d’Iran aujourd’hui ! » Son travail consiste à révéler au grand jour l’existence schizophrénique à laquelle sont contraintes les femmes iraniennes. Un thème très cher à une grande majorité des jeunes artistes iraniennes.
Après la fin de la guerre, la période de la reconstruction est suive par l’élection inattendue du président Mohammad Khatami, ex-ministre de la Culture, religieux modéré. C’est sous ses deux mandats (1997-2005) que l’Iran s’ouvre. Il initie « le dialogue des civilisations » et essaye de remettre l’Iran sur la scène internationale. Son ministre de la Culture – aujourd’hui damné par le régime et exilé en Grande-Bretagne – a prôné dès son arrivée l’ouverture vers l’Occident et l’assouplissement de la censure.
C’est de cette époque que date la fermeture du bureau de censure pour l’art plastique. Auparavant, lors d’une exposition, il fallait lui soumettre la liste des œuvres, et la galerie s’organisait en fonction de l’avis du bureau. Mais, depuis lors, c’est à la discrétion du responsable de la galerie que revient le choix des œuvres qui doit cependant respecter la ligne rouge de la morale islamique. Tout en sachant que cette ligne rouge est élastique et dépendra du voisinage de la galerie (quartier riche ou pauvre), du public (laïc ou religieux), géographique (Téhéran ou la province),… Actuellement il y a des galeries qui ont même une salle privée pour les visiteurs privilégiés proches et fiables qu’on est certain de ne pas choquer !
L e Musée d’art contemporain dépendant du ministère de la Culture et de la Guidance islamique sera pendant toutes ces années (période des réformateurs) sous la direction d’Alireza Sami Azar, étudiant révolutionnaire, anti-occidental des années 1980, aujourd’hui conseiller auprès des grandes maisons de vente aux enchères dans les Émirats et en Grande-Bretagne, et vivant toujours en Iran.
C’est grâce à cette institution et à d’autres que la nouvelle génération éduquée, urbaine, sortant des facultés d’art, voit mis à sa disposition des facilités et des soutiens. C’est aussi avec l’aide directe ou indirecte du Musée d’art contemporain que plusieurs grandes expositions d’artistes iraniens sont organisées dans le monde et que le dégel culturel porte ses fruits.
À partir de 2006, avec l’installation des grandes maisons de vente d’art à Dubaï, le marché de l’art iranien a pris un essor phénoménal. Même si cela ne concernait au départ que les célèbres artistes de la génération « moderne », des œuvres des jeunes artistes ont également battu des records. Cela a influencé les prix du marché interne et la floraison des galeries d’art dans le pays.
Lili Golestan, galeriste de longue date, disait : « Je reçois régulièrement dans ma galerie des gens sans aucune connaissance artistique qui me montrent une liste d’artistes dont ils voudraient acquérir des œuvres. Ce sont des gens qui se sont enrichis rapidement et qui, après avoir vidé les magasins d’antiquités, viennent aujourd’hui, sur les conseils de leurs enfants, acquérir des œuvres modernes contemporaines qui ont la cote. »
Depuis 2005, avec l’élection de Mahmoud Ahmadinejad, il y a un changement dans la politique culturelle. La fréquentation des expositions continue et se développe ; mais, cette fois, les artistes ne peuvent compter que sur un soutien privé via les galeries privées et indépendantes. Ces galeries n’ont pas pignon sur rue et sont au nombre approximatif de 150 à Téhéran et 30 en province. Elles sont installées dans des appartements résidentiels transformés en espaces d’exposition, ce qui sous-entend des superficies allant rarement au-delà de 200 m².
Le nombre d’artistes ayant explosé ces dernières années, la liste d’attente avant de pouvoir exposer est de trois ans. Étrangement, ces galeries sont détenues à 99²% par des femmes. « Les autorités estiment que ce métier n’est pas sérieux pour les hommes », ironise une amie galeriste. Les expositions changent toutes les semaines. Aujourd’hui, chaque dernier jour de la semaine, la jeunesse téhéranaise passionnée par l’art arpente la ville au gré des galeries.
Si la guerre Iran-Irak a frappé l’imagination des artistes de l’époque, un autre événement suinte dans les œuvres de la jeune génération d’artistes, celle qui est née après la révolution de 1979 : les manifestations de 2009. Car c’est surtout cette génération issue de la classe moyenne des grandes villes, éduquée, souvent étrangère à l’idéologie de la révolution et au sacrifice de la guerre, qui y a largement participé. Cette jeunesse a contribué aux élections en espérant que leur vote pour un candidat réformateur apporterait l’ouverture et le changement auxquels elle aspire.
C’est à cette génération que je me suis adressée pour l’exposition « Unexposed » qui a voyagé de novembre 2012 à juin 2013 de Bruxelles à Varsovie via Athènes, par un appel sur Facebook en exigeant trois critères : être une femme iranienne née entre 1971 et 1991, vivant et travaillant en Iran, et avoir déjà fait une exposition. Avec l’aide d’un comité de sélection composé de journalistes, d’académiciens, de sociologues, de galeristes et d’artistes confirmés, j’ai sélectionné 40 artistes parmi les 400 dossiers envoyés qui remplissaient ces trois critères. En Iran, je les ai rencontrées une à une, et j’ai choisi parmi leurs œuvres qui n’avaient pas encore été exposées dans le pays, ou celles qui avaient été refusées pour participer à une exposition. D’où le nom « Unexposed ».
Au total, 75 œuvres constituent cette exposition. Beaucoup de peintures et de photos ainsi que quelques sculptures. Bien qu’aucun thème n’ait été imposé, des dénominateurs communs en ressortent indéniablement :
– le rapport au corps : dans la peinture de Sepideh Nourmohammad Manesh (née en 1979) « Untitled » (100×100 cm), on voit une femme assise en petite tenue dans une salle de bain face au mur dont le carrelage est taché de sang. « Je travaille avec des modèles, je mets dans mes tableaux l’idée de sacrifice, le sang pour rappeler toutes les lois discriminatoires qu’on doit transgresser tous les jours en Iran en tant que femme. Le corps de la femme en Iran est un champ de bataille, et chaque acte érotique prend une signification de résistance. » Ce tableau ne peut évidemment pas être exposé en Iran.
– l’hypocrisie de la société : dans le triptyque photo et collage de Fariba Dehghanizadeh (née en 1988), « Untitled » (90×270 cm), on découvre son autoportrait sans maquillage et le crâne rasé, entouré de deux miroirs au-dessus desquels pendent des cheveux noirs coupés. C’est une œuvre puissante qu’elle relie à son histoire personnelle. « Ma rencontre avec un homme que j’aimais et que je voulais épouser a tourné court, car sa famille ne voulait pas d’une bru sans tchador (long voile noir porté par les femmes en Iran, un code vestimentaire en vigueur dans les familles très religieuses et traditionnalistes). Cette rupture m’a bouleversée, et j’ai fait cette œuvre pour dénoncer l’hypocrisie dans laquelle nous grandissons, où la seule valeur importante pour une fille est le respect de son apparence. Je bannis ces cheveux qui sont la cause de mon malheur, je ne les veux plus et je me rase la tête. »
– l’identité de femme : dans le tableau mixed media « Left alone in abyss » (120×80 cm) de Zahra Maddah (née en 1976), on voit dans le bas de l’œuvre une femme kurde complètement ensevelie sous un châle qui ne laisse passer que ses yeux baissés et au-dessus de la toile un homme stylisé, sérieux et couché. Des graffitis dorés sont les seuls liens entre ces deux êtres. Elle m’a expliqué qu’elle avait réalisé cette série de tableaux en s’inspirant de son propre poème :
« Tout a commencé à la conception
Tu n’auras plus de droit
Ni de protester, ni à la liberté, ni à l’abandon
Car tu es une femme
Désormais tu dois avoir honte
Ne pas rire pleinement, ne pas protester, rester calme et obéissante
Car tu es une femme
Tu es née
Chaque jour s’ajoute un fardeau
On y ajoute une barrière
Tu traverses le chemin et tu grandis
Car tu es une femme
Tu grandis et tu te trouves au milieu des contradictions
Entre hier et aujourd’hui, entre désir et attente
Entre l’idée et l’action
Car tu es une femme
Mais tu ne supportes pas tant de peine
Tu ériges ta pensée et exiges ton existence
Alors tu cries
Tu t’adoucis, tu apparais dans mes dessins
Car tu es un être humain
Mes traits et mes couleurs se sont bouleversés et sont devenus tous des cris
Un cri à toutes les discriminations, à toutes les contradictions, à toutes les barrières
Car avant d’être une femme, tu es un être humain. »
– le contrôle de l’espace privé et des médias par le pouvoir politique : dans la peinture « Contemporary Paradox » (100x120cm) de Shima Sohrabi (née en 1981), une foule indistincte est représentée en rose et blanc. Elle a peint les photos qu’elle a prises durant les manifestations de 2009 avec son téléphone portable. Lorsque l’on se met devant le tableau avec un portable en mode caméra et en mode négatif, on aperçoit la vraie prise. « Nous sommes toujours devant deux réalités, la réalité officielle et la réalité pure. Et je me suis servie de ce téléphone portable comme d’un pont pour rendre visible ce qui est invisible, une manifestation oui mais pacifiste. »
– la transition entre la tradition et la modernité : la sculpture nommée « Precious » (200x110x60cm) de Farnaz Rabieijah est constituée d’une grande antenne parabolique noire qui déverse des lettres de l’alphabet persan en couleur argentée. « Cette œuvre montre la dévaluation progressive d’une culture. La plaque représente la complexité d’un pays et les mots sont le symbole de la culture, de la langue, de la poésie et de la littérature qui sortent de la plaque, et rien ne pourra les remplacer et remplir la plaque à leur place. Il semble y avoir une inquiétude croissante au sujet de la préservation de notre patrimoine culturel, mais il apparaît que la préoccupation n’est qu’un prétexte et, en réalité, notre culture sera bel et bien oubliée et perdue à jamais. »
Dans les critiques des œuvres des artistes iraniennes, on rencontre souvent ces mots : schizophrénie, hypocrisie, hybride, paradoxe, fil rouge… C’est leur façon de contourner, de détourner leur constat d’une société qui les place dans une relation d’amour et de haine.
Elles n’ont jamais été aussi nombreuses qu’aujourd’hui. D’un côté, le pouvoir ouvre une multitude d’écoles officielles d’enseignement artistique pour leur apprendre les techniques, l’histoire et la philosophie de l’art. De l’autre, on réduit les soutiens pour leur exposition, et aucune structure n’est mise en place pour les encourager dans leur voie. Il y a des centaines d’artistes qui sortent des nombreuses facultés d’art d’Iran, mais elles ne peuvent compter que sur leur famille et le privé pour percer. Même si la société dans son ensemble subit un manque de liberté d’expression, en tant que femmes, ces artistes vivent sous le code juridique islamique qui leur octroie des droits inférieurs aux hommes. Cette injustice et ce mal-être sont perçus ouvertement ou en filigrane dans leurs œuvres.
Ces artistes savent qu’il faut composer avec cette société et ce régime et, au lieu de se soumettre ou d’abandonner, elles débordent d’imagination. Leur esprit est vif et rebelle, leurs œuvres universelles et contemporaines. Elles sont l’avenir du pays. Lorsque l’horizon s’éclaircira, elles pourront briller dans le ciel turquoise de leur pays.
Pour conclure, je laisse la parole à Firouzeh Amini, une artiste iranienne née en 1941 : « C’est l’histoire qui démontrera les hauts et les bas de ce mouvement artistique, mais malgré toutes les pressions, ce mouvement continue, c’est comme l’eau qui coule sous la rivière gelée. »