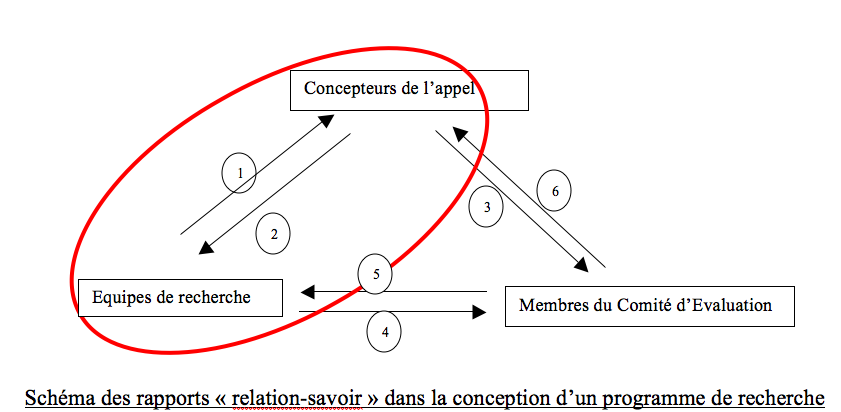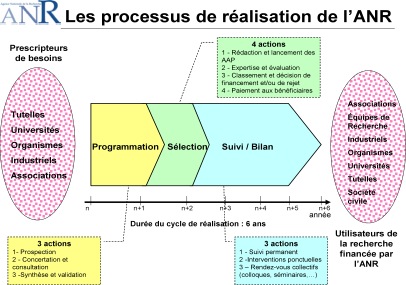Investissements d’avenir : quelques mises en perspectives (I)
Jean d’Yvoire* (Université Pierre et Marie Curie) – Chargé de mission Investissement d’avenir auprès du président. * L’auteur s’exprime à titre personnel
De nombreuses réformes, depuis près de dix ans, ont fait bouger le paysage de la recherche et de l’enseignement supérieur français. La politique d’investissements d’avenir sur laquelle je me propose ici d’ouvrir une réflexion est la dernière en date de ces politiques.
Il est temps de prendre quelque recul par rapport au tourbillon frénétique dans lequel ses appels à projets ont plongé la communauté scientifique et de comprendre ce qui s’est passé. En établissant un bref parallèle avec les politiques comparables conduites en Allemagne, en revenant sur l’histoire et les évolutions du paysage français de la recherche et de l’enseignement supérieur, je tâcherai d’esquisser, sans prise de position a priori, quelques hypothèses sur l’impact des investissements d’avenir et leur pertinence (ou impertinence) pour le monde scientifique et universitaire et au regard d’une approche plus globale des objectifs visés.
Retour sur la genèse du Programme d’investissements d’avenir (PIA)
La recherche et l’enseignement supérieur sont l’un des quatre secteurs prioritaires de la politique d’investissement décidée au lendemain de la crise financière de 2008 ; ils entrent donc dans le champ d’une politique plus vaste. Cette politique s’inscrit-elle dans le prolongement de celle qui portait spécifiquement sur la recherche et l’enseignement supérieur ? Marque-t-elle un tournant ? Il faut revenir sur sa genèse.
Face à l’insuffisance de la politique de relance mise en place début 2009 pour faire face à la crise, le président de la République décide de lancer un « grand emprunt » pour financer « les priorités qui [devaient] préparer l’avenir de la France »[1]. En juillet 2009, il charge deux anciens premiers ministres, MM. Juppé et Rocard, de « procéder à une large consultation » en vue de définir ces priorités.
Bien des voix se font alors entendre[2] – celles de politiques, d’acteurs économiques ou de représentants d’organisations et d’institutions porteuses d’intérêts divers. Ainsi, pour s’en tenir, côté politique, à la majorité de l’époque, a-t-on entendu des députés réclamer un emprunt à 100 Md€ « pour faire face aux risque de déclassement liés à l’immobilisme »[3] tandis que d’autres se faisaient l’avocat d’une réduction du déficit budgétaire et que d’autres encore mettaient en doute la capacité de l’Etat à « être toujours le mieux placé pour trouver la manière de dépenser de l’argent qui va créer la richesse »[4]. Du côté des représentants du monde économique, le Medef défendait des critères de rentabilité et de retour sur investissement sans avancer de secteurs spécifiques dans lesquels investir, tandis que les différents secteurs industriels faisaient entendre chacun de leur côté leurs priorités propres[5]. De nombreux acteurs du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche – la Conférence des grandes écoles et la Conférence des présidents d’université, des organismes et des alliances thématiques de recherche, des syndicats et des associations diverses, etc. – ont également fait entendre leur voix, mais en ordre dispersé, sans qu’une position commune ait été recherchée. C’est la ministre alors en charge de ce portefeuille qui s’est présentée comme leur porte-parole. Elle a défendu les priorités qui découlaient de la Stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI) récemment définie et qui, disait-elle, ne pouvaient être que celles de « l’ensemble des communautés représentées [par les chercheurs, universitaires, industriels, responsables de valorisation ou de pôles de compétitivité] »[6].
Dans son rapport remis en novembre 2009, la commission Juppé-Rocard « a dû chercher un équilibre, toujours délicat, entre la définition de priorités trop générales et le soutien à des projets trop précis ».
Trois raisons majeures appelaient à ses yeux une action urgente :
La crise qui bouleverse les repères et bientôt les hiérarchies ; les atteintes à l’environnement, qui d’ores et déjà menacent les grands équilibres auxquels nous devons la vie ; l’accélération du progrès technique [qui] de plus en plus divise les pays en deux catégories.
C’est à l’aune de ces trois facteurs critiques et avec l’ambition d’« aider à l’indispensable transition vers un nouveau modèle de développement, plus durable » « moins dépendant des énergies fossiles et davantage tourné vers la connaissance » qu’elle a dégagé sept axes prioritaires d’investissements d’avenir. Correspondant à un investissement de l’Etat de 35 Md€ (un montant arrêté par le chef de l’Etat début novembre 2009[7]), ces besoins ont finalement été mis au service de quatre priorités stratégiques par la loi de finances rectificatives du 9 mars 2010 : l’enseignement supérieur, la formation et la recherche (19 Md€) ; l’industrie et les PME (6,5 Md€) ; le développement durable (5 Md€) et le numérique (4,5 Md€).
C’est donc aux côtés des secteurs des PME et de l’industrie, du développement durable et de l’économie numérique que l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) apparaissent comme un « secteurs prioritaires » de la politique des investissements d’avenir. Quelle cohérence forme l’ensemble de ces quatre secteurs prioritaires au regard d’une politique d’investissement ?
Les PME et les industries constituent le secteur de la production de biens et de services. Le développement durable et l’économie numérique peuvent être considérés, au sein du secteur de la production, comme des vecteurs de transformations socio-économiques : les exigences du premier et les potentialités de la seconde pourraient transformer les modalités de production de biens et de services. Quant à l’ESR, il est identifié comme un secteur prioritaire dans la mesure sans doute où l’on attend de lui qu’il soit le moteur d’une transformation socio-économique en profondeur : en nous rapprochant de « ce que les économistes qualifient de ‘frontière technologique’ », en « formant ceux qui déplaceront les frontières de la connaissance » nous serons, lit-on dans le Rapport Juppé-Rocard, « de ceux qui bâtissent l’avenir en en tirant directement les bénéfices en termes d’activité et de dynamisme » (p.19).
Le PIA a donc une visée plus ambitieuse que le seul renforcement de la compétitivité : en portant sur des secteurs relevant de logiques et de niveaux différents, susceptibles de développer entre eux une dynamique transformatrice, il entend contribuer à l’invention d’un nouveau modèle de développement, plus durable. Il n’a pas pour seul objectif d’investir dans l’ESR pour qu’il soit plus performant, plus compétitif, mais de faire en sorte qu’il contribue à cette dynamique, et d’inciter ses acteurs, dans la diversité de leurs rôles et de leurs positionnements, à s’inscrire dans cette perspective.
Bref parallèle avec l’Allemagne (1) : compétitivité économique et excellence scientifique
L’Allemagne, qui aurait inspiré certains volets du PIA en direction des universités, a, quant à elle, développé deux politiques distinctes : l’une en faveur de l’innovation technologique et de la compétitivité des entreprises, l’autre en faveur du soutien à l’excellence scientifique.
La Stratégie Hightech, lancée en 2006 et renouvelée en 2010, a eu dès le départ pour but de favoriser le passage « des idées aux produits », d’accélérer le transfert des résultats de la recherche vers les nouveaux marchés les plus porteurs, de rendre plus simples et flexibles les conditions et le cadre de l’innovation, de « mettre en cohérence recherche, entreprises et politique ».
Fédérant dans un souci politique de lisibilité des mesures et des budgets pour une large part déjà engagés, elle vise à accroître les capacités d’innovations technologiques de l’Allemagne, en particulier dans les secteurs d’avenir des technologies de pointe et des services[8]. Elle fixe par exemple des objectifs climatiques et écologiques ambitieux : des villes sans émissions de dioxyde de carbone (CO2) et un million de voitures électriques d’ici 2020. C’est en effet dans la perspective d’une réorientation en profondeur des vecteurs de la compétitivité économique de l’Allemagne, du secteur des techniques de production (où elle bénéficie traditionnellement de la R&D la plus intensive) vers les secteurs des technologies de l’environnement et de l’énergie, que se positionne la Stratégie Hightech.
L’Initiative d’excellence, lancée en 2006-2007, résulte de 18 mois de négociation entre l’Etat fédéral et les ministres régionaux en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la question du soutien à l’excellence en recherche des universités : le gouvernement Schröder souhaitait sélectionner cinq universités « d’élite » en les dotant de 50 M€ complémentaires pendant cinq ans tandis que la conférence des ministres des Länder proposait d’identifier et de soutenir 20 à 30 centres d’excellence et de mettre en place une trentaine d’écoles doctorales. Trois appels d’offre en deux vagues et avec une phase de présélection ont permis la sélection et le financement à hauteur de 1,9 Md€ sur 5 ans de 9 universités pour leur « stratégie d’avenir », de 39 écoles doctorales et de 37 pôles ou clusters thématiques d’excellence, répartis dans 36 universités (sur 88). Reconduite en 2011-2012 pour cinq ans, l’Initiative d’excellence a permis de sélectionner et de financer à hauteur de 2,9 Md€, 11 stratégies universitaires d’avenir (dont 5 nouvelles), 45 écoles doctorales et 43 pôles ou clusters.
Parallèlement, dans le but de renforcer durablement la compétitivité et l’attractivité scientifique de l’Allemagne, un Pacte pour la recherche et l’innovation, négocié à la fin du gouvernement Schröder et lancé pour cinq ans par le gouvernement Merkel puis reconduit pour la période 2011-2015, a garanti aux cinq grandes organisations scientifiques extra-universitaires allemandes[9] une augmentation annuelle de leur financement fédéral et régional de 3% entre 2006 et 2010 puis de 5% entre 2011 et 2015.
L’Allemagne mène deux politiques distinctes en faveur de l’excellence scientifique d’une part et de l’innovation et de la compétitivité d’autre part, tout en renforçant le financement de base à ses cinq organisations scientifiques. Le PIA français, piloté au niveau gouvernemental par le Commissariat général à l’investissement, créé dans ce but, et mis en œuvre par une dizaine d’opérateurs, conduit, lui, une seule et même politique dont les actions (près de 90 appels à projets) s’inscrivent sur tout le spectre allant du soutien à l’excellence scientifique au soutien à des projets d’entreprises. En France comme en Allemagne, ces politiques n’ont bien évidemment de sens que sur le long terme. En France, le lancement du PIA s’est trouvé contraint, voire précipité, par la nécessité d’agir rapidement face à la crise mais aussi sans doute du fait des échéances électorales. En Allemagne, la définition et la mise en place de ces politiques sont intervenues avant la crise financière de 2008, sur la base d’une analyse globale et à long terme de l’économie du pays, et n’ont pas été affectées par les changements de gouvernements. La mise en œuvre des appels à projets de l’Initiative d’excellence allemande a laissé, tant en 2006 qu’en 2011, plus de temps aux acteurs du monde universitaire pour concevoir et monter ses projets que cela n’a été le cas en France. En revanche, si le PIA prévoit, dans le cas de ses « Idex » des dotations pérennes en capital, l’Initiative d’excellence allemande, elle, n’apporte de financements aux universités que pour des durées limitées.
Bref parallèle avec l’Allemagne (2) : le positionnement des acteurs
Seule une approche comparée des systèmes français et allemand de relations entre les milieux politiques, scientifiques et économiques[10] permettrait d’éclairer ces différences. Je me limiterai à avancer l’idée que le jeu des acteurs politiques, scientifiques et économiques repose en Allemagne sur des rôles et des positionnements, sur des complémentarités et des interactions, ainsi que sur des instances de concertation et de décision qui permettent au système, constitué ainsi dans son ensemble, non seulement d’avoir une forte capacité d’autorégulation, mais aussi de pénétrer la société, de la mobiliser, et cela, d’une façon relativement plus englobante et consensuelle que ce n’est le cas, à première vue, en France.
Le fédéralisme inscrit au cœur de la Loi fondamentale allemande définit un partage des compétences qui exige la définition d’accords ou de compromis entre les niveaux fédéral et régional et qui, de fait, a suscité la formation d’une culture de la négociation politique : ce fonctionnement a certes ses lenteurs, mais il a aussi pour vertu de forger des vues partagées qui souvent dépassent les clivages politiques ou du moins relativisent le jeu politique au profit de la société et d’autres acteurs, économiques et universitaires. C’est dans ce cadre que l’enseignement supérieur, relevant exclusivement de la compétence des Länder, peut bénéficier de financements fédéraux (par exemple quand un consensus se forme autour de l’augmentation de la capacité d’accueil d’étudiants dans les universités). C’est dans ce cadre également que se négocient des politiques communes en faveur de la recherche pour laquelle les niveaux fédéral et régional ont une compétence partagée.
L’université, depuis sa refondation humboldtienne, s’est placée au cœur du paysage scientifique allemand et participe de sa culture. Elle coexiste avec quelques grandes institutions ou organisations de recherche dont les premières (si l’on met de côté les académies) ont été mises en place par l’Etat dès la fin du XIXème siècle, et qui sont regroupées de nos jours en cinq acteurs majeurs aux rôles et aux positionnements complémentaires. L’un de ces acteurs majeurs, la DFG, y joue un rôle spécifique, puisque, finançant la recherche par projets, il met les universités en concurrence. Dans sa mission de formation supérieure, l’université coexiste également, depuis les années 1970, avec des Fachhochschulen, établissements d’enseignement supérieur en sciences appliquées[11]. Les relations de complémentarité qu’entretiennent ces différents types d’acteurs sont aussi et peut-être de plus en plus des relations de concurrence, mais ces relations de concurrence conduisent à une diversification des profils des uns et des autres, en particulier des universités. Elles ne les empêchent pas, par ailleurs, de savoir se concerter et parler d’une même voix.
Quant au monde économique, il se caractérise, en Allemagne, par le fait, d’une part, que les entreprises de taille intermédiaire y sont sensiblement plus importantes qu’en France (les différences des modalités et des cultures de transmission familiale des entreprises pourraient en partie éclairer cette importante différence des tissus économiques) et, d’autre part, qu’elles ont depuis longtemps noués des relations fortes avec les milieux scientifiques sans que les pouvoirs publics aient nécessairement eu pour cela un rôle majeur. Ainsi, à titre illustratif, on mentionnera le rôle que joue la fondation des donateurs pour la science (Stifterverband) qui réunit les acteurs du monde économique s’engageant en faveur de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Stratégie Hightech et Initiative d’excellence vont de pair avec la configuration des relations existant entre les mondes politique, scientifique et économique allemands. Reposant sur la reconnaissance des exigences, des logiques et des rôles propres à chacun, elles trouvent leur force dans la capacité des acteurs de ces trois mondes à nouer non seulement entre eux, deux à deux, mais aussi en leur sein, des positions de consensus ou de compromis. Aucun d’eux, et notamment le monde politique, n’est à même d’occuper une position de surplomb qui lui permettrait d’imposer ses vues aux autres. Bien que distinctes, l’Initiative d’excellence et la Stratégie Hightech allemandes n’en apparaissent pas moins assez cohérentes entre elles. Et si les modalités et la portée de ces politiques restent bien évidemment l’objet de débats, les milieux scientifiques et économiques partagent, dans l’ensemble, la vision que portent ces politiques. On peut se demander si elles ne constituent pas des leviers tout aussi pertinents pour orienter le pays dans la voie dans laquelle le PIA, avec ses objectifs plus vastes et ambitieux, entend engager la France, celle du passage à une croissance durable.
Situation de la recherche et l’enseignement supérieur au moment du lancement du PIA
Au moment où le gouvernement décide de faire de l’ESR la première priorité de sa politique d’investissement, celui-ci est sous tension. Ces tensions trouvent leurs causes bien au-delà des mouvements qui ont marqué le printemps universitaire 2009. Elles résultent d’évolutions contrastées qui conditionnent pour une large part la capacité du PIA à porter ses fruits au sein de l’ESR, et sur lesquelles il nous faut revenir[12]. Nous verrons ensuite le rôle déterminant que prennent dans ce contexte les modalités de mise en œuvre du PIA pour la réussite de ses objectifs.
Alors que la science ou plutôt la techno-science est de plus en plus impliquée dans une économie mondialisée, le système français de l’ESR, tel qu’il s’est forgé durant ces deux derniers siècles, en lien étroit avec la constitution politique et sociale du pays, peine à faire évoluer son organisation. L’espace relativement protégé et cohérent dans lequel il s’est développé ainsi que les valeurs républicaines qui lui sont traditionnellement attachées et grâce auxquelles l’esprit compétitif inhérent à la recherche scientifique a pu être contenu, ont vu leur cohésion s’affaiblir au fur et à mesure qu’ils se trouvaient pénétrés par les grands vents de la concurrence et les impératifs de compétitivité.
Les acteurs institutionnels du système de l’ESR français
Fruit d’une longue histoire de créations et de réformes menées depuis le sommet de l’Etat, le système français d’ESR n’a traditionnellement pas donné à l’université, organisée en facultés sans véritables liens entre elles, le rôle central qu’elle a dans d’autres pays. Le positionnement de l’université résulte d’un double partage, d’une part avec les « grandes écoles », d’autre part avec les organismes de recherche[13]. Depuis la Révolution, l’Etat a créé de grandes écoles pour former les « élites » dont il avait besoin tout en confiant aux facultés universitaires des formations conduisant d’abord aux professions de juristes, de médecins, et de professeurs de lettres ou de sciences des lycées. Depuis la 2ème guerre mondiale principalement, il a créé de grands (ou moins grands) organismes de recherche, que ce soit en recherche fondamentale ou dans des domaines plus appliqués et/ou spécifiques, liés à des secteurs d’activités d’intérêt national. Pendant un temps, ce double partage a constitué un système national relativement cohérent d’acteurs aux missions complémentaires et ce système, duquel font aussi partie de grands établissements, a été une force dans le contexte des transformations politiques, sociales, économiques et scientifiques de la France des trente glorieuses.
D’un côté, cependant, ces transformations se sont accompagnées d’une demande sociale et économique de formation supérieure de plus en plus forte, en lien avec l’allongement de la scolarité obligatoire et l’augmentation du nombre de bacheliers, à laquelle l’université, principalement, a répondu. Le nombre d’étudiants qui y sont inscrits est ainsi passé de 200.000 environ en 1960 à 750.000 en 1975 et à 1,260 millions en 2000. Le partage entre universités et grandes écoles a alors basculé : il ne s’agit plus d’assurer, d’un côté, la transmission vivante des savoirs scientifiques et, de l’autre, l’acquisition de savoirs et savoir-faire requis par l’exercice de fonctions essentielles à l’Etat ; il s’agit de satisfaire à deux types de demandes sociales qui stigmatisent en fin de compte l’inégalité des acteurs. Entrant en tension, égalité démocratique et élitisme méritocratique ont conduit les universités et les grandes écoles à se positionner dans un jeu concurrentiel asymétrique qui les a incitées à diversifier leur façon de mettre en œuvre leur mission de formation supérieure. L’essor d’instituts (tels les IUT), de formations (telles les STS) ou d’écoles a peut-être atténué ou masqué l’effet de cette tension, mais il a rendu le jeu des acteurs plus complexe et n’a pas, loin de là, levée l’inégalité de la concurrence surgie entre universités et grandes écoles.
D’un autre côté, le développement de relations plus étroites entre sciences, techniques, innovation et croissance économique est allé de pair avec une double et profonde transformation tant de l’économie que du régime de puissance des Etats. En France ces transformations se sont traduites par une politique de création puis de renforcement du rôle des organismes de recherche (EPST ou EPIC). A partir des années soixante-dix, ceux-ci ont développé des laboratoires associés ou mixtes avec les universités ; ils en sont venus à jouer un rôle majeur dans le pilotage de la recherche universitaire. Parallèlement, le financement de la recherche par appels d’offre compétitifs s’est développé, venant d’acteurs ou d’opérateurs divers (économiques, caritatifs, publics ou privés, locaux, régionaux, nationaux ou internationaux).
La relative complémentarité des positionnements et des missions des acteurs institutionnels de l’ESR a ainsi évolué selon des logiques de multiplication et d’enchevêtrement des structures et de diversification des modes de financement, vers une configuration plus complexe, difficilement lisible et sournoisement concurrentielle.
Les réformes engagées à partir du milieu des années 2000 se sont attaquées à la restructuration de ce paysage devenu illisible pour faire apparaître des entités compétitives plus lisibles (PRES[14], RTRA[15], Plan Campus…), (re)placer les universités au cœur du paysage scientifique (cf. la LRU) et permettre une simplification de la gestion de structures ayant plusieurs tutelles (Rapport d’Aubert). Consistant en des ajustements partiels, ces réformes n’ont pas encore, loin de là, fait apparaître leur capacité à opérer une véritable simplification de l’ESR.
Corrélativement, le secteur de l’ESR, et en particulier les universités, souffre depuis des décennies d’un sous-financement chronique, de la faiblesse des investissements dont il aurait besoin et d’une diminution relative des salaires des personnels au regard de l’évolution des salaires dans d’autres secteurs[16]. Face à cette situation critique, le candidat Sarkozy avait proposé à l’automne 2006 d’injecter 9 Md€ supplémentaires en cinq ans dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, et d’augmenter de 50% les ressources allouées aux établissements universitaires. De fait, après que la loi sur les responsabilités et libertés des universités, votée à l’été 2007, a témoigné de la volonté politique de faire de l’université un acteur central du paysage français de l’ESR, les moyens attribués à la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES) ont augmenté[17] tout en faisant évoluer les modalités de leur affectation aux acteurs de l’ESR. L’augmentation du budget de l’ESR a cependant donné lieu à des lectures qui en relativisent l’importance[18] ; elle n’a manifestement pas suffi pour combler le retard des universités.
C’est dans ce contexte, peu après le déclenchement de la crise financière, qu’a été mis en œuvre le PIA.
Suite de l’article
[1] Courriers du président de la République adressé le 6 juillet 2009 à M. Juppé et à M. Rocard reproduit dans le rapport de la Commission « Investir pour l’avenir ».
[2] Le rapport de la Commission Juppé-Rocard ne fait pas apparaître la liste des représentants des entités concernées et des personnalités entendues. Les modalités des prises de positions publiques et des démarches restées confidentielles de tels ou tels acteurs comme celles de la médiatisation de ce débat exigeraient une véritable étude.
[3] Tribune publiée dans Le Monde du 2 novembre 2009 signée par 63 députés de la majorité.
[4] J.-P. Raffarin, lors d’un débat avec J.-F. Copé, le mercredi 25 juin 2009 à Meaux.
[5] « Grand emprunt : ce que propose le Medef » in Le Figaro du 3 octobre 2009.
[6] Cf. Dépêche AEF n° 120758 du 6 octobre 2009.
[7] Celui-ci ne se concrétisera finalement comme tel que sur les marchés financiers, et à hauteur de 22 Md€, 13 Md€ ayant déjà été remboursés par les banques.
[8] En 2006 : biotechnologies et santé, TIC, technologies optiques, nanotechnologies, sécurité, énergie ; en 2010 : énergie/climat, santé/alimentation, mobilité, sécurité et communication
[9] La Société Max Planck (MPG) s’organise autour d’instituts de recherche fondamentale, la Société Fraunhofer (FhG) autour d‘Instituts de recherche partenariale avec le monde économique, la Communauté Helmholtz (HGF) regroupe les grands centres de recherche orientée et les grands instruments, la Communauté Leibniz (WGL) réunit pour une large part des centres de recherche issus de l’académie des sciences de l’ancienne Allemagne de l’est ou des Länder que le Bund, après expertise scientifique, a labellisés et qu’il finance, la Communauté allemande pour la science (DFG) finance des projets de recherche sur appels à projets.
[10] Il faudrait bien évidemment s’intéresser à leurs institutions ou organisations, à leur histoire depuis le début du XIXème siècle et plus particulièrement à leur évolution durant les quarante dernières années.
[11] Il faudrait rappeler qu’à côté des universités et des Fachhochschulen, les acteurs du monde du travail jouent traditionnellement un rôle important dans la formation professionnelle supérieure.
[12] Je prendrai pour ce faire appui sur des travaux comme ceux de D. Pestre sur les transformations de la recherche scientifique dans ses rapports à la politique, à l’économie et à la société ou comme ceux de Ch. Musselin, M. Gauchet ou P. Veltz, sur l’histoire de l’enseignement supérieur français la crise qu’il connaît.
[13] Cf. M. Gauchet « Vers une ‘société de l’ignorance’ », in Le Débat n° 156, septembre-octobre 2009, p. 147.
[14] Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
[15] Réseau Thématique de Recherche Avancée
[16] Cf. « Rapport du salaire brut des maîtres de conférences au 1er échelon sur le SMIC brut de 1984 à 2008, construit par N. Tintillier, reproduit par F. Vatin, « Expansion et crise de l’université » in Commentaire n° 139, automne 2012, p. 824.
[17] Augmentation d’1,28 Md€ pour le Projet de loi de finances (PLF) 2008, d’1,8 Md€ pour le PLF 2009 et pour le PLF 2010, et de 0,7Md€ pour le PLF 2011.
[18] Cf. notamment Jean-Yves Mérindol, alors président de l’ENS Cachan, Dépêche AEF n°166327 du 9 mai 2012 et Thomas Piketty, Libération, 13 mars 2012.