Langage et temps dans « Premier Contact »
Langage et temps dans Premier contact : la fin du monde humain
Guillaume Lurson est professeur agrégé de philosophie et doctorant. Il travaille essentiellement sur la philosophie française des XIXe et XXe siècle, et en particulier sur le spiritualisme.
Résumé
Cet article cherche à mettre en évidence une réflexion sur le langage et le temps à partir du film Premier Contact de Denis Villeneuve. En dépit de sa sobriété apparente, cette œuvre pose la question de l’unité du genre humain à partir d’une langue universelle, dont les heptapodes font cadeau à la protagoniste du film, Louise Banks. Cependant, la maîtrise de cette langue est associée à une temporalité qui dépasse les cadres humains de la pensée discursive et de la représentation. L’enjeu dépasse dès lors la seule possibilité d’un « monde humain » : c’est la formation d’une communauté à l’échelle de l’univers qui est envisagée. Faut-il abolir les frontières du monde humain pour élargir notre existence ? Peut-on dépasser les conditions finies de la représentation ? Ces questions sont liées, dans l’œuvre de Denis Villeneuve, aux conditions mêmes de l’expérience cinématographique.
Mots-clés : Denis Villeneuve, cinéma, temps, langage, représentation
Abstract
This paper aims at offering a reflection on both time and language in Denis Villeneuve’s movie Arrival. Despite its apparent sobriety, the movie poses the question of the unity of Mankind through a universal language, given as a gift by the heptapods to main character Louise Banks. However, mastering this language comes with grasping a temporality that exceeds the scope of both human discursive thought and representation. What is therefore at stake is no longer a merely “human world”: the movie allows us to envision the formation of a universe-scaled community. Should we abolish the boundaries of the human world in order to enlarge our existences? Can we exceed the finite conditions of representation? In Denis Villeneuve’s work, these questions are intimately bound to the very conditions of the cinematographic experience.
Keywords: Denis Villeneuve, cinema, time, language, representation
Introduction
Si la pluralité des langues a pu être tenue pour le signe d’une mésentente et d’une confusion universelles, Premier contact semble de prime abord être une fable babélienne. En effet, le film de Denis Villeneuve propose, en dépit de son apparente sobriété, une intense réflexion sur la faillite de la communication en l’absence d’une langue commune. Nous verrons d’abord en quoi cette faillite menace l’unité du genre humaine (I), avant de voir comment Louise Banks, l’héroïne du film, cherche à la résorber (II). Le dilemme de langue universelle ou d’un indépassable relativisme des conceptions du monde devra ensuite être posé (III). Nous verrons alors que la question du langage se trouve enveloppée dans celle de l’expérience possible d’un temps lui-même universel (IV), avant de voir en quoi le film de Denis Villeneuve interroge les structures mêmes de l’expérience cinématographique (V).
I. Pluralité des langues et faillite de l’humanité
Dans un premier temps, la situation est similaire à la malédiction qui s’abat sur Babel :
Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit : « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise ! Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons ! Descendons ! Et là, confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres. » Yahvé les dispersa de là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c’est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.[1]
De cette communauté originaire, rien ne subsiste. La situation de guerre qui fait le fond du film manifeste le tragique de la condition humaine[2] : celle-ci se trouve divisée en nations qui ne parviennent pas à se mettre d’accord sur ce qu’il s’agit de faire face aux heptapodes[3]. En dépit de la simultanéité des informations permise par des moyens technologiques avancés, les intérêts divergent et n’arrivent ni à se communiquer, ni à concorder. Ainsi, l’unité réelle du monde se trouve menacée. L’on pourrait même dire que les possibilités de mécompréhension et de conflit n’ont jamais été aussi accélérées, en raison de la diffusion immédiate des informations permise par les moyens technologiques. Que reste-t-il alors du « monde humain », compris, au moins à titre d’idée, comme totalité harmonieuse ? La dispersion des intérêts économiques, politiques et militaires souligne l’impossibilité d’une convergence des buts particuliers. L’éclatement du monde est alors celui d’une finalité commune qui subsumerait tous les points de vue sous une unique direction, à la manière dont Kant pouvait l’espérer dans l’Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique[4]. Mais surtout, la présence des heptapodes intensifie cette dispersion des points de vue en les soumettant à la potentialité d’une menace imminente. Ne met-elle pas en péril leur convergence, au point d’engendrer le chaos ?
 Kant envisageait, dans L’histoire générale de la nature et la théorie du ciel, que d’autres mondes puissent exister, et se demandait ainsi qui serait « assez hardi pour se risquer à répondre à la question de savoir si le péché exerce aussi sa domination dans les autres globes de l’univers, ou bien si la seule vertu règle le gouvernement[5] ? ». Cette question, toutefois, est encore posée dans les limites de la représentation comme de l’exigence morale qui incombe à la volonté humaine. S’il s’avérait que des non-humains pensent et agissent par-delà les antinomies qui sont les nôtres, toute perspective pratique serait anéantie. L’humanité serait ainsi réduite à se considérer comme une juxtaposition d’individus dotés de fins finales, sans qu’une « fin dernière[6] » ne puisse ultimement les associer. N’est-ce pas même la confrontation à un potentiel néant d’être qui se trouve ouverte ?
Kant envisageait, dans L’histoire générale de la nature et la théorie du ciel, que d’autres mondes puissent exister, et se demandait ainsi qui serait « assez hardi pour se risquer à répondre à la question de savoir si le péché exerce aussi sa domination dans les autres globes de l’univers, ou bien si la seule vertu règle le gouvernement[5] ? ». Cette question, toutefois, est encore posée dans les limites de la représentation comme de l’exigence morale qui incombe à la volonté humaine. S’il s’avérait que des non-humains pensent et agissent par-delà les antinomies qui sont les nôtres, toute perspective pratique serait anéantie. L’humanité serait ainsi réduite à se considérer comme une juxtaposition d’individus dotés de fins finales, sans qu’une « fin dernière[6] » ne puisse ultimement les associer. N’est-ce pas même la confrontation à un potentiel néant d’être qui se trouve ouverte ?
La présence des heptapodes consacre un véritable arrachement, ou un déracinement, qui rend l’entremêlement harmonieux des représentations impossible. Or, une telle confrontation à l’in-humain fait voler en éclat la possibilité d’une totalisation des subjectivités : le concept de monde lui-même, en son usage régulateur, est subitement volatilisé en raison de la pluralité des mondes qui se trouve découverte. La méthodologie du jugement téléologique, dans la Critique de la faculté de juger, faisait de l’homme le but final de la création. Mais en présence d’êtres in-humains dotés de fins impénétrables, signes d’un univers sans bornes, toute faculté de juger téléologique n’est-elle pas radicalement détruite ? Si l’intensification du mal au sein du monde contredit l’unification des représentations humaines, qu’en est-il du surgissement d’une représentation foncièrement inhumaine et acosmique ? Tout projet de cosmopolitisme serait alors caduc, mais, plus encore, c’est l’homme comme but final de la création, ainsi que la théologie qui y est relative, qui se trouvent anéantis[7].
L’éclatement de la finalité pourrait également tenir au fait que les heptapodes ne sont pas capables du redoublement réflexif qui leur permettrait de s’apparaître à eux-mêmes comme doués de finalité. Ainsi, lorsque Louise Banks explique les difficultés qu’il y a à cerner l’intention des extra-terrestres, elle met tout d’abord en question le sens même de cette possible intention. Elle illustre ce problème grâce à l’exemple suivant :
« What is your purpose on earth ? »
Cet énoncé suppose que les termes et la structure de la phrase aient un sens pour les heptapodes. Ainsi, pour que le mot « purpose » (but) en ait un, il faut que ces derniers soient pourvus de volonté et de conscience. La confrontation anthropologique avec d’autres sociétés laissait ouverte la possibilité d’une compréhension, sinon d’une entente commune, par le postulat d’une intentionnalité partagée, quand bien même elle serait au service d’intérêts différents. Or, si les heptapodes sont privés du redoublement réflexif permettant d’intégrer l’altérité dans un moi universel, nous nous découvrons à nous-mêmes au mieux comme différence pure d’être, sinon comme un néant d’être, qu’aucune synthèse générique ne peut sauver. L’épochè cognitive et morale que soulève la présence des heptapodes apparaît alors comme la plus directe contestation de l’assignation de l’homme à une essence stable et déterminée. L’interrogation néantisante que recèle l’exemple de Louise Banks met ainsi en jeu la potentielle disparition de l’humanité.
Selon Kant, l’espèce humaine pouvait en effet être désignée comme « une race, si on la conçoit comme une espèce d’êtres terrestres raisonnables, par comparaison avec ceux d’autres planètes, en tant que constituant une multitude de créatures issues d’un unique démiurge[8] ». Mais il laissait sous-entendre l’unité possible des humains et des non-humains par leur relation commune à un être supérieur. Rien ne laisse pourtant penser que l’univers n’est pas le règne de la différence pure, au sens où aucune ligne de fuite ne permettrait de faire coïncider une multitude de plans d’existence. La présence des heptapodes semble alors l’occasion d’une nouvelle monadologie, dans laquelle les monades ne sont pas non plus subordonnées, dans leur développement, à un principe de raison suffisante[9]. Monadologie sans providence, fins sans finalité : l’effondrement du monde humain passe donc par l’impossible rassemblement des corrélats intentionnels. La difficulté est donc extrême : est-il seulement possible d’unifier les buts humains et les buts des aliens, qui demeurent largement inconnus ?
II. Louise Banks, le « Champollion » du langage des heptapodes
Pour surmonter l’éclatement de la finalité, il faudrait, a minima, qu’une communication soit possible, c’est-à-dire qu’une objectivité idéelle puisse émerger du croisement des représentations. Or, la communication n’est possible que dans la mesure où deux individus peuvent s’apparaître à eux-mêmes comme doués de fins, ce qui implique la mise en œuvre d’au moins deux subjectivités. Benveniste écrivait ainsi : « Une langue sans expression de la personne ne se conçoit pas[10] ». Si les heptapodes agissent en suivant un instinct, il devient au contraire impossible de communiquer avec eux. Telles les abeilles de Von Frish, l’absence de subjectivité dans le langage renvoie au mieux à un système de signaux[11], sinon à une exécution d’actes sans conscience. Pour que l’opération de traduction soit possible, il faut des règles et des structures récurrentes qui permettent de déchiffrer la langue étrangère, et que ces règles puissent être réfléchies. Le « premier contact » est établi lorsqu’il y a un échange de messages qui permettront, à terme, de découvrir les différents types de termes utilisés de part et d’autres (nom commun, nom propre, verbe, etc.). L’apprentissage d’une langue étrangère ne se réduit donc pas au vocabulaire : il faut une syntaxe, qui ne peut être pure altérité.
Tout se passe néanmoins comme si, à l’aune de ces échanges, la scientifique Louise Banks avait affaire à une « Pierre de Rosette » qu’il fallait déchiffrer. Comment traduire un langage dont nous n’avons, a priori, aucun équivalent ? Sans tertium comparationis, comment mettre en œuvre l’opération de traduction ? Champollion, lorsqu’il faisait face aux hiéroglyphes, a eu – entre autres – l’idée de comparer le nombre de mots grecs et celui des hiéroglyphes : le second étant largement supérieur au premier, il en a déduit que ce système d’écriture était à la fois phonétique et idéographique. Or, le langage des heptapodes ressemble, sur ce point, aux hiéroglyphes. Comme le dit le collègue de Louise Banks, il n’y a : « pas de corrélation entre ce que dit un heptapode et ce qu’il écrit » (54’03’’)[12]. Autrement dit, les signes mobilisés ne représentent pas une parole (quand nous prononçons « chat », l’aspect phonétique du mot est inclus dans son écriture). Les « logogrammes » des heptapodes ressemblent ainsi beaucoup aux systèmes des premières écritures (cunéiforme par exemple, peut-être aussi les dessins des grottes préhistoriques).

Louise Banks a affaire à une écriture de type « sémasiographique » : le sens est symbolisé par une forme circulaire qui se module sans qu’il y ait un sens précis de lecture. Or, une telle chose peut ne pas être comprise en raison de deux difficultés majeures qui tiennent à la structure même de notre langue, qui ne peut s’exercer que dans les limites de notre représentation :
– Le premier obstacle est la fausse « anecdote du kangourou[13] ». Louise Banks raconte cette histoire pour illustrer les malentendus qui peuvent advenir lorsque deux personnes ne parlant pas la même langue essaient de communiquer. Des colons, montrant du doigt un kangourou, demandent aux aborigènes de quoi il s’agit. Les aborigènes prononcent « kangourou », ce qui en réalité veut dire « je ne comprends pas ». On peut ainsi se tromper sur la nature de l’intention d’un locuteur en croyant parler de la même chose. C’est ce qui adviendra avec la phrase des heptapodes « use weapon », qui rendra perplexes toutes les nations. Veulent-ils signifier le terme d’« arme », ou est-ce nous qui donnons ce sens à un terme mal compris ? Le malentendu n’est cependant pas une simple erreur de traduction : il s’agit d’une méprise concernant l’intention d’autrui, voire d’une contrefaçon de cette intention. Jankélévitch écrivait en ce sens « L’un a bien dit ce qu’il voulait dire, et l’autre parfaitement compris ce qu’il y avait à comprendre, mais ce qu’il désirait entendre submerge ce qu’il a entendu et lui fabrique une espèce de demi-bonne foi.[14] ». En interprétant le message des heptapodes de cette manière, la plupart des nations ne font que vicier le sens de cette phrase par la projection de leur angoisse de disparition.
– Le second obstacle tient à l’habitude que nous avons de vivre avec un système phonétique, ce qui nous conduit à disqualifier l’hypothèse d’un langage sémasiographique. Or, nous appelons de tels systèmes « pré-écriture », ou « proto-écriture » : il nous est apparu comme un progrès de conjoindre parole et écriture. Mais les heptapodes possèdent en réalité un système plus perfectionné que le nôtre, en ce qu’ils ont la capacité de construire une phrase complexe de manière directe. Tout se passe comme s’ils ne butaient pas sur la difficile formulation d’une pensée. Ils « écrivent » en effet « à une main » et immédiatement, lorsque Louise Banks, dans ses tentatives de communication, doit construire une phrase en juxtaposant des symboles. Ils peuvent ainsi communiquer de manière instantanée des messages que nous devons décomposer, puis recomposer. Cependant, le langage sémasiographique ne reste-t-il pas un langage prisonnier de signes, qui altèrent pensée et parole[15] ? Il semble plutôt que ce langage pousse dans ses limites ultimes les conditions de la représentation.
D’une part, l’écriture des signes sur la paroi est vouée à une disparition presque immédiate : c’est par le moyen de dispositifs techniques de fixation (enregistrement) que l’on peut les restituer. En ce sens, l’écriture est confrontée à son devenir liquide ou vaporeux : elle semble être une coupe dans le flux de pensée des heptapodes. Ne faut-il pas y voir un cratylisme qui nous oblige à renoncer à notre tendance au platonisme[16] ? D’autre part, l’écriture « à une main » (ce qui ne limite pas la production d’énoncés, qui pourra être immédiate et multiple, comme on le verra en 1’15’’30’’’) traduit un rapport à l’espace incommensurable avec le nôtre. Le corps des heptapodes n’est pas orienté de la même manière que le nôtre : nous écrivons de gauche à droite, ou de droite à gauche, ces distinctions n’ayant de sens qu’à l’aune d’un comportement qui les intègre[17]. Mais le corps « tournant », ou « enroulé » des heptapodes n’a ni devant ni derrière, ni droite ni gauche[18]. Enfin, il est impossible de relier le signe linguistique à un comportement qui fait sens : l’heptapode, en raison de l’orientation multiple de son corps et de l’absence de visage, rend impossible tout face à face. Il ne peut être appréhendé que de manière partielle ou oblique, interdisant la totalisation de l’expérience intersubjective.
Pour autant, la décorrélation apparente de la parole et du signe linguistique écrit chez l’heptapode masque peut être une corrélation inaperçue. Le devenir vaporeux de l’écriture pourrait être la forme adéquate par laquelle une parole informe, quasi inarticulée, se déploie. En-deçà du logos qui découpe des unités de sens, des termes, et qui assemble des éléments, il se pourrait que ce discours fluide et fait de résonnances soit l’expression d’une pensée qui est pure multiplicité. L’heptapode fabrique et agence des signes selon une logique non propositionnelle : il semble plus proche de l’association d’idées que du discours ordonné. Libre dans son agencement syntaxique, la parole des heptapodes « flue » et se module, pour former ensuite sur l’écran des totalités signifiantes qui disparaissent aussi vite qu’elles sont produites. Ne traduisent-elles pas le flux d’une voix universelle et primordiale, le souffle même de l’être[19] ? Cette parole infra-catégorielle, sans découpes, serait alors le fondement « cratylien » de l’écriture des heptapodes.
Le langage des heptapodes défait ainsi ce par quoi l’humanité s’est instituée : a) la production et la conservation du langage dans des signes, conservation redoublée par les procédés d’enregistrement (de la plus humble copie du scribe jusqu’au copier-coller, en passant par l’imprimerie), b) la manifestation spatio-temporelle de l’écriture selon une certaine linéarité, et c) le face à face rendant l’expérience du dialogue possible. En ce sens, l’humain s’est institué comme un reproducteur, un distributeur, et un interprétant de signes, s’enfonçant toujours plus dans la matérialité des copies de copies pour les conserver et les utiliser. Par une régression forcée en-deçà des conditions de production de nos énoncés, les heptapodes nous obligent à inverser le mouvement même de notre pensée. Quel est alors le but de cette conversion ?
III. Leibniz ou Sapir-Whorf ?
Il semblerait que les heptapodes possèdent la clé d’un langage universel, dont le fantasme humain est ancien. Outre l’histoire de la tour de Babel, celui-ci a fait l’objet de nombreux développements philosophiques, et notamment chez Leibniz, qui écrivait en ce sens que, si un tel langage existait, « Son véritable usage serait de peindre, non pas la parole, comme dit M. de Brébœuf, mais les pensées, et de parler à l’entendement plutôt qu’aux yeux.[20] ». En ce sens, les heptapodes annonceraient l’horizon d’une langue libre et parfaitement transparente, mais aussi d’une pensée libérée des équivoques. Il s’agirait alors d’éliminer toutes les ambiguïtés liées à la matérialité de la langue (prononciation, registre de langue, etc.) et à la difficulté de traduire fidèlement des intentions en mots. La promesse d’un tel langage est celle d’une unité des intellects, ou de leur subsomption sous un intellect unique[21]. N’exige-t-elle pas alors de défaire ce qu’il y a d’humain en nous ? Ne s’agit-il pas d’aboutir à une communication intuitive, libérée de la discursivité ? Et comment penser ce langage sans parole ? Leibniz définissait le projet d’une langue universelle ainsi :
Toutes les pensées humaines peuvent tout à fait se résoudre en un petit nombre d’entre elles considérées comme primitives […] Une fois pourvues de cette seule réalisation, quiconque se servirait de caractères de ce genre en écrivant et en raisonnant ne faillirait jamais ou alors pourrait lui-même non moins que d’autres, surprendre ses propres fautes par les plus faciles examens[22].
Leibniz nommait « caractéristique universelle » cette forme de langage, et affirmait qu’il devait prendre appui sur l’algèbre et les mathématiques. L’enjeu était alors de parvenir de manière systématique à la vérité et de prévenir les erreurs grâce à une univocité totale des signes utilisés. Les logogrammes des heptapodes semblent pouvoir jouer un rôle analogue : ils sont censés réunifier le genre humain divisé et permettre ainsi d’amener la paix. Il s’agit ici d’un « don[23] », comme si l’arrivée providentielle des extra-terrestres devait suppléer aux insuffisances de la communication humaine (ce que relève Louise Banks, en disant que par ce moyen, les heptapopdes nous « obligent à coopérer », à 1’24’’). L’on peut cependant douter que les hommes puissent aboutir à la production d’un tel langage : unifier les signes et les représentations qui y sont corrélés, n’est-ce pas réduire la diversité des pensées à des contenus identiques ? N’y a-t-il pas, en outre, un risque d’uniformisation qui en découle ? Comment la transparence du sens pourrait-elle advenir, si ce n’est au prix du sacrifice du signe, et donc de la possibilité même de l’échange ?
C’est bien pourtant les mathématiques qui donneront la clé de l’énigme, et qui permettront de décoder le flux de pensée, de parole, et d’écriture des heptapodes (1’21’’40’’’ à 1’22’’40). Même au sein du chaos de signes libéré par les heptapodes (1’15’’30’’’), il reste une récurrence mathématique qui en délivre le sens. La thèse galiléenne de L’Essayeur semble pouvoir être réactivée : l’univers est mathématisable, toute évènement pouvant, de droit, être formalisé de cette manière. La fraction 1/12 exprime ainsi la nécessité de la coopération entre humains sans la dire. Seraient-ce alors les mathématiques qui sont le véritable langage universel, ou ne sont-elles que l’instrument qui permet de décoder les structures syntaxiques des langues ? Le langage mathématique reste cependant indicible : ne sommes-nous pas condamnés à la traduction, à défaut de la communication intuitive ?
Si le langage universel est possible, cela suppose néanmoins que les diverses représentations que nous nous faisons du monde puissent être dé-clôturées, puis accordées. Or, celles-ci sont différentes, au sens où la langue structure l’expérience que nous faisons de celui-ci. C’est l’hypothèse dite de « Sapir Whorf » dont il est question dans le film :
Les êtres humains ne vivent pas uniquement dans le monde objectif ni dans le monde des activités sociales tel qu’on se le représente habituellement, mais ils sont en grande partie conditionnés par la langue particulière qui est devenue le moyen d’expression de leur société. Il est tout à fait erroné de croire qu’on s’adapte à la réalité pratiquement sans l’intermédiaire de la langue, et que celle-ci n’est qu’un moyen accessoire pour résoudre des problèmes spécifiques de communication ou de réflexion. La vérité est que le « monde réel » est dans une large mesure édifié inconsciemment sur les habitudes de langage du groupe. Il n’existe pas deux langages suffisamment similaires pour qu’on puisse les considérer comme représentant la même réalité sociale. Les mondes dans lesquels vivent les différentes sociétés sont des mondes distincts, et non pas simplement un seul et même monde auquel on aurait collé différentes étiquettes[24].
Edward Sapir utilise divers exemples pour illustrer cette théorie, et notamment concernant l’appréhension du temps. Il montre que la manière dont celui-ci est représenté (linéaire, cyclique, etc.) dépend des catégories de langue que nous utilisons. Autrement dit, toute conception du monde est relative à une grammaire, une syntaxe, et à un vocabulaire, et Babel fonctionne à plein régime. Le pluralisme est premier, l’objectivité impossible, et la pluralité des mondes était toujours déjà là, même en l’absence des heptapodes. Il faut donc choisir entre le relativisme de Sapir et la caractéristique leibnizienne, soit entre l’amour de l’humanité et le désir d’immensité.
IV. Langue et perception du temps
Si l’on suit l’hypothèse de Sapir Worhf, il faut bien dire que c’est le changement de catégories linguistiques qui bouleverse la conception du temps. Ce n’est précisément pas l’inverse, si nous pensons dans notre langue. En ce sens, le langage des heptapodes n’est pas un métalangage qui nous donnerait les clés pour comprendre notre propre langue : l’apprendre, c’est apprendre une autre manière de communiquer et de penser. Or l’apprentissage d’une langue est immanent à la mise en œuvre de ses signes. Comment surmonter autrement la difficulté qui provient de l’absence d’un tertium comparationis ? C’est ce qu’écrivait Wittgenstein dans le Tractatus Logico-philosophicus : « 3.262 – Ce qui, dans les signes, ne parvient pas à l’expression, l’emploi de ceux-ci le montre. Ce que les signes escamotent, leur emploi l’énonce.[25] ».
« Parler » comme les heptapodes, c’est donc apprendre les règles par lesquelles nous utilisons les signes plus que leur sens. Comment l’apprentissage d’une nouvelle langue peut-elle bouleverser nos catégories cognitives au point de transformer notre conception du monde ? L’apprentissage par l’usage des règles peut être illustré par la scène allant de 1’13’’10’’’ à 1’14’’56’’’ : renonçant à la fabrication de signes enregistrés pour écrire directement sur la paroi, Louise Banks fait l’expérience d’un apparent flashback. L’usage de la langue coïnciderait alors avec une expérience inédite du temps. Peut-on dire que l’apprentissage du langage des heptapodes nous délivre une conception absolue du temps, soit l’essence de celui-ci ? La maîtrise du langage universel délivre-t-elle simultanément la compréhension d’une temporalité originaire ? Faut-il même s’attendre à ce que soient révélées les fins finales qui nous manquaient jusqu’alors ? Quelle est l’extension de l’expérience cosmologique du temps qui va être engendrée ?
Ce questionnement engage un problème a) philosophique sur la nature du temps, et b) concernant le statut de l’expérience esthétique filmique. La narration du film est à la fois organisée et défaite par un temps non linéaire : l’enchaînement d’une temporalité au présent et d’apparents flashbacks va progressivement se renverser, dès lors que l’on comprend qu’ils sont des prémonitions de l’avenir. Cet enchâssement n’est compris par Louise Banks que lorsqu’elle maîtrise le langage des heptapodes. Nous distinguons entre passé, présent et futur, alors que les heptapodes perçoivent le déroulement des évènements dans leur simultanéité (1’38’’). En effet, la linguiste avait déjà remarqué que les « logogrammes s’affranchissent du temps » (54’’50’’’), soit du temps humain, découpé en périodes, soumis à l’hésitation et à la délibération. Cette simultanéité du temps conditionne également l’expérience cinématographique du spectateur qui comprend, à ce moment, la règle de construction du film, cette règle n’étant pas formulée, mais bien montrée dans l’immanence des images en mouvement.
Le film libère la perception habituelle qui s’attache à distinguer dans le temps des moments. Cet arrachement est véhiculé par la coïncidence du passé, du présent et du futur : le passé devient futur, et le futur passé : le présent n’est plus que l’instant qui condense tous les aspects du temps. Ne retrouve-ton pas ici l’expérience de la durée, au-delà du temps ? Mais de quelle durée est-il ici question ? S’agit-il d’une durée absolue, ou d’une modalisation de celle-ci ? Bergson écrivait ainsi : « Plus on y réfléchira, moins on comprendra que le souvenir puisse naître jamais s’il ne se crée pas au fur et à mesure de la perception même.[26] ». Il ne s’agit pas seulement de reconnaître le caractère sensori-moteur du présent, mais bien la continuité hétérogène qui subsiste sous les découpes perceptives. Le souvenir est donc créé par le futur auquel il se trouvera associé, tout en étant actualisé par la perception présente. La perception, selon Bergson, est en effet ce qui attache le souvenir aux besoins de l’action présente sous le régime de la discontinuité et de la restriction. Mais elle implique une frange immense de virtualité qui l’enveloppe et la conditionne, et la conscience semble bien plus « aspirée » par son devenir que « retenue » par la stase du passé.
Si le passé et le présent ne s’élucident que dans leur rapport avec un futur, alors souvenir et perception actuelle sont les contractions de cette frange de virtualité. Chez Bergson, le passage de la perception pure à la mémoire nous permettait de quitter « définitivement la matière pour l’esprit[27] ». Mais il fallait alors rendre raison du mécanisme de la perception par le primat métaphysique et ontologique du passé, soit par un principe de conservation de l’être. Or, le passé et le présent sont gros de l’avenir, et ils doivent en particulier être rattachés au mode du futur antérieur : ils sont ce qu’ils auront été. Il faut, à ce titre, distinguer réminiscence et entrevision : la première désigne l’extension de la perception en direction d’une totalité vécue de manière retardataire, la seconde d’une totalité anticipée[28]. N’est-ce pas cependant reconnaître une forme de nécessitarisme universel ? Et n’est-ce pas même troquer une appréhension nostalgique du réel contre une anticipation impuissante de l’avenir ?
Il faut cependant dire que Louise est ce qu’elle sera, et non le contraire, ce qui serait souscrire à un déterminisme pauvre. Mieux, elle est ce qu’elle aura toujours déjà été, c’est la raison pour laquelle elle accepte d’avoir une fille qui tombera malade. Cette contraction du temps révèle sa teneur cosmologique, irréductible à toute intériorité psychologique. Dans les moments de flashforward de Louise, c’est la coexistence du plan actuel et du plan virtuel de sa vie qui est réalisée. Deleuze remarquait la possibilité d’une telle superposition (qu’il appelait « coalescence »), à propos de « l’image-cristal[29] ». Mais « l’image cristal » ne désigne pas ici la seule coalescence du passé et du présent : il s’agit de celle du présent et du futur. Cette superposition révèle l’existence d’un temps cosmique dans lequel nous sommes : toute intériorité psychologique est alors détruite.
En effet, comme le remarquait Deleuze, « la seule subjectivité, c’est le temps, le temps non chronologique saisi dans sa fondation, et c’est nous qui sommes intérieurs au temps, non pas l’inverse.[30] ». En conséquence, on ne peut attribuer à Louise Banks la propriété d’être sujet de ses flashforwards : ils expriment le devenir de l’univers se reflétant dans une conscience transcendée. Mais si les flashforwards de Louise Banks sont les simulacres d’une entrevision, il ne faudrait pas croire que la Louise Banks (A) du présent se distingue de la Louise Banks (B) du temps cosmique : (A) n’est transcendé par (B) qu’au sein d’un même plan d’immanence. De la même manière, (A) n’est pas la copie dégradée de (B). C’est donc une intensification de la coalescence qui est engendrée par la superposition des plans d’existence, d’abord distingués, et ensuite intégrés les uns aux autres. La perception actuelle du monde est toujours débordée par son au-delà, soit par un infini temporel s’étirant à la fois vers le passé et le futur.
V. L’expérience de cinéma
L’existence de l’heptapode exprime le temps cosmologique, qui nous arrache à tous les percepts et concepts humains. Il détient la face irreprésentable du temps, dont nous sommes séparés par une paroi de verre. A un moment, cependant, cette paroi sera non pas brisée, mais abolie temporairement, lorsque Louise Banks sera transportée dans le vaisseau. C’est le moment où, recevant le message « use weapon, Louise », elle dit ne plus rien comprendre. L’abolition de la distance symbolisée par la paroi de verre n’aurait-elle pas du rendre le « contact » plus clair, et dissiper les malentendus ?

Il n’en est rien : la représentation, même celle qui est propre au langage sémasiographique, ne peut être excédée. Louise ne comprend pas pourquoi elle doit utiliser ce « cadeau », ni à quel moment, ni dans quel but, bien qu’un heptapode lui révèle que leur venue sur terre consiste à aider l’humanité (1’30’’27’’’). Elle se retrouve alors avec un outil dont elle n’a pas le mode d’emploi. Il reste donc, au terme de ce premier contact, une énigme dont on ne peut percer le secret. Il n’y a, enfin, aucune révélation quant au « sens » de l’existence[31], aucune information relative au devenir du monde, sinon que le langage universel aura, un jour, un rôle à jouer (mais encore une fois : pour composer des mondes, ou pour les détruire ?). L’hypothèse de Sapir-Worhf se trouve réfutée : l’acquisition d’une nouvelle langue ne s’accompagne pas des représentations qui s’y attachent. C’est sous la modalité d’un contact éclair, ou d’une révélation subite, que deux lignes d’existence sont surprises dans leur enveloppement réciproque. Seule une intuition hors du logos pourrait délivrer la raison de la présence des heptapodes sur terre. Mais il faut supposer que les heptapodes eux-mêmes ne sont pas à la fois dans la représentation, et hors de celle-ci : ils n’ont pas le point de vue kosmothéorique et circulaire excédant la finitude de leur existence.
L’expérience de Louise Banks est alors similaire à celle du spectateur, qui, bien qu’il comprenne la règle de composition du film, ne peut en cerner l’intention. L’œuvre reste ouverte, mais d’une ouverture qui dépend d’une certaine opacité. La paroi qui sépare les humains des heptapodes ressemble à celle qui sépare le spectateur du film, qu’il n’appréhende que dans et par le biais des images en mouvement. Il ne s’agit pas d’une nouvelle caverne, dont l’ordre est celui des simulacres, mais bien d’un voile qui laisse deviner un devenir universel, échappant aux catégories linguistiques et cognitives humaines. Seulement, c’est bien par la médiation du signe que ce devenir est entrevu : la langue et l’image jouent le rôle d’indices vers un au-delà qu’ils contiennent en germe. En arrachant le signe linguistique (dans le film) et l’image (pour le spectateur) à un présent sensori-moteur, la fonction narrative du récit s’écroule. Malgré la fin du film, l’œuvre n’épuise pas les lignes de bifurcation qu’elle a ouvertes. Elle maintient la tension propre à l’entrevision du tout que permet l’image cinématographique : la simultanéité du plan actuel (A) et du plan virtuel (B) est hors du film. Tout ce que celui-ci peut faire, c’est rendre effective l’opération de dédoublement du réel propre à la représentation, bien qu’il l’étire au maximum.
En s’appuyant sur les thèses de Matière et mémoire et du dernier chapitre de L’évolution créatrice, Deleuze montrait en quoi l’univers apparaissait comme métacinéma[32]. Mais dans Premier contact, c’est le cinéma qui apparaît comme métaunivers, de par l’expérience cinématographique elle-même, mais aussi par la mise en abîme du cinéma que symbolise la paroi translucide sur laquelle écrivent les heptapodes[33]. Ceux-ci ne nous libèrent pas du signe ou de la représentation : leur présence ne peut que défaire le primat de l’humanité et l’attachement qu’elle se porte à elle-même. En contrepartie, elle étend les limites de la perception par son extension cosmique. L’on ne peut déchirer le « voile[34] » pour coïncider avec la durée, mais l’on peut toutefois dévoiler un nouveau rapport d’agencement, un nouveau rythme de durée[35]. L’enchâssement des « voiles » est en ce sens indéfini : déterminer la « fée[36] » qui les a tissés serait dépasser la finitude et les limites spatio-temporelles qui nous constituent en propre, et qui, dans une certaine mesure, déterminent également les heptapodes (dont l’un d’eux est au moins en « processus de mort » dans le film, 1’29’’21’’’).
Premier contact est donc le récit non-narratif et non-linéaire d’une epistrophè en direction d’un au-delà de la représentation. La conversion était déjà symbolisée par le renversement de perspective au moment de l’entrée dans le vaisseau. La verticalisation subite de l’orientation apparaissait alors comme l’abandon de la bipédie terrestre (la marche devient une ascension verticale) et de l’inscription dans un espace anthropomorphisé (devenu non-euclidien et vaporeux dans le vaisseau). L’arrachement à un enracinement terrestre manifestait ainsi le dépassement du « Nomos de la terre[37] » qui nous destinait à sceller notre appartenance au « monde ». L’avenir cosmologique de l’humanité était en effet voué à l’éternel retour de Babel, soit à la répétition de l’échec de l’unification. Or, le devenir cosmique de l’humanité ouvre une brèche sans équivalent dans l’histoire, en relativisant la portée du cosmopolitisme, dont l’horizon est dorénavant celui d’une politique-univers.
Cette régression dans l’institution de l’humanité, et dans les conditions de la représentation, ne dévoile aucun absolu, mais le croisement de plans d’immanence qui vont différant dans l’univers, et qui peuvent pourtant coïncider de manière affine[38]. Ni « le monde », ni « la communication », ni le « temps » ne sont retrouvés, bien qu’ils soient dé-clôturés. La faillite initiale de l’humanité ne réside pas dans son éclatement, mais dans sa relativisation. Le dilemme désormais irréversible est donc le suivant : soit l’humanité s’anéantit par une division insurmontable (fermeture de la représentation), soit elle s’abolit par son dépassement vers un univers immense (extension de la représentation). Telle est la leçon de Premier contact : être, ou ne plus être humains, il faut choisir. L’abandon de l’humanité ne consiste alors pas dans une existence surhumaine, fantasme lié au désir d’excéder nos limites, mais dans l’intériorisation du devenir cosmique de cette existence.
[1] Genèse, 11, 1-9.
[2] Tragique redoublé, sur le plan personnel, dans la relation que Louise Banks entretient avec celui qui deviendra le père de sa fille.
[3] La reprise de la symbolique du chiffre sept n’ouvre-t-elle pas, à ce titre, l’horizon d’une re-création du monde ? Le septième jour, laissé originairement vacant, n’est-il pas celui d’un nouveau commencement ?
[4] Voir notamment la neuvième proposition, qui envisage une « perspective consolante sur l’avenir » par l’intégration des nations dans un système (Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique [1784] in Opuscules sur l’histoire, Paris, GF, 1990, p. 88).
[5] L’histoire générale de la nature et la théorie du ciel [1755], dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1980, tome 1, p. 104.
[6] Critique de la faculté de juger [1790], Paris, Folio, 1985, § 83.
[7] Ibid., § 87.
[8] Anthropologie d’un point de vue pragmatique [1798], Paris, GF, 1993, p. 323.
[9] C’est notamment l’enjeu de la relecture de la monadologie leibnizienne par Tarde, lorsqu’il écrit « Exister, c’est différer » (Monadologie et sociologie [1893], Paris, Les empêcheurs de tourner en rond, 1999, p. 72).
[10] Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Tel Gallimard, 1966, Tome 1, p. 261.
[11] Ibid., p. 62.
[12] Cette décorrélation est ce qui pousse Thamous à refuser l’écriture que lui propose Teuth. Dans le Phèdre de Platon. Le langage « royal » est celui du discours de l’âme, qu’il oppose au discours écrit qui est analogue à la peinture. Selon les propos de Socrate, celui qui connaît le bien et le beau ne prendra pas le risque d’« écrire sur l’eau » (Phèdre, 276c), puisqu’il sait que la dialectique révèle à l’âme son immortalité.
[13] Que l’on trouve chez Quine à propos de l’inscrutabilité de la référence, thèse notamment développée dans La Poursuite de la vérité, Paris, Seuil « L’ordre philosophique », 1993.
[14] Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Tome 2, Paris, Seuil, 1980, p. 189.
[15] A la différence cependant que les signes ne sont pas durables. L’écriture échappe ainsi à l’écueil d’une fixation du sens, puisqu’au contraire, pour nous, « Elle crée le sens en le consignant, en le confiant à une gravure, à un sillon, à un relief, à une surface que l’on veut transmissible à l’infini. » (Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 24).
[16] Voir Deleuze, Proust et les signes, Paris, PUF, 1976, p. 135 : « l’âme grecque a toujours eu l’impression que les signes, muet langage des choses, étaient un système mutilé, variable et trompeur, débris d’un Logos qui devaient être restaurés dans une dialectique, réconciliés par une philia, harmonisés par une sophia, gouvernés par une intelligence qui les devance. ».
[17] Voir notamment Merleau Ponty, La structure du comportement, Paris, PUF, 1942, p. 128.
[18] Leur « forme » approche celle de la pieuvre ou du poulpe, dont la figure est analysée par Jean Pierre Vernant dans Les ruses de l’intelligence, la mètis des Grecs, Paris, GF, 1974, p. 46 : « Animaux obliques, dont l’avant n’est jamais distingué clairement de l’arrière, ils confondent en eux-mêmes, dans leur démarche et dans leur être physique, toutes les directions. ». Le poulpe est la figure du multiple et du renversement, échappant sans cesse au face à face, car n’ayant pas de face. L’écriture n’est-elle d’ailleurs pas similaire au jet d’encre de la pieuvre ?
[19] Ce que désigne par exemple l’Aum dans l’hindouisme (voir par exemple La Bhagavad-Gita, X, 25).
[20] Leibniz, Lettre à Gallois, septembre 1677. La condamnation de l’écriture dans le Phèdre s’appuyait justement sur l’assimilation de l’écriture à la peinture de la parole, rendant le dialogue impossible.
[21] A la manière du monopsychisme d’Averroès. Jean Baptiste Brenet écrit à ce sujet : « Télépathie et transfert des pensées constitueraient le mode fondamental de communication entre les individus ; un mode originel, archaïque, dépassé par le langage des signes physiques, mais pas disparu, toujours mobilisable […]. » (Averroès l’inquiétant, Paris, Les belles lettres, 2015, p. 110).
[22] Cité par Frédéric Nef, Leibniz et le langage, Paris, PUF, 2000, p. 66.
[23] Cette traduction étant l’envers positif et non compris du « weapon » proposé par les heptapodes. Que le don puisse se renverser en arme ne contredit en aucun cas les découvertes anthropologiques sur la question depuis Mauss, Godelier ou Clastres.
[24] Edward Sapir, « The Status of Linguistics as a Science », Language, Vol. 5, No. 4 (Dec., 1929), p. 207-214.
[25] Tractatus Logico-philosophicus [1921], Paris, Tel Gallimard, 1993, p. 44.
[26] Bergson, L’énergie spirituelle, Paris, PUF, 1919, p. 131.
[27] Bergson, Matière et mémoire [1893], Paris, PUF, p. 165.
[28] D’où la différence radicale avec le projet proustien de retrouver un temps « perdu ». Les flashbacks apparaissent d’abord similaires à des réminiscences, purifiées de leur contingence matérielle, tant que la règle de construction n’est pas comprise.
[29] Deleuze, Cinéma 2, L’image-temps, Paris, Minuit, 1985, chap. IV.
[30] Ibid., p. 110.
[31] Comme me l’a fait remarquer l’aimable relecteur de cet article, Louise Banks déclare à la fin du film : « « Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it and I welcome every moment of it ». On peut y voir une forme de resilience, une sagesse acquise au travers de l’expérience cosmologique du temps. Qu’il en soit remercié.
[32] Deleuze, Cinéma 1, L’image mouvement, Paris, Minuit, 1983, p. 88.
[33] A moins qu’un renversement ironique ne s’opère : l’heptapode en pâte à modeler de la fille de Louise Banks (1’31’’20’’’) est-il la trace du devenir universel et cosmique, ou le modèle de l’heptapode ? Est-il eikon, ou phantasma, suivant la distinction esquissée dans le Sophiste de Platon ? Le film, d’autant plus s’il appartient au genre de la « science-fiction », n’est-il pas l’envers fantasmé du réel, la matérialisation du refoulé ? Louise Banks n’a-t-elle pas créé de toute pièce ce récit, de la même manière que le réalisateur « monte » le film ? L’imagination n’est-elle pas cette faculté qui dé-monte, puis monte et re-monte l’ensemble des images ?
[34] Bergson, Le rire [1900], Paris, PUF, 1967, p. 115.
[35] Qui sait si la révélation de l’ordre du temps dont Louise Banks fait l’expérience n’est pas seulement celle d’un agencement possible parmi une infinité d’autres ? Sur la pluralisation de la durée, voir Bergson, « Le possible et le réel » [1911], in La pensée et le mouvant, Paris, PUF, 1993, p. 210.
[36] Bergson, Le rire, op. cit., p. 115.
[37] Selon l’expression utilisée par Carl Schmitt pour désigner un gouvernement intra-mondain.
[38] L’affinité étant le contact sans pénétration.










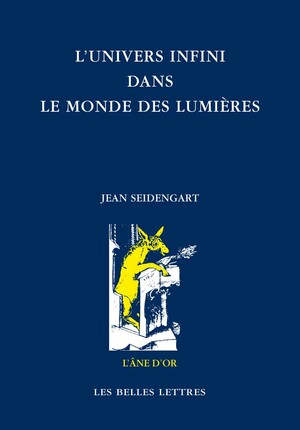




MErci.