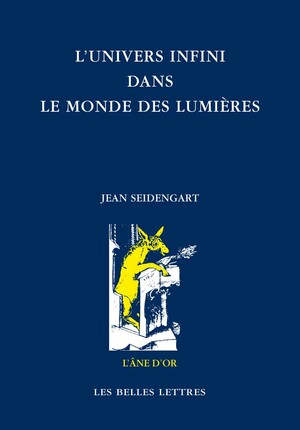Thorstein Veblen: la formation des préférences et les instincts barbares dans la société industrielle
« Not long ago a much esteemed writer informed the world that he felt ‘disposed to cry out with delight’ before a figure by Michael Angelo.
I wonder whether he would feel disposed to cry out before a real Michael Angelo, if the critics had decided that it was not genuine, or before a reputed Michael Angelo which was really by someone else. »
(Samuel Butler, The way of all flesh, IV)
Dans la Venise du XVe siècle, la mode féminine des patins de liège, démesurément hauts, suscite de nombreuses polémiques. Les législateurs les condamnent rudement : non seulement ils épuisent les ressources en liège de la nation, mais ils provoquent de nombreux incidents. L’un d’eux écrit : « Des femmes enceintes, qui allaient par les rues chaussées de patins si hauts qu’elles ne pouvaient garder l’équilibre, ont fait des chutes leur ayant porté si grand dommage qu’elles ont perdu leur enfant ou en ont avorté, causant la perdition de leur corps et de leur âme ». Le vertugadin, cette armature rigide conçue pour tenir les robes écartées des hanches, suscite tout autant d’étonnement à la Renaissance. Il est coûteux, dit-on : le volume de tissu pour la confection d’une robe de cette ampleur est très important. Les femmes aussi s’en plaignent. Il est lourd, il rend difficile le franchissement des portes, et très incommode pour s’asseoir[1].
Si nous avons cité ces deux exemples, c’est que l’histoire du costume féminin nous semble, à bien des égards, le musée des horreurs des préférences individuelles[2]. Plus que tout autre revirement du bon goût, cela interpelle, exige explication. Nous aimerions montrer que ce problème philosophique et anthropologique de la formation des préférences, individuelles ou collectives, que certains considèrent comme le véritable oubli des sciences sociales[3], est traité avec force et cohérence par Thorstein Veblen dans la Théorie de la classe de loisir. Sa théorie des préférences en terme de consommation et de loisir ostentatoire est soutenue par une théorie darwinienne des instincts, que nous nous proposons d’expliciter.
Les préférences individuelles et collectives au sein d’une société sont fonction de nombreux facteurs, tels l’avancée de la technique ou la taille des groupes humains. Ce constat est trivial. Mais malgré cela, la ressemblance la plus vague entre deux époques ou deux peuples est presque aussitôt consacrée comme une constance de la nature humaine, et l’expression d’un instinct. Notre pari sera d’expliquer les dépendances causales entre trois notions : préférences, instincts, milieu.
Veblen considère que, de la sauvagerie pacifique des origines de l’humanité, jusqu’à l’Amérique capitaliste de la spéculation et des trusts, certains instincts demeurent et traversent l’histoire. D’autres, au contraire, se forgent et se fortifient par le filtre de la sélection naturelle. La haute société industrielle, caractérisée par la différenciation forte de la classe de loisir, ou classe oisive, et de la classe industrielle, est ainsi traversée par les survivances de mœurs barbares, par les instincts prédateurs de l’homme des tribus. Bien entendu, ils ne s’affichent jamais immédiatement comme tels, et pour cette raison, Veblen précise que pour son objet d’étude – la place et la valeur de la classe de loisir prise comme facteur économique de la vie moderne – il devra s’attarder sur certains traits de la vie sociale qui ne sont généralement pas considérés comme économiques. Toute une série de pratiques, comme le sport, la pratique des jeux de hasard, la religion et le sacerdoce, l’habillement, l’amour des beaux arts, et même la pratique des langues anciennes, seront ainsi l’objet de son étude, et tenus comme des manifestations indirectes et déguisées des instincts barbares ou prédateurs. Ces instincts, dont les manifestations explicites sont la férocité, l’égoïsme, l’esprit de coterie, la sournoiserie ou le recours à la force et à la fraude, nous dit Veblen, se forgent sous la force de l’habitude, comme nous le verrons (à la période barbare, comme son nom l’indique). Le changement de préférence pourrait s’expliquer en partie par la modification des instincts, bien qu’un même instinct puisse se manifester de nombreuses manières lorsque les conditions et le milieu diffèrent. Mais Veblen semble parfois tout autant considérer, au contraire, que les instincts sont immuables, et que le seul changement du milieu – par exemple la complexification de la structure sociale, ou la soudaine prodigalité des biens alimentaires – crée chez les individus, de façon mécanique, des comportements et des préférences nouvelles. Les mêmes tendances et instincts s’expriment à travers tous les âges de la civilisation. Pour emprunter ses mots, « la vie du groupe étant une lutte entre individus, les pacifiques à l’ancienne sont des lutteurs aux ongles rognés » (p. 146). S’agit-il un naturalisme inconséquent ? Nous ne tenterons pas de trancher.
Nous nous proposons de retracer l’histoire des sociétés occidentales en décrivant leurs phases économiques successives, telle que la conçoit Veblen. Nous suivrons ainsi à la trace le développement de la classe de loisir. Nous tenterons de donner un aperçu de sa théorie des instincts, et de dégager le rôle majeur joué par l’instinct prédateur et l’instinct artisan qui lui fait pendant. En décrivant certains mécanismes en jeu dans la course à l’estime, nous nous tournerons enfin vers quelques manifestations des instincts barbares dans la société industrielle.
L’évolution de la société et la naissance de la classe de loisir
L’histoire des sociétés occidentales peut être découpée en quatre phases principales, ou périodes économiques : i) l’époque sauvage, ii) l’époque barbare, iii) l’époque artisanale, iv) l’époque machiniste. Nous étudierons les deux premières époques, afin de comprendre la nature et l’émergence de la classe de loisir.
Veblen insiste longuement : le passage d’une phase à une autre est très progressive et toutes les parties de la société n’évoluent pas simultanément et uniformément. Il définit une époque par l’ensemble des institutions humaines à un moment donné. Ce terme d’institution est fort équivoque, et la traduction en « formes de conscience » proposée par Adorno[4], est insatisfaisante. Il ne semble pas se rendre compte que les institutions au sens de Veblen, désignent aussi bien les caractères et les préférences individuelles (sous l’expression générale habit of thought) que les institutions politiques, de manière plus conforme à l’usage ordinaire du terme.
Différences avec Auguste Comte.
Si la philosophie du progrès de Comte semble être une source importante d’inspiration pour Veblen, nous devons signaler deux différences importantes entre ces deux théories. Tout d’abord, pour Veblen, l’évolution des sociétés ne se fait pas en vertu d’une nécessité irrésistible. Elle est conçue sur un mode darwinien comme une adaptation produite par un changement dans le milieu, par pression de sélection. Deux facteurs principaux semblent motiver ces changements : la grandeur des groupes sociaux et le niveau d’avancement de la technique. De plus, le passage d’une phase à une autre n’a rien d’irréversible, la réversion est toujours possible tandis que chez Auguste Comte, le passage à l’état positif, qui est aussi un état final, est sans retour, alors que l’état métaphysique est seulement transitoire. En témoigne cette remarque de Veblen, selon laquelle les sociétés primitives qui existent encore de son temps ont sans doute, pour des motifs inconnus, connues jadis une réversion à partir du haut état barbare vers l’état premier, l’état sauvage.
Pour véritablement comprendre les mécanismes permettant le passage d’une phase économique à une autre, il nous faudra exposer sa théorie des instincts, ce que nous ajournons à la seconde partie de notre travail. Mais voyons tout d’abord comment Veblen caractérise la première phase économique.
Comment prendre connaissance des phases économiques ? L’état sauvage et la rivalité pacifique.
Veblen, pour les besoins de sa démonstration, postule l’existence originaire d’un stade pacifique primitif. Pour connaître les différentes phases de la société, leur ordre de succession, et les caractères individuels dominants qui les caractérise, la pratique de l’archéologie est inutile, et la considération des peuplades reculées ne l’est pas moins. Il suffit de regarder en soi-même et en ses concitoyens pour lire tout le passé de sa civilisation. Chaque période, à la condition qu’elle fut assez longue, a forgé par adaptation un nouveau jeu d’instincts dans la nature humaine, qui demeurent aujourd’hui comme traces plus ou moins identifiables ou vives selon leur sollicitation actuelle, leur ancienneté ou leur importance passée. Voilà pourquoi Veblen peut dire que l’hypothèse de la phase sauvage est davantage justifiée par la psychologie que par l’ethnologie.
Dans l’état primitif, sauvage et paisible, les sociétés humaines prennent la forme de clans, de groupements humains de petite taille à forte solidarité. La classe oisive n’est pas encore instituée, et il n’existe pas encore de réelle distinction fonctionnelle entre les individus selon leurs rangs[5]. S’il n’y a pas encore division structurelle de la société, il existe néanmoins dès l’origine une discrimination des actions et des travaux : ils sont dignes ou indignes. Sont dignes, les actions extraordinaires, rares, les exploits et les prouesses. Indignes sont les besognes, les actions répétitives, les travaux qui renvoient aux nécessités ordinaires de la vie. La « comparaison provocante » (invidious comparison), définie comme un « procédé de cotation des personnes sous le rapport de la valeur » (p. 25), est un fait originel, bien qu’il ne prenne pas encore la forme prédatrice qu’il ne tardera pas à acquérir. À ce stade, les individus des clans barbares étant indifférenciés, les prouesses d’un individu augmentent le mérite de tout le groupe. La rivalité, la « comparaison provocante », se joue entre les clans eux-mêmes.
Le passage de la rivalité pacifique à la rivalité prédatrice
La progression de la technique, ainsi que l’augmentation de la taille de la communauté, vont finir par changer la donne. Ce premier paramètre va produire une certaine opulence. La subsistance sera assurée dans des conditions assez faciles pour dispenser une partie de la communauté de s’appliquer régulièrement aux besognes courantes. En raison du second paramètre, la communauté va prendre pour coutume de causer préjudice, par force ou stratagème, car les frictions entre les différents clans se font plus nombreuses, des conflits de territoire peuvent apparaître. Cela va augmenter la concurrence et les motifs pour rivaliser. Entre les clans d’abord, mais aussi entre individus.
Les preuves tangibles de vaillance – les trophées – prennent leur place dans les façons de penser des hommes, et surtout dans leur attirail. Le butin, les trophées de chasse ou de razzia, sont bientôt prisés comme autant de témoignages d’une force remarquable. L’attaque devient la forme admise de l’action, et le butin témoigne prima facie de sa réussite (p. 13).
Il n’en fallait pas plus pour que l’esprit belliqueux apparaisse : « honorable c’est redoutable, digne, c’est prédominant » (p. 14) Tout fini par se juger du point de vue de la lutte : le travail d’industrie, qui exploite un matériau brut, passif, qui n’oppose pas aux fins de l’agent des fins contraires, comme dans le cas de l’exploit, se fait odieux. Obtenir des biens autrement que par la mainmise devient indigne d’un homme du meilleur rang.
Le rôle capital de la prouesse
Les individus en viennent à considérer leurs intérêts privés et non seulement ceux du clan, sous la pression des deux facteurs énoncés plus hauts. Ils recherchent l’honneur pour eux mêmes. Or, ces mêmes facteurs rendent en partie caduques les moyens traditionnels de publier la prouesse accomplie. La prouesse effectuée (par exemple, le combat victorieux contre un animal féroce) a rarement assez de témoins pour garantir une publicité et une honorabilité durable à l’individu qui l’effectue. Dans les premiers stades de la civilisation, celui des clans, la prouesse de l’un se faisait connaître de tous par voie de témoignage, et comme les intérêts individuels n’interféraient pas encore, les individus avaient-ils de bonnes raisons de les remettre en doute ? Mais à mesure que grandit la communauté, le bénéfice d’honorabilité produit par la prouesse diminue en proportion. Est-ce à dire qu’elle disparaît ? Il est vrai que dans les premiers stades de la civilisation, Veblen le rappelle souvent, la prouesse tenait une place bien plus capitale qu’aujourd’hui, et provoquait un intérêt bien plus considérable. Mais si elle se raréfie, elle ne va pas disparaître pour autant.
Il faut bien comprendre que l’estime de soi, le respect de soi même dérive pour Veblen de la représentation du degré auquel les autres nous estiment. Il ne s’agit néanmoins pas d’une simple moyenne arithmétique de l’évaluation de nos proches et de nos connaissances : la représentation de l’avis favorable d’un inconnu pèse peut être moins que celle d’un ami, mais elle n’est pas nulle.
Les indices de la prouesse, et comment l’indice en vient à être estimé en lui même
Pour publier la prouesse accomplie en exposant aux regards de façon durable son résultat au sein d’une communauté, l’on invente des indices de prouesse. Ce sont les trophées. Veblen va jusqu’à faire dériver l’existence de la propriété, celle des biens et des personnes, de cette transformation de la quête d’honorabilité :
le motif qui se trouve à la racine de la propriété, c’est la rivalité […]. La possession des richesses confère l’honneur : c’est une distinction provocante (p. 19).
Bien entendu, la nécessité d’accroître le confort, et celle de subsister, a sans aucun doute été un mobile pour accroître l’acquisition, mais Veblen affirme que si elle a pris cette importance, c’est car dès le principe le grand aiguillon, « fut la distinction qui provoque l’envie » (p. 20). Tout d’abord, la propriété est le signe visible par tous de l’exploit (par exemple, le butin de guerre). Mais à mesure que la technique progresse, les occasions d’exploit deviennent moins courantes. D’abord prisée comme témoignage de vaillance, elle va devenir en elle même un acte méritoire.
Pour décrire plus abstraitement le mécanisme en jeu ici, disons qu’en bref, la tendance à rivaliser, à se comparer avec autrui pour le rabaisser, est « l’un des traits les plus indélébile de la nature humaine » (p. 73), mais ce n’est pas le cas pour l’objet de la rivalité, qui lui est fixé arbitrairement, au gré des associations et des habitudes. Lorsque, en raison de modifications du milieu, l’objet de la distinction ne peut s’afficher plus aussi clairement qu’avant, un indice plus visible pour cet objet sera trouvé, jusqu’à que l’indice devienne l’objet même de l’estime[6]. D’abord, la prouesse garantie l’estime. Mais lorsque les occasions de prouesse se sont trop raréfiées, ou qu’elles ne garantissent pas une publicité suffisante, les trophées prennent de l’importance. Ils deviendront la propriété privée, qui elle même se signalera, en raison de modifications semblable du milieu, par la consommation et le loisir ostentatoire, et enfin, la consommation et le loisir délégataires, désormais les ruses les plus élaborées pour la distinction. Comme nous le verrons bientôt.
La naissance de la classe de loisir
Comme nous l’avons déjà évoqué, avec la prise d’importance de la prouesse et de ses indices (le loisir et la richesse), vient l’opprobre jeté sur les travaux industriels. Sont tenues pour nobles les fonctions relevant ostensiblement de la prédation. Ce seront celles qui appartiendront en propre à la classe de loisir : le gouvernement, la guerre, la chasse… Ignobles, moralement indignes d’un homme de haut rang, les occupations de la classe industrielle : travail manuel et besognes serviles en tout genre. À partir d’une distinction seulement rituelle, va s’instituer une distinction réelle de classe, se dégager un espace où les individus s’adonnent au loisir, défini comme un travail dont on ne découvre aucun but, aucune intention, sinon celle de montrer qu’on ne s’emploie pas à quoi que ce soit de lucratif ou d’utile et qu’on n’a nul besoin de le faire. Quels sont ces loisirs ? La chasse par exemple, à condition qu’elle soit au dessus de tout soupçon de travail manuel (on évoquera la beauté du sport, et on se préservera parfois même de consommer les gibiers). Mais aussi tous les arts dits d’agréments. En bref, tout ce qui ne contribue pas directement au progrès de la vie humaine.
En bref, la complexification des groupes sociaux et l’accumulation des richesses produit une distinction réelle entre une classe de loisir et une classe industrielle, incarnation de ce qui était jusqu’alors la seule distinction morale du noble et de l’ignoble. Ces deux classes vont se structurer en rangs et grades d’une complexité croissante.
La théorie des instincts
Il s’agit désormais d’exposer la conception des instincts qui soutient l’édifice théorique de Veblen. Nous ne tenterons pas d’en sauver grand chose, nous passerons sous silence les explications détaillées qu’il fournit de la formation des instincts (transformation des réflexes conditionnés ou habitudes en réflexes inconditionnés ou instincts) : il y est rarement original, et s’appuie sur une biologie datée[7].
L’instinct prédateur et l’instinct artisan
Nous souhaitons nous attarder sur deux instincts, deux « constantes du naturel humain » (p. 70), dont les conflits permanents hantent la société industrielle : l’instinct prédateur (ou rapace), et l’instinct artisan. Ces deux instincts ont été forgés à deux périodes distinctes de l’histoire, car l’hérédité permet la survivance de traits plus ou moins anciens, dont l’antagonisme n’est pas exclu.
Les conditions de vie, le milieu, poussent les hommes à s’adapter, produisent une adaptation sélective du tempérament et des façons de penser, mais aussi corrélativement, un changement de la nature humaine. Nous héritons en quelque sorte de nos ancêtres d’un naturel non uniforme, non homogène. Notre « présent héréditaire » manifeste ainsi deux tendances à la réversion vers l’archaïsme : une tendance pacifique, ou anté-prédatrice, correspondant au tout premier stade de la vie en société, et une tendance prédatrice, survivance d’une modification plus récente.
L’instinct artisan pousse l’homme à considérer favorablement l’efficacité productive, et tout ce qui peut servir l’humanité, et le pousse à désapprouver tout gaspillage de substance et d’énergie. C’est lui même qui sera le premier moteur de la distinction entre la classe industrielle et la classe de loisir, en favorisant l’exploit et la distinction entre les classes nobles et ignobles. Ainsi, le gaspillage ostentatoire sera tempéré, avec plus ou moins de force, par l’instinct artisan.
L’instinct barbare ou rapace, au contraire, c’est la violence sous toutes ses formes : férocité, ruse et mépris des scrupules. Aux stades les plus élémentaires c’est la violence physique et l’agression pures et simples (sous la figure de la prouesse), mais elles s’expriment désormais modifiées sous la forme des vertus aristocratiques : l’habileté, la sagacité, la chicane…
La classe de loisir et les instincts barbares
La distinction entre l’instinct artisan et l’instinct prédateur va coïncider en grande partie avec la distinction de la classe industrielle et la classe de loisir. Car le tempérament rapace est clairement un atout pour survivre en régime de rivalité. Si Veblen reconnaît que la société contemporaine est essentiellement pacifique et qu’aucune société n’a désormais le moindre intérêt à l’emporter sur les autres, il reconnaît que les intérêts des individus n’ont jamais été aussi bien servis que par la rapacité[8]. La vie économique favorise la survie, le renforcement, du tempérament prédateur, alors même que le système moderne est globalement pacifique :
les professions que la classe de loisir exerce dans l’industrie moderne sont de nature à maintenir en vie certaines habitudes et aptitudes prédatrices (p. 153).
On trouve une grande concentration de la réversion au naturel archaïque prédateur et barbare au sein de la classe de loisir. Est-ce en raison d’une différence naturelle de tempérament entre les membres de ces deux classes ? Cela pourrait être vrai s’il n’y avait pas de communication entre elles. Il faut voir plutôt dans ce fait sociologique le résultat d’une sorte d’opération de tri permanente.
Voici en trois opérations rapidement esquissées, le fonctionnement de cette distribution :
1) Les individus des classes impécunieuses n’ont ni les moyens ni le temps d’exprimer leurs inclinations rapaces, ce qui ne crée pas de renforcement.
2) La classe de loisir recrute parmi ceux qui ont réussi dans le domaine pécuniaire, ceux qui sont mieux dotés que l’ordinaire en terme de rapacité.
3) Si un individu au sein de la classe de loisir retourne au naturel pacifique, il est presque immédiatement éliminé et rejeté au sein des classes impécunieuses.
La classe de loisir comme classe conservatrice et le cultural lag
La classe de loisir est naturellement conservatrice, car l’instinct prédateur y domine. Elle rechigne à toute modification des institutions, du tempérament et des façons de penser. Elle tente toujours de réhabiliter des éléments de la culture archaïque, alors même que l’évolution industrielle tente à tout prix de les effacer de la société contemporaine (p. 219). Pour elle, toute nouveauté « ébranlerait les assises de l’édifice social », « plongerait la société dans le chaos », ou même « saperait les fondements de la moralité » (p 133). Par intérêt, mais aussi par instinct, elle tente de perpétuer l’inadaptation. C’est ce qu’on nomme le cultural lag : les institutions humaines sont reçues d’une époque antérieure, et comme elles ont été élaborées dans le passé avant d’être transmises, elles sont donc adaptées aux conditions passées et ne peuvent jamais être tout à fait accordées aux exigences du présent (p. 216). Le milieu humain change toujours plus vite que les instincts ! Le progrès social que promet l’industrie, c’est tout simplement un réajustement, une mise en harmonie, entre un naturel humain, des instincts et des institutions archaïques, et des circonstances externes nouvelles. La classe de loisir, comme institution, a pour effet de réduire le rendement industriel de la société, de « retarder l’adaptation de la nature humaine aux nécessités de la vie industrielle moderne ». Les loisirs qu’elle promeut convergeront vers cette tâche conservatrice.
La survivance de la barbarie dans la société industrielle
Violence physique, violence symbolique
À en croire Veblen, la plupart de nos comportements sociaux ont un caractère économique, et sont autant de manifestations de notre naturel archaïque barbare. Leur violence est rarement aussi nettement affichée que dans le penchant pour le combat et la prouesse guerrière. Mais l’admiration des faits d’arme et de la violence physique n’est pas moins une expression de ce naturel.
Bien entendu, les individus sont consciemment mus par des motifs plus bienveillants, et d’autres incitations, d’autres motifs que la rapacité, seront invoqués. Un chasseur dont l’occupation principale est de « plonger la nature dans un état de désolation chronique » (p. 169) invoquera peut-être l’amour de la nature pour justifier sa pratique, mais c’est peu dire qu’il s’aveugle ici sur ses motifs réels…
Nous apprendrons ainsi que les sports sont par nature rapaces et désintégrateurs, et contribuent à ressusciter des penchants néfastes à l’industrie. Que l’étude des humanités est aussi un outil au service du loisir ostentatoire et fausse l’instinct artisan en ne servant qu’à maniérer l’intellect et à diminuer le rendement économique, en inspirant une aversion pour le savoir utile.
Il nous faut désormais nous tourner vers les mécanismes plus subtils développés par l’instinct barbare pour l’affirmation de la rivalité.
Gaspillage ostentatoire : Consommation et loisir
Nous avons vu que l’augmentation de la taille du groupe social a rendu la bonne réputation, la notoriété, insuffisante pour garantir l’estime. Aussi, la rivalité doit-elle trouver d’autres ruses, la supériorité pécuniaire doit devenir voyante pour tous, être affichée perpétuellement. Le défi de la modernité, c’est de « tracer la signature de sa puissance pécuniaire en grosses lettres, assez grosses pour qu’on pût les lire en courant ». Cette ruse, ça sera le gaspillage, entendu comme dépense inutile à la vie ou au bien-être des hommes.
L’estime ne revient pas à notre quantité de richesse réelle, mais à celle qu’on laisse apparaître. Dès lors, la consommation ostensible de biens coûteux et inutiles devient alors l’une des ruses les plus importantes pour s’attirer l’estime. Mais ce n’est pas la seule. Le loisir ostentatoire, montrant qu’on se dispense présentement de toute activité industrielle, permet aussi de renseigner l’étendue de sa richesse. Une habitude difficile à acquérir, telle une manière de parler raffinée, atteste rétrospectivement et avec force d’un volume élevé de temps passé sans activité industrielle. Cela doit à ce titre être considéré comme une manifestation de loisir ostentatoire. La consommation ostentatoire a aussi son pendant rétrospectif : consommer certes, mais consommer comme il sied, en montrant ainsi le temps et l’application mis à la culture de ces facultés esthétiques. Car l’œil avisé remarque vite les manières apprises trop vite, et les réprouve…
Veblen remarque que plus le groupe social est important en taille, plus la consommation ostentatoire prime sur le loisir ostentatoire. Les moyens de communication et la mobilité de la population exposent désormais l’individu à bien des gens qui n’ont d’autre moyen de juger sa réputation que les biens dont il est capable de faire étalage.
Consommation et loisir délégataire
A partir d’un certain degré de richesse, l’on a beau être vêtu le mieux du monde, et consacrer tout notre temps à la pratique des sports et des arts d’agréments, il nous devient impossible de nous distinguer pécuniairement de ceux qui ont une richesse approchante à la notre. Et pourtant, la distinction et la rivalité doivent s’afficher encore, et trouver d’autres ruses. Si une vie seule ne suffit plus pour afficher l’étendue réelle de sa richesse, c’est qu’il en faut d’autres. C’est là qu’intervient le gaspillage délégataire. On engagera ainsi des domestiques, et on leur fera porter livrée. Eux mêmes pratiqueront loisir et consommation ostentatoire, pour témoigner de la capacité de paiement de leur maître. Le rôle des domestiques, et c’est aussi celui de l’épouse : procurer un loisir délégataire qui serve l’honorabilité du propriétaire. « Le loisir du serviteur n’est pas son loisir ». (p. 42)
Les motifs économiques dans les canons du goût
Si la règle du gaspillage honorifique oriente la consommation et la production, c’est parce qu’elle modifie les préférences individuelles. Veblen le rappelle : elle peut parasiter, influencer, le sens du devoir, de la beauté, de l’utilité. L’envie consciente, c’est d’être en conformité au modèle du goût, non pas d’agir en conformité de la loi du gaspillage ! C’est ce qui fait dire à Veblen que la loi du gaspillage oriente la consommation vestimentaire au « second degré ».
L’habillement ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, est soumis à au moins trois normes : le gaspillage ostentatoire (cherté et propreté des vêtements), le loisir ostentatoire[9] et le goût du jour[10].
Veblen ne pense néanmoins pas que les jugements de goût soient uniquement des appréciations en terme de valeur économique. Bien qu’il avoue que souvent, « absolument ravissant ! » puisse se traduire par « pécuniairement honorifique ! » (p. 87), il croit à l’existence objective des propriétés esthétiques : la grande beauté de l’or n’est pas seulement due à sa valeur marchande, et la plupart des œuvres d’art observées est bien « intrinsèquement belles » (les motifs d’appréciation sont clairement alors à distinguer des motifs d’acquisition des œuvres). Néanmoins, pour satisfaire totalement à notre sens de la beauté, s’attirer un jugement favorable, un objet doit satisfaire aussi aux exigences de la cherté ! L’appréciation, souvent, ne peut facilement être désolidarisée de la règle de cherté. Cette confusion s’illustre mieux encore dans la mode vestimentaire que dans les beaux arts : « En fait de vêtement, l’honorabilité décide des formes, des couleurs, des matières ; enfreindre ce code, c’est blesser le goût : c’est dirait-on, pêcher contre la vérité esthétique ».
Il faut prendre toute la mesure du pessimisme de Veblen : le monde contemporain est agité par la loi de la pure perte d’effort. Voilà ce qui nous fait courir. C’est tout notre temps, nos biens, notre énergie, qu’on investit dans cette lutte infinie[11] pour l’honorabilité. En décrivant avec la finesse de nos meilleurs moralistes les mécanismes de cette course à l’estime, Veblen nous donne à voir tout ce que la haute culture peut avoir de radicalement barbare. Lorsqu’on énonce une préférence esthétique par exemple, décrit-on seulement nos états émotionnels, ou une propriété de la chose qu’on estime ? Non. Il faut prendre toute la mesure de cette affirmation : énoncer une préférence, c’est aussi un acte de guerre.
Mais cette lutte n’est pas seulement présente dans les relations interindividuelles, car nous avons vu que la consommation ostentatoire oriente aussi la production des biens. Les objets manufacturés sont rendus par cette loi de moins en moins fonctionnels, de moins en moins adaptés à leur fin. En plus d’offenser notre sens esthétique, ils sont de plus en plus hostiles à l’homme. De plus en plus inconfortables aussi, puisque leur but n’est pas d’épanouir la vie du consommateur, mais d’augmenter la réputation pécuniaire, et servent d’autant mieux ce but qu’on les désolidarise de leur fonction propre (– que ces tabourets sont inconfortables ! – oh oui, mais tellement design…). La société de consommation crée-t-elle, comme on le répète inlassablement, des besoins artificiels ? Certes, mais nous en sommes les artisans. Par une étrange inversion de valeurs, c’est l’individu lui-même qui semble réclamer sa servitude et l’afficher avec tant de fierté, et tant d’insistance que son oisiveté en devient un travail à plein temps : regardez comme mes occupations sont vaines, comme mon esprit est byzantin, semble-t-il dire. Car la distinction doit s’affirmer encore, c’est cela ou la guerre.
Willy Abécassis (Université Paris 1)
[1] Sur ces deux points, voir Diane Owen Hugues, in Histoire des femmes en occident vol. 2, sous la direction de G.- Duby & M. Perrot, p. 181-207
[2] Veblen remarque: « Avec une demi-douzaine d’années de recul, nous sommes frappés de voir combien la meilleure des modes fut saugrenue, disons même franchement vilaine. Notre engouement d’un jour pour tout ce qui est du jour a des mobiles qui n’ont rien d’esthétique » (p. 117) Comme nous le verrons, que les exemples les plus frappants proviennent du vêtement féminin s’explique parfaitement dans la théorie de Veblen : la toilette féminine forçant plus nettement sur les détails certifiant l’exemption du travail, en raison des règles de la consommation délégataire. Cela fournit une illustration supplémentaire de l’assujettissement de la femme passée comme présente, montre que la « femme demeure toujours la protégée économique de l’homme […] qu’elle est toujours sa chose », Thorstein Veblen, Théorie de la classe de loisir, Gallimard, Tel, 1979, p. 119.
[3] C’est l’avis de J. Elster, Tocqueville : The first social scientist, p. 11 : « Contemporary social science has little to say about mechanisms of preference formation and preference change ».
[4] Adorno, L’attaque de Veblen contre la culture, in Prismes, Petite bibliothèque payot 2010, p. 86.
[5] Une exception, peut être. Veblen semble parfois considérer que la distinction de l’exploit et de la besogne coïncide, dès ce stade, avec la distinction des sexes. La distinction entre les professions industrielles et non industrielles serait déjà en germe ici, produite par l’inégalité naturelle de force et de tempérament, entre les hommes et les femmes.
[6] C’est un principe central dans la psychologie de Veblen : toute appréciation conditionnée se transforme sous la force de l’habitude en appréciation inconditionnée. Voir p. 43 : « une chose que nous avons une fois approuvée, quelle qu’en soit la raison, prend pour nous l’attrait de la chose satisfaisante en soi ; elle s’installe dans nos façons de penser comme essentiellement bonne ». C’est ainsi que la consommation improductive, d’abord honorable comme preuve de vaillance, va pouvoir devenir foncièrement honorable.
[7] Néanmoins, Veblen nous a paru souvent étonnamment proche de la psychologie évolutionniste contemporaine, où il s’agit de décrire l’environnement d’adaptation évolutionnaire (Wright), la niche écologique (située au pléistocène) où les adaptations humaines ont évolués, pour comprendre les faits psychologiques. Pinker qualifie parfois ce procédé de « reverse engineering ». Veblen est d’autant plus proche de la psychologie évolutionniste contemporaine que son pessimisme procède en partie de sa théorie du cultural lag: le hiatus brutal entre l’écologie et la constitution mentale, produit par le développement rapide des institutions humaines. Cette idée joue un rôle capital dans l’économie théorique de la psychiatrie évolutionniste (voir « La psychiatrie darwinienne », O. Morin, in Darwin en tête, PUG, 2009)
[8] Pour utiliser le vocabulaire de l’économie comportementale, manifester un tempérament rapace, c’est agir en free-rider : voici une équivalence somme toute assez conforme à l’esprit du texte de Veblen.
[9] Par exemple une mise élégante mais contraignante qui expose clairement que nous n’employons nullement à produire quoi que ce soit, tel les grands chapeaux des élégantes.
[10] Il s’agit là d’un corolaire de la loi de gaspillage ostentatoire : puisqu’un vêtement n’est toléré que dans un bref espace de temps, il s’agit là d’une « astuce » supplémentaire pour augmenter considérablement la dépense ostensible.
[11] Infinie, car l’individu tente avant tout de rivaliser avec la classe qui lui est immédiatement supérieure dans l’échelle sociale, et que la seule estime qui fasse vraiment honneur à un individu, c’est celle de ceux qui lui sont légèrement supérieurs. Par conséquent, l’esprit de comparaison provocante incite à laisser de côté, et plus bas que nous, ceux qui étaient jusqu’alors nos égaux et nos amis. Heureusement, ceux là nous rejettent tout autant, pour ne pas démériter à leurs propres yeux en s’infligeant le spectacle permanent d’une fortune plus élevée que la leur ! C’est le véritable drame du surclassement ! (Cf. fin du chapitre VII)