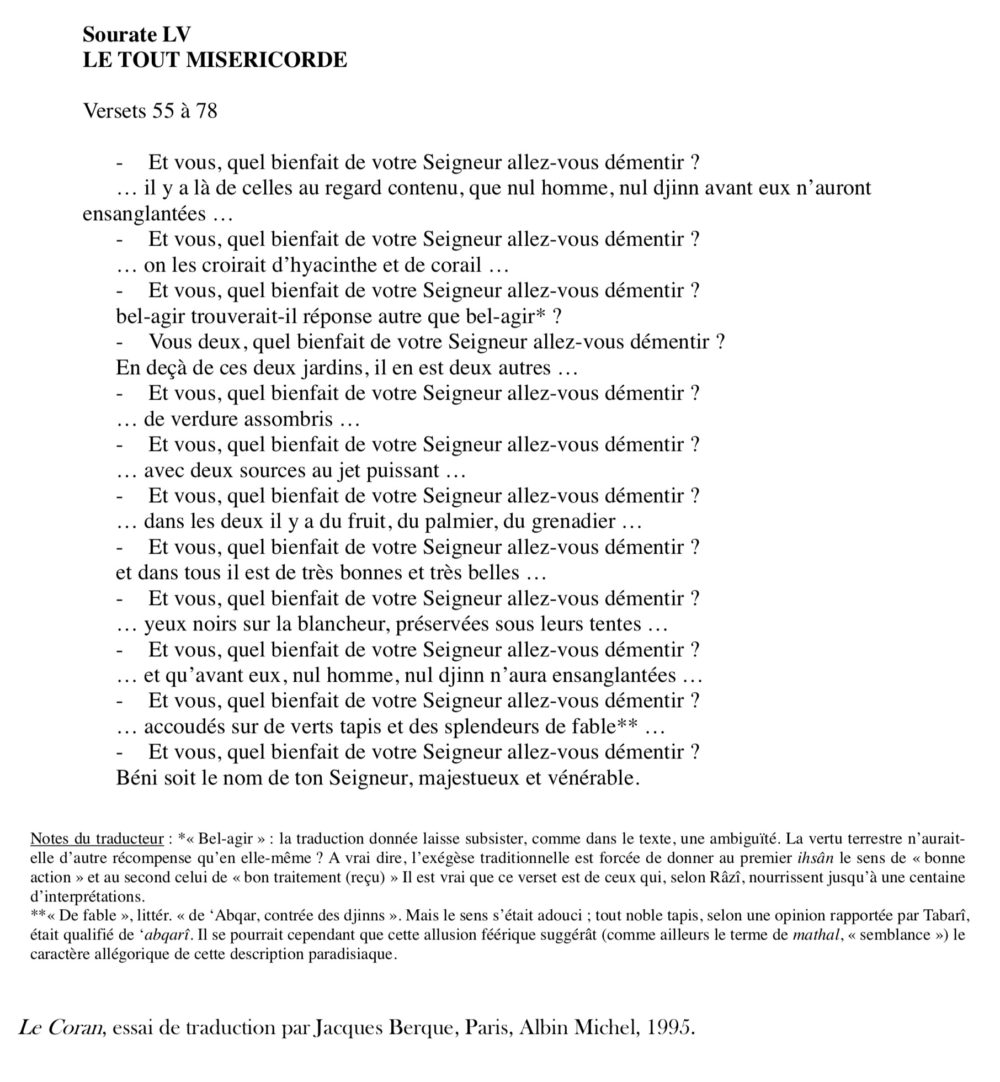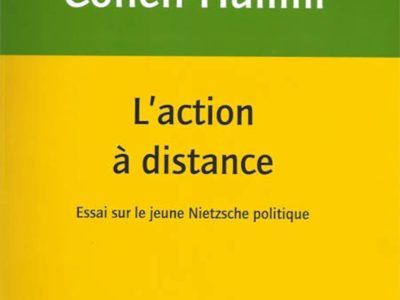Garces d’excellente beauté.
Regards de Montaigne et Pascal vers le paradis des autres.
François Athané et Isabelle Schlichting.
Ce travail est né de la lecture d’un texte d’Ali Benmakhlouf. Dans un court article, cet auteur met en regard Montaigne et Pascal (et l’on sait que si Pascal a beaucoup critiqué Montaigne, il l’a surtout beaucoup lu) et les propos qu’ils tiennent sur l’islam. Ali Benmakhlouf montre que ces deux auteurs reprennent les mêmes stéréotypes, hérités le plus souvent de polémistes chrétiens médiévaux, mais qu’ils les font jouer de manière opposée. Nous avons voulu approfondir cette question en nous attachant particulièrement à deux textes, dans lesquels Montaigne et Pascal évoquent chacun le paradis musulman.
Vraisemblablement, ni Montaigne ni Pascal n’ont eu accès aux divergences nombreuses, au sein du monde musulman, sur le statut des énoncés coraniques parlant de l’au-delà. Cette méconnaissance ne leur est pas spécifique : pour nombre d’auteurs européens des XVIe et XVIIe siècles, l’islam se réduit à des clichés hérités du Moyen Age. L’un des plus fréquents, que l’on trouve déjà chez Pierre le Vénérable, Raymond Lulle, Duns Scot, ou plus tard chez Grotius, est la ridiculisation de l’islam, réputé promettre un paradis de plaisirs grossiers, bestiaux, finalement vulgaires, en somme un paradis en pays de Cocagne.
Notre propos voudrait approfondir les brèves et éclairantes remarques d’Ali Benmakhlouf, en nous appuyant aussi sur les travaux de Dominique Carnoy-Torabi. Nous montrerons comment, dans le même contexte d’information très limitée, la réflexion aboutit chez Montaigne et Pascal à deux postures radicalement différentes.
Montaigne, de la clôture cognitive à la charité herméneutique
Le texte de Montaigne que nous examinerons est extrait de L’Apologie de Raymond Sebond (Essais, livre II, chapitre XII). Montaigne l’a composé dès 1576 mais l’a notablement développé dans l’édition de 1588, et même après cette date. Après que Montaigne a passé en revue diverses conceptions de la divinité, fustigeant notre tendance à « faire des dieux de notre condition » et à ramener la nature divine « ça bas à notre corruption et à nos misères », il écrit :
Quand les philosophes épluchent la hiérarchie de leurs dieux et font les empressés à distinguer leurs alliances, leurs charges et leur puissance, je ne puis croire qu’ils parlent à certes. Quand Platon nous déchiffre le verger de Pluton et les commodités ou peines corporelles qui nous attendent encore après la ruine et anéantissement de nos corps, et les accommode au ressentiment que nous avons en cette vie,
Secreti celant calles, et myrtea circum
Sylva tegit ; curae non ipasa inmorte relinquunt
quand Mahomet promet aux siens un paradis tapissé, paré d’or et de pierreries, peuplé de garces d’excellentes beauté, de vins et de vivres singuliers, je vois bien que ce sont des moqueurs qui se plient à notre bêtise pour nous emmieller et attirer par ces opinions et espérances, convenables à notre mortel appétit. Si, sont aucuns des nôtres tombés en pareille erreur, se promettant après la résurrection une vie terrestre et temporelle, accompagnée de toutes sortes de plaisirs et commodités mondaines. Croyons-nous que Platon, lui qui a eu ses conceptions si célestes, et si grande accointance à la divinité, que le surnom lui en est demeuré, ait estimé que l’homme, cette pauvre créature, eût rien en lui applicable à cette incompréhensible puissance ? et qu’il ait cru que nos prises languissantes fussent capables, ni la force de notre sens assez robuste, pour participer à la béatitude ou peine éternelle ? Il faudrait lui dire de la part de la raison humaine :
Si les plaisirs que tu nous promets en l’autre vie sont de ceux que j’ai sentis çà-bas, cela n’a rien de commun avec l’infinité. Quand tous mes cinq sens de nature seraient combles de liesse, et cette âme saisie de tout le contentement qu’elle peut désirer et espérer, nous savons ce qu’elle peut : cela, ce ne serait encore rien. S’il y a quelque chose du mien, il n’y a rien de divin. Si cela n’est autre que ce qui peut appartenir à cette nôtre condition présente, il ne peut être pris en compte. Tout contentement des mortels est mortel. La reconnaissance de nos parents, de nos enfants et de nos amis, si elle peut toucher et chatouiller en l’autre monde, si nous tenons encore à un tel plaisir, nous sommes dans les commodités terrestres et finies. Nous ne pouvons dignement concevoir la grandeur de ces hautes et divines promesses, si nous les pouvons aucunement concevoir : pour dignement les imaginer, il faut les imaginer inimaginables, indicibles et incompréhensibles, et parfaitement autres que celles de notre misérable expérience.
Ce passage explore deux thèmes centraux : les images de l’au-delà et les limites de la raison. Quel statut faut-il accorder à l’eschatologie et à la sotériologie, aux discours qui traitent du sort de l’âme après la mort ? Comment les comprendre ? La thèse paraît simple : nous n’avons aucun moyen de nous représenter adéquatement ce qui peut advenir après la mort. Si donc des auteurs réputés sages ont parlé de ce sujet, il nous faut prendre et interpréter leur discours avec une distance critique, et non pas au premier degré.
Le texte oppose deux ordres : l’humain d’une part, ordre « terrestre », « temporel » de notre « misérable expérience » de « pauvre créature » animée d’un « mortel appétit » ; le divin d’autre part, ordre « céleste », « éternel », de « l’autre vie », de « l’autre monde », de « l’incompréhensible puissance ». Montaigne insiste sur l’impossibilité de qualifier cet ordre autrement qu’en évoquant son altérité radicale, son caractère inimaginable. De cette opposition, il découle que les humains sont incapables de penser l’ordre divin. Le problème est donc cognitif. Quelle que soit la structure que l’on prête à l’au-delà (qu’il s’agisse de résurrection ou de réincarnation), il y a toujours projection de nos expériences de l’ici-bas sur l’au-delà, qui dès lors perd son caractère d’autre monde.
La critique prend donc pour objet la question des satisfactions sensorielles dans l’au-delà. Platon et les monothéismes ont en commun d’associer la vision de l’au-delà à une conception de la justice, où le salut de l’âme sage ou méritante est d’accéder à une joie perpétuelle. Mais ce bonheur est alors présenté dans les termes de nos satisfactions en ce monde-ci. Or, puisque « tout contentement des mortels est mortel », la représentation par les mortels d’un contentement éternel est une impossibilité. Concevoir les satisfactions de l’autre monde, c’est ne pas les concevoir, les manquer dans leur altérité radicale, « envoyer là-haut » dans l’éternité, notre condition mortelle, et réduire l’inconnu au connu.
Cette critique est adressée à Platon, mais elle peut l’être aussi à tous les textes qui parlent de l’au-delà, et donc aux descriptions coraniques du paradis. Tout aussi bien, elle peut l’être à « aucuns des nôtres », c’est-à-dire à ces chrétiens qui pensent l’au-delà avec des images tirées de notre expérience terrestre. Il se pourrait qu’une majorité de chrétiens soient concernés. Mahométans, chrétiens et platoniciens sont donc plus ou moins tous à la même enseigne. Il y a une sorte de fatalité de la représentation de ne pouvoir sortir des cadres expérientiels de notre monde. Dès lors toute représentation de l’autre monde est fausse. Montaigne mentionne ainsi la joie, typiquement terrestre, de reconnaître et retrouver nos proches ; or, à travers la résurrection, l’eschatologie chrétienne a abondamment promis cette forme de contentement dans l’autre monde.
Reprenant un topos classique de la critique de l’islam par les chrétiens, la condamnation du paradis musulman comme sensuel, l’auteur montre que cette critique s’applique aussi aux figurations chrétiennes de l’au-delà. C’est là le scepticisme de Montaigne, qui prend la forme de l’arroseur arrosé : résurrection et retrouvailles avec nos proches dans l’autre vie ne sont pas moins une félicité des sens que les houris, les « garces d’excellente beauté » du Coran.
On aboutit au paradoxe central : « pour dignement imaginer » « la grandeur de ces hautes et divines promesses », « il faut les imaginer inimaginables ». L’oxymore dit bien que l’imagination est le seul recours pour avoir quelque « communication » à la divinité, mais c’est un recours impossible. L’eschatologie est donc vouée à la contradiction : posant un monde autre, par une fatalité anthropologique, elle réduit ce monde autre à notre monde. Ceci est valable universellement, autant pour le paradis des autres que pour le nôtre. Ainsi, le scepticisme de Montaigne parvient à une thèse sur l’universel ; il retourne contre lui-même l’ethnocentrisme chrétien, qui s’exprime exemplairement dans la raillerie du paradis musulman.
Examinons maintenant les principes herméneutiques, ou principes d’interprétation, que Montaigne met en œuvre. De tout ce que nous avons dit, on pourrait tirer deux conclusions opposées sur les discours qui parlent de l’au-delà. La première conclusion serait qu’il faut rejeter ces textes, parce que sans fondement rationnel. Or Montaigne n’aboutit pas à cet orgueil intellectuel qui se réjouit de rejeter l’erreur dans les ténèbres de l’ignorance. La seconde conclusion suppose que ces textes n’ont pas pu ignorer leur absence de fondement, et donc qu’ils peuvent et doivent être compris autrement : en distanciant leur sens littéral, on accède à leur véritable et profonde raison d’être, et Montaigne adopte cette seconde interprétation. C’est une forme de charité herméneutique, par laquelle, entre deux interprétations possibles, on choisit celle qui prête au texte le sens le plus riche et le plus robuste. Il y a finalement réhabilitation des images de l’au-delà, mais non sans une subtile ambiguïté. Lorsque « la raison humaine », personnifiée, prend la parole : « il faudrait lui dire (à Platon) de la part de la raison humaine », cette prosopopée de la raison prend place dans un chapitre qui s’acharne à montrer quel faible et débile outil est la raison. « La raison humaine » ne prend la parole que pour déclarer sa faillibilité. La critique sceptique de la raison est elle-même une raison qui sait s’auto-limiter, consciente de sa propre clôture cognitive.
Mais comment ne pas ruiner la réputation de sagesse d’un auteur prétendant parler de l’au-delà ? Car Montaigne vise bien plutôt à « sauver » les auteurs qui ont été consacrés par une tradition quelle qu’elle soit. C’est pourquoi il reconsidère le statut que ces auteurs ont accordé à leur discours sur l’au-delà, car il fait valoir une double exigence : faire droit à la raison et à la tradition à la fois. Rappelons ici que Montaigne considère la tradition comme étant par soi digne de respect. Frédéric Brahami a mis l’accent sur ce point : si l’on peut parler de conservatisme chez Montaigne, ce conservatisme n’est pas refus du mouvement, mais au contraire, refus de la rupture avec la sédimentation historique, refus de prétendre abolir la distance qui nous sépare de l’origine, en fait, refus du fantasme de la pureté retrouvée. Voilà pourquoi il qualifie d’« exécrables » les « nouvelletés de Luther » (p. 439). Voilà pourquoi le plus sage est de se tenir « dans la route commune » (p. 558), et de fuir « la nouvelleté et l’étrangeté » (p. 558). Et lorsqu’il écrit « nous ne recevons notre religion qu’à notre façon et par nos mains […]. Nous sommes Chrétiens à même titre que nous sommes ou Périgourdins ou Allemands » (p. 445), il ne se borne pas à constater la contingence de nos appartenances et de nos croyances : il reconnaît la légitimité d’une autorité qui s’est constituée dans la longue durée, par les usages des hommes.
Des vertus du scepticisme contre la pensée mimétique
Il en résulte une tension entre la raison, qui montre qu’il ne peut y avoir d’énoncé humain légitime à propos de l’au-delà, et la tradition, qui a consacré de tels discours. Pour la résoudre, il faut poser qu’un auteur peut être divin, c’est-à-dire conscient de l’écart entre l’humain et le divin, tout en paraissant ignorer cet écart (en formulant dans des images terrestres un discours sur l’au-delà) précisément parce que, sachant qu’il s’adresse à des humains, il sait qu’il doit transgresser l’interdit de franchir cet écart. La tradition a raison de qualifier de divin tel ou tel auteur (Mahomet, Platon), mais ce n’est pas pour les raisons qu’elle avance. Ce n’est pas parce que Platon a dit quelque chose de l’au-delà qu’il mérite d’être appelé « divin », c’est parce qu’il l’a dit alors même qu’il a nécessairement su qu’il n’en pouvait rien dire. En d’autres termes : ces auteurs ont su qu’il faut « nous emmieler » (= nous attirer avec du miel). L’eschatologie de Mahomet, ridiculisée par l’Occident, repose sur la même arrière-pensée que celle de Platon, consacrée par l’Occident. Mahomet dans le Coran, Platon au Livre X de La République, sont « des moqueurs qui se plient à notre bêtise », à « notre mortel appétit » : ils sont donc moins à blâmer que nous. La sagesse ne consiste ni à dire quelque chose de l’au-delà, ni à montrer qu’on n’en peut rien dire. Elle consiste à assumer la duplicité : tout en sachant qu’on ne peut rien en dire, savoir aussi qu’on doit cependant en dire quelque chose, pour élaborer les affects communs qui sont indispensables à la vie commune. En d’autres termes, la sagesse est la conscience et de notre clôture cognitive et de la nécessité somme toute politique de transgresser celle-ci. L’eschatologie est, pour partie, un outil pour faire société, bâtir le vivre-ensemble.
C’est pourquoi Mahomet est placé au même niveau que Platon. Les trois énoncés du début (« Quand les philosophes … Quand Platon … Quand Mahomet … ») mettent sur le même plan ces trois instances, ensuite comparées à « aucuns des nôtres », c’est-à-dire à ceux des Chrétiens qui se font également une image terrestre de l’au-delà. Et quand Montaigne écrit « notre bestise », « nous emmieler et attirer », « notre mortel appetit », ce « nous » inclut Montaigne et son lecteur (supposés chrétiens) avec les Mahométans, avec aussi les anciens Grecs – de même que le « nous » universalisant de « Nous sommes Chrétiens à même titre que nous sommes ou Périgourdins ou Allemands ». Le scepticisme est alors une pensée des limites de la raison et de la communauté des esprits délimitée par l’universelle clôture cognitive. Au lieu de dresser les traditions culturelles les unes contre les autres, elle inclut les diverses traditions dans une commune condition humaine. Alors, on peut reconnaître, dans les inanités routinièrement attribuées aux autres, nos propres faiblesses. La réflexion sur l’autre devient connaissance de soi et tout à la fois connaissance de l’humaine condition. Alors les différentes cultures apparaissent comme autant de formes de la même « humaine nature » ; et de cette diversité, il y a lieu de s’émerveiller plutôt que de désespérer : « le trouble des formes mondaines a gagné sur moi que les diverses mœurs et fantaisies aux miennes ne me déplaisent pas tant comme elles m’instruisent, ne m’enorgueillissent pas tant comme elles m’humilient en les conférant [=comparant] » (p.516).
René Girard a suggéré qu’une forme de mimétisme consiste à s’assurer illusoirement de sa propre identité, en projetant sur un autre ce que l’on pourrait voir de dérangeant ou de critiquable en soi-même. Selon l’analyse girardienne de la tragédie dans La Violence et le sacré, par exemple, lors de la dispute entre Œdipe et Tirésias, chaque protagoniste reproche à l’autre tout ce qu’il pourrait se reprocher à lui-même, et se déclare lui-même pur de tout ce qu’il reproche à l’autre. Le mimétisme consiste alors dans le fait d’élaborer une image de l’autre par laquelle j’attribue à l’autre ce qui en moi me perturbe souterrainement. L’ethnocentrisme est la transposition de ces mécanismes sur le plan collectif. Il ne consiste pas seulement à prendre sa propre culture comme référence pour juger des autres cultures ; il s’agit aussi, et c’est le mécanisme mimétique, de se prétendre pur de ce que l’on reproche aux autres.
Montaigne nous aide à démanteler ce piège mimétique. Il montre que ce qui est raillé par les chrétiens dans le paradis des musulmans s’applique aussi à l’au-delà chrétien. Le préjugé sur l’autre s’auto-réfute, parce qu’il est retourné contre le porteur de ce préjugé, dans un geste typiquement sceptique. Et c’est une leçon importante, car cela signifie que la pensée qui évite l’ethnocentrisme ne passe peut-être pas toujours, ou pas nécessairement, par le dialogue avec l’autre, ou par une meilleure information sur l’autre. Car il s’agit d’abord d’une posture critique vis-à-vis de nous-mêmes. En somme, la philosophie sceptique est un des antidotes possibles contre la tentation mimétique.
Clartés et obscurités selon Pascal
Comparons maintenant la pensée de Montaigne à celle de Pascal. On sait que cet auteur a non seulement beaucoup lu Les Essais mais qu’il s’en est inspiré très directement, et parfois littéralement, dans nombre de ses textes – tout en critiquant le projet et les positions de Montaigne. Il hérite pourtant de lui une manière de penser la société et la coutume, mais il emploie cet héritage à des fins très différentes. Ainsi le fragment de Pascal que nous allons lire, rédigé autour de 1660 :
Ce n’est pas par ce qu’il y a d’obscur dans Mahomet et qu’on peut faire passer pour un sens mystérieux que je veux qu’on en juge, mais par ce qu’il y a de clair : par son paradis, et par le reste. C’est en cela qu’il est ridicule. Et c’est pourquoi il n’est pas juste de prendre ses obscurités pour des mystères, vu que ses clartés sont ridicules. Il n’en est pas de même de l’Écriture. Je veux bien qu’il y ait des obscurités qui soient aussi bizarres que celles de Mahomet, mais il y a des clartés admirables et des prophéties manifestes et accomplies. La partie n’est donc pas égale. Il ne faut pas confondre et égaler les choses qui ne se ressemblent que par l’obscurité, et non par la clarté, qui mérite qu’on révère les obscurités.
Ce fragment repose sur une dialectique entre obscurité et clarté des textes : il s’agit, à partir des clartés respectives du Coran et de la Bible, de porter un jugement sur leurs obscurités. Il faut souligner l’apparence démonstrative de ce fragment qui déploie une rhétorique subtile. Pascal en appelle au jugement du lecteur, mais les obscurités du Coran sont d’emblée discréditées : si « on peut les faire passer pour mystérieuses », c’est évidemment qu’elles ne le sont pas. La seconde phrase poursuit sur cette voie : « C’est en cela qu’il est ridicule » : l’adjectif est cinglant et méprisant. « Ridicule », terme éminemment subjectif qui nous fait quitter brutalement la démonstration pour le discours à charge. En cela Pascal ne fait que reprendre une routine lexicale, qui date du Moyen Age, chez les polémistes chrétiens anti-mahométans. Au XVII° siècle, « ridicule » est l’un des adjectifs appliqués à l’islam qui revient le plus fréquemment chez les apologues du christianisme (Grotius, François Garasse), mais aussi dans les récits de voyageurs ou de missionnaires (Baudier, Surius, Jean Coppin) que cite Dominique Carnoy dans son ouvrage sur les Représentations de l’islam dans la France du XVII° siècle. Ridicules, les récits des Hadiths sur la vie de Mahomet. Ridicule, Mahomet lui-même. Ridicules, ses prophéties sur le paradis. Il semble s’agir de véritables automatismes de langage et de pensée, au XVII° siècle, dès qu’un auteur aborde un sujet touchant à l’islam. Le paradoxe est que ces routines lexicales se perpétuent alors même que les récits de voyage dans les pays musulmans se multiplient, et que le Coran est traduit en français en 1647 par André Du Ryer. Et Dominique Carnoy écrit à ce propos qu’alors même que la connaissance de l’islam est en mesure de progresser, tout incline à se demander « si on ne lui préfère pas les fantasmes de l’ignorance » (p. 46).
Le texte de Pascal multiplie des liens logiques qui paraissent bégayer la fausseté et le ridicule de la religion mahométane. Cet effet de verrouillage d’une symétrie sans égalité ni réciprocité entre christianisme et islam est une forte rhétorique, mais ne fait-il pas tomber Pascal dans le travers qu’il dénonce lui-même au fragment 480 ?
« Langage.
Ceux qui font des antithèses en forçant les mots font comme ceux qui font de fausses fenêtres pour la symétrie.
Leur règle n’est pas de parler juste, mais de faire des figures justes. »
Le fragment 204 affirme le caractère incomparable des textes du Coran et de la Bible – et pour le prouver, il les compare. Les obscurités du Coran sont ridicules parce que ses clartés sont ridicules, tandis que les obscurités de l’Écriture sont à vénérer parce que ses clartés sont admirables. Le Coran semble bien constituer le double inversé de l’Écriture.
Lorsqu’un esprit tel que Pascal s’empêtre de lui-même dans de telles contradictions, comparer et condamner la comparaison, faire des figures justes rhétoriquement, mais sans charité herméneutique à l’endroit de la croyance qu’il examine, n’est-ce pas la passion qui se dote alors des atours de la raison ? Est-ce que Pascal n’est pas en train de céder à la tentation de construire imaginairement l’autre en « double monstrueux » de soi ? Au rebours de Montaigne, qui disait s’humilier en comparant la diversité des cultures, Pascal s’enorgueillit d’être chrétien, lorsqu’il parle de l’islam.
Notons du reste que dans Les Pensées, il n’évoque jamais Mahomet et sa religion que très rapidement, donnant souvent l’impression de fragments non travaillés. Il se borne en outre à quatre idées qui sont autant de clichés : Mahomet est un prophète sans témoins, sans miracles, sans prédictions et sans autorité, un faux prophète, donc ; Mahomet tue ; Mahomet défend de lire ; Mahomet prêche une religion matérielle car son paradis promet des biens terrestres. Mais d’où sait-il que les versets coraniques sur le paradis sont des clartés, ayant vocation à être pris à la lettre ? Et surtout, car on ne saurait lui reprocher une ignorance qu’il partage avec tous ses contemporains : pourquoi n’envisage-t-il pas la possibilité qu’il y ait là au contraire une énigme, appelant la méditation, ou l’interprétation allégorique ?
« Deux sortes d’hommes en chaque religion » affirme-t-il au fragment 269 : « les charnels et les spirituels ». Les charnels seraient les fidèles attachés à la lettre des prescriptions rituelles ; les spirituels ceux qui au-delà de la lettre de la loi, parviennent à l’amour de Dieu. Par exemple les chrétiens charnels sont ceux qui se figurent que Jésus « est venu nous dispenser d’aimer Dieu, et nous donner des sacrements qui opèrent tout sans nous » (fragment 270). Pascal envisage ainsi cette dualité chez les païens, chez les juifs et chez les chrétiens – mais jamais chez les Mahométans qui paraissent, de ce fait, condamnés à n’être que charnels. On attendrait sur ce point une juste symétrie, mais de façon troublante, elle est introuvable. Pourquoi donc n’imagine-t-il pas des « mahométans spirituels » ? De même, fragment 445, « Pour les religions, il faut être sincère : vrais païens, vrais juifs, vrais chrétiens ». La charité de Pascal s’étend jusqu’aux païens mais elle n’inclut pas les mahométans, décidément toujours absents de ces séries symétriques. Il faut questionner cette absence.
On se trouve manifestement ici aux antipodes de la charité herméneutique d’un Montaigne qui, sans en avoir eu connaissance, a pressenti la possibilité des débats, dans le monde musulman, sur l’interprétation des versets coraniques évoquant l’au-delà.
De l’ignorance de Dieu à la vraie religion
Cette absence de charité herméneutique chez Pascal nous semble s’expliquer par trois notions :
– Le concept de vérité appliqué à la religion (= la « vraie » religion)
– L’intention apologétique : dans les Pensées, Pascal se donne pour objectif de convertir l’athée au Christ
– La conception pascalienne de l’individu, qui fait sur certains points complètement rupture avec celle de Montaigne.
La notion de « vraie » religion est centrale chez Pascal. Dans les Pensées, elle n’est jamais employée pour critiquer le protestantisme, ou un courant quelconque du christianisme, mais seulement à propos de l’islam. Même lorsque Pascal critique le paganisme, ses arguments sont autres. Le paganisme étant par définition à l’extérieur du monothéisme, il est plus manifestement faux que l’islam. On ne réfute que ce qui a quelque plausibilité d’être vrai, ce qui n’est pas le cas avec le paganisme. La question de la vérité s’exacerbe lorsque Pascal traite de l’islam précisément parce que celui-ci est une altérité à l’intérieur du monothéisme, altérité non du lointain mais du proche, dont il est crucial de se distinguer. La proximité paraît enclencher la rivalité. Citons à nouveau Dominique Carnoy : « Le mimétisme est donc pire que l’altérité absolue, car il prête à confusion », p. 38.
La proximité dans l’altérité conduit à récuser la prétention de l’autre à la vérité, et à la caricature de cet autre. A cet égard, le fragment 204 semble tout entier construit sur un schème mimétique : Mahomet apparaît comme une sorte de double monstrueux (en fausseté, en ridicule) de Jésus. Conjointement, on trouve dans les Pensées la présupposition de l’unité de la foi chrétienne, consubstantielle au projet pascalien d’une Apologie de la religion chrétienne. Il reste une relation à trois termes : christianisme, paganisme, islam, comme l’indique le curieux schéma du fragment 485 :
Remarquons que les trois arbres ont pour terre commune l’ignorance de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur l’étrange absence du judaïsme dans ce schéma, mais cette confession est sans doute implicitement présente dans la sorte de tronc qui mène à Jésus, ce qui suggère que le destin du judaïsme est de mener au Christ (voir par exemple le fragment 272). Pour nous en tenir à notre propos : ce schéma implique que Mahomet n’a pas d’enracinement dans Jésus, ce qui est faux sur le plan historique et textuel. L’islam y est même exclu de la filiation abrahamique. Ici Pascal ne tient pas compte de ce que les musulmans disent d’eux-mêmes, et de leur auto-affiliation aux patriarches et prophètes de l’Ancien Testament, ni des très nombreuses mentions de Jésus dans le Coran.
Mais peut-être Pascal ignorait-il ces deux points. En revanche, il est saisissant de constater qu’il reproche à Mahomet de n’avoir pas été annoncé par des « prophéties manifestes et accomplies », ou dans, d’autres fragments, de n’avoir pas accompli de miracles (fragments 1, 189, 195, 227) : car, aussi bien, cet argument aurait pu jouer en faveur de Mahomet, selon la logique même de Pascal. En effet, la distinction entre charnel et spirituel suggère fortement que miracles et prophéties relèvent des attentes charnelles des humains. Une authentique religion spirituelle pourrait, et même devrait s’en passer, si l’on suit la logique de Pascal, pour qui la religion a essentiellement à rendre compte du fait que Dieu est caché.
Nous pouvons repérer ici une difficulté quant au sens de l’histoire sainte pour Pascal. Celle-ci semble ne pas pouvoir être pensée autrement que s’achevant avec Jésus. Tout ce qui vient après Jésus est en quelque sorte lettre morte, alors que tout ce qui a eu lieu avant, jusqu’à l’ignorance de Dieu, peut être recueilli et réinterprété comme faisant sens dans l’histoire du salut qui mène à Jésus. En revanche, il ne peut rien y avoir de vrai dans ce qui, après Jésus, se prétendrait comme révélé. De ce fait le vrai mahométan – le mahométan spirituel – paraît impossible et presque inconcevable.
Choix rationnel et raison absente
Cette notion de vérité en matière de religion suppose une position de surplomb par rapport aux diverses religions. On considère la prétention de chacune à la vérité, en vue d’un choix entre elles, en fonction d’un critère d’adéquation entre les énoncés religieux et la réalité de la condition humaine. Ce surplomb est possible à partir de l’esprit individuel, c’est le côté « existentialiste » de Pascal. C’est parce que le « je » peut s’abstraire en pensée de son lieu et de son moment, de sa propre naissance et de son expérience concrète de la vie, qu’il peut dire (fragment 64) :
« Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée devant l’éternité précédant et suivant (« memoria hospits unius diei praeteruntis »), le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent, je m’effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, car il n’y a point de raison ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? Par l’ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ?»
L’esprit peut, par l’abstraction, penser l’éventualité métaphysique d’être toujours soi, le même, mais né et arrimé dans un autre lieu, un autre temps. A partir de ce « je »-là, qui est un point d’abstraction, la variété des religions devient appréhendable comme autant de possibles pour la foi. De là découle le besoin d’un choix dans cette variété, mais alors un choix en raison – lequel doit tenir compte, précisément, du fait que, fondamentalement, « il n’y a point de raison » – c’est le problème typiquement pascalien du deus absconditus, du dieu caché évoqué plus haut. La problématique du pari pascalien en dépend, car parier suppose la possibilité de choisir. L’argumentaire de Pascal, initialement destiné à servir à la conversion des athées, repose sur le fait que la religion peut ne pas être seulement reçue, mais activement adoptée, choisie sur des bases rationnelles, alors que l’idée d’un choix de la confession religieuse est absente chez Montaigne, qui la pense plus comme reçue que comme choisie. En d’autres termes, Pascal pense que nous pouvons être chrétiens à un autre titre que nous sommes ou « Périgourdins ou Allemands ».
Le problème est posé en termes de croire ou ne pas croire. Mais alors la difficulté est : croire, oui, mais pourquoi pas en Mahomet ? Et c’est là qu’il lui faut faire recours à la notion de vraie religion. Le mouvement d’abstraction de la pensée par lequel le « je » se saisit lui-même comme pure existence, pensée susceptible de se remplir de tous les contenus possibles dans la variété des lieux et des temps, doit énormément à Descartes. Tout le problème de l’absence de raisons, et ensuite du choix, à l’intérieur de l’espace des doctrines, de celle qui sera la plus adéquate à cette absence de raison suppose le cogito cartésien, structure de la pensée à même de persister à l’identique quels que soient les contenus de pensée qu’elle accueille en elle.
Mais le legs de Montaigne, dans Pascal, et d’abord l’anthropologie de la coutume, conteste de l’intérieur la possibilité même de ce dispositif. En effet, lorsque Pascal écrit au fragment 541 : « La chose la plus importante à toute la vie est le choix du métier, le hasard en dispose » (= il n’y a pas véritablement de choix), on pourrait se dire dans le même esprit : la chose la plus importante à toute la vie est la foi religieuse, le hasard en dispose (parce que je suis né dans tel milieu, telle époque… que je n’ai pas choisis). Cette contingence de l’appartenance religieuse, Pascal la déplore quand il s’agit des mahométans, c’est le fragment 182 : « C’est une chose pitoyable de voir tant de Turcs, d’hérétiques, d’infidèles, suivre le train de leurs pères, par cette seule raison qu’ils ont été prévenus chacun que c’est le meilleur et c’est ce qui détermine chacun à chaque condition de serrurier, de soldat, etc. ». Pascal trouve « pitoyable » de suivre la coutume, l’exemple des pères, lorsqu’il s’agit des Turcs, alors même qu’il juge par ailleurs que toujours nous suivons la coutume, et qu’il ne peut ni ne doit pas en être autrement. Il y a ici plus qu’un paradoxe : un impensé, voire une contradiction. Tout se passe comme si la force de la coutume pouvait être évacuée en matière de religion, pour laisser place au choix rationnel, alors que partout ailleurs, le contraire prévaut. Car il n’y a pas moyen d’évacuer la coutume en ce qui concerne les institutions, le gouvernement, la justice. Sur ces questions, Pascal suit Montaigne. Ainsi dans le fragment 56 : « la coutume fait toute l’équité, par cette seule raison qu’elle est reçue ». Et parfois il se veut même plus radical encore que Montaigne sur la question de la coutume : « Montaigne a tort. La coutume ne doit être suivie que parce qu’elle est coutume, et non parce qu’elle soit raisonnable ou juste. Mais le peuple la suit par cette seule raison qu’il la croit juste » (fragment 469).
Et c’est donc dans une tension très forte avec son anthropologie de la coutume que, pour les besoins de son apologétique, Pascal pense un sujet déraciné, sans attachement – sans enracinement, dirait Simone Weil – auquel il s’adresse pour l’amener à se convertir. De là, il ne pense pas non plus la communauté comme médiation vers la foi. Il y a plutôt un tête-à-tête solitaire de l’individu avec la possibilité de croire ou non, et ensuite, une fois le choix fait, l’accès à la communauté de l’Église. Chez Montaigne, c’est l’inverse : l’appartenance à la communauté précède la foi. De sorte qu’entre Montaigne et Pascal, ce sont vraiment deux époques différentes dans l’histoire de l’individu (dans l’archéologie du sujet, pour le dire autrement).
Paradis des autres
Il nous semble nécessaire de terminer notre propos en posant la question très générale de la non-compréhension du paradis musulman par les auteurs chrétiens. Ce phénomène ne nous semble pas accidentel, le simple fait qu’il traverse la très longue durée le suggère. Il touche, plausiblement, à une différence de fond entre christianisme et islam. Les auteurs dont nous avons parlé héritent d’une tradition cléricale de chasteté, où l’activité spirituelle réputée la plus haute, la relation au sacré, implique le renoncement à la chair et à l’activité sexuelle. Et c’est alors le péril que Nietzsche a signalé dans la culture chrétienne : que la relation au sacré se fasse selon des idéaux qui calomnient le monde, le corps, les joies de la chair, de la bonne chère et de la terre. Or, avec le paradis mahométan et ses « garces d’excellente beauté », les auteurs dont nous avons parlé se trouvent confrontés à un monothéisme qui, précisément, ne calomnie pas le monde, mais au contraire, glorifie les joies de la chair et de la terre en les éternisant dans l’au-delà. Dans leur incompréhension du paradis musulman, les auteurs chrétiens expriment, nous semble-t-il, cette difficulté de fond de l’Occident chrétien, sa tendance à développer des idéaux ascétiques qui dénigrent le monde. Sous ce rapport, Pascal est plausiblement très exposé à la critique nietzschéenne. Mais remarquons aussi que Pascal est proche de nous, en ceci que nous vivons dans une sorte de marché des religions, comme le dit le titre d’un ouvrage dirigé par Laurent Mayali, dans ce self-service eschatologique contemporain où les questions religieuses semblent, en Occident du moins, affaire de choix personnel et d’autonomie.
Toutefois, et paradoxalement, Montaigne peut paraître cependant plus proche de nous, en ceci qu’il récuse la tentation d’une position de surplomb qui tracerait des hiérarchies entre les religions. D’où une contradiction peut-être insoluble : nous sommes pascaliens en tant que sujets qui se pensent auteurs de leurs choix en matière spirituelle. Nous sommes « montaigniens » dans l’exigence de nous défier de tout ethnocentrisme.
La pensée de Pascal fait époque, car en lisant Pascal, finalement, c’est le problème moderne que nous avons rencontré : l’incompatibilité du sacré avec le choix individuel. Les contradictions et l’ethnocentrisme de Pascal dès qu’il s’agit de l’islam sont en réalité liés, nous l’avons vu, à cette idée de choisir de croire. Mais que reste-t-il du sacré, si nous pouvons le choisir ? Choisir son sacré est peut-être un non-sens. Et là réside, peut-être, l’incompatibilité structurelle du sacré et du moderne.
Mais retenons pour finir la leçon de Montaigne : « Tout contentement des mortels est mortel ». La philosophie sceptique peut nous aider à éloigner les dangers de l’ethnocentrisme, tout autant qu’à défaire les problèmes de la pensée mimétique. Le scepticisme délimite une place pour une possible érotique.