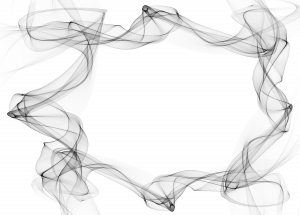Formes et fonctions de la confiance dans la société moderne
Cet article a été publié dans le dossier 2014 – la confiance.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des contributions du dossier
Flavien Le Bouter (EHESS, Paris)
L’intérêt de la sociologie pour le thème de la confiance s’est considérablement accru ces dernières années, en particulier dans les pays anglo-saxons mais aussi en Allemagne. On ne peut donc plus aujourd’hui partager le constat de Niklas Luhmann, qui estimait que « la confiance n’a jamais été un thème du mainstream sociologique[1] ». Cet intérêt est incontestablement lié à la conscience d’être entré dans une phase avancée de la modernité, caractérisée par une différenciation fonctionnelle très poussée, un anonymat accru, un développement des structures organisationnelles, un accroissement des risques et un déclin des formes traditionnelles d’appartenance au profit d’un univers marqué par une réflexivité à l’égard des modèles sociaux. Cette « obsession de la modernité[2] » prend aussi sa source dans une crise de la confiance : à l’égard des institutions démocratiques et de leur capacité à résoudre les problèmes auxquelles nos sociétés sont confrontées ; mais aussi à l’égard de l’industrie et des développements technologiques qui font courir des risques perçus comme de plus en plus menaçants. Une culture de la méfiance se propage dans des champs toujours plus étendus de la vie sociale.
Cette prolifération éditoriale à l’étranger contraste avec le peu d’intérêt qu’ont porté jusqu’à présent à ce thème les chercheurs français[3]. Il est possible que cela tienne à une tradition sociologique française marquée par le positivisme. Il est vrai que les recherches sur la confiance sont souvent restées très abstraites et ont peu recouru aux enquêtes empiriques. On ne peut évidemment que le regretter ; mais il se peut que cela tienne à la nature même de la confiance. Son analyse empirique présente en effet de grandes difficultés. Il existe certes des enquêtes d’opinion qui interrogent sur la confiance en des personnes ou des institutions. Elles donnent cependant des informations très lacunaires sur les opinions et les comportements réels des individus. Elles confondent aussi parfois la confiance avec l’espoir, le souci ou l’assurance. Enfin, il n’est pas exclu que l’analyse concrète de la confiance soit entravée par l’insuffisance de sa conceptualisation et de sa théorisation de la confiance, qui seules peuvent donner sens aux données factuelles.
Notre article entend contribuer à la clarification des problèmes sociologiques que pose la confiance. Il vise à montrer que le passage à la société moderne, anonyme, hautement complexe et fonctionnellement différenciée s’est accompagné d’une transformation radicale du statut de la confiance : l’ordre social ne repose plus seulement sur la familiarité et la confiance personnelle mais aussi sur la confiance en des systèmes abstraits.
Définition et formes de la confiance
Si la sociologie a reconnu, au moins de manière implicite, l’importance sociale de la confiance, celle-ci est restée un concept très vague, qui prête à confusion tant dans sa signification que sa fonction sociale. Les sciences sociales se sont trop souvent contentées de souligner les bénéfices tirés de la confiance sans chercher à en donner une définition rigoureuse.
Définir la confiance exige dans un premier temps de déterminer son objet. On a d’abord foi en des personnes ; mais on peut ainsi accorder son crédit à des choses ou des institutions. Un examen plus minutieux montre ainsi que l’objet de la confiance peut-être un système social général, une institution, un système technique ou expert, une organisation, un produit, un professionnel, un Dieu, une personne ou soi-même[4]. En conséquence, une analyse sociologique rigoureuse de la confiance devrait se faire à plusieurs niveaux. Une microanalyse cherchera à déterminer le statut de la confiance dans les processus interactionnels, par exemple dans les relations intimes ou dans la communication par internet. Une mésoanalyse portera sur le rôle de la confiance dans les organisations. Elle pourra par exemple être étudiée dans le monde du travail et de l’entreprise ou dans des « groupes de confiance » comme la mafia[5]. La macroanalyse s’intéressera quant à elle à la confiance dans les institutions ou les systèmes et à son rôle dans les processus de transformation sociétale.
La confiance présuppose un manque de savoir, une insuffisance de l’information. Elle constitue un équivalent fonctionnel du savoir au sujet des intentions d’acteurs souvent pas ou mal connus dans une société moderne largement anonyme. C’est donc avec raison que Anthony Giddens souligne que « la première situation exigeant un besoin de confiance n’est pas l’absence de pouvoir, mais l’insuffisance d’information[6] ». Georg Simmel notait déjà que la confiance se situe entre le savoir complet et l’absence de savoir et que « celui qui sait tout n’a pas besoin de faire confiance, celui qui ne sait rien ne peut raisonnablement même pas faire confiance[7] ». Dans son analyse des interactions professionnelles, qu’il illustre par la relation médecin/patient, Talcott Parsons montre que la confiance sert à combler le « competence gap » entre l’expert et le profane. Il n’y a donc confiance que parce qu’il est impossible de maîtriser toute la complexité d’une situation. En raison même de l’insuffisance des informations, la réduction de la complexité qu’opère la confiance s’apparente dès lors plus à une induction qu’à une déduction. Georg Simmel en déduit que la confiance repose sur un « savoir inductif atténué » ; à preuve, « si l’agriculteur ne croyait pas que son champ va porter des fruits cette année comme les années précédentes, il ne sèmerait pas ; si le commerçant ne croyait pas que le public va désirer acheter ses marchandises, il ne se les procurerait pas[8] ».
Requérant une extrapolation réalisée à partir des informations disponibles, la confiance ne peut donc jamais être pleinement fondée. Elle se forme progressivement lorsque l’autre tient parole ou ne ment pas. Mais elle exige un saut dans l’incertitude et comporte de ce fait toujours un risque. Selon Niklas Luhmann, c’est dans la confiance personnelle que le risque est le plus manifeste. Il distingue la familiarité avec certaines choses, êtres humains ou situations, la confiance personnelle et la confiance dans des systèmes fonctionnels (en particulier, l’économie, la science ou la politique) et leurs médias respectifs de communication que sont l’argent, la vérité et le pouvoir. La différence entre ces trois attitudes dépend de la question de savoir si on a conscience de la possibilité de la déception et si on perçoit cette déception comme un risque, c’est-à-dire comme la conséquence de sa propre décision[9]. Etre familier d’une personne ou d’une situation n’est pas l’objet d’un choix par une subjectivité : la situation familière est donnée. Dans la confiance systémique, l’attente est bien accompagnée d’anticipation future d’un danger de déception mais qui ne peut être évité par sa propre décision. On sait par exemple que l’économie connaîtra des crises périodiques, que ses biens pourront perdre de leur valeur ; les éventuels dommages de telles crises ne sont pas pour autant considérées comme les conséquences de sa propre décision et on n’envisage pas sérieusement de se soustraire à l’économie monétaire. C’est uniquement dans la confiance personnelle que la déception est envisagée comme une conséquence de sa propre décision, c’est-à-dire comme un risque. C’est pour cette raison qu’elle peut faire l’objet d’un regret. La théorie du choix rationnel a elle aussi situé le risque est au cœur de la relation de confiance. James Coleman voit ainsi dans la confiance une stratégie de maximisation de l’utilité dans une situation de risque. Les situations de confiance comportent en effet une asymétrie du fait qu’il existe un décalage temporel entre le moment où on accorde sa confiance et celui où l’action de l’autre agent confirmera ou non son bien-fondé. C’est précisément dans cette non-simultanéité que se situe le risque lié à la confiance.
En outre, la confiance ne concerne que les attentes qui ont des répercussions sur ma propre décision. C’est ce qui distingue la confiance du simple espoir. Dans la confiance, l’attente à l’égard des libres sélections d’autrui conditionne mon propre agir. Il n’y a de confiance que lorsque, pour déterminer mon propre agir, je dois savoir quelles actions je peux attendre d’autrui. Je m’associe à telle personne dans la création d’une entreprise uniquement parce que j’estime qu’elle dispose de compétences dont je manque. Cela diffère de l’espérance que cette entreprise prospérera. Niklas Luhmann peut ainsi affirmer que « la confiance réfléchit la contingence, l’espoir l’élimine[10] ». La confiance peut enfin comporter plusieurs degrés de réflexions selon le risque et l’incertitude qui doivent être absorbés. Elle s’exerce le plus souvent sans réflexion, de manière routinière dans l’assurance que nos attentes seront satisfaites. Cependant, lorsque l’incertitude se fait plus grande et que nous sommes confrontés à une situation nouvelle, la confiance peut être accordée de manière plus consciente, après un calcul probabiliste des risques. L’ensemble de ces remarques nous permet de définir la confiance comme la croyance plus ou moins réfléchie que, dans une situation de risque, les attentes à l’égard d’actions de personnes ou de systèmes qui conditionnent ma propre décision ne seront pas déçues.
La confiance comme fondement de l’ordre social
La confiance constitue un socle de l’existence tant individuelle que sociale. Au plan psychologique, une confiance de base, ce que les Allemands désignent par le terme de Urvertrauen, est nécessaire à la stabilité psychique et au développement de la personnalité. Les psychologues ont montré que cette confiance première se forge dès la prime enfance dans la relation avec les parents. La confiance procure un sentiment de sécurité ontologique qui permet de ne pas vivre en permanence dans l’angoisse ou la peur ; c’est ce qui fait dire à Niklas Luhmann que si l’être humain « ne faisait pas confiance de manière courante, il n’arriverait même pas à quitter son lit le matin. Une angoisse indéterminée, une répulsion paralysante l’assailliraient… Tout serait alors possible. Nul ne peut supporter une telle confrontation immédiate avec la plus extrême complexité du monde[11] ». La confiance tisse tout autant la trame de la société. Georg Simmel voyait déjà en elle « l’une des forces de synthèse les plus importantes au sein de la société[12] ». Sans confiance des individus les uns envers les autres ou envers les institutions, la société s’effondrerait ou ne se maintiendrait que dans la peur. Simmel, qui inscrivait sa réflexion sur la confiance dans le cadre d’une explication de la forme « argent » et de la logique du crédit, estimait avec que « sans la confiance des hommes les uns envers les autres, la société tout entière se disloquerait – rares, en effet, les relations uniquement fondées sur ce que chacun sait de façon démontrable de l’autre, et rares celles qui dureraient un tant soit peu, si la foi n’était pas aussi forte, et souvent même plus forte, que les preuves rationnelles ou même l’évidence ! – de même, sans la confiance, la circulation monétaire s’effondrerait[13] ».
La nécessité de la confiance pour la stabilisation de l’ordre social apparaît dès lors que l’ordre social n’est plus considéré comme naturel ou divin mais comme une institution humaine. Ce besoin d’une culture de la confiance résulte de l’indétermination des relations entre des acteurs sociaux dont la liberté rend la vie sociale imprévisible. Cette nécessité trouve ainsi sa source dans la contingence même de tout ordre social. C’est ce que, en prolongeant des analyses de Talcott Parsons, Niklas Luhmann cherche à mettre en évidence à partir du concept de « double contingence ». Celle-ci désigne une situation originaire où les individus ne savent pas comment les autres vont réagir à leur propre agir. Le champ du possible est alors beaucoup trop élevé pour permettre des actions sociales. Pour sortir de cette situation paralysante, les acteurs sociaux doivent pouvoir former des attentes d’attentes, c’est-à-dire des attentes au sujet des attentes des autres acteurs et ainsi structurer un champ du possible. Du fait de cette contingence de l’ordre social, la confiance apparaît comme cette disposition antérieure au contrat qui rend possible et structure les relations sociales[14]. Le contrat lui-même ne lie que si les contractants s’apparaissent mutuellement comme fiables. Thomas Hobbes avait déjà perçu ce rôle constitutif de la confiance et montré que la peur qu’inspire le souverain ne peut suffire à garantir un ordre social durable. Le contrat social fondateur permet de substituer à la défiance qui caractérise l’état de nature une double confiance : celle dans le souverain qui doit garantir la sécurité et celle dans les autres citoyens qui doivent respecter le contrat[15]. Selon nous, cette nécessité sociale d’une culture de la confiance peut être envisagée selon trois perspectives : (1) comme vecteur de la solidarité, (2) comme réduction de la complexité et (3) comme facilitation de la coopération entre agents libres.
(1) Selon une première approche, inspirée par la théorie des jeux, l’ordre social requiert que les acteurs sociaux se fassent une représentation rationnelle de la conduite probable des autres acteurs. La confiance signifie ici que les individus doivent considérer que les autres individus respecteront probablement leur engagement[16]. A certains égards, l’approche de Talcott Parsons s’inscrit dans une telle perspective. Il cherche en effet à comprendre comment un ordre social est possible dans une démocratie où les acteurs sociaux poursuivent leur propre intérêt et choisissent librement leurs activités. Comme Durkheim, il estime que l’ordre social ne peut pas reposer sur le seul intérêt des individus et que la cohésion entre les actions individuelles n’est possible que par l’intégration de valeurs et de normes communes. Tout le problème est alors de comprendre comment ces normes communes parviennent à motiver les acteurs sociaux. Selon le sociologue fonctionnaliste, l’intégration sociale requiert la solidarité, comprise comme la capacité de mettre en accord les individus d’un système avec les besoins intégratifs de celui-ci, d’empêcher les comportements déviants et par là de favoriser les conditions d’une coopération harmonieuse. Dans ces conditions, la confiance est la croyance d’un individu que les autres vont subordonner leur intérêt personnel à celui de la collectivité en l’accordant aux normes sociales et, partant, assumer leur responsabilité sociale. On ne monte dans un téléphérique que parce qu’on pense que les services de maintenance ont fait leur travail consciencieusement.
(2) Niklas Luhmann récuse l’approche normative développée par Parsons et voit dans la confiance un mécanisme de réduction de la complexité nécessaire à la formation et à la stabilisation de l’ordre social. La confiance permet en effet d’accroître les possibilités d’action sans avoir à recourir à tout un appareil normatif. Il part du constat que le monde présente plus de possibilités que celles que les acteurs sociaux peuvent prévoir. Ceux-ci n’ont alors d’autre choix que d’interpréter le monde en sélectionnant les informations. Cette complexité est redoublée par le fait que les autres êtres humains peuvent eux aussi sélectionner librement. C’est parce que, dans une telle société, nous en savons toujours moins au sujet des autres avec lesquels nous entrons en contact que la confiance est requise pour masquer les risques et les contingences et pour permettre la poursuite coordonnée des interactions. La confiance sert de mécanisme élémentaire de stabilisation des attentes et ainsi de condition de possibilité de l’agir individuel : « Là où il y a confiance, il existe davantage de possibilités d’expérience et d’action, la complexité du système social s’accroît et, donc, le nombre de possibilités que celui-ci peut réconcilier par sa structure, puisque réside dans la confiance une forme plus efficace de réduction de la complexité[17] ». Réduisant l’incertitude et la complexité, la confiance constitue ainsi un fond routinier des interactions quotidiennes qui rend le monde social prédictible et fiable. La confiance peut ainsi être comprise comme un habitus, c’est-à-dire, comme l’entend Pierre Bourdieu, comme un système de dispositions intériorisées et durables qui fonctionnent comme des principes inconscients structurant la perception et l’action[18].
(3) La confiance sert aussi, pourrait-on dire, de lubrifiant social ; elle facilite la coordination de l’agir social dans des conditions d’un anonymat étendu. La confiance permet d’élargir le champ d’action dans une situation de risque. Elle favorise la coopération en assurant que les acteurs sociaux ne font pas faire défaut. Elle régule les interactions sociales non en limitant la liberté mais en permettant une collaboration entre agents libres. Niklas Luhmann souligne en ce sens que la confiance « sert à traverser un moment d’incertitude dans le comportement des autres hommes dont on fait l’expérience au même titre que l’imprévisibilité des modifications d’un objet[19] ». Sans la confiance dans la baby-sitter, nous nous priverions d’une soirée avec des amis ; sans la confiance dans nos voisins dans le train, nous ne pourrions aller prendre un café au wagon-bar tout en laissant des effets personnels à notre place. La théorie du choix rationnel a particulièrement pointé cette fonction de coopération entre agents se percevant mutuellement libres. Selon cette approche, la vie sociale est l’agrégat de décisions individuelles rationnelles, la rationalité étant ici comprise en termes utilitaristes comme le choix de l’action qui est susceptible d’être la plus utile. Pour James Coleman, la confiance est un comportement visant la maximisation de l’utilité, c’est-à-dire le plus grand profit ou le moindre mal, dans une situation de risque[20]. Une personne est digne de confiance si on estime que la probabilité que son comportement ne corresponde pas à nos attentes est relativement faible. James Henslin a ainsi pu montrer que les conducteurs de taxi font preuve d’une certaine perspicacité sociale pour établir si un passager est digne de confiance : ils recourent à des stéréotypes socioculturels (lieu de la prise en charge, jour/nuit, homme/femme, etc.), à une interprétation du comportement assis du passager et des signes tels que la voix[21].
De la familiarité à la confiance
Une approche socio-historique permet de préciser la fonction sociale de la confiance. Ce n’est en effet qu’avec la modernité, que la confiance devient un fondement du tissu social qui ne repose plus uniquement sur la familiarité. Elle n’est d’ailleurs conçue comme un mécanisme fondamental des relations sociales qu’à partir de la fin du XVIIIe siècle. Cette préoccupation n’a cessé de croître au cours du XIXe siècle et a culminé à partir du dernier tiers du XXe siècle. Cela ne signifie pas que les sociétés traditionnelles aient ignoré la confiance ; cependant celle-ci ne fut appréhendée comme constitutive de la société qu’avec les transformations radicales que connues la société à partir de la fin du XVIIIe siècle[22]. Au premier rang de celles-ci se trouve l’anonymat. Dans les sociétés modernes, nous sommes fréquemment en relation avec des personnes inconnues. En particulier dans les contextes urbains, nous vivons avec des personnes que nous ne connaissons pas sans pour autant les considérer comme menaçantes. C’est à partir du moment où l’environnement social a perdu sa familiarité que la confiance devint essentielle aux interactions sociales. Avec la modernité, le monde, marqué par l’effritement de repères stables et changements incessants, devient plus imprévisible et perd de son évidence routinière. La familiarité caractérise des situations que nous connaissons bien et dans lesquels nous pouvons nous orienter à partir de codes communs de conduite (des normes morales, des signes, des symboles, des rituels) qui permettent de prédire ce qu’on peut attendre d’autrui. Dans les sociétés traditionnelles, il n’est guère besoin d’accorder son crédit : la familiarité y garantit une prédictibilité élevée des comportements[23].
Niklas Luhmann a particulièrement pointé cette mutation en envisageant la familiarité et la confiance comme deux manières différentes de réduire la complexité du monde. A ses yeux, dans les sociétés modernes complexes, la confiance ne repose plus sur la familiarité : « la complexité de l’ordre social fait naître un besoin accru de coordination et, partant, un besoin de déterminer l’avenir, donc un besoin de confiance qui peut de moins en moins être satisfait par la familiarité[24] ». Selon lui, dans les sociétés traditionnelles, le monde présente un caractère d’évidence et de familiarité. Un monde de la vie évident, ininterrogé et non constitué par la conscience, est le fondement de la vie sociale. La contingence du monde y est masquée et sa complexité est déjà réduite ; il n’existe aucune raison de questionner sa constitution : « dans les ordres sociaux simples, l’assurance dans la conduite de la vie, pour autant qu’une telle assurance a pu exister, a été atteinte, au-delà du recours à la confiance dans des personnes en particulier, par la supposition, reposant sur des bases religieuses, de l’existence d’un être vrai, du naturel et du surnaturel, au moyen de mythes, de la langue et du droit naturel[25] ». Le monde se donne de manière unifiée sous la forme d’une nature qui présente un caractère normatif. Mais, avec la modernité, puisqu’il n’est plus possible de se fonder sur la familiarité avec un monde proche, la confiance est devenue nécessaire pour affronter la contingence de l’ordre social.
Pour faire comprendre cette profonde transformation, Niklas Luhmann s’efforce de repenser le monde de la vie non à partir d’une méthode phénoménologique mais à partir d’un constructivisme opérationnel. Au lieu de faire du monde de la vie, à l’instar d’Alfred Schütz et Jürgen Habermas, un fond originaire de familiarité, un donné originairement évident constitutif de l’intégration sociale, Luhmann entreprend d’en faire la genèse, c’est-à-dire de décrire les opérations qui mènent à sa constitution. Il avance que le monde de la vie représente la forme de condensation de la distinction entre le familier et le non-familier. La familiarité désigne et le sol de l’expérience et la non-familiarité son horizon. Fondement de notre expérience, le sens est l’unité de la différence entre l’actuel et le potentiel par laquelle le monde émerge comme un donné actuel ouvert à un horizon du possible. Le monde apparaît comme monde de la vie lorsqu’il se donne sous la forme répétée de la distinction entre le familier et le non-familier, c’est-à-dire comme « condensation de la familiarité[26] ».
L’évolution de la société a cependant radicalement transformé le sens de la distinction entre le familier et le non-familier. Les sociétés tribales archaïques se structurent autour d’un monde délimité par les frontières strictes entre le familier et le non-familier qui correspondent aux montagnes, aux ténèbres ou aux différences linguistiques. Des ethnologues comme Alfred R. Radcliffe-Brown ou Fredik Barth ont ainsi montré que les tribus, constituées de quelques centaines de membres, se distinguent par les différences linguistiques. Au-delà de ces frontières linguistiques, il n’était plus possible de communiquer avec des êtres qui prennent la figure de l’inhumanité, de l’étrangeté, de l’ennemi[27]. Dans ces sociétés, la distinction familier/non familier s’exprime de manière religieuse par la distinction sacré/profane, des récits mythiques, des rituels et des tabous. L’invention de l’écriture puis de l’imprimerie modifie profondément le sens de cette distinction. L’écriture provoque une fragmentation du familier dans la mesure où ce qui est familier pour quelqu’un ne l’est pas nécessairement pour quelqu’un d’autre. L’imprimerie accentue ce phénomène car « elle habitue la société à l’idée qu’il existe beaucoup plus de choses sues ou familières que quiconque peut le savoir[28] ». A l’inverse de ce que pensent Schütz et Habermas, Luhmann considère donc que le monde de la vie ne peut plus être pensé comme ce qui confère à la société son unité puisque la société moderne se définit par sa polycontexturalité, c’est-à-dire par une multiplicité de mondes de la vie.
La familiarité et la confiance diffèrent dans leur relation au temps. Dans les sociétés prémodernes, fondées sur la familiarité, le passé prédomine car on a la conviction que le monde se perpétuera tel qu’il est, qu’il existe une continuité des choses. La société moderne présente une césure entre le passé et l’avenir beaucoup plus saillante qu’autrefois. La distinction familier/non familier y acquiert un sens avant tout temporel : « elle coïncide plus ou moins avec la différence entre le présent et le futur[29] ». Le passé est associé à la certitude tandis que l’avenir est perçu sous l’angle de l’incertitude. Luhmann affirme en ce sens que la société ne parle « de l’avenir que sur le mode de l’incertitude[30] ». C’est cet l’avenir qui se drape d’un voile de non-familiarité : la société se décrit elle-même comme une société du risque car elle « perçoit son avenir sous la forme du risque des décisions[31] ». La contingence de l’avenir était reconnue dans les sociétés anciennes mais elle était appréhendée par des dispositions morales telles que la prudence ou l’impassibilité stoïcienne. Dans la société moderne, la confiance ne peut pas être définie comme la simple conséquence des expériences du passé puisqu’elle requiert également une décision risquée relative aux attentes : « mais la confiance n’est pas la conséquence du passé ; elle extrapole au contraire à partir des informations dont elle dispose relativement au passé et se risque à déterminer l’avenir[32] ».
De la confiance personnelle à la confiance systémique
En sus de son anonymat, la société moderne se définit par sa différenciation en systèmes doués d’une fonction propre. Cela a pour conséquence que la confiance nécessaire à la cohésion sociale ne peut plus être dirigée uniquement vers des personnes : une confiance envers les systèmes et leurs médias symboliques est elle aussi requise. Georg Simmel a été le premier à percevoir cette évolution. A ses yeux, le comportement interpersonnel de la société moderne se caractérise par le fait que « la motivation et la régulation de ce comportement … se sont objectivées de telle sorte que la confiance ne requiert plus une connaissance réellement personnelle[33] ». Dans la société moderne, les relations sociales sont médiatisées par des « marques symboliques[34] », comme l’argent. L’économie moderne, fondée sur le crédit, requiert une confiance à la fois dans le gouvernement émetteur et dans la « sphère économique[35] ». Il en conclut que « le sentiment de sécurité personnelle qu’assure la possession de l’argent est peut-être la forme et l’expression la plus concentrée et la plus aigüe de la confiance dans l’organisation et dans l’ordre étatico-social[36] ».
Niklas Luhmann prolonge les analyses de Simmel en lui donnant une interprétation systémique. Selon lui, la société moderne hautement complexe et différenciée requiert avant tout une confiance dans les systèmes et leurs « médias symboliquement généralisés de communication » que sont l’argent, le pouvoir ou l’amour. Il fait ainsi le constat que « à mesure que s’accroît la besoin de complexité et qu’apparaît l’autre homme comme alter ego, en tant que co-responsable de cette complexité et de sa réduction, la confiance doit être élargie et elle doit repousser la familiarité du monde originellement évidente, sans toutefois pouvoir la remplacer totalement. Elle se transforme en une confiance systémique[37] ». C’est d’ailleurs cette confiance dans les systèmes qui manifeste le mieux la contingence et le risque propres à la modernité : « Au sein de la confiance systémique s’exprime la conscience du fait que toutes les opérations sont produites, que toutes les actions ont été décidées en comparaison d’autres possibilités. La confiance systémique se fonde sur des processus explicites de réduction de la complexité, donc sur des hommes, et non sur la nature[38] ».
L’argent est à cet égard un médium idéal-typique. Le système économique ne peut en effet fonctionner que si on a confiance dans la stabilité de l’argent, son médium symboliquement généralisé de communication. Cette confiance ne repose pas tant sur des personnes que sur le fonctionnement du système économique lui-même : « celui qui possède de l’argent n’a pas besoin de faire confiance aux autres[39] » dit Luhmann en ce sens. Cette dépersonnalisation de la confiance systémique facilite d’ailleurs grandement la perpétuation des opérations économiques car elle permet d’assurer dans le présent des attentes futures qui ne sont pas encore définies. Pourtant, le fonctionnement du système économique et de l’argent reste très largement obscur. La confiance systémique sert ainsi d’équivalent fonctionnel de la certitude mais rend ainsi le contrôle du système très difficile.
Partant du constat similaire que les institutions modernes sont étroitement liées à des mécanismes de confiance dans des systèmes abstraits et experts, Anthony Giddens accorde quant à lui un rôle décisif joué par les « points d’accès » dans l’édification de la confiance systémique. Ceux-ci désignent les points de contact avec les représentants des systèmes (un médecin, l’employé d’une administration, une hôtesse de l’air, etc.) qui doivent permettre de faire naître la confiance en faisant la preuve de la fiabilité. C’est pour cette raison que ces représentants doivent manifester une attitude professionnelle pour gagner la confiance, et cela d’autant plus que l’activité présente des risques. Un des rôles des professionnels est de gagner la confiance personnelle en vue de créer la confiance dans le système. A ces points d’accès, la distinction faite par Erwing Goffmann entre la scène et les coulisses s’avère décisive pour entretenir la confiance. Le comportement « sur scène » permet de masquer l’irréductible contingence systémique, les limites du savoir des spécialistes et les éventuelles défaillances. Par ailleurs, dans la mesure où une certaine défiance s’exprime à l’égard des systèmes, ces points d’accès sont, selon Giddens, des « points de tension entre scepticisme profane et compétence professionnelle[40] ». Les expériences vécues dans ces points vulnérables conditionnent ainsi largement le degré de confiance envers les systèmes.
Mais que devient la confiance personnelle dans la société moderne ? L’extension de la confiance systémique ne lui a pas fait perdre de son importance. La société moderne ne réduit pas à une masse d’individus aliénés et indifférenciés : les organisations, mêmes les plus bureaucratiques, requièrent une confiance dans les personnes. Anthony Giddens a pointé la nécessité, outre des points d’accès, de la « relocalisation » au sein des systèmes experts. La rencontre entre les différents collègues spécialistes d’un système expert apparaît en effet indispensable pour vérifier la fiabilité des confrères et asseoir la confiance dans le système. La confiance personnelle a néanmoins subi une profonde transformation : elle s’est privatisée car elle n’implique plus le partage de la vision du monde de l’autre. Avec la modernité, la confiance s’est faite tolérante. Il est par ailleurs possible de voir dans ce qu’Erwing Goffman dans l’ « inattention civile » le fondement de la confiance interpersonnelle dans la société moderne anonyme[41]. Cette forme d’engagement de face se définit comme un principe de politesse minimale, comme une distance polie qui se manifeste par un coup d’œil furtif sur autrui et l’évitement du regard au moment où les personnes se croisent. Par cette conduite, l’individu montre qu’il ne soupçonne pas d’attitude malveillante chez autrui. Cette forme élémentaire de coordination sociale manifeste la reconnaissance d’une coprésence dénuée d’intention hostile. Elle s’oppose à différentes formes du regard méprisant qui ne reconnaissent pas l’autre comme personne. Il en est ainsi du regard trop insistant (à l’égard par exemple de personnes handicapées ou de couleur) ou d’une indifférence par laquelle on signifie que l’autre ne mérite pas d’être regardé.
La crise de la confiance des sociétés contemporaines
Alors que la confiance procure un indispensable sentiment de sécurité dans notre rapport aux autre et au monde, les sociétés contemporaines sont confrontées à une profonde crise de confiance qui se manifestent notamment par une défiance à l’égard des institutions et des systèmes. La crise économique et l’explosion du chômage qu’elle provoque ont suscité un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité. La flexibilité du travail, favorisée par le libéralisme économique, génère de nouvelles formes de précarité et empêche les salariés qui accumulent les contrats à durée déterminée de se projeter avec assurance dans l’avenir[42]. Une telle défiance peut déboucher sur du fatalisme. Nous ne faisons plus confiance dans les institutions politiques ou le système économique pour résoudre les problèmes dans la société ; mais nous renonçons pourtant à les modifier ou nous en soustraire. L’usage de Facebook est de ce point de vue significatif. Nous savons que ce réseau social utilise nos données personnelles à des fins commerciales ; mais nous continuons à en faire usage pour entretenir nos relations personnelles ou pour parfaire notre présentation de nous-mêmes. La défiance à l’égard des systèmes experts se manifeste quant à elle par un repli sur des formes de socialité fondées sur la confiance personnelle et par une repersonnalisation de la confiance systémique. Le populisme et le fascisme représentent assurément des modes de cette repersonnalisation[43]. Le populisme s’alimente en effet d’une méfiance à l’égard des institutions politiques et cherche à faire reposer la confiance sur les qualités charismatiques du leader en cherchant à créer une intimité artificielle et parfois quasi religieuse avec le « peuple ». Enfin, la prolifération des lois dans des champs les plus divers témoigne d’un recul inquiétant de la régulation sociale par la confiance. On peut voir dans cette extension de la juridicisation au détriment de l’intégration sociale par la confiance une des formes de ce que Jürgen Habermas nomme la « colonisation du monde de la vie » par la rationalité systémique[44]. Cet effritement d’une communication dialogique fondée sur la confiance met incontestablement en péril la transmission du sens par la culture, l’intégration sociale et la socialisation des individus.
Mots-clés : confiance, sociologie, modernité, argent, Georg Simmel, Niklas Luhmann, Anthony Giddens
[1] Niklas Luhmann, « Vertrautheit, Zuversicht, Vertrauen : Probleme der Alternativen » in Martin Hartmann, Claus Offe (dir.), Vertrauen. Die Grundlage des sozialen Zusammenhalts, Francfort-sur-le-Main/New York, 2001, p. 143.
[2] Selon l’expression d’Ute Frevert, Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne, Munich, 2013.
[3] La confiance a plutôt été étudiée par les économistes et a peu fait l’objet d’une étude systématique par les sociologues. On notera cependant les travaux suivants : Louis Quéré/Albert Ogien (dir.), Les moments de la confiance. Connaissance, affects et engagements, Paris, 2006 ; Patrick Watier, Eloge de la confiance, Paris, 2008 ; Michela Marzano, Le contrat de défiance, Paris, 2010, réédité sous le titre Eloge de la confiance en 2012.
[4] Sur ce point, voir Piotr Szompka, Trust. A Sociological Theory, Cambridge, 1999, p. 18 sq.
[5] Pour l’analyse de la confiance au sein de la mafia sicilienne, voir Diego Gambetta, The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection, Boston, 1993.
[6] Anthony Giddens, Les conséquences de la modernité, Paris, 1994 pour la tradction française, p. 40.
[7] Georg Simmel, Sociologie, Paris, 1999 pour la traduction française, p. 356.
[8] Georg Simmel, Philosophie de l’argent, Paris, 1987 pour la traduction française, p. 197
[9] Luhmann distingue le risque du danger. Selon lui, on peut parler de risque lorsque les dommages possibles sont considérés comme la conséquence de sa propre décision. Il est en revanche question de danger lorsqu’un préjudice éventuel est produit extérieurement par l’environnement, par des événements naturels ou par des décisions d’autres personnes ou organisations, et échappe ainsi à son propre contrôle.
[10] Niklas Luhmann, La confiance, Paris, 2006 pour la traduction française, p. 26.
[11] Ibid., p. 1.
[12] Sociologie, p. 355.
[13] Philosophie de l’argent, p. 197.
[14] Sur ce point, voir l’article « Confiance » de Adam B. Seligman in Sylvie Mesure, Patrick Savidan (dir.), Le dictionnaire des sciences humaines, Paris, 2006, p. 181.
[15] Sur ce point, voir l’article de Marc Parmentier, « Hobbes, la coopération et la théorie des jeux », Methodos (en ligne), mis en ligne le 19 mars 2010.
[16] Marc Parmentier, op. cit.
[17] La confiance, p. 8
[18] Sur ce point Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, 1980, pp. 88-89.
[19] OP. cit., p. 24.
[20] Voir James S. Coleman, Foundation of Social Theorie, Cambridge, 1990.
[21] James Henslin, « Trust and the Cab Driver » in Marcello Truzzi (dir.), Sociology and Everyday Life, Englewood Cliffs, 1968, pp. 139-159.
[22] Sur ce point, voir Ute Frevert, op. cit., p. 23 sq.
[23] Sur ce point, voir Adam Seligman, op. cit.
[24] La confiance, p. 22.
[25] Ibid., p. 55
[26] Niklas Luhmann, « Lebenswelt. Nach Rücksprache mit Phänomenologen », Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 72, 1986,
p. 183.
[27] Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Francfort/Main,1997, p. 645.
[28] Ibid., p. 648.
[29] Lebenswelt, p. 189.
[30] Short Cuts n°1, Peter Gente, Heidi Paris, Martin Weinlmann (dir.), Francfort/Main, 2001, p. 96.
[31] Beobachtung der Moderne, p. 141.
[32] La confiance, p. 22.
[33] Philosophie de l’argent, p. 339.
[34] Ibid., p. 198.
[35] Ibid., p. 196.
[36] Ibid., p. 198.
[37] La confiance, p. 24.
[38] Ibid., p. 70.
[39] Ibid., p. 60.
[40] Les conséquences de la modernité, p. 97.
[41] Erwing Goffmann, Comment se conduire dans les lieux publics. Notes sur l’organisation sociale des rassemblements, Paris, 2013, pour la traduction française, pp. 73-77. Anthony Giddens s’y réfère d’ailleurs.
[42] Sur ce point, voir David Le Breton, Sociologie du risque, Paris, 2012, pp. 28-30.
[43] Sur ce point, voir Claus Offe, « Wie können wir unseren Mitbürger vertrauen ? » in Hartmann, op. cit., pp. 284-285.
[44] Voir Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, tome 2, Paris, 1987 pour la traduction française.