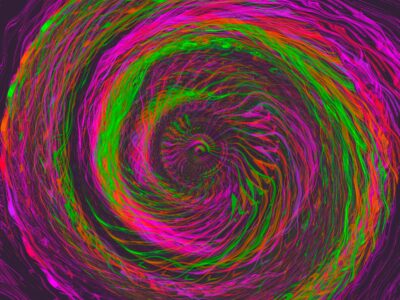Faut-il « ubériser » la pensée de l’Emergence ?
Florian Forestier est écrivain et docteur en philosophie. Conservateur à la Bibliothèque nationale où il occupe les fonctions de responsable de la politique de la diversité et de la création du centre de recherche. Docteur en philosophie, il a consacré des travaux à la question de la singularité dans la philosophie française contemporaine (La phénoménologie génétique de Marc Richir, Phaenomenologica, 2014, Le réel et le transcendantal, Jérôme Millon, 2015, Le grain du sens, Zetabooks, 2016). Il est également auteur de roman (Basculer, Belfond, 2021, Un si beau bleu, à paraître chez Belfond en 2024) et de nouvelles. Comme directeur des études du Think tank #Leplusimportant, il a coordonné plusieurs rapports et un essai (Désubériser. Reprendre le contrôle, Éditions du Faubourg, 2020) consacré aux effets de la transformation numérique sur le travail et à la régulation des réseaux sociaux.
Résumé
Une philosophie de l’émergence telle que Ferraris l’appelle ne peut s’appuyer sur des catégories physicalistes ou naturalistes. Elle ne peut pas non plus prendre son point de départ dans un niveau identifié de la nature (la physique atomique, les molécules, les organismes vivants). En effet, elle doit questionner la possibilité et la structure ontologique de l’émergence. Chez Ferraris, le noyau spéculatif de la logique transcendantale de l’émergence est l’enregistrement. Mais celui-ci ne présuppose-t-il pas d’autres conditions de possibilité – en particulier, le virtuel et le processus d’individuation. Lorsqu’on prend ceux-ci en compte, ne faut-il pas raconter autrement l’histoire de l’émergence, et ses différents moments ?
Mots-clés : Emergence, individus, virtualité, individuation, trace, institution
Abstract
A philosophy of emergence such as Ferraris calls it cannot be based on physicalist or naturalistic categories. It can even less take its starting point in an identified level of nature (atomic physics, molecules, living organisms). Indeed, tt must question the possibility and ontological structure of emergence. For Ferraris, the speculative core of the transcendental logic of emergence is registration. But does this not presuppose other conditions of possibility – in particular, the virtual and the process of individuation? When we take these into account, do we not have to tell the story of emergence and its different moments in a different way?
Keywords: Emergence, individuals, virtuality, individuation, trace, institution
I. Une histoire d’individus
Le philosophe peut-il prendre le Big Data au sérieux sans en déplorer les effets ? Peut-il considérer que celles-ci ouvrent la voie vers une autre façon de comprendre la connaissance, qui ne soit pas plus pauvre, mais plus exacte, et qui ne ferme pas non plus la porte à toute philosophie ? Fidèle à son habitude des contrepieds, Maurizio Ferraris se met sans nostalgie à l’école de Chris Anderson[1]. Pour celui-ci en effet, notre capacité actuelle à collecter, traiter, analyser des données engendre une révolution profonde de la méthode scientifique en rendant le passage par la théorie et l’activité de théorisation superflu. Une déclaration qui, le plus souvent, suscite l’horreur des philosophes : Bernard Stiegler voit par exemple dans ce déclin annoncé de l’activité théorique l’avènement d’une prolétarisation généralisée et d’une misère symbolique[2] qui remettent en cause notre capacité même à penser et menacent les fondements de notre humanité.
Plus optimiste, Ferraris y trouve l’occasion d’un tournant philosophique et réhabilite une thèse nominaliste radicale : le Big Data nous révèle une donnée ontologique fondamentale, à savoir que le monde est bien fait d’individus et que les universaux ne sont rien de plus que des noms, des abstractions qui ne s’appliquent à plusieurs individus qu’au prix d’une simplification. Loin de jouir d’une dignité particulière, la science telle que nous l’avons connue n’aura été qu’une étape provisoire, palliant notre incapacité à traiter des individus directement, dont nous sommes peu à peu amenés à nous affranchir.
En nous permettant de nous passer de cette médiation théorique, le Big Data nous aide par ailleurs aussi à nous libérer du filtre de notre propre faculté de connaître et des écrans transcendantaux et idéalistes qui nous font mesurer le monde à la façon dont nous le connaissons. Par lui, nous sommes confrontés à ce fait que la médiation théorique tend à occulter : la réalité précède et détermine bel et bien la connaissance que nous en avons, s’impose à elle parce qu’elle est comme elle est, indépendamment de l’intelligibilité que nous lui donnons.
Mais les conséquences d’un tel nominalisme sont lourdes si on l’assume jusqu’au bout. S’il n’y a que des individus, l’intelligibilité ne peut en effet être que descriptive et factuelle : toute théorie n’est qu’un moment provisoire, voué à se dissoudre dans une description plus fine[3], et la connaissance parfaite a la forme d’une histoire qui n’a pas pour vocation de fonder ou de rendre compte, mais de constater. Connaître vraiment le monde n’est rien de plus que raconter l’histoire des individus qui le composent et le processus de genèse de la facticité qui se présente actuellement à nous et à laquelle nous appartenons.
Paradoxalement, ce changement de statut de la connaissance ne signe pas la mort de la philosophie, mais lui ouvre au contraire un autre destin, hors de la forme théorique qu’elle voulait partager avec la science. L’obsolescence d’une certaine forme d’appréhension théorique, qui vise à rendre compte et rendre raison, n’implique en effet pas celle de la pensée spéculative elle-même. Une affirmation qui constitue un cheval de bataille des nouveaux réalismes dont Ferraris s’est fait le promoteur et le théoricien : la philosophie doit se rendre capable de penser le réel dans sa facticité et sa contingence et développer des instruments intellectuels à sa mesure. Autrement dit : mettre en œuvre une pensée qui ne cherche plus à légitimer ou à fonder – à rendre raison du sens – mais à saisir la portée spéculative du fait brut.
Pour Ferraris, la connaissance en redevenant narration redonne tout son sens à la philosophie, à condition que celle-ci change son mode d’exposition, renonce à la déduction conceptuelle pour tendre vers le récit. Le rôle de la philosophie n’est plus de redoubler la théorie scientifique mais de refluer en deçà d’elle pour articuler ce que son abstraction ne peut plus saisir, l’histoire des individus eux-mêmes, de leur formation, de leur combinaisons, c’est-à-dire l’émergence. Ce récit ne peut évidemment être exhaustif. Il ne saurait y avoir qu’une seule histoire. Celles que la philosophie propose ne peuvent prétendre épuiser le réel et restent elles-mêmes aussi spéculatives que fragmentaires. Leur rôle est de donner à penser, de rendre intelligible. Elles empruntent aux Ages du monde de Schelling plus qu’à la Logique de Hegel : proposer un regard approximatif mais acceptable sur la façon dont des choses aussi diverses que les galaxies, les gastéropodes, les virus, ou les philosophes transcendantaux ont pu émerger du monde.
Si distinctes soient-elles en effet, ces choses ne relèvent pas de catégories ontologiques étanches. Chacune à sa façon, elles ont émergé d’un monde dans lequel elles n’existaient pas d’abord, sont le produit de processus impliquant d’autres choses, elles-mêmes produites par d’autres processus, etc. L’épistémologie comme la politique font aussi partie de l’histoire de l’émergence. En effet, notre appareil cognitif, notre capacité à le comprendre, notre façon de nous rapporter à lui autant que nos façons de nous comporter viennent de lui. Comment le réel nous a-t-il produit ainsi que la compréhension que nous avons de lui ? Comment oriente et guide-t-il le regard que nous portons sur lui à travers diverses saillances et affordances ? Comment le fonctionnement réflexe, l’instinct, le conditionnement, l’habitude, ont-ils produit la liberté ?
II. L’ontologie et le virtuel
Au fond de ce récit cependant persiste un noyau spéculatif qui donne à la logique narrative sa structure. L’émergence doit être comprise philosophiquement, c’est-à-dire, dans l’horizon schellingien assumé par Ferraris, narrativement, mais selon une narration reflétant la façon dont elle se fait. Une philosophie de l’émergence telle que Ferraris l’appelle ne peut donc pas s’appuyer sur des catégories physicalistes ou naturalistes, et encore moins prendre son point de départ dans un niveau identifié de la nature (la physique atomique, les molécules, les organismes vivants). Elle ne peut pas non plus se contenter de comprendre l’émergence comme la production de structures « au niveau global d’un système à partir d’interactions entre ses constituants à un niveau d’intégration inférieur » (selon la définition traditionnelle). Elle doit dire quelque chose de la possibilité et de la structure ontologique de l’émergence.
La question devient alors de donner un véritable fondement transcendantal à l’’émergence, de la penser à partir d’un processus matriciel. Pour Ferraris, il s’agit de l’enregistrement : « A la longue tradition de l’émergentisme, je n’ai rien à ajouter sinon qu’émerger c’est être enregistré »[4]. L’enregistrement est le ciment d’un univers constitué d’individus, c’est-à-dire de points de forces extérieurs les uns aux autres (irréductibles aux arrangements dans lesquels ils s’inscrivent), inamendables, des unités spatio-temporelles.
Ce concept d’enregistrement est difficile à définir : il ne désigne de fait pas quelque chose qu’il faut expliquer ou décrire, mais une catégorie transcendantale. En toute rigueur, Ferraris en effet ne nous dit pas ce qu’est l’enregistrement. Il procède à un raisonnement transcendantal : pour penser ontologiquement la possibilité d’un monde structuré considérer celui-ci prédonné, il faut poser ce qu’il appelle l’enregistrement, c’est-à-dire la possibilité de laisser des traces (ou, dit encore Ferraris, la passivité). L’enregistrement ne postule aucun principe de consistance intérieur à l’étant mais seulement sa possible capacité à marquer, à inscrire. Celle-ci s’articule en trois moments : l’inscription (quelque chose existe et résiste), l’itération (la persistance de l’inscription), altération (la capacité de l’inscription répétée à faire la différence). Les premiers instants de l’univers tels que la science les reconstitue sont une bonne illustration de ce phénomène : des ruptures de symétries (entre matière et antimatière) qui ont une incidence déterminante sur l’évolution de l’univers et sa structure[5].
On peut cependant se demander s’il n’est pas malgré tout hâtif de faire ainsi de l’enregistrement un transcendantal sans s’interroger sur ses propres conditions de possibilité : s’il est nécessaire qu’il y ait enregistrement, on peut en effet se demander pourquoi et comment il y a enregistrement. La description de Ferraris donne l’impression que l’enregistrement fonctionne comme l’action d’individus atomiques sur d’autres individus atomiques, comme si finalement tout était d’une façon ou d’une autre enregistré, même si toute inscription ne donne pas forcément lieu à répétition et altération. Mais précisément, l’inscription n’est en quelque sorte marquée qu’après coup dans le processus qui mène à l’altération. Le concept d’inscription est lui-même problématique : peut-on concevoir une inscription qui ne dure pas, ou au contraire, une inscription qui ne se matérialise que dans le processus qui émerge d’elle ?
En d’autres termes, l’idée même d’enregistrement nous semble difficilement séparable de celle de passivité. Si l’enregistrement est synonyme de passivité (ce que Ferraris semble entendre), celle-ci ne signifie pas seulement recevoir la marque ou l’empreinte, mais être susceptible de le faire. La passivité pure implique l’inertie : elle conduit parfois à l’enregistrement, mais est constitutivement indifférente à lui. Sa capacité à inscrire la trace, à accueillir la forme, est inséparable de son épaisseur ontologique. L’enregistrement est hasardeux, il est rare, il émerge à même le bruit, à même l’épaisseur informe de l’être.
Peut-être ne devons-nous pas simplement partir des individus et de l’enregistrement qui leur sert de ciment, mais les concevoir sur fond de virtualité. Autrement dit, si les individus sont une catégorie descriptive essentielle à l’économie transcendantale de l’émergence, il n’est pas si sur qu’on doive admettre sans reste qu’il n’y ait originairement que des individus distincts et interagissants, que les individus soient bien le mobilier ontologique ultime. De fait, il n’est pas contradictoire de reconnaître à la fois l’indépendance ontologique des individus (ils existent hors des arrangements dans lesquels ils entrent, ils ont une réalité au-delà des propriétés relationnelles) et de faire place au transindividuel dès lors qu’on conçoit justement celui-ci comme le fondement de leur consistance.
Cela implique (avec Schelling et quelques autres) de postuler que l’individuation implique toujours de la « réserve » par rapport à elle. La physis chez Schelling est justement en « résistance » par rapport à elle-même, en retard et en avance sur elle-même, en décalage[6]. Cela veut dire qu’elle n’est pas pur mouvement de s’auto-révéler, de s’auto-manifester, mais mouvement différencié, se fragmentant, pluralité originaire de processus d’individuations, dont émergent des consistances réelles mais éphémères, partielles, aléatoires. Dans ce schéma, la résistance et l’extériorité n’appartiennent pas aux individus : au contraire, ce sont elles qui fondent les individus. Ceux-ci s’individuent parce ce qu’ils se différencient, se stabilisent, s’opposent.
La tradition des débats métaphysiques consacrés aux individus et au préindividuel et au virtuel est au moins aussi riche que celles des pensées de l’émergentisme. Elle trouve des formulations diverses (entre métaphysique analytique, nouveaux réalismes, philosophie classique allemande, phénoménologie). Nous estimons pour notre part que l’argumentation devrait sur ce point introduire un autre paramètre qui est celui de la finitude. La question est alors la suivante : pourquoi est-il difficile de considérer les individus comme des constituants originaires achevés et isolés ? Pourquoi penser l’individu implique-t-il de poser autre chose que l’individu, qui le soutient et l’excède ? Qu’est-ce qui, ontologiquement, nous appelle à penser l’individu sur fond du préindividuel, non pas isolé, mais arrangé avec d’autres individus, toujours d’une certaine façon débordé ? Répondre précisément à cette question nécessiterait de très longs développements. Le centre de l’argumentation serait la finitude qui interdit de penser une substance déterminée, qu’elle soit une ou morcelée. Cette même finitude interdit ainsi d’attribuer au préindividuel la complétude que l’on refuse aux individus et de résorber ceux-ci dans leurs arrangements. Elle conduit à concevoir l’être comme différant de lui-même, ne coïncidant pas avec lui-même, mais aussi résistant à lui-même.
Il n’est cependant pas besoin de nous concéder l’ensemble de ces points pour transformer considérablement l’histoire que nous raconte Ferraris. Il suffit de reconnaître que l’enregistrement est inséparable du virtuel donc du bruit[7]. De fait, Ferraris lui-même semble l’admettre sans cependant s’y attarder. : or revenir à la matérialité, à l’opacité intrinsèque de la trace elle-même, conduit à porter un tout autre regard sur l’enregistrement et les processus qui en relèvent. Si l’être brut est virtualité d’individuation, d’événementialité, d’accidents, réserve d’émergence que peut réveiller le hasard, l’histoire de l’émergence n’est plus seulement celle des processus, où fatalement, nécessairement, la vérité vient à faire surface. C’est une histoire pleine de bruit et de fureur, faite de bifurcations, de coups d’audace, de créations ou d’ensevelissements ; une histoire où l’activité ne nait pas sans déphasage et toujours pareillement de la passivité, où la signification émergentiste ne prévaut pas forcément sur la signification pentecôtiste, où la décision n’est pas seulement fille de la soumission, où l’impossible n’est jamais exclut.
III. Entre signification et folie
Ferraris appelle pentecôtiste la conception classique de la signification selon laquelle il existe un sens antérieur et indépendant par rapport aux formes par lesquelles il s’exprime : je vise un sens à partir d’un signe ou d’un mot, une idée à partir des figures ou formules qui la manifestent, etc. Dans l’histoire de l’émergence et de l’enregistrement, ce type de signification ne peut être un modèle et doit être dérivé d’une signification émergentiste :
En premier lieu, il y a les traces, ces dernières commencent ensuite à avoir une signification pour les hommes et pour les animaux, et enfin émergent les signes et leur vouloir-dire, dont descendent le langage, l’écriture au sens coutant, la signification, la responsabilité, la vérité. [8]
D’une certaine façon, l’épistémologie telle que Ferraris la comprends émerge bien avant l’être humain, avant la vie elle-même, avec la différenciation des étants et l’émergence de structures traitant de l’information. Il y a épistémologie en ce sens dès qu’il y a orientation de l’espace et redoublement des processus d’émergence par complexification. Pour Ferraris, cette complexification est le fruit d’une dialectique : l’orientation rend possible une interaction, qui rend possible une fixation (une modification qui transforme les choses en véritable environnement et constitue un véritable couplage entre les individus interagissant), qui rend à son tour possible des affordances (l’environnement devient source de nouvelles possibilités de développements et d’actions pour les individus qui interagissent).
 On pourrait (Ferraris ne le fait pas) considérer l’émergence du vivant à ce prisme : synthèse des monomères (acides aminés, bases organiques) puis des polymères complexes (protéines constituées par accrochage d’acides aminés, acides nucléiques par accrochage de sucres, puis combinaisons des uns et des autres), puis mise en place de la membrane cellulaire qui permet à des structures plus vastes et complexes de se répliquer en utilisant la capacité des acides nucléiques à transporter l’information. L’exemple du vivant est intéressant car il plaide lui aussi pour un infléchissement du récit que propose Ferraris. La vie n’est pas seulement le fuit d’une interaction poursuivie en fixations : elle est fille d’une fixation qui dépasse le strict cadre des individus interagissant et stabilise un environnement passif fait d’autant de déchet que de fonctionnel. La membrane cellulaire permet la séparation d’un intérieur et d’un extérieur mais elle a aussi pour effet d’inclure dans cet intérieur une véritable facticité : des éléments et de la matière qui ne jouent pas un rôle immédiat dans la vie et la reproduction de la cellule, qui auraient été sinon voués à la dissolution rapide, mais constituent une véritable réserve de croissance et d’évolutions ultérieures[9]. Les affordances sont aussi rendues possibles par la stabilisation de l’inerte.
On pourrait (Ferraris ne le fait pas) considérer l’émergence du vivant à ce prisme : synthèse des monomères (acides aminés, bases organiques) puis des polymères complexes (protéines constituées par accrochage d’acides aminés, acides nucléiques par accrochage de sucres, puis combinaisons des uns et des autres), puis mise en place de la membrane cellulaire qui permet à des structures plus vastes et complexes de se répliquer en utilisant la capacité des acides nucléiques à transporter l’information. L’exemple du vivant est intéressant car il plaide lui aussi pour un infléchissement du récit que propose Ferraris. La vie n’est pas seulement le fuit d’une interaction poursuivie en fixations : elle est fille d’une fixation qui dépasse le strict cadre des individus interagissant et stabilise un environnement passif fait d’autant de déchet que de fonctionnel. La membrane cellulaire permet la séparation d’un intérieur et d’un extérieur mais elle a aussi pour effet d’inclure dans cet intérieur une véritable facticité : des éléments et de la matière qui ne jouent pas un rôle immédiat dans la vie et la reproduction de la cellule, qui auraient été sinon voués à la dissolution rapide, mais constituent une véritable réserve de croissance et d’évolutions ultérieures[9]. Les affordances sont aussi rendues possibles par la stabilisation de l’inerte.
Ferraris nomme technologie le caractère des arrangements individuels capables de transmettre l’information et d’assurer l’itération. Ces structures constituent de véritables dispositifs de calcul et d’enregistrement permettant d’exploiter l’information au-delà de ce qui serait permis par les affordances offertes à des individus séparés par leur l’environnement. La technologie n’est pas intentionnelle, construite, elle émerge d’abord par la stabilisation hasardeuse de structures collectives. Nous avons évoqué les cellules : l’auteur donne l’exemple des colonies de termites et d’insectes sociaux capables par agrégation de comportements simples de constituer des structures complexes, relativement évolutives. Ces structures, il faut le souligner, ne fonctionnent cependant pas « efficacement » : la technologie se constitue sur fond de beaucoup de bruit, évolue et se complexifie par la force du bruit et par les accidents.
Pour Ferraris, il n’y a pas de saut qualitatif évident entre les structures technologiques que représentent les colonies d’insectes sociaux et les premières sociétés humaines. Celles-ci se construisent d’abord comme des techniques de la mémoire, constitution d’une mémoire de groupe, inorganique (au sens de Stiegler) par différenciation sociale, transmissions de comportements, de savoir-faire, d’outils. En ce sens, comme nous l’ont appris les anthropologues de l’école de Leroi-Gourhan, le milieu technique devient indissociable du milieu naturel. La capacité à traiter de plus en plus finement l’information nait en quelque sorte de l’information elle-même et les significations pentecôtistes émergent finalement d’une longue histoire technologique.
A son commencement est l’historia, la représentation et le souvenir de l’individu singulier ; à force de répétitions, celle-ci rend possible la sélection du mythos, de l’individu exemplaire considéré comme prototype ou diagramme renvoyant à une classe d’objets, à une idée générale : « l’historia manifeste une ecceité : cette chasse, ce bison, cette pointe de silex. Mais de l’ecceité peut naitre une classe à partir de la logique de l’exemplarité : le bœuf qui est peint ici sert à en trouver d’autres, à les reconnaître lorsqu’on les rencontre, à organiser l’action. »[10] De là se développe peu à peu l’abstraction du logos, par laquelle le signe devient symbole puis idée. Cette émergence de la signification à proprement parler signifie celle de l’épistémologie au sens fort : non plus comme simple processus de traitement de l’information, mais comme mode de rapport aux choses médiatisé par un horizon de vérité. La signification elle-même s’institue peu à peu avec l’invention de l’écriture, son perfectionnement, et tout le processus que Husserl postule à la racine de l’idéalisation.
L’élargissement et la complexification du social orientent le regard vers les formes, les lois de configurations, vers la recherche de ressemblances, de relations, des lois de configurations, et finalement d’identités porteuses de systèmes d’objectivation et de généralisation. L’écriture élargit le champ du rapport à soi au-delà de la mémoire immédiate : elle encourage à la fois l’enrichissement (ce qui est extériorisé n’est pas exactement ce que je voulais dire, je peux dire plus ou mieux) et l’interprétation (ce qui est écrit n’est pas directement exprimé, il doit être re-compris, ré-interprété). L’être humain exposé à la sphère documentale est éduqué (c’est-à-dire dressé) de façon à acquérir des dispositions (propensions à réagir d’une certaine façon). Celles-ci deviennent à leur tout des systèmes de motivation et de justification. Autrement dit, les habitus et disposition qui fondent la culture sont incorporées par l’automatisation et l’observance avant de prendre sens : en termes heideggériens : la Weltgeschichtlichkeit configure notre rapport aux choses avant toute intentionnalité.
Là aussi cependant, le processus de passage de la documentalité à la culture, de l’observance à la responsabilité peut-être raconté de façon plus complexe. Certes, le social est le milieu auquel s’est adapté notre cerveau : l’humain « (…) est une créature premièrement et nécessairement pro-sociale dont le cerveau a été « pré-câblé » pour la vie en société. »[11] Mais cette adaptation est un ajustement, un équilibre précaire, et plus qu’ailleurs encore, l’émergence ne se conçoit pas sans bruit et sans accidents. Cette histoire-là d’ailleurs, la philosophie du XXe siècle n’a cassée de nous la raconter : une humanité fille de l’instabilité, dont la nature serait précisément de se dénaturer sans cesse, dont le propre serait de n’avoir aucun propre et d’avoir toujours alors à réaliser son essence. Avec les mots d’Edgar Morin, « ce sur quoi s’achève l’hominisation, c’est l’inachèvement définitif, radical et créateur de l’homme »[12]. L’homme n’est pas seulement caractérisé par le soumission mais par l’hybris, par la difficulté à distinguer ses représentations internes du réel, à les enchainer de manière ordonnée et cohérente : « (…) c’est sur et à partir du « bruit de fond », c’est-à-dire des « rencontres d’idées, d’images, de souvenirs qui forment le fond de notre vie intérieure et qu’on pourrait appeler le mouvement brownien de la pensée » que se construit le logos (…) sans ce bruit de fond, le logos est un moulin à eau »[13].
IV. L’acte exemplaire et la praxis collective
L’horizon ultime de l’ouvrage est politique : Ferraris reconnaît au moins à la tradition continentale ce mérite de rendre indissociables l’activité philosophique et le projet de transformation du monde. Toutefois, ce projet demande à établir pour cette philosophie de nouvelles bases afin de sortir de son pharisianisme. Enfant (certes ingrat) de la philosophie transcendantale et du constructivisme post-moderne (constructivisme), le philosophe militant contemporain fait passer la transformation du monde par la réforme des systèmes conceptuels, comme si bouleverser les interprétations conduisait nécessairement à bouleverser la réalité. Le post-modernisme attribue une influence exorbitante à nos systèmes conceptuels et sous-estime au contraire la résistance du réel qu’il considère un peu comme une pâte inerte, disponible pour nos mises en forme.
Le but n’est pas de nier l’intérêt d’agir sur les systèmes conceptuels pour influencer le réel : l’épistémologie fait après tout elle-même partie de l’ontologie, et les mots et concepts que nous utilisons pour penser le monde font partie de la réalité de ce monde. Mais il est illusoire de vouloir fonder sur ce principe des projets qui relèvent d’un véritable titanisme politique et prétendent tout transformer et refonder – tout en exerçant le plus souvent une influence au mieux dérisoire. Un projet de transformation politique doit s’appuyer sur la réalité du fonctionnement humain et des fonctionnements sociaux. Cette réalité, la société numérique la met justement mieux que toute technique passée en évidence : le succès du web, des mobiles, des applis, de l’ « ubérisation »[14], nous apprend que sommes moins des êtres libres et révolutionnaires que des êtres mobilisables et disponibles, dont l’essentiel des comportements relève de techniques et de dispositifs de mobilisations qui couvrent d’une manière toujours plus extensive l’ensemble des champs de notre vécu pour nous pousser à agir et à réagir.
En diffusant à tous les secteurs de la vie des dispositifs qui fonctionnement sur le principe de l’alerte et de la réaction instinctive (téléphone, mail, notification, etc.), le numérique a amené à la surface cette vérité cachée de la nature humaine : nous sommes naturellement et spontanément des êtres de réaction, avides d’être activés, programmés, motivés. Contrairement à beaucoup de philosophes et de penseurs, Ferraris ne considère pas sous l’angle de l’aliénation cette augmentation des comportements addictifs. Il serait réducteur de considérer que les réseaux sociaux nous aliènent, que les comportements que nous y développons sont seulement liés à la façon dont les algorithmes sont programmés (pour maximiser notre temps de connexion en exploitant certaines tendances, nous confrontant toujours aux stimuli qui nous font réagi). Par leur facilité à susciter et entretenir des addictions, les réseaux sociaux révèlent notre nature par : le web révèle en les manifestant les structures profondes de la réalité sociale : « la soumission constitue le caractère fondamental de l’humain »[15].
Mais – c’est le message final du livre – en révélant la façon dont nous fonctionnons, le numérique indiquerait aussi comment il est possible de nous changer : « au lieu de nous demander pourquoi nous sommes esclaves, demandons-nous comment il se fait que, dans des circonstances déterminées, nous pouvons agir librement[16] ». Evidemment, ce changement ne peut être que lent, progressif, hasardeux : « il serait absurde de prétendre que la norme serait la révolution[17] ». L’acte qui peut être considéré comme libre est rare : il nait quand quelque chose résiste aux projets et déjoue les automatismes et que nous ne pouvons suivre les voies prétracées. Lorsque nous nous heurtons : « c’est justement de la résistance du réel, de son inamendabilite, que dérive la possibilité de la libération. » Avec Kierkegaard, Ferraris voit l’instant de la décision comme « une folie », parce ce que ce qui la suscite est réel, sérieux. Nous faisons ne faisons l’expérience de la liberté qu’en des moments de crises et c’est bien le réel qui chaque fois les suscite[18].
De cette thèse finalement assez classique qui fait de l’événement et de la perte du monde la condition d’une liberté toujours située[19], Ferraris déduit cependant un projet politique original. L’humanité n’étant que le fantasme que nous en avons, elle dépend des techniques de production de ce fantasme. L’homme nait soumis mais peut s’émanciper à condition d’être éduqué et prédisposé à ce type de liberté, préparé à l’ébranlement, à la crise, cela en étant souvent exposé aux actions exemplaires. Ce n’est ni par la morale ni par l’injonction révolutionnaire mais par l’exemple qu’on peut espérer transformer les hommes. A ce projet dont la résonnance a quelque chose de chrétien (être chrétien, c’est témoigner de ce que veut dire être chrétien, montrer ce que peut-être la vie bonne), les technologies numériques peuvent donner la forme d’un projet politique et anthropologique. Ainsi, l’enjeu n’est plus de prendre position pour ou contre le numérique, ni même pour ou contre ses usages addictifs, mais de s’en saisir pour mobiliser collectivement les humains en vue de l’acte libre. Cela, sans, cependant se faire d’illusion sur les effets transformateurs d’une telle politique et en espérer autre chose que de lentes et incertaines évolutions.
Une telle politique veut trancher avec les grands soirs proclamatifs, avec la complaisance des révolutions par articles et théories interposées. Mais elle risque la même paralysie en cédant à peu près tout aux dispositifs techniques sans craindre (comment le pourrait-elle avec ses prémisses ontologiques) une atomisation et une désymbolisation totales. Indéniablement, elle fait fond sur des tendances structurantes de l’être humain, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne les altère pas ni qu’elle ne compromet en les exacerbant les équilibres fragiles dont dépendent sa capacité à être mobilisé autant qu’à se transformer. Le fond du problème est là encore la distinction abstraite de l’observance et de la liberté dont il faudrait plutôt penser la co-appartenance dialectique dans la praxis : il y a déjà de la marge interprétative dans l’observance, déjà une dimension pentecotiste dans le rite. Le sens n’est certes pas donné mais dessiné en creux, comme sens-qui-se-fait, du fait de la foi même qui nous fait collectivement le postuler et le chercher. Il faut chercher à comprendre pour appliquer les règles, il faut de la réflexivité pour faire vivre l’institution symbolique, il y a – comme le dit Marc Richir – déjà des ferments d’idéalisation dans l’application seule des techniques d’arpentage. L’enregistrement n’est rien sans l’effort vivant, l’agentivité vécue, l’effort au sens de Fichte et Maine de Biran.
Il nous semble pour finir difficile, au nom même de l’action et de l’efficacité, de passer comme semble le faire Ferraris l’institution et le collectif par pertes et profits. Nous avons besoin de donner du sens et de faire vivre le sens pour élargir nos capacités de prise, ménager des espaces de flottement, d’indécision, de possible liberté. En sciences comme en politique, nous avons besoin d’institutions pour nous ouvrir un espace et un temps échappant à la répétition de la vie nue, d’horizons théoriques creusant le virtuel à même l’actuel, fut-ce simplement pour prendre prise sur les choses, élaborer des capacités d’action dignes de ce noms. Nous avons besoin d’horizons collectifs, fédérateurs, appelant un effort dans la durée, un travail, une praxis, et en deçà sans doute, à un même horizon commun de sens. L’histoire de l’émergence ne peut être seulement celle des choses, des individus, des actes exemplaires. Elle doit pouvoir être aussi celle des institutions ouvrant à son tour celle des idées et des œuvres, de toutes les médiations susceptibles de potentialiser le virtuel.
[1] Chris Anderson, « La fin de la théorie. Le déluge de data rend la méthode scientifique obsolète », tr.fr. Pierre-Emmanuel Dauzat, Le Débat, no 207, 2019.
[2] Bernard Stiegler, De la misère symbolique, Paris, Flammarion, 2013.
[3] L’argument de la méta-induction pessimiste est plus radical encore. Comme l’explique Michael Esfeld : « Le pessimiste prend les théories que l’histoire des sciences nous présente comme des cas individuels. Il applique à ces cas la méthode de l’induction, effectuant ainsi une sorte de méta-induction : ici l’induction ne concerne pas des phénomènes dans le monde, mais des théories scientifiques. […] Comme un grand nombre de théories que nous a présentées l’histoire des sciences se sont révélées fausses, le pessimiste conclut à la règle générale que les théories scientifiques sont fausses. Sur cette base, il fait la prédiction que les théories dont nous supposons aujourd’hui la vérité se montreront fausses dans l’avenir. » (Michael Esfeld, Philosophie des sciences : une introduction, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009, p. 6.)
[4] Maurizio Ferraris, Emergence, Paris, Le Cerf, 2018.
[5] L’exemple pose beaucoup de questions. La description des premiers instants de l’univers est essentiellement une construction théorique à partir de laquelle il est particulièrement difficile d’isoler des individus au sens où Ferraris l’entend. Les objets manipulés par la théorie sont abstraits. En revanche, le statut des lois physiques lors de ces premiers instants pourrait être interprété dans le sens de Ferraris, c’est-à-dire d’une émergence et d’une détermination progressive.
[6] Friedrich Schelling, Introduction à l’Esquisse d’un système de philosophie de la nature, Paris, Le Livre de Poche, 2001, p. 89-90 ; voir aussi Die Weltalter. Fragmente. In den Urfassungen von 1811 und 1813, Friedrich Wilhelm Joseph (von) Schelling sämtliche Werke, Manfred Schröter (hrsg.), München, CH. Beck, 1917 (1993), Nachlassband ; Les Âges du monde, tr.fr. Pascal David, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
[7] Ferraris accepte une certaine proximité avec Deleuze, tout en revendiquant un émergentisme moins prolixe et foisonnant. Typiquement, le mot virtuel n’apparait pas dans son ouvrage.
[8] Maurizio Ferraris, Emergence, op.cit., p. 66.
[9] La théorie des spandrels, des trompes, le théorise en quelque sorte explicitement. Cf. Stephen Jay Gould et Richard Lewontin, « The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme » , Proceedings of the Royal Society of London, vol. 205, no 1161, 1979, p. 581-598 ; Stephen Jay Gould & Richard Lewontin, « L’adaptation biologique : les trompes de l’églises San Marco et le paradigme panglossien », La Recherche, 13(139), 1982, p. 1494-1502.
[10] Maurizio Ferraris, Emergence, op.cit., p. 93.
[11] Laurence Kaufmann et Laurent Cordonier, « Vers un naturalisme social », SociologieS, Débats, Le naturalisme social, mis en ligne le 18 octobre 2011.
[12] Edgar Morin, Le paradigme perdu, Paris, Seuil, 1973, p. 105.
[13] Edgar Morin, ibid., p. 135.
[14] Florian Forestier (dir), Désubériser. Reprendre le contrôle, Paris, Editions du Faubourg, 2020.
[15] Maurizio Ferraris, Emergence, op.cit., p. 148.
[16] Ibid., p. 161.
[17] Ibid., p. 158.
[18] A l’opposé de la lecture que fait Derrida, « Donner la mort », in Jean-Michel Rabaté, Michael Wetzel, L’éthique du don. Jacques Derrida et la pensée du don, Paris, Métailié Transition, 1992, p. 70 : « Ce qui me lie à des singularités, à tel ou à telle plutôt qu’à telle ou tel, cela reste finalement injustifiable (c’est le sacrifice hyper-éthique d’Abraham), pas plus que n’est justifiable le sacrifice infini que je fais ainsi à chaque instant. Ces singularités sont des autres, une tout autre forme d’altérité : une ou des autres personnes, mais aussi bien des lieux, des animaux, des langues. Comment justifierez-vous jamais le sacrifice de tous les chats du monde au chat que vous nourrissez chez vous tous les jours pendant des années, alors que d’autres chats meurent de faim à chaque instant ? Et d’autres hommes ? ».
[19] Avec bien des nuances, c’est la position de Badiou, de Zizek, et de nombreux autres.