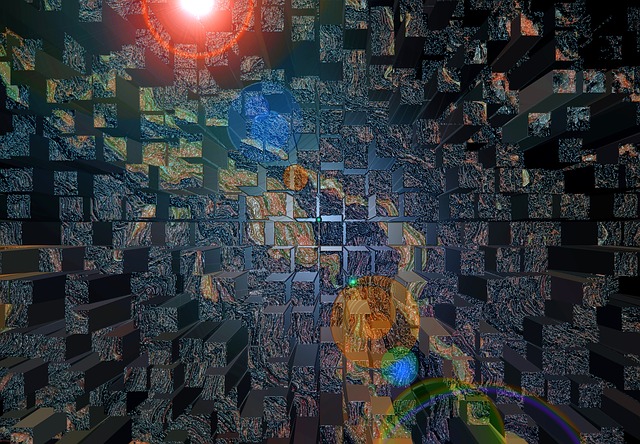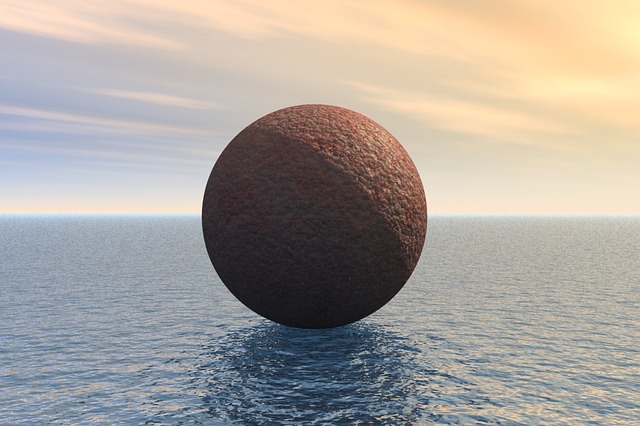Éthique pratique et expérience : le cas de la neuroéthique
Bernard Baertschi – Institut d’Ethique Médicale, Université de Genève
Résumé : Dans la philosophie morale, les philosophes ont soutenu deux positions antagonistes sur la nature des décisions et des jugements moraux. Pour les rationalistes, il s’agit d’activités rationnelles de part en part, alors que pour les empiristes et les sentimentalistes, elles sont ancrées dans notre vie affective (nos émotions). Récemment, des neuroscientifiques ont affirmé que les expériences qu’ils ont menées font pencher la balance en faveur du sentimentalisme et certains d’entre eux, comme Joshua Greene, ont même ajouté qu’elles constituent des preuves de la vérité de l’utilitarisme et de la fausseté du déontologisme. Dans ce texte, j’examine la thèse de Greene et conclut qu’il n’est pas possible de donner un tel poids à l’expérimentation : les arguments conceptuels et normatifs ne peuvent ainsi être mis de côté, même s’ils doivent s’appuyer sur l’expérience.
Abstract: In moral philosophy, philosophers have defended two main conflicting views concerning the nature of moral judgment and decisions. For rationalists, they are completely rational activities, whereas for empiricists or sentimentalists, they are anchored in our affective life (our emotions). Recently, neuroscientists have claimed that their experiments tip the balance in favor of sentimentalists and some of them, like Joshua Greene, have added that they could even constitute evidence for utilitarianism and against deontology. In this text, I examine Greene’s thesis and concludes that we cannot give experiments such a decisive function: conceptual and normative arguments cannot be put aside, even though they should lean on experience.
Les philosophes sont connus pour la grande confiance qu’ils accordent à la raison. Chez certains, cela s’accompagne d’un dédain pour l’expérience en tant que source fiable de connaissance. Historiquement, on connaît le débat qui, à l’époque Moderne, a opposé les rationalistes et les empiristes. Ce n’est pas que les premiers aient jugé que la philosophie pouvait se passer de toute expérience, mais celle-ci ne venait qu’après que la raison avait construit a priori le système de la connaissance. Pour eux, l’expérience était le domaine de l’application et servait au mieux à des vérifications empiriques ou à affiner les détails de la théorie au vu d’un monde qui manifestait quelques résistances à l’ordre rationnel. Ainsi Descartes, dans la dernière partie du Discours de la méthode, constate : « Je remarquais, touchant les expériences, qu’elles sont d’autant plus nécessaires qu’on est plus avancé en connaissance », alors que, jusque-là, il estime avoir découvert les premières causes à partir « de certaines semences de vérités qui sont naturellement en nos âmes[1] ».
Le cas de Descartes est intéressant en ce que sa philosophie s’appuie sur le cogito, c’est-à-dire sur quelque chose qu’on considérerait volontiers comme une expérience de soi-même par la conscience : Je pense, donc je suis. C’est d’ailleurs ainsi que Maine de Biran, au début du XIXe siècle, le comprendra, substituant à l’expérience de la pensée celle du mouvement corporel, la conscience d’exister surgissant de l’expérience de la résistance musculaire dans l’effort volontaire[2]. Mais Biran était un empiriste ; les rationalistes, eux, ont préféré à l’instar de Husserl considérer le cogito comme une expérience transcendantale[3], l’adjectif vidant le substantif de sa signification habituelle.
En éthique et en philosophie morale, le rationalisme s’est généralement accompagné d’une profonde méfiance envers le côté affectif et émotionnel de la nature humaine. Kant est exemplaire de cette attitude, lorsqu’il affirme :
Il ne faut pas du tout se mettre en tête de vouloir dériver la réalité du principe [moral] à partir de la constitution particulière de la nature humaine. […] Ce qui est dérivé de la disposition naturelle propre de l’humanité, ce qui est dérivé de certains sentiments et de certains penchants, […] tout cela peut bien nous fournir une maxime à notre usage mais non une loi, un principe subjectif selon lequel nous pouvons agir par penchant et inclination, non un principe objectif d’après lequel nous aurions l’ordre d’agir, alors même que tous nos penchants, nos inclinations et les dispositions de notre nature y seraient contraires[4].
Les inclinations, c’est-à-dire les désirs, ou les penchants ne peuvent être ni une source de connaissance morale – l’impératif catégorique n’en dérive pas et ne pourrait le faire, puisqu’il est a priori – ni une source de vertu : suivre ses inclinations et ses penchants constitue le contraire même de la morale. Toutefois, ici aussi, l’expérience intervient après coup, car l’éthique s’applique à cette partie de la réalité qu’est notre comportement et doit régler des cas particuliers. D’où les « Questions casuistiques » que Kant aborde à de nombreuses reprises dans la Doctrine de la vertu, telle la suivante :
Dois-je, si je dis une contre-vérité, supporter toutes les conséquences qui peuvent en découler ? Par exemple un maître a ordonné à son domestique de répondre à une certaine personne qu’il n’était pas là. Le domestique obéit, mais par là permet à son maître de s’échapper et de commettre un grand crime[5].
L’éthique des empiristes donne évidemment un autre rôle à l’expérience et corrélativement à notre vie affective et émotionnelle. On connaît cette célèbre affirmation de Hume : « La raison est et ne peut qu’être l’esclave des passions et elle ne peut jamais prétendre à une autre fonction que celle de servir les passions et de leur obéir[6] ». Dans cette approche, la casuistique passe volontiers au premier plan et l’éthique qui s’en occupe n’est plus une éthique appliquée, mais une éthique pratique : il ne s’agit pas en effet de partir de principes rationnels et de les appliquer à une réalité forcément un peu réfractaire, mais de formuler des règles de conduite toujours provisoires qui sont des généralisations empiriques à partir de multiples cas. La vie affective est aussi réhabilitée. Ainsi Aristote considère qu’il n’est pas possible d’être vertueux si l’on n’éprouve pas des émotions appropriées :
Dans la crainte, l’audace, l’appétit, la colère, la pitié, et en général dans tout sentiment de plaisir et de peine, on rencontre du trop et du trop peu, lesquels ne sont bons ni l’un ni l’autre ; au contraire, ressentir ces émotions au moment opportun, dans les cas et à l’égard des personnes qui conviennent, pour les raisons et de la façon qu’il faut, c’est demeurer dans une excellente moyenne, et c’est là le propre de la vertu[7].
Les neurosciences actuelles sont des sciences empiriques, par définition. Mais elles sont aussi empiriques au sens philosophique en ce qu’elles accordent à notre vie affective – à nos émotions, comme on dit volontiers de nos jours – un rôle fondateur en morale. Cela est vrai tant au niveau de la décision qu’au niveau de la théorie. Dans L’erreur de Descartes, Antonio Damasio a montré que les personnes ayant subi une lésion dans le cortex préfrontal ventromédian développaient une sociopathie résultant de leur incapacité à mobiliser leurs émotions lorsqu’ils devaient prendre une décision morale ou rationnelle[8]. Jonathan Haidt a même soutenu que la plupart des décisions morales que nous prenons ne sont pas consécutives à une délibération rationnelle, mais font suite à une intuition rapide, généralement émotionnellement chargée, et que nous inventons après coup des raisons d’avoir décidé comme nous l’avons fait, lorsqu’on nous les demande ou que nous cherchons à nous expliquer, voire à nous justifier[9].
Joshua Greene, neuropsychologue mais philosophe de formation, défend lui aussi une conception empiriste ou sentimentaliste de la décision morale. Il estime que, quand nous prenons une décision, nous pouvons le faire de deux manières différentes : tantôt sur la base d’une intuition rapide, tantôt sur la base d’une évaluation rationnelle des biens en présence. C’est ce qu’on appelle le modèle duel de la cognition morale. Toutefois, l’existence de cette évaluation rationnelle n’est en aucun cas une réhabilitation, ne serait-ce que partielle, du rationalisme, car elle repose elle aussi sur des émotions, mais différentes de celles qui sont mobilisées avec nos intuitions :
Je n’affirme pas que le jugement [rationnel] est dépourvu d’émotion. Au contraire, j’incline à être d’accord avec Hume que tout jugement moral doit posséder quelque composante affective, et je suspecte que la pesée [rationnelle] des dommages et des bénéfices est un processus émotionnel[10].
La position de Greene ne se limite pas à une théorie neuropsychologique de la décision, mais se développe en une conception générale de la normativité en philosophie morale. En effet, il utilise les mêmes expériences qui lui ont permis de développer et d’illustrer le modèle duel comme pierre de touche pour départager les deux principales doctrines normatives défendues de nos jours : le déontologisme et l’utilitarisme. Son approche est donc particulièrement intéressante pour déterminer le rôle de l’expérience en éthique pratique.
Le déontologisme soutient qu’une action est moralement bonne si et seulement si elle est conforme à une norme, devoir ou droit. Pensons aux Dix commandements ou à l’impératif catégorique de Kant, qui interdit de traiter une personne humaine comme une chose ou un objet, c’est-à-dire de l’instrumentaliser. Ainsi, par exemple, l’esclavage se trouve ipso facto condamné, même s’il est avantageux pour certains voire pour la société.
L’utilitarisme est une forme de conséquentialisme, c’est-à-dire qu’il affirme qu’une action est bonne si et seulement si ses conséquences le sont – Greene utilise souvent indifféremment les deux termes. Ainsi, on pourrait imaginer des situations où l’esclavage serait moralement justifié – imaginer, car à la réflexion, le conséquentialisme pense qu’aucune ne peut se rencontrer dans la réalité. Ce qui permet de juger la bonté des conséquences pour l’utilitarisme, c’est le critère du bien-être ou de la satisfaction des préférences. Ainsi, une action est bonne si elle maximise le bien-être dans ses conséquences prévisibles[11].
Selon Greene, l’étude expérimentale des dilemmes moraux montre que l’utilitarisme est une théorie morale plus adéquate que le déontologisme. Il l’établit en contrastant deux variantes du dilemme du wagon fou. Dans la variante de l’aiguillage, un wagon hors de contrôle dévale une pente et va écraser cinq ouvriers qui travaillent plus bas sur la voie. Toutefois, on peut actionner un aiguillage qui fera dévier le wagon sur une autre voie, où un seul ouvrier se trouve. Ainsi, si l’aiguillage est actionné, une seule personne mourra au lieu de cinq. On pose alors la question suivante aux personnes à qui on a raconté cette histoire : est-il selon vous moralement permis d’actionner l’aiguillage ? La grande majorité (environ 90%) répond par l’affirmative. Dans la variante de la passerelle, un wagon menace aussi d’écraser cinq ouvriers, mais il n’y a pas d’aiguillage. Cependant une passerelle enjambe la voie, sur laquelle se trouve un très gros homme. Si ce dernier tombe sur la voie, il sera tué, mais son corps arrêtera le wagon et les cinq ouvriers seront épargnés. On demande alors : est-il selon vous moralement permis de pousser le gros homme sur la voie ? Ici, la majorité s’inverse dans la même proportion : près de 90% rejettent l’idée, bien que le résultat soit rigoureusement le même.
Greene est le premier à conduire l’expérience en plaçant les personnes questionnées dans un scanner à résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf) afin d’observer ce qui se passe dans leur cerveau. Il remarque que ce ne sont pas les mêmes zones qui réagissent le plus fortement. En effet, dans la variante de la passerelle, les zones émotionnelles sont bien plus activées que dans celle de l’aiguillage. Il en tire la conclusion suivante :
Nous faisons l’hypothèse que la pensée de causer la mort de quelqu’un en le poussant personnellement (comme dans la variante de la passerelle) est plus forte émotionnellement que la pensée de causer les mêmes conséquences de manière plus impersonnelle (par exemple en manipulant un aiguillage, comme dans la variante de l’aiguillage) […]. Les personnes tendent vers le conséquentialisme dans les cas où la réponse émotionnelle est faible, et tendent vers le déontologisme dans les cas où la réponse émotionnelle est forte[12].
Ainsi, nous sommes tous tantôt déontologistes, tantôt conséquentialistes ; nous plaçons notre comportement tantôt sous la férule de commandements et d’interdits absolus, lorsque notre réponse émotionnelle est forte, tantôt sous l’égide de l’évaluation des conséquences de nos actes, lorsque notre réponse émotionnelle est faible – ce disant et de manière tout à fait paradoxale Greene range le déontologisme, et donc Kant, du côté de l’irrationel ! Nous possédons donc des ressources morales duelles, que nous mobilisons tour à tour. Ce « cablage » moral a cependant quelque chose d’insatisfaisant, puisqu’il nous fait réagir de manière opposée à des situations équivalentes d’un point de vue éthique, comme le dilemme du wagon fou le montre. En sommes-nous prisonniers et cette forme d’irrationalité est-elle notre destin ? Non, car il nous est loisible de faire preuve de plus de rationalité, c’est-à-dire de devenir plus utilitaristes ou plus conséquentialistes. C’est-là une attitude que nous pouvons décider d’adopter, sinon en faisant taire nos émotions d’alarme, du moins en ne les écoutant pas, bref en ne leur conférant pas de poids moral.
Cette attitude doit être encouragée, car les réactions émotionnelles d’alarme sont évolutionnairement archaïques et donc mal adaptées à notre situation présente :
La tension entre les perspectives utilitaristes et déontologistes en philosophie morale reflète une tension plus fondamentale qui vient de la structure du cerveau humain. Les réponses socio-émotionnelles que nous avons héritées de nos ancêtres primates (dues sans doute à quelque avantage d’adaptation qu’elles conféraient), structurées et affinées par la culture, sous-tendent les interdictions absolues qui sont centrales au déontologisme. Par contraste, le “calcul moral” qui définit l’utilitarisme est rendu possible par des structures apparues plus récemment dans les lobes frontaux, soutenant la pensée abstraite et le contrôle cognitif de haut niveau[13].
On pourrait objecter à ce raisonnement qu’il saute une étape, en ce qu’il ne montre aucunement que ce qui est archaïque est moralement inadéquat. Greene en est conscient, c’est pourquoi il soutient aussi que ce qui est archaïque nous rend sensibles ici à des facteurs qui ne sont actuellement plus pertinents. Ainsi que le relève Frances Kamm :
Il semble clair que causer un dommage à quelqu’un [un gros homme] de manière immédiate par un contact physique ou par le biais de moyens mécaniques [actionner un aiguillage] n’est moralement pas pertinent. C’est pourquoi, dit Greene, les tentatives des philosophes déontologistes pour justifier leur interdit en faisant appel à d’autres facteurs apparemment pertinents ne sont que pures “confabulations” ou rationalisations[14].
Et ici, Greene rejoint Haidt : nous inventons nos raisons morales après coup.
Ainsi, pour Greene, il se peut que dans la morale – ou proto-morale – de nos lointains ancêtres, l’action par contact physique immédiat avait des caractéristiques qui la rendaient moralement importante, mais ce n’est plus du tout le cas actuellement, où l’action « à distance » et les longues chaînes causales accompagnées de transmission de responsabilité jouent un rôle prépondérant. Qui pourrait le nier ?
Voilà l’argument de Greene. Pour mon propos, il soulève les deux questions suivantes : quel rôle l’expérience joue-t-elle exactement dans son argument et quel en est l’impact philosophique précis ?
Quel rôle l’expérience joue-t-elle ? La question est en fait complexe. En effet, le dilemme du wagon fou vient de plus loin que la neuroéthique : il a été inventé en tant qu’expérience de pensée en 1967, par Philippa Foot dans sa discussion conceptuelle et normative de l’avortement[15]. Greene, ainsi que Marc Hauser, l’ont récemment placé sur le plan empirique, le second en le soumettant à la sagacité des internautes[16]. Autrement dit, l’expérience a joué trois rôles : expérience de pensée (Foot), questionnaire proposé aux internautes (Hauser) et examen cérébral par IRMf (Greene). Le premier est classique en philosophie, entreprise éminemment conceptuelle, et il n’a rien à voir avec l’expérimental pratiqué par la philosophie de ce nom ; les deux autres, par contre, marquent sa spécificité : chaque fois, une étude est montée selon les canons de la science, même si c’est avec des moyens différents. Il faut toutefois noter que la nouveauté est relative, en ce que l’éthique pratique, et singulièrement la bioéthique, s’appuie depuis qu’elle existe sur des éléments empiriques. Pensons aux cas et aux vignettes, présentant des situations, fictives parfois, mais aussi réelles, soumises à la sagacité des soignants et des bioéthiciens et aux enquêtes d’opinion en politique de santé. La casuistique encore, dès son origine, s’est intéressée aux cas et proposait ce qu’on appellerait aujourd’hui des vignettes ; mais il est vrai qu’il s’agissait souvent d’expériences de pensée.
Greene accorde à l’expérience qu’il a menée une très grande portée théorique, on l’a vu. Mais son étude a-t-elle réellement un tel impact ? Pour le déterminer, il me faut d’abord examiner de plus près la structure de son argument. On peut le reconstruire ainsi :
1. Observation psychologique : les sujets donnent des réponses à première vue incompatibles aux deux variantes du dilemme du wagon fou.
2. Observation neuroscientifique : l’imagerie cérébrale révèle que différentes régions du cerveau sont activées dans les deux cas.
3. Théorie neuropsychologique : les réactions cérébrales correspondent à différentes émotions : des émotions raisonnées (aiguillage) et des émotions d’alarme (passerelle).
4. Interprétation neuroéthique : les émotions d’alarme sont liées aux réponses déontologiques, alors que les émotions raisonnées le sont aux réponses utilitaristes.
5. Théorie évolutionnaire : les émotions d’alarme sont archaïques et mal appropriées comme base de décision dans notre monde contemporain.
6. Conclusion éthique : par conséquent, l’utilitarisme est plus approprié que le déontologisme pour guider nos décisions et contrôler notre comportement.
Comme on le voit, ce raisonnement fait appel à ne nombreuses considérations empiriques et théoriques, tant scientifiques que philosophiques. C’est tout à fait classique, sauf que, comme je l’ai dit, l’expérience invoquée est menée selon les canons de la science actuelle, ce qui était rarement le cas par le passé, où les considérations empiriques des philosophes n’étaient souvent que l’expression d’intuitions personnelles ou d’observations spontanées faites dans un cercle restreint (la famille ou le milieu social)[17]. Cela dit, l’étude menée par Greene donne-t-elle une force de preuve à l’argument qu’il présente ? Il est facile de montrer que ce n’est pas le cas, même si je n’ai pas la place d’entrer ici dans une discussion détaillée de ce point[18].
Prenons d’abord l’expérience elle-même. Dans la variante de l’aiguillage, près de 90% des personnes interrogées pensent qu’il est permis de l’actionner. Il y a donc près de 10% d’entre elles qui estiment que ce n’est pas le cas. C’est une petite minorité. Mais qu’est-ce qui permet de dire qu’elle a tort ? Somme toute, agir moralement est quelque chose qui demande un effort, une lutte contre ses penchants spontanés – c’est du moins ce que l’on pensera si l’on est kantien. La présomption de vérité ne serait-elle alors pas en faveur plutôt de la minorité ? Par ailleurs, ce qui compte en éthique, ce sont autant les raisons que les décisions ; quelles sont les raisons alléguées par les deux camps ? La question n’a pas été posée par Greene. Cela pourrait paraître très surprenant, mais il faut se rappeler que cet auteur estime que, souvent, nous inventons nos raisons après coup. Ainsi, elles ne sont pas vraiment fiables et ne sauraient éclairer les réponses. Cette thèse aussi peut être contestée, et l’a d’ailleurs été[19].
L’interprétation de Greene a aussi été mise en question, sur plusieurs plans. Sur le plan empirique, on a observé que les psychopathes considéraient comme plus permis de pousser le gros homme[20]. Ils seraient donc plus utilitaristes et, par conséquent, de meilleurs décideurs moraux que les autres êtres humains. Étant donné la manière dont ils se comportent, cela paraît hautement improbable. Sur le plan philosophique ensuite : Greene présente le déontologiste kantien de manière assez étrange : il serait comme pris de panique morale à l’idée de certaines transgression et se réfugierait dans des interdictions absolues motivées par son état émotionnel. Certes, nous sommes tous des kantiens dans une certaine mesure, vu le système duel de décision, mais le kantien « professionnel » élèverait cette réaction viscérale au rang de vérité éthique, à l’exclusion de toute autre considération. Enfin, on peut contester que la diversité des réactions dans les deux variantes du dilemme ne puisse être justifiée moralement : en effet, on peut y pointer des différences qui semblent moralement pertinentes, notamment le fait que dans la passerelle on utilise un gros homme comme moyen pour sauver des vies, ce qui n’est pas le cas dans l’aiguillage. Cela a donné lieu à de longs débats, étayés par de nouvelles expériences sur des variantes assez subtiles du dilemme du wagon fou[21].
Ainsi, si l’expérience est fort utile en éthique et si l’expérimentation en est un prolongement bienvenu, elle ne saurait constituer la pierre de touche qui permet de décider de débats conceptuels et normatifs de la même manière qu’elle peut le faire en science. Les philosophes, surtout lorsqu’ils veulent avoir du mordant sur la réalité, comme c’est le cas en éthique, ont d’ailleurs toujours recouru à des données empiriques ou qu’ils croyaient telles. Ce que la neuroéthique ajoute, dans le sillage de la philosophie expérimentale, c’est une rigueur de type scientifique dans la conduite des expériences : il s’agit de s’appuyer sur des études menées selon le canon de la méthode expérimentale. D’où l’importance des neurosciences. Il y a là, à mon sens, un progrès substantiel. En effet, je l’ai déjà dit, jusqu’à présent les philosophes s’appuyaient surtout sur les intuitions dominantes – les leurs et celles de leur milieu –, sans les soumettre à un examen autre que conceptuel. Parfois jusqu’à la caricature comme le souligne Guy Kahane : « Bien que les éthiciens ignorent de manière significative les intuitions qu’ils ne partagent pas, il suffit que certaines intuitions bizarres soient partagées par plusieurs éthiciens influents pour qu’elles dominent les débats un certain temps[22] ». Cela est en train de changer, et c’est une très bonne chose.
[1]. Discours de la méthode, in Œuvres philosophiques, éd. F. Alquié, 1963, t. I, p. 635-636.
[2]. Voir par exemple Mémoire sur la décomposition de la pensée, in Œuvres, éd. F. Azouvi, t. III, Paris, Vrin, 1988, section II, chap. V.
[3]. Voir E. Husserl, Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, 1969.
[4]. E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Vrin, 1980, p. 100-101.
[5]. Métaphysique des mœurs. Doctrine de la vertu, Paris, Vrin, 1985, p. 106.
[6]. D. Hume, Traité de la nature humaine, livre II, p. 148, accessible à : http ://classiques.uqac.ca/classiques/Hume_david/traite_nature_hum_t2/hume_traite_nature_hum_t2.pdf.
[7]. Aristote, Éthique à Nicomaque, p. 104-105. Je souligne.
[8]. A. Damasio, L’erreur de Descartes, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 27.
[9]. J. Haidt, The Emotional Dog and its Rational Tail : A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment, Psychological Review, vol. 108, 2001.
[10]. J. Greene, The Secret Joke of Kant’s Soul , in W. Sinnott-Armstrong, Moral Psychology, Cambridge MA, MIT Press, vol 3, 2008, p. 64.
[11]. Pour ces théories, voir par exemple mon livre La valeur de la vie humaine et l’intégrité de la personne, Paris, PUF, 1995, chap. 1 et 2.
[12]. J. Greene, The Secret Joke of Kant’s Soul, op. cit., p. 43.
[13]. J. Greene et al., The Neural Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment, Neuron, vol. 44, 2004, p. 398.
[14]. F. Kamm, Neuroscience and Moral Reasoning : A Note on Recent Research, Philosophy and Public Affairs, vol. 37, 2009, p. 334.
[15]. P. Foot, The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, in Virtues and Vices, Oxford, Blackwell, 1978.
[16]. M. Hauser et al., A Dissociation Between Moral Judgments and Justification, Mind and Language, vol. 22, 2007.
[17]. Cf. F. Cova, Qu’en pensez-vous ? Introduction à la philosophie expérimentale, Paris, Germina, 2011, p. 14. Dans le même esprit, Ruwen Ogien mentionne que les philosophes expérimentaux « remettent en cause le privilège que se donnent certains philosophes de penser qu’ils en savent plus que tout le monde sur ces concepts, sans avoir fait l’effort d’aller voir. » (L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, Paris, Grasset, 2011, p. 242)
[18]. Je l’ai fait ailleurs, dans mon livre L’éthique à l’écoute des neurosciences, Paris, Les Belles Lettres, 2013, chap. 1 et 2.
[19]. Par exemple par Gerd Gigerenzer, dans Moral Intuitions = Fast and Frugal Heuristics? , in W. Sinnott-Armstrong (éd.), Moral Psychology, Cambridge MA, MIT Press, vol 2, 2008.
[20]. M. Koenigs & al., Damage to the Prefrontal Cortex Increases Utilitarian Moral Judgements, Nature, vol. 446, 2007.
[21]. Je les ai présentés dans L’éthique à l’écoute des neurosciences, op. cit. Voir aussi S. Berker, The Normative Insignificance of Neuroscience, Philosophy and Public Affairs, vol. 37, 2009.
[22]. The Armchair and the Trolley, Philosophical Studies, vol. 162, 2013, p. 435.