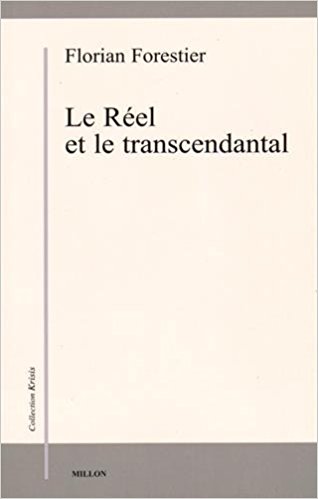Entretien. Florian Forestier, Le Réel et le Transcendantal (2/2).
Voici la deuxième partie de l’entretien d’Étienne Besse avec Florian Forestier, au sujet de l’ouvrage de ce dernier, Le réel et le transcendantal.
Etienne Besse : L’enjeu de ton livre est de « trouver une optique transcendantale qui fixe le cadre phénoménologique. » Quelle serait la différence de l’optique avec l’enquête critique ou le système ? Peut-on dire que Richir propose une « optique » ou bien une sorte de cartographie des niveaux descriptifs ? Comment cette optique peut en même temps rendre compte en phénoménologie d’un langage et de ses montages qui se déprennent systématiquement ? Est-ce que l’optique veut indiquer les zones friables uniquement ?
 Florian Forestier : C’est moi qui utilise les mots optiques, disposition, etc., envers lesquels Richir aurait été pour le moins méfiant. Je le fais pour souligner l’importance de l’attitude phénoménologique : s’il y a quelque chose que Richir reprend de Husserl et surtout de Fink, c’est bien cela, et la question de la « conversion de regard » est totalement centrale chez lui – même si elle ne se fait pas selon les mêmes modalités et ne conduit pas aux mêmes effets que chez Fink. Sinon, Richir met bien en place un système – au sens ou ses différents éléments ont sens par leur totalité, les uns relativement aux autres, mais c’est un système au sens kantien plus qu’hégélien. Il encadre, guide, ajuste le mouvement de la phénoménologie. Il s’exprime principalement à travers une architectonique, plutôt qu’une cartographie.
Florian Forestier : C’est moi qui utilise les mots optiques, disposition, etc., envers lesquels Richir aurait été pour le moins méfiant. Je le fais pour souligner l’importance de l’attitude phénoménologique : s’il y a quelque chose que Richir reprend de Husserl et surtout de Fink, c’est bien cela, et la question de la « conversion de regard » est totalement centrale chez lui – même si elle ne se fait pas selon les mêmes modalités et ne conduit pas aux mêmes effets que chez Fink. Sinon, Richir met bien en place un système – au sens ou ses différents éléments ont sens par leur totalité, les uns relativement aux autres, mais c’est un système au sens kantien plus qu’hégélien. Il encadre, guide, ajuste le mouvement de la phénoménologie. Il s’exprime principalement à travers une architectonique, plutôt qu’une cartographie.
Etienne Besse : Nous allons à présent procéder si tu le veux bien à la lecture de quelques passages de ton travail dont je souhaiterai quelques commentaires ou précisions de ta part :
Nous lisons à partir de la page 33 que « l’intentionnalité est un outil plastique, caractérisant une certaine structure de vécu que l’on peut d’ailleurs extrapoler au-delà de l’humanité. L’objectivité peut être visée en deux sens, selon qu’on la considère dans sa concrétude ou sa généricité. La perspective transcendantale est donc d’articuler les deux (…) notre objectif est d’examiner les conditions de la double thématique de l’eidétique et de la structure de l’en-tant-que, capitales pour la détermination ultérieure du concept de phénomène, et, tout autant, de l’idée de phénoménologie. (p. 35) (…) l’objet tombe radicalement en dehors de la conscience. Il y a bien en ce sens réalisme, dans la mesure où l’objet est radicalement transcendant à la conscience qui le vise, et où sa consistance propre est indépendante de l’acte noétique l’appréhendant. La seule question phénoménologiquement valable est alors celle des conditions d’accès à ces objets, et plus précisément, les conditions auxquelles ceux-ci peuvent « fonder » une connaissance. » (p. 37).
Avec le recul et à partir de ces éléments, comment considères-tu avoir atteint dans ton travail en phénoménologie ces conditions d’une articulation entre concrétude et généricité ?
Florian Forestier : Ils le sont formellement. Ensuite, tout cela mériterait certainement d’être repris autrement, dans un ouvrage plus unitaire, qui déploie la question pour elle-même plutôt que d’en chercher des jalons chez Kant, Fichte, Husserl, Heidegger, Derrida ou Richir. J’aimerais en tout cas donner une autre présentation à tout cela : à la fois plus systématique et plus simple, moins ancrée dans la langue phénoménologique aussi, peut-être parce que cette langue déjà, par elle-même, risque d’orienter et de déformer la problématique que j’aimerais reprendre comme telle.
Maintenant, concrètement, les deux points que tu cites sont quand même très liés à des éléments de discussions canoniques de la pensée de Husserl. Le premier reprend la vieille question du noème qui ne brûle pas, mais je n’ai jamais vraiment compris le débat autour de cela. Le noème de l’arbre n’est pas l’arbre comme je le vois. Or, ce que je vois, c’est bien l’arbre réel. A la limite, le noème, c’est la façon dont la réalité de l’arbre s’impose à moi. Est-ce que l’arbre réel tombe hors de la conscience ? La question n’a pas vraiment de sens : il est perçu comme tel, cela fait partie de la façon dont je le vois que de le voir comme quelque chose qui n’est pas une simple représentation. Réciproquement, je ne peux pas voir l’arbre réel autrement qu’en le voyant. Tout cela est compliqué parce que le concept de noème (ou de forme noématique) rassemble plusieurs choses : l’idée du phénomène de l’arbre, de l’arbre en tant que je le vois, mais aussi, l’idée de la forme de cette objectivité, de l’arbre en tant qu’il est un certain type d’objet (engendre un certain nombre d’anticipations, je le regarde « comme un arbre), et en deçà, pour Husserl, relève d’un domaine (les objets extérieurs se donnant de façon spatiale, obéissant à la causalité, à l’action réciproque). S’il y a quelque chose d’intéressant dans ce concept, c’est vraiment sur fond de cette structuration des formes objectives de leur légitimation phénoménologique (le temps, etc.). En déplaçant cette problématique vers la métaphysique (l’arbre est-il vraiment dehors ?) ou vers la psychologie (le jeu des schèmes perceptifs, des jugements, etc.), on perd ce fil de l’élucidation des grands domaines d’objets, des grandes régions de l’être.
De même, pour l’eidétique, qui est aussi une problématique très située, très husserlienne, que je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de reprendre comme tel. Encore une fois, il est très intéressant de comprendre ce que Husserl a voulu faire avec le concept d’essence et l’eidétique, et aussi de comprendre ce qui a permis à Merleau-Ponty de le déplacer, et à Richir de reprendre autrement le déplacement merleau-pontien. Cela étant : l’usage que Richir fait du terme essence implique-t-il réellement qu’on appelle encore ce dont il parle « essences » ? En quel sens ? Cela ne prend sens que sur fond de descriptions concrètes, en tout cas. En ce qui me concerne, ma méthode était de montrer de l’intérieur de la pensée husserlienne la possibilité d’un certain nombre d’évolutions ou de reprises. Je ne suis pas sûr que le point de départ husserlien soit à chaque fois nécessaire (sinon à titre d’exercice spirituel) pour accéder à ces perspectives.
Etienne Besse : À la lecture des pages 65-66, peut-on dire que Husserl cherche l’apodictique dans sa description phénoménologique par réduction du contingent et soustraction selon l’ego transcendantal, alors que Richir cherche les modalités d’une forme apodictique à partir et selon du contingent.
Si la plasticité est le processus qui donne et prend forme simultanément, dans la description phénoménologique, peut-on dire que ce dynamisme éveille en quelque sorte des virtualités jusqu’à l’apodicticité de leur apparition et/ou de l’apparaitre : l’enjeu est donc moins le transcendantal que la plasticité qui est cette articulation constitutive d’une concrétude ?
Florian Forestier : Ou pourrait dire cela comme ça, même si le terme d’apodictique est assez difficile à appliquer à Richir. C’est d’ailleurs la principale difficulté de son œuvre : à revendiquer à la fois l’évolutivité de l’ensemble de ses catégories et sa pertinence (Richir pense bien que sa façon de faire de la phénoménologie et bonne, et parfois même, qu’elle est la bonne, qu’elle permet d’atteindre ce qu’il y a à atteindre), elle devient contrainte à avancer sans cesse pour ne pas s’effondrer (la révolution est comme un vélo, quand elle n’avance pas elle-tombe). C’est tout l’enjeu de la reprise que fait Alexander Schnell : sur beaucoup de points, il est très richirien, mais il repose clairement les enjeux du point de vue de la légitimation, de l’attestation, des modalités du transcendantal, etc., et assume à ce niveau aussi les enjeux de la dimension constructive. Richir accepte finalement qu’il y ait de la « construction », même s’il n’aime pas ce terme et que la construction pour lui est tout aussi bien description (son ethos de physicien nourrit peut-être cette compréhension élargie de la description). En ce qui me concerne, l’enjeu est à la fois la systématique transcendantale et sa mise en mouvement (ou la mise en mouvement de la pensée selon cette systématique). Mais la plasticité n’est pas une façon de nier le transcendantal. Elle est plutôt une façon de le réaliser. Entre la réécriture systématique et toujours différenciée de la doctrine de la science et l’effectuation du système hégélien dans ces différents cercles, je me sens plutôt proche de Hegel. La philosophie transcendantale s’exprime de différentes façons : mais l’une d’elles doit être son exposition conceptuelle comme philosophie transcendantale.
Etienne Besse : À partir de la page 94, nous abordons Heidegger : ce qui m’a surpris et intéressé, c’est que tu l’abordes presque exclusivement sous l’angle de l’Ereignis. N’est-ce pas plutôt avec Heidegger un passage du monde à l’aletheia ? Non plus transcendance à l’immanence mais dévoilement ? il semble que tu priorises chez lui la déclosion ou ce qui est scellé dans la terre et non le dévoilement. Peux-tu préciser la manière dont tu as travaillé la pensée de Heidegger ?
Florian Forestier : C’est que chez Heidegger, l’un est inséparable de l’autre. J’ai eu longtemps une compréhension très esthétique et contemplative, et sans doute biaisée de l’Aletheia. Je vais donner une image : ce qui me renvoyait le plus à l’Aletheia, c’est le sentiment qu’on peut éprouver parfois quand on découvre l’existence concrète du monde autour de soi à travers un paysage. Un paysage de montagne ce n’est pas de l’être brut, du chaos, comme l’aurait dit Hegel. C’est une sorte d’évidence articulée du dehors, de sa solidité. Avec l’Ereignis, le paysage devenait vespéral ; l’ombre, la nuit vibrant sous la chose.
Mais cette analogie était trop romantique, et surtout très trompeuse. Le dévoilement est le dévoilement du sens comme sens, comme faire question. L’Aletheia désigne la rencontre avec la problématicité même, de plus en plus évidée au fil de l’histoire de l’être. Tout l’enjeu alors de la pensée heideggérienne de la finitude, de la façon dont elle est remise en jeu dans l’Ereignis est d’insister sur cela qu’il y a « cèlement » au sein même du dévoilement. Le dévoilement se comprend comme tel en tant qu’il est en même temps voilement. Chez Richir, il en va un peu différemment. Le sens n’est pas transparent, n’est que se faisant, il est toujours configuré au sein de signes, toujours un peu « tamisé » (c’est l’héritage derridien de Richir), mais il est malgré tout réflexible : c’est l’essence de tout sens de se donner comme mise en question de lui-même. Il n’a pas cette facticité de la d’éclosion heideggérienne. Richir, disons, donne plus d’importance à la catégorie du comprendre, du Verstehen, qu’à celle de l’entendre. Sa « scène primitive » c’est l’expérience de tenter de comprendre quelque chose, de sentir les éléments s’enchainer, se nouer, entrer dans une dynamique ; on sent vraiment le modèle de l’expérience du physicien ou du mathématicien qui comprend enfin la structure d’un problème, ou qui arrive à résoudre une difficulté.
Etienne Besse : Tu insistes sur le statut phénoménologique des lois a priori : « en résumé, la question essentielle de la phénoménologie est selon nous de savoir si les structures de la phénoménalité qu’elle déploie ont le statut de lois a priori, si la structure du champ phénoménologique a bien un caractère prescriptif pour les contenus accessibles à la conscience, en d’autres termes, de quelle façon sens et facticité s’articulent dans le développement du champ phénoménologique. » (p. 89) Qu’est-ce que cette loi ? une sorte de relation de « nécessité » qui pourtant ne se répète pas mais se modalise selon ses caractères ? ses domaines descriptifs ? La loi marquerait donc les limites entre les domaines décrits. Comment s’établirait la limite d’un domaine, d’une couche de sens (qui plastiquement fait et donne sens par la limite qui détermine et restreint, ou fait passer), d’une structure phénoménale en propre ? est-ce que la loi est rehaussement descriptifs ou bien extérieur vide ? tu parles de mathesis universalis comme ayant – avec Bachelard – une axiomatique immanente dans sa pratique : est-ce que la loi est du même ordre ?
Florian Forestier : Chez Husserl, la réduction doit idéalement au moins éclaircir un ensemble de structures ultimes dont l’articulation au sein de l’ego transcendantal (qui est l’unité, le système de ces lois) donne l’intelligibilité. J’évoque l’exemple mathématique parce qu’il est important pour Husserl même. Le programme d’Erlangen, les groupes formels, ont donné à Husserl l’exemple d’une pureté formelle qui l’a influencé dans sa conception de l’ego après réduction, et dans sa relation avec les autres systèmes de lois, formelles et matérielles. Le développement des mathématiques depuis donne d’autres modèles inspirants pour penser le champ phénoménologique et ses dimensions.
Sinon, il y a une différence nette entre Husserl et Richir à propos de l’origine du sens. Husserl cherche à en faire la généalogie : à revenir à une institution fournissant son contenu originaire à la science. La phénoménologie, statique ou génétique, revient à cette origine. Chez Richir, la genèse du sens n’est pas traçable. D’abord, il y a une distinction nette entre la signification et le sens. La signification est instituée : elle est stable, elle n’a pas besoin de nous et la façon dont elle est expérimentée n’a aucune espèce d’importance sur les règles dont elle dépend : son statut phénoménologique, si on veut, est d’être non phénoménologique. Le sens, on l’a vu, c’est une autre dimension. Il est lui-même « influencé » par le hors sens (mon corps, mes réflexes, tout le grésillement des traces dans mes neurones participent à ma « pensée » en ce sens là, au processus par lequel je comprends, mais la phénoménologie transcendantale ne peut pas (et de doit surtout pas chercher) à rendre raison du contenu des significations à partir des mouvements de sens, ou des mouvements de sens à partir des synthèses passives. Elle peut seulement – de façon très kantienne à nouveau – éclairer la façon dont ces dimensions, institutions, etc., se transforment, à la fois sous l’effet des efforts de compréhension et de réflexion, et de la lorsqu’elles rencontre du phénoménologique même quand les l’élaboration des concepts les conduits à s’interroger eux-mêmes, dans le cas de l’arithmétique, par exemple, et que le raisonnement tente d’opérer la où les conditions de son opérativité ne sont plus assurées (Richir le fait très bien dans ses écrits sur Dedekind, Frege, Cantor, Zermelo). Les mathématiques dans leur mouvement d’explicitation d’elles-mêmes rencontrent une dimension qui n’est plus réductible à leur institution (de l’arithmétique au schème de la répétition se répétant, de l’infini aux infinis cantoriens, etc.) Elle doit se donner les moyens de traiter symboliquement ces apories, de les faire exister au sein des mathématiques.
Etienne Besse : Entrons un peu plus dans le cœur de ton livre et le projet phénoménologique richirien dont tu écris qu’il « est moins de réinscrire le phénomène au sein de catégories outrepassées par sa libération, que de comprendre ces catégories à la lumière du phénomène. A l’issue d’une réduction radicale, que Richir qualifie de réduction hyperbolique, le terrain originaire de la phénoménologie n’est plus celui de la perception, du donné sous l’horizon d’une essence fixe, mais celui du flottement, de l’imagination au sens de ce que Richir thématise comme phantasia. La concrétude est ainsi rendue à la fécondité de sa puissance schématique. » (p. 161) Est-ce que la description n’est pas prise dans ce geste de réduction, comme à la recherche « d’un reste » ou d’une assise qui elle-même dépend de ce geste de réduction ? Comment Richir l’interprète-t-il ?
Florian Forestier : Si. Et c’est très ambigu. Richir semble parfois dire que du fait du fond « phantasique » de notre expérience, cette mise en flottement phénoménologique est toujours là. Inversement, la remarque a déjà été faite à Richir et semble pertinente : la réduction hyperbolique telle qu’il la thématise a en effet un point noir, celui du statut de la visée descriptive même. La posture phénoménologique fondamentale de Richir est à la fois très esthétique (l’implication dans une situation, une action, un contexte, un sens performé et pas seulement compris, est toujours dérivée, ce que Guy van Kerckhoven souligne très bien) et malgré tout très thématique.
J’avais déjà posé la question à Marc Richir de l’impensé d’une réduction conçue comme hyperbolique, de ce qu’elle risquait de perdre d’essentiel à une compréhension de la phénoménalité. Richir avait répondu qu’aucune pensée n’est sans perte, et qu’un système de l’intelligibilité totale, sans perte, est une sorte de contradiction (il se référait à ses discussions avec Pierre-Jean Labarrière) Mais la question n’en demeure pas moins. Elle a été posée par l’importance de l’idée de situation en phénoménologie. On pourrait même dire que les différents degrés de tensions, d’implication dans l’expérience sont justement des configurations phénoménologiques fondamentales, que la réduction hyperbolique ne nous conduit qu’à une certaine configuration (Husserl aussi s’est battu avec des difficultés de ce genre, il a introduit l’idée de Vollzugsepokhe pour cela, qu’il distinguait bien sûr de la pratique phénoménologique, qui ne devait pouvoir se réduire à une praxis parmi d’autres). En tout cas, cette question peut inviter à penser d’autres formes de phénoménologie et de « réduction » (si on peut encore les appeler comme telles. De la même façon si quelque chose chez Heidegger tient lieu de réduction (l’ennui, l’angoisse), cela ne conduit pas une connaissance au sens de la réduction husserlienne. Chez Richir même, il y a plusieurs modalités de réductions possibles, il un intérêt pour l’anthropologie phénoménologique, pour ce qu’il appelle la métaphysique phénoménologique, même si cela est moins central que la réduction hyperbolique et la réduction architectonique. Pablo Posada a également conceptualisé une « réduction méréologique » qui conçoit les phénomènes au sein de tous sur fond desquels ils vibrent, se détachent.
En ce qui me concerne, je dirais qu’au bout d’un moment, la réflexion sur la méthode doit s’interrompre ; la « réduction » a intérêt à s’oublier elle-même et à se « performer » en une écriture (Jean-François Courtine semble d’ailleurs trouver quelque chose de ce genre chez Ponge).
Etienne Besse : Peux-tu préciser ce qu’entend Marc Richir par son architectonique ? « L’architectonique n’est pas architecture spéculative mais tectonique au sens géologique du terme, d’une archè introuvable ». Est-ce lié à la « tectonique au sens géologique du terme, de l’archaïque, lequel ne vieillit pas, en général inconscient. » (p. 174) ?
Florian Forestier : L’architectonique est une méthode, chez Richir. En ce qui concerne l’archaïque, il faudrait le replacer dans une réflexion sur ce que Richir appelle la mémoire phénoménologique, l’inconscient phénoménologique, sur les différents degrés de synthèses passives selon lui, mais aussi sur les schématismes et l’affectivité. Il n’est pas en tout cas question chez lui de revenir vers l’archaïque. Comme je le disais plus haut à propos des concrétudes, il s’agit plutôt de comprendre comment le sens nait sur fond de cet archaïque et se nourrit de lui ; et en particulier, de produire une phénoménologie du temps, de la temporalité sur cette base. Je renvoie aux passages consacrés à cela dans La phénoménologie génétique de Marc Richir.
Etienne Besse : Vient la question de l’anthropologie : « l’anthropologie permet de mieux comprendre l’inscription de différentes attitudes existentielles dans des structures phénoménologiques plus profondes, et comme la possibilité d’user de cette pluralisation des formes d’incarnation comme d’un puissant outil de décentrement…. l’anthropologie phénoménologique est le lieu de la métaphysique phénoménologique (p. 183) (…) cette anthropologie entend décrire la mondanisation elle-même autant que de distinguer des modes (ou des types) d’incarnations, des façons de faire le monde. Elle ne décrit plus seulement la légalité d’un donné ; en prenant pour terrain la totalité elle-même, elle ouvre la possibilité d’une remise en question radicale des façons selon lesquelles se noue un rapport au donné (p. 184) (…) cette anthropologie serait à l’image des « stades » kierkegaardiens » (p. 185). Est-ce que malgré elle, la phénoménologie cherche à « fonder » l’anthropologie ?
Non, mais elle s’en nourrit, s’en inspire, voisine avec elle. Je parlais plus haut de l’anthropologie phénoménologique. Pour rappel : l’anthropologie phénoménologique est un certain mode d’analyse phénoménologique, mise en œuvre par Husserl, Scheler, Heidegger, et aussi d’une autre façon par des auteurs comme Erwin Strauss, Von Gebstattel, Minkowski, ou surtout Binnswanger qui dans la dernière phase de son œuvre est revenu à une méthode inspirée de la phénoménologie transcendantale husserlienne. Richir, lui, parle je l’ai dit de l’anthropologie phénoménologique comme voie vers la métaphysique phénoménologique, vers des façons d’appréhender des modes de configurations d’ensemble du champ phénoménologique.
C’est une autre question encore que celle des stades kierkegaardiens. Il y a bien sûr un intérêt à les considérer sous cet angle, comme construction de fictions phénoménologiques. Mais il y a aussi un autre regard, qui va dans le sens opposé, ne cherche pas à comprendre phénoménologiquement les stades kierkegaardiens, mais les prend au contraire au sérieux et se sert d’eux pour mettre en question la posture phénoménologique dans son ensemble. Les stades kierkegaardiens désignent en effet plus que des configurations de l’expérience (comme le serait la station hystérique qu’évoque Jean-Christophe Goddard, ou d’une autre façon Zizek, qui distingue le sujet hystérique, définit par le manque, l’écart au monde, du sujet pervers qui est être au monde, corporel et incarné). Il ne faut pas oublier que le stade se comprend chez Kierkegaard du point de vue de l’esprit : pas seulement donc selon la façon dont sont ressenties les choses, mais selon le nouage de temporel et d’éternel à chaque fois mis en jeu. C’est une approche totalement différente, qui ne peut plus se comprendre en terme d’expérience (comme c’est le cas chez Richir), ni même sans doute d’existence (au sens en tout cas de Heidegger). Kierkegaard est un des auteurs les plus radicaux pour nous amener à un point de vue qui n’est plus celui de la phénoménologie – l’ironie est qu’il est aussi un des inspirateurs les plus récurrents de la phénoménologie, sans cesse appelé à l’aide dans ses mouvements de dépassement successifs (c’était l’objet de mon article « Actualité et inactualité de Kierkegaard », dans le collectif Kierkegaard, incidences et résonnances, publié par la Bibliothèque nationale.
Enfin, il y a l’anthropologie comme telle, lue indépendamment de toute fondation phénoménologique autant que de toute assertion d’étrangeté définitive : entre les deux, ouvrant à ce champ qui est familier autant qu’inappropriable, celui des pratiques, qui ne sont pas qu’affaire de compréhensions, ni même de sens. Bêtement par exemple, je n’ai plus le rapport aux problèmes et concepts philosophiques depuis que mon « milieu » professionnel n’est plus le milieu philosophique. Ici, à nouveau, l’intérêt est d’inquiéter la posture phénoménologique, de modérer ou tempérer l’appétit phénoménologique.
Etienne Besse : Tu termines l’exposition sur Marc Richir en indiquant l’horizon d’une « auto-relativisation qui sera l’horizon kantien pour nous orienter dans la pluralité » (p. 206) Est-ce que cette auto-relativisation est à rapprocher de ce que tu dis p. 173 : « La phénoménologie richirienne est directement liée à la problématique kantienne du jugement réfléchissant, c’est-à-dire à la capacité pour l’entendement de proposer la loi non donnée a priori d’un divers en se laissant guider par les aspects d’unité organique (ou harmonique) qu’elle y décèle. ».
Florian Forestier : L’auto-relativisation au sens de la capacité de la raison à revenir sur elle-même et à tracer, sinon ses propres limites (chez Kant oui), à remettre en cause son univocité. Il n’est pas question de faire de Kant un relativiste, bien sûr. C’est surtout une reprise de la dimension critique.
La relation au jugement réfléchissant (que je traite un peu vite) est un autre point : ici, il sert surtout pour caractériser la pratique du phénoménologue. Pour Marc Richir, son rôle est en effet plus vaste. Le modèle du jugement réfléchissant est en effet très élargi. D’une certaine façon, toute science va mettre en jeu une part déterminante (au sein d’une institution symbolique donnée) et une part réfléchissante, sans qu’il soit possible a priori de les distinguer. Je consacre un article entier à cette question dans un recueil d’acte d’un colloque qui s’est tenu à l’université Laval, et qui sera publié aux éditions Hermann en 2018 : « Marc Richir et la question de l’idéalité ».
L’enjeu est aussi d’avoir une conception de la science moins étroite que celle que beaucoup de philosophes ont (c’est, au passage, le problème d’une bonne partie du dit réalisme spéculatif selon moi), de prendre acte d’une certain nombre de tournants (pas seulement galiléen, mais lagrangien, etc.) : quoiqu’on pense de Kant, sa compréhension des enjeux de la théorie scientifique, en particulier physique, sont essentiels à ce sujet (Richir n’est pas le seul d’ailleurs à s’y référer : il y a son ancien élève Pierre Kerzsberg, ou bien Jean Petitot).
Etienne Besse : Arrêtons-nous sur un passage :
« le transcendantal, pour rendre compte de sa transcendantalité, doit s’expérimenter sans que l’expérience transcendantale n’aie à son tour à relever d’une transcendantalité de niveau plus élevée, et ainsi de suite à l’infini. Qu’est-ce qui motive cette recherche illimitée des conditions de possibilités ?
Réponse : l’expérience transcendantale mise à jour par la phéno est précisément l’expérience de discord que nous venons de décrire plus haut. La fécondité de la phénoménologie transcendantale vient de sa capacité à distinguer d’une part les questions transcendantales pures, c’est-à-dire les structures de questions, des questions transcendantales phénoménologiques, qui doivent de leur côté s’enchainer et s’articuler pour décrire l’expérience. L’armature transcendantale pure fournit à la phéno se faisant une sorte de grammaire interne selon laquelle aucun phénomène concret ne doit être hypostasié, ni cependant nié, mais toujours décrit selon sa structure et mis en corrélation avec les éléments que l’intelligibilité de cette structure implique de construire, sans que jamais les éléments construits soient jamais eux-mêmes considérés comme origines et fondements, mais seulement comme jalons d’un enrichissement mutuel de la description et de la construction, au cours duquel le transcendantal pur n’intervient jamais que pour couper court au dogmatisme potentiellement toujours larvé dans la démarche phénoménologique. (p. 214-215)
A la lecture de cela, nous ne pouvons nous empêcher de nous dire qu’au fond, ce qui est nommé le phénoménologique n’est jamais qu’une discipline de garde-fou multiples, un peu comme avec Wittgenstein et ses scrupules sur le sens pour le diluer dans le dérisoire par ses aplatissements par le rasoir de l’usage qui, en phénoménologie, est celui de l’expérience descriptive en distinction permanente ?
Florian Forestier : En ce qui me concerne, je la vois en partie comme cela. Mais elle n’est pas seulement cela sinon, elle ne pourrait pas l’être. J’ai eu une discussion tournant autour de cette question avec Markus Gabriel. Markus Gabriel disait que sa pensée des champs de sens, de leur structure, faisant de l’inexistence du monde et de l’existence (située, à définir selon les règles de la situation ; le champ de sens, à ce que j’ai compris, permet de ne plus séparer la description, donc le sens, de l’être à désigner, on ne le désigne plus justement, à considérer que la situation comprend, en plus de certaines lois structurelles, ses propres catégories qui lui sont intrinsèques : dès lors qu’on évoque cette situation, on l’évoque selon cette ontologie propre) de tout le reste permettait de définir négativement les conditions d’une philosophie. Ma conception de la philosophie transcendantale partage une partie de ce souci (même si cela prend plus pour moi la forme kantienne de la régulation), mais pour moi, une telle régulation ne peut pas bloquer a priori les conflits par une sorte de technologie philosophique, de remise à plat, telle qu’aucune tension, aucune confrontation n’est jamais vraiment possible (tous les champs de sens n’ont pas, disons, la même implication mais je ne connais pas assez bien la pensée de Gabriel, et la façon dont il se revendique de Hegel, sa reconnaissance de l’importance la question du droit, par exemple, devraient sans doute m’amener à mitiger cette réserve). Je parle de phénoménologie pour me situer sur un plan où la pensée rencontre des difficultés, des contradictions, des problèmes, etc. Ce que j’appelle phénoménologie implique une forme de passion et de déchirement, pour parler comme Hegel, justement : une rencontre de la tension en tout cas, de l’alternative, et aussi de la perte dans l’alternative.
Tout aussi bien d’ailleurs, il me semble pour cela même beaucoup trop tard pour tenter de proposer une vision déflationniste de la philosophie, encore plus de son langage. Celui-ci s’est depuis trop longtemps mélangé avec tout le reste pour qu’on puisse espérer « désintriquer » tout cela. Autant faire avec, de l’intérieur. J’ai envie de dire : il y a une dimension de délire maîtrisé dans la phénoménologie, une régulation de ses propres proliférations. Secouons le bocal pour donner l’impression qu’il est infini.
Etienne Besse : Tu effectues à la fin de ton ouvrage des ouvertures très intéressantes sur les grands penseurs de l’idéalisme allemand, notamment Schelling p. 317 ; tu y écris que « pour Schelling il est de l’essence du savoir de s’échapper dans la révélation ».
N’est-ce pas plutôt que le savoir selon Schelling est la déchéance de la pensée ? Je pense notamment à ce passage : « La pensée dépasse la science… La contingence du savoir provient du fait qu’il a perdu le lien avec ce qui se trouve dans la pensée. En effet, la nécessité originelle se situe uniquement dans la pensée. L’exigence de retrouver ce lien et de la rétablir autant que possible, voilà qui est la cause du fait que la pensée passe avant la science… la science attire, en général, plus que la pensée pure » (Schelling, Introduction à la philosophie de la mythologie, leçon seize, p. 342, p. 363-364).
Florian Forestier : Oui, mais la pensée dépassant la science est en quelque sorte extasiée dans l’intuition. C’est cette idée d’extase de la raison que Fichte et Hegel contestent – en tout cas selon ces modalités-là. Peut-on se maintenir dans la philosophie ? Dans la vérité philosophique ? Peut-on penser la philosophie et la vérité philosophique sans assumer ces intermittences comme fondamentales ?
Etienne Besse : J’aimerais à présent te poser une question générale de reprise et de synthèse : il y a dans ton ouvrage un terme qui revient constamment quelque soient les auteurs ou les problèmes que tu abordes, « l’enroulement » (p. 172, p. 119). Est-ce que nous ne pourrions pas dire que le réel est le mouvement d’enroulement du sens, de la pensée à l’être comme langage dont l’expression du parcours est transcendance ? le problème vient de ce que ce mouvement d’enroulement est plastiquement réflexif pour prendre et donner forme au transcendantal comme au réel, donc distinction essentielle de la pensée de l’Etre : chez Heidegger, on pourrai alors dire que ce mouvement est celui de l’aletheia, et chez Richir, que ce mouvement est celui de la phantasia et son institution symbolique (p. 180) mais dont le rythme plastique relativise l’Etre comme « filtre symbolique » (p. 182). Est-ce que cet enroulement est alors le philosopher authentique qui ne fait pas qu’interroger les conditions de possibilité (p. 37) ou « redoubler la question du sens » (p. 209) mais exprime et « expérimente » (p. 214-215) réellement une « philosophie de la nature réflexive » (p. 212) ?
Pourtant, tu sembles objecter à la page 153, en note : « une intuition profonde – mais problématique – est d’assimiler la structure même de la réflexivité, l’épreuve singulière elle-même, à la manifestation de l’Etre. Toute notre objection revient à dire qu’il s’agit chaque fois d’une structure transcendantale posée par la coupure de la phénoménalité, et que celle-ci n’est pas mieux expliquée, lorsqu’elle est réimplantée dans l’Etre, que lorsqu’elle est isolée pour elle-même ».
Florian Forestier : Le motif de l’enroulement est très important en effet. Je reprends le terme comme tel, mais il ne faut pas oublier la façon dont cette métaphore apparaît dans l’histoire de la phénoménologie, ce qui motive cette apparition, etc. Je ne sais pas en tout cas si je dirais que le réel est l’enroulement du sens, mais plutôt que le motif de l’enroulement permet de mieux rendre intelligible les deux dimensions du sens et du réel, leur coappartenance. D’une certaine façon aussi, le réel serait l’enroulement du sens à condition que celui soit heurté : c’est ce que j’essaie d’exprimer avec mes développements sur le pli, la pliabilité, la réflexivité et la réflexibilité. Pour moi, il s’agit de schèmes de pensées parents, qui renvoient à une même économie transcendantale, mais en n’y entrant pas de la même façon. Cela dit, que l’on parle de pli ou de réflexivité, le motif introduit doit tout de suite être « compliqué », comme dirait Derrida. Parler du pli de l’être n’a pas de sens comme tel, si le pli est introduit comme actuel : c’est pourquoi je dis que le pli n’a conceptuellement de sens que comme pliabilité, qu’il est pli se repliant. De la même façon, la réflexivité présuppose la réflexibilité, et celle-ci est « se faisant » – elle est impliquée dans un mouvement, ou plutôt dans un bouger (là encore, le terme du mouvement est ambigu ; ce qu’on essaie de penser est un mouvement brisé, et même si on dit comme Barbaras que le mouvement pur est mouvement vivant, implique un archi-événement, il faut encore comprendre pourquoi, élucider transcendentalement cette configuration de pensée. Bref, il faut penser l’arythmie dans le rythme, l’ogkorythme, comme le dit Robert Alexander, et comprendre pourquoi il faut la penser, pourquoi nous sommes amené à penser cela.
Etienne Besse : Intéressons-nous un peu plus à la question du sens. A la page 172, tu écris : « Le sens est le mouvement de concrétion active du phénoménologique, ce en quoi la transitivité pure du phénomène se fait pensée qui s’auto-affecte. L’expérience de l’idée qui nous vient est paradigmatique de la conception richirienne du sens-se-faisant. » Et p. 24 : « le sens désigne à la fois la transitivité de la donation au donné, et la transitivité du donné au donné » Avant de citer Jean-Luc Nancy p. 25 : « le sens se tient à un rapport à soi en tant qu’à un autre, ou à de l’autre. Avoir un sens, ou faire sens, ou être sensé, c’est être à soi en tant que de l’autre affecte cette ipséité, et que cette affection ne se laisse pas réduire ni retenir dans l’ipsé lui-même (une pensée finie) ».
Que retiens-tu de ce propos sur le sens (Sens comme « être-à ») alors même que le fondement ontologique n’est pas en vue? Que veux-tu dire du sens si l’on rapproche ces éléments (p. 142, 147) de ton propos p. 228, « donner un sens phénoménologique à la structure du quadriparti heideggerien » ?
Florian Forestier : Il y a en effet un risque à passer du fondement à l’effondement (Deleuze) ou à l’infondation (Levinas), sans réfléchir à ce qui les lie, c’est-à-dire la question de la légitimation. Alexander Schnell et Marc Richir ont plusieurs fois discuté de cela : Alexander Schnell et Jean Siegfried Hanin ont fini par me convaincre alors même que je me rattache par ailleurs de plus en plus à un certain pragmatisme (mais l’un et l’autre ne sont pas antithétiques).
Etienne Besse : Tu termines ton livre en faisant remarquer que pour Richir la phénoménologie n’est qu’une « exigence » (p. 230) et donc, pas un corpus de question-réponse : au fond, il n’y a de phénoménologie que d’une possibilité de la phénoménologie, tout le reste n’est que garde-fou pour garantir la fondation ou pratique de l’anthropologie, qui elle-même semble plus être, selon Michel Bitbol, un « repérage ethnographique ». Or celui-ci aussi va de pair avec le fait de trouver une dynamique de l’infondation (p. 220) qui est une disposition à décrire sans céder à la « réification de l’objet » (p. 224), mais aussi à prendre en compte « la pulsion culturelle occidentale » de la « distanciation » (il n’y aurait donc pas « d’incoïncidence » p. 209) ? Il semble alors que cette mise en question soit elle-même occidentale ?
Florian Forestier : Une fois encore, je suis d’accord à ce sujet ; je suis beaucoup plus attentif maintenant à la logique spéculative elle-même, au point que je me demande si la forme de pensée que je mets en œuvre relève encore de la phénoménologie (elle touche sans doute quelque chose de phénoménologique, mais doit-elle encore s’appeler phénoménologie ?)
Ce qui m’intéresse chez Bitbol, c’est l’aspect à la foi existentiel et éthique qu’il souligne. Les questions ont sens parce que nous y sommes engagés. Bitbol articule une réflexion d’inspiration kantienne et phénoménologique avec cette approche wittgensteinienne. Les questions ont sens à partir du moment où nous vivons à travers elles, collectivement à travers elles (et nous tenons collectivement pour acquis un certain nombre de choses, de distinctions, d’interdits, etc.) L’important ici n’est pas le formalisme des démonstrations mais ce qui sous-tend un certain nombre de choix, de priorités, etc., au sein des modes de raisonnement. Bitbol le montre très bien pour la physique (qu’est-ce qu’on est prêt à admettre comme objectivité, comme théorie, etc., quelle valeur présuppose ces choix ?), et Putnam pour les mathématiques (quels types d’objets sommes-nous prêts à admettre ? quels types de démonstration ? qu’est-ce qui peut valoir comme preuve ? etc.)
La phénoménologie est à la fois très proche et très éloignée de cette conception qu’elle interprète trop vite en attitude naturelle, monde de la vie, etc. La perspective phénoménologique tend spontanément à tenter de comprendre le statut de cette adhésion (comme sédimentation, traditionalisation, etc.), ce qui laisse tout un pan de la question de côté : ce qui se fait au sein de cette traditionalisation, au sein de sa pratique. Or, encore une fois, c’est en entrant dans cette pratique qu’on peut précisément rencontrer des questions qui peuvent prendre un sens « phénoménologique », ou tout simplement une densité philosophique. Or c’est là aussi (quand il y a des ruptures, des contradictions) que ces processus d’appropriations-plastifications ont lieu, et la philosophie elle-même ne pourrait pas continuer à vivre (et peut-être ne le fera-t-elle pas) sans cette forme d’adhésion (qui n’est pas une expérience, qui n’est pas un état) qui rend ces enjeux cruciaux. Bitbol essaie de développer une pratique qui dédramatise ces enjeux sans les mettre à plat : précisément, qui leur permette de garder leur acuité sans s’interdire l’une l’autre : prendre soin des attitudes existentielles soutenants les traditions, les arts, les sciences en y ouvrant des marges, des latences, des espaces les libérant de leurs propres enfermements, crispations, contradictions. Il n’y a pas de plasticité sans formes.