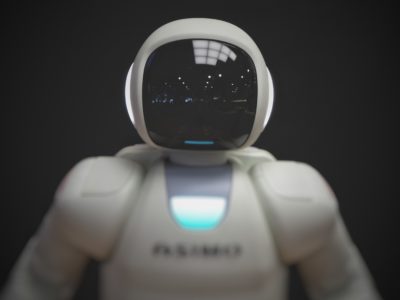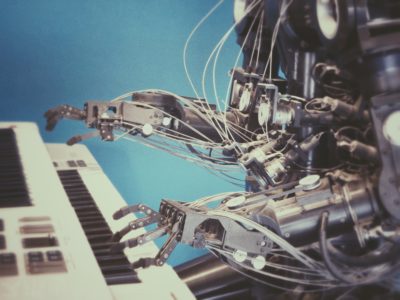Décider et faire (1)
Marta Spranzi – Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Décider et faire : le « savoir-comment-faire »
entre sagesse pratique, habileté et éthique du care
Depuis quelques décennies déjà, la décision médicale fait l’objet d’une attention particulière. Avec l’essor du principe de respect de l’autonomie des patients, sanctionné par la loi des « droit des patients » de 2002 (n° 2002-303 du 4 mars), la décision médicale devient partagée. Elle fait aussi — du moins en théorie — l’objet d’une discussion collégiale au sein de l’équipe médicale : les arguments éthiques sont donc échangés, évalués et pesés lors d’un processus de délibération qui aboutit à une décision. Malgré les controverses qui entourent l’interprétation de la notion d’autonomie[1], le champ de l’éthique médicale a exploré, et continue d’explorer, la problématique difficile de ce qu’on appelle les « dilemmes » éthiques, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les décisions médicales sont le plus controversées, soit au niveau sociétal, soit au niveau individuel. L’éthique « clinique », par opposition à la bioéthique, concerne traditionnellement la décision médicale dans des situations singulières : c’est précisément quand des médecins s’interrogent sur « Que décider ? », et quand plusieurs options sont techniquement possibles que se pose la question des valeurs et des principes éthiques de référence et de leur éventuel arbitrage.
En effet, la dimension éthique de la décision médicale se présente de façon aiguë quand l’équipe est confrontée à un dilemme : deux solutions opposées se défendent non seulement du point de vue technique mais également par rapport à des principes éthiques de référence : est-il bien de ne pas nourrir de force un patient âgé et dément qui refuse de se nourrir ? Faut-il interpréter ce refus comme un manifestation de son autonomie résiduelle ou comme une manifestation de sa maladie ? Et même si c’est le cas, faut-il le laisser mourir alors qu’il n’a pas de pathologie létale sous jacente ? Respect de l’autonomie du patient et non-malfaisance semblent être ici en contradiction. Un processus de délibération est donc nécessaire dans lequel les différents arguments sont évalués et « mis en balance ». Cette expression, utilisée notamment par Tom Beauchamp et James Childress dans leur ouvrage de référence sur l’éthique médicale[2], signifie que dans une situation dans laquelle deux décisions opposées pourraient se justifier à partir de deux principes différents, il convient de donner la priorité à l’argument qui, étant donné les circonstances, a le plus de poids. Ce processus aboutit à une décision qui clôt la délibération et sanctionne ses conclusions. Un bon exemple de ce difficile arbitrage est la décision d’arrêt ou de continuation des soins en néonatologie : il s’agit de décider si la qualité de vie du futur enfant justifie un éventuel arrêt de soins ou si au contraire il convient de tout mettre en œuvre pour lui sauver la vie. Comme l’a bien montré Anne Paillet[3] dans un livre consacré à cette question, le personnel infirmier dans le doute préfère en général prendre le risque d’arrêter une vie qui aurait pu être acceptable, plutôt que prendre le risque inverse, de prolonger une vie avec un très grand potentiel de souffrance pour l’enfant lui-même et pour son entourage.
Par conséquent, dans la succession naturelle délibération/décision/action, l’éthique ne semble concerner que les deux premiers moments, l’action en elle-même passe au second plan. Elle n’a d’importance qu’en tant qu’elle est l’aboutissement de la décision, qu’Aristote justement appelle le « désir délibératif » pour mettre en évidence son caractère dynamique. Dans l’exemple donné, et en supposant que la décision ait été prise de nourrir de force le patient, dans l’espoir qu’il se remette physiquement et qu’il puisse à nouveau se nourrir avec plaisir, le personnel soignant est convoqué pour attacher le patient, le nourrir par sonde, le détacher une fois la séance terminée. Cet ensemble d’actes — dirait-on — n’est éthiquement légitime que si la décision préalable est bonne. En effet, dans la vision courante l’évaluation éthique de l’action des soignants dépend du bien-fondé de la décision dont elle résulte et qui informe son « intention ». À son tour le bien-fondé de la décision repose sur le processus de délibération et des principes invoqués, interprétés et pesés.
La conséquence en est que, si éprouvant soit-il, le travail des soignants reste souvent invisible. Comme l’écrit Pascale Molinier, « un travail attentionné efface ses propres traces »[4]: en effet, il vise à ce que tout se passe sans heurts, et il n’est donc remarqué que quand des obstacles se présentent et que les rouages complexes des relations de soin ne fonctionnent pas de façon fluide. Mais cette invisibilité n’est pas simplement pratique : elle s’étend à la dimension éthique. C’est précisément le fait que le travail soignant soit intrinsèquement lié à la pratique qui le rend moralement invisible. Le rôle principal du personnel infirmier est d’assurer l’« application » de la décision médicale et de permettre la réalisation des objectifs identifiés lors de la délibération qui a conduit à la décision. « L’infirmier applique et respecte les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés »[5]. Par dérogation, l’infirmier peut en urgence agir sans prescription médicale en attendant une validation médicale a posteriori. Ainsi, l’action du soignant elle-même reste dans l’ombre, alors qu’elle constitue une source importante de ce qu’il est convenu d’appeler la « détresse morale » des soignants : faire des soins qui n’ont pas de sens, faire des soins douloureux, prendre en charge un patient avec lequel on n’a pas de relation, ne pas réussir à harmoniser le bien-être de toutes les parties en présence.
Dans cet article je voudrais montrer que la manière dont la décision se traduit en action comporte une dimension éthique indépendante de la décision elle-même. Ainsi, même en admettant que la décision de nourrir de force le patient soit la meilleure éthiquement, sa mise en œuvre soulève des questions éthiques nouvelles : Faut-il attendre le soir ou sédater le patient ? Comment gérer sa rébellion éventuelle ? Comment concilier la bienfaisance médicale et humaine de nourrir et la violence inhérente à l’alimentation forcée ? En effet, « trouver ce chemin (du quoi au comment) est une tâche pratique, même expérimentale. Il en va de même dans la logique du soin : définir “bien”, “pire” et “mieux” ne précède pas la pratique, mais en fait partie. Une partie difficile »[6]. Étant donné la complexité que l’action recèle, il ne convient donc pas de parler d’« application » de la décision mais de sa « mise en œuvre ».
La dimension éthique spécifique inhérente à l’action repose sur les différences entre décision et action. Premièrement, la décision reste interne à ceux qui la prennent et concerne leur propre conscience, alors que l’action implique la relation aux autres et suscite leurs réactions. C’est la dimension plus proprement éthique de la pratique soignante qui consiste en un « travail du care », c’est-à-dire en un engagement continu et fondamental à assurer le bien-être de l’autre[7]. Deuxièmement, la décision occupe un instant déterminé du temps, alors que l’action se prolonge dans le temps par une succession de gestes et d’actes qui peuvent prendre des formes différentes et doivent s’adapter au contexte. La mise en œuvre de la décision principale — nourrir le patient de force — implique une multitude de micro-décisions qui demandent beaucoup de finesse de jugement et de réactivité au contexte de l’action. Ces « petits jugements » relèvent moins d’une vertu de sagesse pratique proprement dite que d’une capacité d’identifier (voir) de façon immédiate ce qu’il convient de faire. Troisièmement, le travail soignant implique outre un « savoir juger » également un « savoir-faire » (skill en anglais) comparable à celui des techniques artisanales. Ce savoir-faire implique une connaissance de comment faire quelque chose qui est distincte d’une connaissance de quelque chose ; elle suppose une intelligence particulière qui est par définition irréductible à une succession de règles précises[8]. Alors que le travail du care demande à la fois une grande capacité de jugement et une certaine habileté pratique, son évaluation morale dépend des modalités fines de son exécution.
Dans ce qui suit je développerai les différentes composantes inhérentes à l’action soignante qui relèvent à la fois de l’éthique du care, de la phronesis aristotélicienne et du savoir-faire technique. Toutefois, je voudrais montrer que le travail du care suppose également, et surtout, un « savoir-comment-faire » qui permet de réaliser les gestes du soin et de le faire en sorte de manifester d’emblée le souci pour le bien de l’autre. En effet, ce n’est pas seulement l’adéquation des gestes soignants au but poursuivi par l’action qui en fait des gestes éthiquement appropriés : les modalités fines du rapport à l’autre déterminent la justesse éthique des gestes soignants. Dans la dernière partie je développerai la notion moralement sensible de « tact » apparentée au toucher, qui tient une si grande place dans le travail quotidien du soignant. Je tirerai également quelques enseignements plus généraux de cette analyse. J’esquisserai les grandes lignes de ce qu’on peut appeler un « savoir-comment-faire » éthique, qui est différent et complémentaire à la fois du « bien faire », du « savoir juger » et du « savoir faire ».
I. Travail soignant et éthique du care
Dans un ouvrage fondateur, Carol Gilligan[9] a décrit les trois piliers d’une nouvelle théorie éthique qui emprunte ses caractéristiques fondamentales à l’attitude que l’on décrit comme typiquement féminine, et qu’elle appelle le « care ». L’éthique est fondée sur la responsabilité et les liens humains, plutôt que sur les droits et les règles, elle donne une place centrale aux émotions par opposition à la rationalité et ne s’évalue que par rapport aux circonstances concrètes de l’action[10]. Depuis l’avènement de l’éthique du care, le soignant est devenu le symbole d’une approche éthique alternative à celle de la tradition rationaliste. Pascale Molinier[11] parle de « travail du care », comme d’une activité, en le distinguant d’une simple disposition à, ou volonté de, prendre en compte le bien de l’autre (sollicitude), ou encore d’une vertu de caractère comme la générosité. Une éthique du care comporte nécessairement un engagement pratique et concret à réaliser des actions qui exemplifient cette attitude bienveillante et qui sont naturellement orientées vers le bien-être d’autrui. Dans cette perspective, l’éthique du care se présente d’emblée comme un savoir-faire plutôt que comme une capacité de juger où est le bien : « faire le bien » est considéré comme prioritaire sur « décider ce qu’il est bien de faire ». Ce savoir-faire concerne les interactions humaines et à ce titre il est d’emblée éthique :
Cette éthique qui reflète une connaissance accrue des relations humaines, pivote autour d’une vérité centrale, celle de l’interdépendance entre soi et autrui. Reconnaître cette interdépendance signifie reconnaître qu’un acte de violence finit toujours par se retourner contre soi tout comme on bénéficie du bien (care) fait à autrui[12].
Cet aspect éthique du travail soignant est explicitement reconnu. Outre les devoirs généraux de respect de la dignité du malade, du secret médical, et le conflit d’intérêt, la dimension éthique du travail soignant concerne l’accompagnement, la relation avec la famille, et tous les soins qu’on appelle « relationnels ». Ces soins jouent un rôle de « facilitation » de l’application de la décision médicale et peuvent donc être évalués dans cette perspective étroite. Ainsi, si le soignant s’y prend bien il peut mieux persuader les patients et les proches, et éviter ainsi les résistances et conflits éventuels. Mais le but des soins relationnels qui occupent une part importante du temps des soignants va bien au-delà de la facilitation : le bien-être de toutes les parties en présence devient un objectif indépendant et même prioritaire par rapport à la facilitation et revêt une dimension éthique à part entière. C’est en cela que le paradigme de l’éthique du care prend tout son sens : par son travail relationnel le soignant vise le bien-être et comporte potentiellement une dimension sacrificielle qui est bien reconnue par les théoriciens de l’éthique du care : « C’est surtout en fonction des soins et du bien-être qu’elles prodiguent à autrui que les femmes se jugent elles-mêmes et sont jugées. Le conflit entre soi et l’autre constitue le problème central des femmes[13]. »
Le bien-être que vise l’infirmier est à la fois modeste et essentiel : il ne s’agit ni du bonheur (en dehors de sa portée) ni de l’absence complète de souffrance (par définition présente dans le situations de maladie). Le bien s’identifie plutôt à une sorte d’harmonie entre les désirs et les plaisirs de tout le monde et repose sur une acceptation intime de chacune des contraintes de la situation et du bien effectivement réalisable. Ainsi, une des causes de la souffrance soignante (par-delà le « burn out » émotionnel) est le fait d’administrer des soins qui n’« ont pas de sens », qui sont incohérents par rapport au bien visé, inutiles, voire clairement néfastes, pour l’une des parties. En effet, même des soins bienfaisants, mais qui seraient perçus douloureusement par la famille, peuvent être cause de malaise. Un idéal de pacification, d’agapé, est inscrit dans le travail du care du soignant.
En effet, l’éthique du care vise la réalisation d’un état de fait positif pour toutes les parties en présence : c’est en relation à ce résultat, et non aux moyens mis en œuvre, que l’action sera évaluée. Toutefois, le travail soignant ne se définit par seulement par rapport à son objectif éthique. Il comporte également une obligation de moyens et dépend donc d’un certain savoir-faire qui requiert une véritable expertise : comme l’écrit Catherine Green en thématisant le savoir-faire soignant, « la vérité réside dans sa direction et non dans son résultat »[14] .
II. La mise en œuvre d’une décision : jugement et coup d’œil
La mise en œuvre d’une décision — nourrir le patient de force — ne relève pas d’une procédure réglée composée de plusieurs étapes standardisées mais elle appelle elle-même des micro-décisions qui relèvent de la responsabilité du soignant et dont l’évaluation dépend éminemment du contexte. Comme le met en évidence Christine Korsgaard[15], une action se décompose en plusieurs actes ou gestes qui sont structurés de façon à pouvoir réaliser la fin inhérente à l’action intentionnelle. Alors que les actions sont « signées » par l’agent, les actes ou « activités » qui la composent ne le sont pas[16] : ils passent souvent inaperçus et ne font pas l’objet d’une attention particulière. De plus, les gestes et les actes du soignant relèvent de plusieurs registres : technique, communicationnel et affectif. En effet, le soignant ne peut pas se limiter à réaliser les gestes techniques impliqués par la décision. Son travail comporte deux autres tâches essentielles. Il doit tout d’abord organiser et gérer la communication inhérente à l’action entreprise et aux différents gestes qu’elle comporte, et ceci aussi bien avec le patient qu’avec ses proches. Souvent il sert aussi de relais informationnel pour les médecins décideurs : c’est au soignant que les proches et/ou le patient s’adressent pour avoir des renseignements et des explications supplémentaires sur le diagnostic, le pronostic et le traitement. Il doit également être sensible à la détresse éventuelle que ces gestes suscitent chez toutes les parties concernées (patients, proches, autres soignants) et réagir de la façon la plus appropriée possible. C’est la raison pour laquelle ce qu’on appelle les « soins relationnels » font partie du cahier de charges des soignants.
Ces soins relationnels comportent également une dimension temporelle complexe. Premièrement, le travail du soin comprend la coordination entre les différents intervenants et l’établissement de leurs liens réciproques dans le temps :
La coordination des temps des différents agents du care est l’axe organisateur des problèmes du care sous son double aspect de travail et d’éthique. Elle est ce qui rend possible la mise en œuvre du care, au-delà des soins et attentions dispensés de manière fragmentée. Elle est la face temporelle de l’intégration du processus, la condition de sa cohérence[17].
À ce titre le soignant est comme le « tuteur de l’histoire » du malade, et contribue à son déroulement. Deuxièmement, le soignant est le garant de la continuité des soins :
Cette continuité, qu’on appellerait sans doute “suivi” dans le langage des institutions, est identifiée comme déterminante par les professionnels du soins également, car elle permet d’engranger les éléments de connaissance du cas singulier : c’est un “capital” de connaissance de la situation, capital accumulé au fil du temps[18].
La dimension temporelle des soins est essentielle non seulement parce que la mise en œuvre d’une décision médicale prend du temps, et parfois beaucoup de temps (plusieurs jours). Elle implique aussi un ajustement permanent et une réactivité au contexte fin et changeant de la situation. Le bien-faire ne dépend donc pas uniquement d’une attitude et d’une visée générales, mais des modalités fines des gestes et de leur capacité réactive.
Tous ces gestes d’ordre différent requièrent des microdécisions dont la justesse relève davantage de l’expérience et d’une certaine sagesse pratique que de règles explicites. Si celles-ci existent, elles ressemblent plus à des maximes de bon sens qu’à un véritable argumentaire éthique. Dans ce sens on pourrait rapprocher le « savoir juger » éthique des soignants de la phronesis aristotélicienne. En effet, la phronesis, la sagesse pratique théorisée par Aristote, est une vertu intellectuelle qui s’applique à l’action particulière plutôt qu’à la contemplation d’objets généraux. Elle implique la capacité de l’agent de conjuguer dans un seul et même moment des maximes d’action pertinentes, les circonstances particulières du contexte de l’action et un désir spécifique, la fin du bien. Cet arbitrage doit être renouvelé à chaque décision et dépend d’un jugement particulier de l’acteur lui-même ; en ce sens, il ne peut pas être réduit à une suite de règles pratiques. Aussi, la phronesis suppose la bonté de la fin poursuivie : « C’est caractéristique de la “phronesis” qu’elle ne se limite pas à posséder la vérité pratique mais qu’elle tend à la mettre en pratique en créant une harmonie entre rationalité et le désir droit[19]. » La fin est incluse dans la définition de la phronesis elle-même : en tant que « vertu intellectuelle pratique, la phronesis est vérité en accord avec le désir droit »[20].
Toutefois, la sagesse pratique aristotélicienne reste liée au raisonnement et à la décision : l’homme prudent est celui qui sait prendre la bonne décision et donc juger correctement de ce qu’il convient de faire. En effet, soutient Aristote, la véritable sagesse morale demande du temps pour s’exercer et n’est pas indépendante des raisons :
Mais elle [la bonne délibération] n’est pas davantage justesse de coup d’œil, car la justesse de coup d’œil a lieu indépendamment de tout calcul conscient, et d’une manière rapide, tandis que la délibération exige beaucoup de temps, et on dit que s’il faut exécuter avec rapidité ce qu’on a délibéré de faire, la délibération elle-même doit être lente. (EN 1142b2-5)[21]
Par conséquent, la phronesis thématisée par Aristote s’applique difficilement à la question de l’action et aux microdécisions qu’elle comporte. En effet, ici le jugement, si jugement il y a, se présente comme la réaction immédiate aux multiples facettes de la situation, y compris les réactions immédiates aux gestes en cours en dehors de toute visée lointaine et de toute conscience de règles même implicites. En effet, certaines positions dites particularistes, qui s’inspirent d’Aristote, développent l’analogie entre le jugement moral et la perception. Le « savoir juger » moral est parfois identifié à une sorte de perception morale. Pour les particularistes, cette faculté morale est comparable à la perception physiologique en ce qu’elle permet de saisir directement — et sans impliquer aucunement le raisonnement et la fin générale de l’action — ce qu’il faut faire, c’est-à-dire la réponse qu’il faut donner à une situation qui appelle une décision éthique. Même a posteriori, il serait impossible de justifier le choix fait[22]. C’est que qu’Aristote appelle un « coup d’œil » et qu’il distingue de sa propre conception du véritable jugement moral émis par l’homme doué de sagesse pratique. D’autres particularistes limitent le rôle de la perception morale au fait de saisir les caractéristiques éthiques pertinentes d’une situation, qui vont à leur tour orienter l’action sans pour autant permettre leur meilleure réalisation. Dans le cas pris en exemple, un soignant peut percevoir la panique du patient relative au fait d’être attaché. Ceci est une indication morale forte sur le degré de malfaisance que les gestes correspondants vont comporter. Il reste ensuite à les réaliser de la façon la plus appropriée possible étant donné les contraintes éthiques identifiées avec l’aide de la perception morale : celle-ci est bien nécessaire mais elle n’est pas suffisante pour un travail du care accompli.
[1] Voir à ce propos, M. Jouan et S. Laugier (dir.), Comment penser l’autonomie ? Paris, PUF, 2009.
[2] T. L. Beauchamp et J. F. Childress, Les principes de l’éthique médicale [1979], 5e édition (2001), trad. M. Fisbach, Paris, Les Belles Lettres, 2008.
[3] A. Paillet, Sauver la vie, donner la mort, Paris, La Dispute, 2007.
[4] P. Molinier, « Apprendre des aides-soignantes », Géronotologie et société, 2010, vol. 133, n° 2, pp. 133-144.
[5] Projet du code de déontologie élaboré par le Conseil de l’ordre national des infirmiers, art. 45, 9 février 2010 (http://www.ordre-infirmiers.fr/code-de-deontologie/le-code.html).
[6] A. Mol, Ce que soigner veut dire. Repenser le libre choix du patient, Paris, Presses des Mines, 2009, p. 149.
[7] P. Molinier, Le travail du care, Paris, La dispute, 2013.
[8] Le « knowing how » a été thématisé pour la première fois par Gilbert Ryle, « Knowing how and knowing that », Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, vol. 46, 1945-1946, pp. 1-16.
[9] C. Gilligan, A Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development [1982], trad. Annick Kwiatek Une voix différente : Pour une éthique du care, Paris, Flammarion, 1986.
[10] En cela, elle n’est pas sans rapport avec l’éthique aristotélicienne (F. Plot, « Ethique de la vertu et éthique du care : quelles connexions ? », in P. Paperman et S. Laugier (dir.), Le souci des autres : éthique et politique du care, Paris, Editions de l’EHESS, 2006, pp. 227-246.
[11] P. Molinier , « Le care à l’épreuve du travail », in P. Paperman et S. Laugier (dir.), Le souci des autres, op. cit.
[12] C. Gilligan, op. cit., note 9, p. 123.
[13] Ibid., note 9, p. 117.
[14] C. Green, « Nursing intuition: a valid form of knowledge », Nursing Philosophy, 2012, vol. 13, n° 2, pp. 98-111, p. 105.
[15] C. Korsgaard, The Constitution of Agency, Oxford, Oxford University Press, 2008.
[16] J. D. Velleman, The Possibility of Practical Reason, Oxford, Oxford University Press, 2000.
[17] P. Molinier, S. Laugier, et P. Paperman (dir.) Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Payot, 2009, p. 144.
[18] Ibid., p. 145.
[19] C. Natali, The wisdom of Aristotle, Albany, NY : State Uinversity of New York Press,
2001, p.13.
[20] Ibid. p. 15 ; voir Aristote, Ethique à Nicomaque, Traduction de J. Tricot, Paris, Vrin, 1998 ; 1139a22-26.
[21] Aristote, op.cit., note 20.
[22] J. Dancy, « Ethical particularism », Mind, vol. 92, 1983, pp. 530-547.