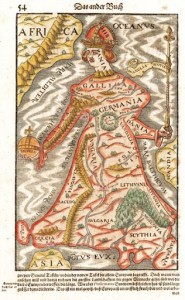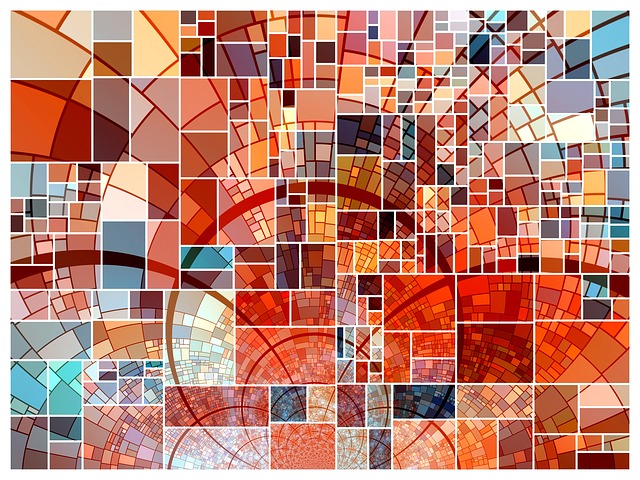De l’oubli européen
Alexis Feertchak – Sciences Po Paris
En 1623, Francis Bacon forge l’expression « Nous, les Européens »[1]. Cinq siècles plus tard, qui, pour se présenter dans un congrès international, déclarerait « Je suis Européen » ? Entre étrangers, fusent partout des « Je suis Français », « I’m British », « Ich bin Deutsch » ou autres précisions nationales. Pourtant, si un quidam venu de Sirius observait un passeport français, britannique ou allemand, il lirait innocemment sur la couverture, devant la mention nationale, celle de l’Union européenne. Et il ne la jugerait pas superflue.
Cet oubli européen est d’autant plus paradoxal que, pour un Chinois ou un Américain, être européen signifie quelque chose de beaucoup plus précis qu’être tchèque, autrichien, slovaque, luxembourgeois ou belge, d’abord parce qu’il est plus facile d’identifier sur une carte l’Europe dans son ensemble que le Luxembourg. Pierre Manent notait ainsi qu’ « ils nous trouvent bien plus ‘’substantiels’’ que nous ne nous sentons nous-mêmes. Puisque les autres le disent, il est probable que nous existons quand même et que nous sommes quelque chose »[2]. Que les autres nous voient comme quelque chose ne signifie évidemment pas que nous soyons cette chose, mais tout de même : pourquoi les Européens ont-ils tant de mal à mettre un nom sur leur caractère européen ?
Dans le débat politique qui entoure aujourd’hui les élections européennes, la question principale n’est pas de savoir ce qu’est l’Europe, mais de savoir ce qu’est la France dans un objet encore politiquement non identifié qu’est l’Union européenne. Autre exemple de cet « oubli européen » : alors même que se déroulent des élections européennes, l’Europe en tant que telle est moins au cœur des préoccupations que la France dans l’Europe. Cet oubli se caractérise donc très précisément par une absence de « rapport à soi »[3], expression empruntée à Jacques Dewitte : nous ne nous présentons pas à nous-mêmes comme européens. De l’identité européenne, les citoyens des pays concernés semblent s’être écartés alors que dans le même temps, un objet politique, l’Union européenne, les gouverne au moins autant que les Etats dont ils sont les administrés.
L’oubli appelle la défiance. Le Front national est en France le grand vainqueur des élections européennes, comme plusieurs autres partis eurosceptiques ou europhobes dans de nombreux pays de l’Union européenne, notamment Ukip au Royaume-Uni : la montée d’une défiance à l’endroit de l’Union européenne est une réalité. La question est donc de savoir si l’on peut déterminer un lien plus ou moins fort entre la défiance des citoyens à l’endroit de l’Union européenne et l’oubli européen lié à l’introuvable identité européenne. En toute logique, si les citoyens des pays d’Europe ont oublié de se sentir européens, toute forme réalisée d’Europe engendre leur méfiance d’abord, leur défiance ensuite. Mais n’est-il pas possible de considérer plutôt que l’Union européenne est en partie désavouée ou ignorée car elle porte en elle le refus d’une identité singulière de l’Europe ?
Ce refus qui a été très bien décrit par Jean-François Mattéi, conduit in fine à ce que Paul Valéry appelait, dans Regards sur le monde actuel, « l’illusion perdue d’une culture européenne »[4].
Comment échapper à ce refus ? L’identité européenne est « excentrique », « ethnodécentrée » et caractérisée par son « regard porté vers le lointain ». Mais sous le choc des événements historiques du 20e siècle, cette identité universalisante s’est effritée. Méthodiquement remise en cause par l’école de la destruction et plus largement par le courant postmoderniste, elle est devenue une identité impossible, par le refus général de toute identité et par la culpabilité historique qui a habité l’Europe depuis 1945. La construction européenne s’est donc inscrite dans la tradition de cette identité impossible. Pourtant, à l’heure où l’Europe ne dicte plus le cours de l’histoire, n’est-il pas d’autant plus possible de reconstruire une identité européenne singulière ?
L’Europe s’est constituée comme une identité « excentrique » et « ethnodécentrée », caractérisée par son « regard porté vers le lointain »
Comme peu d’autres objets politiques, les prémisses de l’identité européenne se nichent jusque dans l’origine mythologique et étymologique de l’Europe. Princesse phénicienne, Europè est conquise par Zeus, qui métamorphosé en taureau l’emmène en Crète. Europè est donc tournée par son histoire hors du lieu où elle est née : originaire du Proche Orient, elle a vécu sa vie entre l’Orient et l’Occident. Le nom même d’Europe traduit ce que Paul Valéry appelle « la curiosité ardente de la Psyché européenne » : tandis que ops signifie le regard, eurus signifie le lointain. L’Europe est donc un regard qui se pose vers le lointain, qui s’étend toujours hors de lui-même. Rémi Brague caractérise cette étymologie par cette formule : « la curiosité envers l’autre est l’attitude typiquement européenne »[5]. L’europanéité, si elle existe, est donc la curiosité pour ce qui n’est pas soi.
L’étude historique de cette « psyché européenne » est marquée par le triptyque composé de Rome, Athènes et Jérusalem et qui fut peut-être autant critiqué que considéré comme le fondement de l’Europe. Paul Valéry, dans son texte Qui est donc européen (1919), propose l’une des plus belles lectures de cette thèse : « Partout où les noms de César, de Gaius, de Trajan et de Virgile, partout où les noms de Saint-Paul et de Moïse, partout où les noms d’Aristote, de Platon et d’Euclide ont eu une signification et une autorité, là est l’Europe ». Paul Valéry, qui qualifie l’Europe de « cap occidental du continent asiatique », reprenant la formule à Nietzsche, ne voit dans l’Europe ni l’union de peuples ni un territoire défini, il ne voit pas cette entité se définir par des éléments naturels, mais par une culture, et précisément par une culture de valeurs. Ces valeurs sont le fruit d’influences extérieures, ce que Rémi Brague appelle la « secondarité » de l’Europe : l’Europe s’est construite sur des emprunts qu’elle fit hors d’elle, en premier lieu en Asie. Pour Paul Valéry, l’Europe qui s’est construite sur des apports extérieurs, a été organisée par Rome : « Rome est le modèle éternel de la puissance organisée et stable ». Rome a organisé politiquement l’émergence de deux valeurs principales, celle de la raison et celle de l’intériorité. La première est la vertu des Grecs, la seconde celle du christianisme. De même que l’Empire romain n’hésitait pas à attribuer aux habitants des peuples si différents qui le composaient le titre de civis romanus, la religion chrétienne s’est imposée dans l’Empire romain en imposant cette même idée d’universalité, par un dieu commun, des fidèles communs et un droit commun. La différence essentielle qu’ajoute le christianisme tient au fait que l’universalité reconnue par l’Empire romain concernait la chose publique – la res publica – alors que le christianisme étend cette universalité à la conscience. Est découvert avec le christianisme ce que les modernes appellent l’intériorité et que les Anciens, romains ou grecs, ne connaissaient pas. Pour Paul Valéry, la découverte de l’intériorité rapproche l’Européen de l’Inde et de l’Asie, continent qui reconnaît dans ses cultures l’existence d’un monde intérieur en chaque homme. A l’universalité de la vie publique et à celle de la vie intérieure, s’ajoute l’universalité de la raison, née dans la Grèce antique. C’est précisément cette « discipline de l’Esprit » qui « distingue peut-être le plus l’Européen de tous les hommes ». L’Empire romain a ainsi été le cadre et le moule de l’idée chrétienne et de la pensée grecque.
Que retenir de cette thèse au-delà de la question de son exactitude historique ? Elle a le mérite de mettre au cœur de l’identité européenne la notion d’universalité et partant de faire sortir la définition des valeurs européennes de considérations distinctives comme celles de peuple, de territoire ou de « race » (terme que l’on retrouve encore dans le texte de Valéry). Ce cadre historique délimité est la condition de possibilité d’une sortie de ce cadre, c’est-à-dire, que, dans la pensée de Valéry, si c’est en Europe (au sens géographique) sous l’influence historiquement marquée de l’Empire romain, du christianisme et de la pensée grecque, qu’est née la psyché européenne, celle-ci, sur ces fondements, est possiblement illimitée dans l’espace. Il faut donc retenir de cette thèse qu’elle fixe l’Europe historiquement tout en la libérant de son cadre géographique.
L’historien et essayiste Emmanuel Berl, auteur notamment d’une Histoire de l’Europe, a réagi avec virulence à cette thèse de Paul Valéry. La phrase célèbre de Berl résume bien sa pensée et frappe par sa simplicité : « Quand Valéry déclare qu’Athènes + Rome + Christianisme = Europe, on se demande où il a l’esprit. Faust, Don Quichotte, Iseut sont-ils vraiment des Grecs organisés par Rome et baptisés par Saint-Paul ? ». Pour Berl, l’Europe est protéiforme et aucune culture historiquement marquée ne l’emporte sur l’autre : s’il faut tenir compte des origines christiano-greco-romaines de l’Europe, il faut aussi tenir compte des influences arabes, sémites, celtes, germaniques, asiatiques, sans fixer de hiérarchie dans la paternité des valeurs de l’Europe. L’existence même de ce questionnement est pour Berl anti-européen, c’est-à-dire qu’il est marqué par les rivalités nationalistes européennes nées au début du 19e siècle et exacerbées au 20e siècle.
Le grand mérite de la thèse de Berl est d’identifier le risque qu’en fondant l’identité européenne et en établissant sa généalogie, on mette l’Europe en désordre, que l’on pose ses parties constitutives en rivalité les unes par rapport aux autres. A l’époque de Valéry, les thèses qui partirent d’une origine gréco-romaine de l’Europe agacèrent les tenants d’une origine celte et germanique de l’Europe. Ainsi, Denis de Rougemont, l’auteur de De l’amour en Occident, mais également Du journal d’Allemagne (1938), pourfend l’exacerbation des distinctions culturelles au sein de l’Europe et pose les bases d’un fédéralisme européen intégral, sur le modèle suisse. Faire la généalogie des valeurs européennes a toujours conduit à des risques d’exacerbation et de tensions politiques. Dans chaque cas, les généalogies de l’Europe poussent à définir des valeurs qui clivent, qui exaltent des différences irréconciliables, qui distinguent les personnes entre elles, et éloignent finalement l’Europe de la valeur que nous avons définie comme étant celle de la curiosité envers l’autre (eurus-ops) et de l’universalité qui a été établie sous l’empire romain pour la vie publique, dans l’idée chrétienne pour la vie intérieure et dans la pensée grecque pour la vie de l’esprit.
L’actualité récente a encore été le témoin de cette tendance à l’élaboration d’une généalogie des valeurs qui clivent l’Europe en différentes parties. Ainsi, dans l’hebdomadaire Marianne, suite aux désaccords entre la France et l’Allemagne sur leur politique économique respective, le sociologue et démographe Emmanuel Todd a publié une tribune expliquant comment les heures de gloire de l’Europe furent celles de l’Europe du Sud gréco-latine tandis que les heures sombres appartenaient à l’Europe du Nord, germanique. Il en appelait ainsi à un « principe de précaution historique » vis-à-vis de l’Allemagne : « L’Allemagne, qui a déjà foutu en l’air deux fois le continent, est l’un des hauts lieux de l’irrationalité humaine. L’Allemagne, c’est une culture immense, mais terrible parce que déséquilibrée, perdant de vue la complexité de l’existence humaine. (…) L’Europe ne serait-elle pas, depuis le début du XXe siècle, ce continent qui se suicide à intervalles réguliers sous direction allemande. Oui, un « principe de précaution » doit être appliqué à l’Allemagne ! »[6]. Illustration flagrante de l’exacerbation des violences lorsque la question de l’identité des valeurs européennes est mise en doute dans la recherche de ses origines.
Rémi Brague, dans son ouvrage Europe, la voie romaine, considère l’identité européenne comme « excentrique ». Jean-François Mattéi parle lui d’ « identité ethnodécentrée » et c’est précisément en cela que le caractère tout à fait spécifique de l’identité européenne permet de répondre aux craintes que d’aucuns ont émises devant les violences du réflexe identitaire : l’identité européenne est moins construite de l’extérieur selon la théorie schmittienne par laquelle ce sont nos ennemis qui nous définissent que par son ordre interne harmonieux, mais néanmoins paradoxal dans la mesure où cet ordre interne s’abreuve hors de lui pour sans cesse s’enrichir et se transformer. Je cite Jean-François Mattéi dans Le regard vide : « L’identité humaine n’est pas un principe immuable comme en logique où A est identique à A, en ontologie où l’être est l’être, et en théologie où Dieu est Dieu ; elle est un mouvement dynamique d’intégration des singularités en un même espace symbolique que les protagonistes identifient sans difficulté (…) Il me paraît donc évident qu’aucune identité n’est substantielle, qu’aucune culture n’est insulaire et qu’aucune société n’est close »[7].
Associée aux travers du 20e siècle, cette identité universalisante fut méthodiquement déconstruite jusqu’à l’émergence d’une identité impossible, qui sous-tend encore la construction européenne
Tout au long de son histoire, l’Europe et son regard tourné vers l’extérieur auraient-ils fait de cette identité un usage tellement extensif et détourné qu’elle ne mériterait ainsi plus de porter son nom ? Guerres de religion, esclavage, colonisation et totalitarismes ont-ils poussé le niveau d’autocritique de l’Europe à un degré tel qu’elle viendrait elle-même à nier son identité ? Telle est la question que soulève entre autres Chantal Delsol à l’endroit de l’Europe[8] et que l’on peut plus largement étendre au « long sanglot de l’homme blanc » et à la « tyrannie de la pénitence » que Pascal Bruckner a décrit il y a plus de trente ans de cela.
Il est possible que la construction européenne, solution pleine de sagesse pour mettre fin à la barbarie nazie, se soit construite dès le départ sur une forme plus ou moins consciente du refus de dire sa propre identité de peur de réveiller les vieux démons qu’elle était chargée de chasser pour de bon. Souhaitant prendre acte que l’identité européenne était un « hors de soi » et que partant elle ne reposait pas sur un « en dedans » minimal, la construction européenne s’est faite non sur un terreau politique et culturel, mais sur un terrain d’une autre sorte, celui de l’économie et du droit. Si l’expression de citoyenneté européenne est aujourd’hui admise dans les textes de droit primaire (c’est-à-dire dans les traités) et de droit dérivé (c’est-à-dire dans le droit produit par l’Union européenne elle-même : directives, règlements, etc), la figure du citoyen n’est pas le cœur du moteur européen, qui lui préfère deux figures plus universelles et moins singulières : le consommateur et le sujet de droit. Si l’on devait caricaturer à grand trait le mouvement européen, celui-ci serait marqué à gauche par une Europe juridique et à droite par une Europe économique. La culture dans les mots de l’Union européenne n’est rien d’autres qu’un bien économique parmi d’autres, soumis aux mêmes règles de libre-concurrence et de libre-échange. En tant qu’objets proprement culturels, ils obéissent aux lois libérales de la neutralité la plus farouche : chacun fait siens les biens culturels que ses préférences individuelles lui dictent. Et disons-le tout de go : c’est un progrès dont chaque consommateur/sujet de droit européen profite avec délice chaque jour ! Mais s’il est un terrain sur lequel la construction européenne n’a pas formé ses membres en tant que citoyens européens, c’est bien sur l’identification à une culture européenne. Comme « mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde » notait Albert Camus, et que ces mots de culture et d’identité peuvent si facilement être mal compris, précisons qu’il ne s’agit pas de parler d’une identité européenne qui serait fixée substantiellement de sorte à ce qu’elle s’abattrait de manière immuable et en bloc sur chaque citoyen, mais tout au contraire d’une identité au sens dynamique qui serait beaucoup plus proche de ce que Paul Ricœur a nommé « une identité narrative », c’est-à-dire qu’un récit se forme, récit que chacun participe à établir et à interpréter.
Dans « La négation de l’identité européenne »[9], Jean-François Mattéi décrit avec précision la déconstruction méthodique de l’identité européenne par ceux qui l’avait construite, les clercs : on pourrait dire que Jean-François Mattéi annonce après Julien Benda une seconde trahison des clercs. Les clercs, de Bacon et son « Nos Europäi »[10] à Valéry, en passant par Montesquieu et Hugo, n’ont jamais douté de l’identité européenne et des valeurs universelles qu’elle portait singulièrement. Mais voilà l’Europe s’est chargée de tous les crimes en devenant au nom de principes universels la force colonisatrice du monde… Et, depuis la Seconde Guerre mondiale, de nombreux intellectuels de pourfendre l’idée même d’une identité européenne. Jean-François Mattéi explicite longuement la déconstruction identitaire, manifestée par l’indécidabilité des principes culturels attachés à l’Europe, déconstruction proposée notamment par Jacques Derrida. Dans son ouvrage L’autre cap (1991), Jacques Derrida propose de déconstruire le capital de la culture européenne en remettant en cause autant l’eurocentrisme que l’anti-eurocentrisme, c’est-à-dire pour Mattéi en remettant en cause autant le monopole que la dispersion de la culture européenne, ou encore autant son universalité que sa particularité. Pour Derrida, l’Europe, qui tire son identité de sa non-identité, doit se soumettre à une obligation paradoxale : elle doit faire l’expérience de la possibilité de l’impossibilité et ainsi créer la possibilité d’une invention impossible, voie nouvelle que Derrida ne décrit pas précisément. Le déconstructionniste poursuit en reprenant l’image du cap de Paul Valéry (l’Europe est le cap occidental de l’Asie) : l’Europe ne devrait pas choisir un autre cap (c’est-à-dire à la fois une direction et une directive), mais l’autre du cap. Formule énigmatique s’il en est qui renvoie à son livre La dissémination : cela signifie qu’en sortant de la logique du cap, l’Européen doit, face à sa propre culture, « perdre la tête », « ne plus où savoir donner de la tête » ou encore pratiquer dans le temps « une coupure », une « castration » ou une « tête coupée »[11]. Pour Mattéi, « ce projet de déconstruction est un suicide programmé dans le renoncement à la culture propre de l’Europe ».
Voici la phrase de Mattéi par laquelle est apparue la possibilité que l’euroscepticisme pourrait paradoxalement venir de ce que la construction européenne porte en elle un rejet profond de l’identité propre de l’Europe : « Si j’ai cité longuement Derrida, c’est que je crains que les Etats européens ne souscrivent à cette auto-infection en supprimant les défenses immunitaires de leur propre culture »[12]. Si Mattéi exprime la crainte que les Etats portent ce projet, ceci est peut-être encore plus vrai de l’Union européenne, qui dans sa forme actuelle technocratique et dans l’économisation et la juridicisation par lesquels elle opère, abandonne l’idée d’un projet politique dont le moteur serait aussi la culture européenne partagée par ses membres. Pour être très précis, le Conseil n’est pas en soi une instance technocratique et il devait être au départ le lieu privilégié d’une vraie stratégie politique : mais à vingt-sept, l’entente n’est pas possible, de sorte que l’impuissance du Conseil amène à un regain de technocratie au sein du couple Parlement/Commission depuis que la procédure législative ordinaire (en vigueur depuis le Traité de Lisbonne) donne autant de poids à ces deux dernières institutions (la Commission restant la détentrice du pouvoir d’initiative législative).
A l’heure où l’Europe ne dicte plus le cours de l’histoire, il est d’autant plus possible de reconstruire une identité européenne singulière
S’il est une réalité aujourd’hui, c’est bien que l’Europe n’est plus le centre du monde, loin s’en faut, et notre monde multipolaire est d’abord mû par des pays tels la Chine, les États-Unis ou la Russie. L’Europe qui a par le passé transformé sa curiosité universelle pour ce qui n’est pas elle en un impérialisme mortifère n’est plus en mesure de réitérer les erreurs qu’elle a commises dans son histoire : la blessure coupable que nous portons en nous-mêmes n’a plus lieu d’être aujourd’hui. En un sens, l’identité européenne retrouvée est à portée de main : notre prétention totalisante à l’universel n’est plus, par le fait même que notre puissance s’est estompée et, en même temps, notre faiblesse relative nous offre la possibilité de repenser notre identité non plus de manière impérialiste, mais au contraire dans une singularité propre. Notre petitesse pourrait être notre meilleur allié pour construire un rapport à soi renouvelé. Cette tâche est d’autant plus urgente que, en apprenti sorcier qui voit sa créature lui échapper, l’Europe a tellement étendu par le passé ses valeurs qu’elle ne peut plus en revendiquer l’exclusivité. Il nous faut donc nous les réapproprier d’abord pour nous-mêmes.
Jacques Dewitte note que pour s’identifier à une culture propre et singulière, l’Europe devrait renouer avec sa mythologie et encourager son « identité narrative ». Les valeurs abstraites valent partout et tout le temps : dès lors qu’elles ne sont exprimées qu’avec les atours de la rationalité, elles ne suffisent pas à forger une identité incarnée et manifeste par laquelle les membres d’une communauté peuvent s’identifier et ensuite s’exprimer. Je cite : « En évoquant des œuvres auxquelles nous sommes attachées et des monuments de la civilisation européenne, pour échapper à la mise en évidence exclusive des idées, des concepts et des valeurs, on introduit une nouvelle étape dans la réflexion sur le caractère problématique de l’identité européenne et de l’identité en général. Les œuvres et les monuments constituent autant de médiations, de tiers termes qui nourrissent notre rapport identificatoire à nous-mêmes et l’empêchent de rester seulement identitaire »[13]. En passant par le biais des œuvres et des monuments de la culture européenne pour déterminer quelle est son identité, le citoyen européen ne va pas chercher cette identité en son for intérieur, dans son intériorité mais, au contraire, dans une extériorité qu’il a construite et qui vit en dehors de lui. On peut penser au concept de « lieu de mémoire » que Pierre Nora a forgé et défini ainsi : « un lieu de mémoire va de l’objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l’objet le plus abstrait et intellectuellement construit »[14]. Par les opéras, les modèles des villes, le théâtre, les écoles de peinture, les cafés comme lieux spécifiques de discussion et de rencontre (note George Steiner[15]), par toutes ces petites ou ces grandes choses objectivables, les membres d’une communauté aperçoivent leur identité toujours en formation. Ça n’est ni plus ni moins la définition que Claude Lévi-Strauss donnait d’une identité comme « foyer virtuel » de tous les caractères dominants d’une culture.
Si l’identité européenne ne peut exister sans remythification de sa culture et de ses valeurs pour pallier l’oubli européen, la défiance à l’endroit de l’Union européenne ne pourra être réduite sans une part nouvelle de mythe politique. A cet effet, le philosophe Peter Sloterdijk a peut-être découvert un autre pan de l’identité politique de l’Europe.Dans Si l’Europe s’éveille, Sloterdijk propose une lecture étonnante de l’Europe qui répond par la même occasion aux politologues qui se demandent si l’Union européenne est une fédération, une confédération ou – acceptons l’oxymore – une fédération d’Etats-nations. L’auteur de Colère et temps rappelle en effet que l’Europe a toujours été un Empire : « la fonction quintessentielle de la constitution de l’Europe tient dans un mécanisme de transfert de l’Empire » reprenant la Translatio Imperii Romani médiévale inaugurée par Charlemagne[16]. Je cite encore : « L’Europe se met en marche dans la mesure où elle parvient à revendiquer l’Empire qui existait avant elle et à le transformer » de sorte que l’identité européenne serait une sorte de « métempsychose de l’Empire romain » qui serait ainsi sa « cellule mytho-motrice ». Or, pour Sloterdijk, depuis la Seconde Guerre mondiale et la logique bipolaire initiée par la Guerre froide, les Etats-Unis ont hérité de cette cellule mytho-motrice de sorte que « l’Europe observe aujourd’hui la forme extérieure de sa propre essence » dans l’empire américain.
Sloterdijk semble croire que l’Europe pourrait échapper à la sortie de l’histoire dans laquelle elle s’est enfermée depuis 1945 et dont les institutions européennes contemporaines en matière de politique étrangère sont archétypales. Si elle parvenait à refaire sienne le mythe de l’Empire et à créer un « rapport à soi constitutif », elle aurait probablement l’occasion de se rendre compte que sa culture si évolutive et en même temps si singulière aura à jouer un rôle essentiel dans le monde multipolaire de ce début de siècle.
En son temps, Stefan Zweig a dépeint l’un des plus beaux panoramas du foyer virtuel de l’Europe, à la fois par son caractère exceptionnel et son extrême fragilité. Dans Le monde d’hier, Souvenirs d’un européen (1941), il écrit : « Le génie de Vienne a toujours été d’harmoniser en soi tous les contrastes ethniques et linguistiques, sa culture est une synthèse de toutes les cultures occidentales ; celui qui travaillait et vivait là se sentait libre de toute étroitesse et de tout préjugé. Nulle part il n’était plus facile d’être un Européen »[17]. Il y a dans ces quelques mots une richesse prodigieuse pour décrire l’Europe : « l’harmonisation en soi » décrit la nécessité d’un rapport à soi constitutif qui repose sur un ordre interne ; la « synthèse de toutes les cultures occidentales » définit le « foyer virtuel » ; être « libre de toute étroitesse » évoque l’étymologie d’Europè et son regard tourné vers le lointain ; être « libre de tout préjugé » symbolise la psyché européenne comme curiosité portée vers ce qui n’est pas soi. Alors, il est finalement possible de sortir de l’oubli européen et, avec Bacon, Valéry, Zweig et tous les autres, de dire de nouveau « Nous, les Européens ».
[1] BACON Francis, « Nos Europäi », De Augmentis (version latine allongée de The Advancement of Learning, 1605), 1623, cité dans HALE John, La civilisation de l’Europe à la Renaissance, Paris, Perrin, 1998, p. 3.
[2] MANENT Pierre, La raison des nations, Paris, Gallimard, 2006, p. 93-94.
[3] DEWITTE Jacques, « Comment parler de l’identité européenne ? », in L’identité de l’Europe, dir. DELSOL Chantal, MATTEI Jean-François, Paris, PUF, 2010, p. 134.
[4] VALERY Paul, Regards sur le monde actuel, Œuvres II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 989.
[5] BRAGUE Rémi, Europe, la voie romaine, Paris, Gallimard, 1992.
[6] Entretien avec Emmanuel Todd, « Goodbye Hollande ! », journal Marianne du 12 mai 2013.
[7] MATTEI Jean-François, Le regard vide. Essai sur l’épuisement de la culture européenne, Paris, Flammarion, 2007, p. 18.
[8] DELSOL Chantal, MATTEI Jean-François (dir.), L’identité de l’Europe, Paris, PUF, 2010.
[9] MATTEI Jean-François, « La négation de l’identité européenne », in L’identité de l’Europe, Paris, PUF, 2010.
[10] Op. Cit. p. 1.
[11] DERRIDA Jacques, La dissémination, Paris, Seuil, 1972.
[12] MATTEI Jean-François, « La négation de l’identité européenne », in L’identité de l’Europe, Paris, PUF, 2010, p. 155.
[13] DEWITTE Jacques, « Comment parler de l’identité européenne ? », in L’identité de l’Europe, dir. DELSOL Chantal, MATTEI Jean-François, Paris, PUF, 2010, p. 140.
[14] NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, vol. 1, Paris, Quarto-Gallimard, 1997.
[15] STEINER, George, Une certaine idée de l’Europe, Arles, Actes Sud, 2005.
[16] SLOTERDIJK, Peter, Si l’Europe s’éveille, Paris, Mille et une nuits, 2003, p.52.
[17] ZWEIG, Stefan, Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Paris, Belfond, 1993, p. 9.