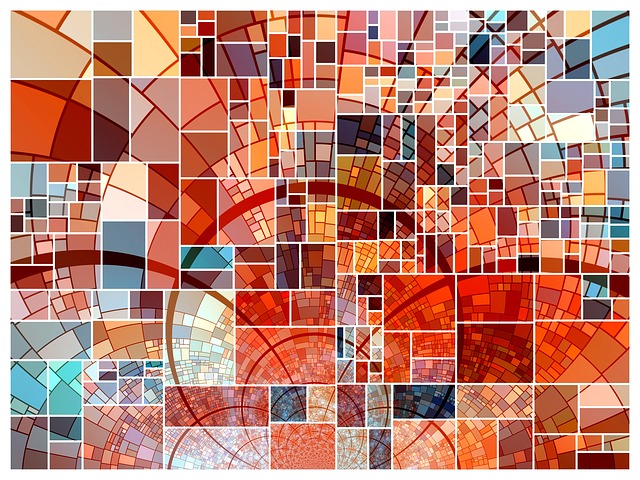De l’identification de l’Europe à la légitimation de l’UE
Janie Pélabay – Chargée de recherche FNSP Sciences Po – CEVIPOF (UMR 7048)
Tant dans les discours publics que dans les travaux académiques portant sur l’intégration politique de l’Europe, on trouve un ensemble de postures normatives qui exhortent à une identification de l’Europe. Les appels au partage d’une « identité européenne » ne sont certes pas nouveaux, mais ils prennent une acuité particulière en ces temps de profond « malaise européen »[1]. Face à la défiance populaire que suscite une politique européenne menée « d’en haut », l’invocation d’une identité commune fait souvent figure de dernier recours pour ramener la discussion vers les citoyens et les peuples européens, et de vecteur privilégié pour les entretenir des défis de l’unité et de la solidarité européennes. Via la thématique identitaire, l’objectif est bel et bien de donner de la « chair », de la « densité » ou de l’« épaisseur » (« thickness ») à ce que d’aucuns espèrent voir émerger sous les traits d’une « communauté » européenne, au sens fort du terme, qui l’associe à celui de Gemeinschaft. C’est qu’en effet, il n’est pas rare que la crise de légitimation de l’Union européenne (UE), corrélée au constat récurrent de son « déficit démocratique », soit interprétée comme relevant d’un déficit d’identité substantielle, voire d’un « déficit de communauté »[2]. D’où la volonté de (re)donner de l’épaisseur éthique et de la profondeur historique au projet politique européen en l’enracinant dans un fonds commun de ressources sémantiques déposées dans un « héritage », une « mémoire » ou un « patrimoine » de l’Europe.
Menée au nom de la clarification et de la promotion de « notre » commune « Européanité »[3], cette quête de sens et d’authenticité peut prendre plusieurs directions. Cependant, qu’il s’agisse de lester l’Europe politique d’un ensemble de convictions éthico-existentielles ou de sources historico-culturelles, l’Europe s’y trouve saisie sous deux aspects dont la superposition est, en tant que telle, caractéristique de la démarche identificatrice, tout autant qu’elle est révélatrice de sa teneur problématique. Pareille superposition concerne l’Europe comme legs civilisationnel et l’UE comme construction politique. Dans son sillage, deux visées pratiques se trouvent confondues, qui correspondent respectivement à une identification substantielle et une légitimation processuelle. Or, de telles jonctions ne vont pas de soi, a fortiori quand elles s’appliquent à un ordre politique aussi pluraliste que l’UE, c’est-à-dire travaillé par une grande diversité de pôles d’identités collectives et, surtout, par une pluralité antagoniste de conceptions relatives à ce qu’est et/ou devrait être le projet d’une Europe politiquement intégrée.
Dans ce qui suit, je voudrais interroger, sous un angle critique, la logique sous-jacente à l’exigence d’identifier l’Europe afin de sortir l’UE de sa crise de légitimité. Car il existe de solides raisons pour vouloir résister aux couplages effectués par cette logique et pour lui substituer une approche où l’attention portée au caractère politique de l’intégration européenne s’accompagne d’un net recentrage sur le besoin de justification publique, indépendamment de considérations identitaires quant à la substance particulière de l’Europe.
La quête d’Européanité ou la « communautarisation » de l’UE
Avec les plaidoyers en faveur d’une identification de l’Europe, c’est la dimension proprement politique du projet européen qui passe au second plan. La logique identificatrice procède, en effet, d’une subsomption du politique sous les impératifs d’une « intégration éthique ». Autrement dit, si cette logique en vient à « communautariser » l’UE, c’est parce qu’elle postule que l’intégration européenne repose sur la reproduction et la défense des « orientations éthiques de base d’une forme de vie culturelle »[4], en l’espèce : « l’Europe ». À rebours du découplage opéré par Jürgen Habermas entre identité nationale et citoyenneté démocratique, les partisans de la quête d’Européanité dénient toute puissance politiquement constitutive aux formes d’intégration axées sur l’attachement aux libertés fondamentales et aux normes juridiques régissant la « polity » européenne mais aussi à celles qui misent sur l’exercice des droits et l’extension des pratiques civiques qu’ouvre formellement la citoyenneté de l’Union.
« Communautarisée », l’Europe politique l’est ici, très précisément, au sens où l’application de la logique identificatrice à l’UE reconduit cette thèse phare de la pensée communautarienne qu’est le lien nécessaire entre identité et légitimité. Poser ce lien à l’endroit de l’UE, c’est estimer que la légitimité des institutions européennes est fonction de leur capacité à exprimer, à incarner, à promouvoir publiquement les « compréhensions partagées du bien »[5] constitutives d’une Européanité, elle-même susceptible de soutenir démocratiquement l’UE. Se revendiquant d’une démarche Euro-communautarienne, Amitai Etzioni préconise ainsi un « épaississement [thickening] »[6] éthique de l’Europe politique. Plutôt que de rester au milieu du gué – Etzioni parle à ce sujet d’une « halfway integration » strictement économique et fonctionnelle – il souhaite que l’UE advienne sous la forme d’une communauté « normative-affective », caractérisée par (1) un « noyau dur de valeurs partagées » (« a core of shared values ») et (2) par un « réseau de liens affectifs » qui ne confinent pas à de simples relations interpersonnelles[7]. Définie de la sorte, l’entreprise de « community building » reposerait sur des « dialogues moraux transnationaux » au travers desquels les citoyens européens s’emploieraient à élucider et à exprimer publiquement « les valeurs qui devraient guider leurs vies »[8]. De tels « dialogues » seraient alimentés par des convictions éthiques, voire religieuses, à propos de sujets hautement controversés, tels que la discrimination positive, le traitement des demandeurs d’asile, la reconnaissance du mariage gay, la peine de mort et, pour ce qui est plus spécifiquement de l’UE, le contrôle des frontières, l’immigration illégale, la lutte contre le terrorisme. Au final, cette politique du « bien commun de l’UE » reproduit la jonction entre identité et légitimité, puisqu’elle vise à forger une communauté européenne « dont les institutions sont considérées comme légitimes dans la mesure où leur configuration et leurs actions sont compatibles avec les valeurs partagées », autant dire : des « valeurs particularistes »[9].
On retrouve la même urgence à défendre l’« identité européenne » dans une autre forme de communautarisation de l’UE, procédant plutôt d’une autoclarification des sources de l’Europe entendue comme « civilisation » et « culture ». C’est un geste généalogique que requiert cette entreprise. Sauf qu’il ne s’agit pas ici d’aller puiser dans l’histoire politique de la construction européenne, ni même dans les narratives des « pères fondateurs » de l’UE[10]. Afin de produire l’« épaississement » recherché, il est recommandé de se lancer à la (re)découverte de racines nettement plus profondes, et même si profondes qu’elles ont pu être enfouies, voire occultées. Ce sont les sources qui nous rattacheraient à un patrimoine riche de « concepts ou de postulats fondamentaux » devant être « assumés à la racine », faute de quoi « l’objet dont il est question » serait entraîné « dans le non-être ». Ainsi Chantal Delsol explique-t-elle qu’« il en va de l’existence même de l’Europe qui, si elle n’ose pas s’identifier ni nommer ses caractères, finit par se diluer dans le rien », avant de poursuivre : « Il s’agit de montrer que nul être, objet, institution, ne peut exister sans être dit, caractérisé et défini. »[11] Selon la formulation retenue par Jean-François Mattéi, l’objectif est de mettre « en évidence ce qui relève d’une identité propre à la seule Europe »[12]. Au demeurant, l’Europe ne souffrirait pas seulement d’un déficit d’identité ; selon Jacques Dewitte, elle serait en proie à « une crise de l’idée même d’identité qui accompagne et double la crise de l’identité européenne »[13]. Traduite tour à tour dans les termes de la « renonciation », de la « déconstruction », de la « condamnation » ou de la « désappropriation », le « refus » de l’identité condamnerait l’Europe à un déni, voire à une forme de haine de soi nourrie de la contestation de l’impérialisme et du « colonialisme culturel »[14]. A trop vouloir s’adonner à « la mise en question critique de l’identité européenne », on se refuserait à « accorder une signification à l’idée d’Europe, c’est-à-dire un contenu substantiel, le terme même d’Europe n’étant plus qu’un mot vide de sens »[15]. Ce serait également retourner contre « la culture européenne » les « principes » et les « outils intellectuels » qu’elle a forgés, non sans laisser le champ libre au « processus mortifère par lequel les élites européennes en viennent à se nier elles-mêmes »[16]. Plus gravement encore, ce front anti-identitaire risquerait de priver l’humanité « de toutes les inventions apportées au monde ou perfectionnées par les Européens durant les cinq derniers siècles »[17]. Exemplifié par les multiples « innovations techniques […] rendues possibles par les progrès scientifiques qui sont au cœur de l’esprit européen » – pour n’en reprendre que quelques-unes citées par Jean-François Mattéi : la lunette astronomique, le journal, la transfusion sanguine, l’avion, le Nylon ou l’aspirine – « ce chapelet interminable d’inventions », auquel s’adjoint des « normes intellectuelles, politiques et morales » toutes redevables au principe d’ouverture à autrui et au monde caractérisant la « civilisation européenne », attesterait du « génie de l’Europe » et de sa « fécondité » insigne[18].
Les pièges de la logique identificatrice
Plusieurs difficultés, d’ordre à la fois théorique et pratique, surgissent de cette identification de l’Europe et de la communautarisation de l’UE qu’elle impulse.
En premier lieu, il est loin d’être avéré que la logique identificatrice soit de nature à prétendre à une quelconque fonction de légitimation, ni qu’elle puisse, en tant que telle, répondre à l’exigence d’un approfondissement démocratique de l’UE. En effet, la clarification d’un socle identitaire fait d’héritages civilisationnels et de convictions éthiques relève d’une démarche fondationnelle, et non pas justificationnelle. Plus précisément : c’est en vertu de leur caractère fondateur que les sources et biens ainsi clarifiés sont directement propulsés au rang de critères publics de légitimation. Néanmoins, la question reste entière de savoir comment s’effectue le passage de la clarification d’un ethos communautaire à la détermination d’un telos public. En quoi des considérations (factuelles) sur l’existence et la prégnance de certains fondements historiques et éthiques permettent-elles de déboucher sur des considérations (normatives) ayant trait à ce que devraient être les finalités politiques de l’Union ? Ces deux registres d’argumentation sont irréductibles l’un à l’autre. Car c’est une chose que de s’attacher à clarifier un « patrimoine », un « arrière-plan » de ressources éthiques et de contenus sémantiques tenus, à tort ou à raison, pour fondateurs d’une identité européenne, et c’en est une autre que de chercher une base de justification publique autour de règles, de principes et de normes susceptibles d’opérer en tant que vecteur de légitimation de l’Union européenne, entendue comme projet et entité politiques.
Aussi, la première difficulté à laquelle se heurte l’entreprise autoclarificative réside-t-elle dans une confusion entre deux registres d’argumentation : d’un côté, « une approche contextualisante et interprétative » et, de l’autre côté, « une approche universalisante et analytique »[19]. On l’a montré, la première appréhende l’intégration européenne sous l’angle d’une identification de l’Europe : elle consiste à comprendre, de l’intérieur d’un cadre spécifique de « significations communes », la portée éthico-existentielle d’une tradition dont l’élucidation supporte la quête d’Européanité. Or, il faut se demander aux cotés de Lynn Dobson si un tel « dévoilement » possède « un quelconque potentiel critique » ou s’il « mine » cette possibilité. Plus encore, la démarche identificatrice est-elle capable de « produire des critères de jugement normatif en fonction desquels les institutions et les politiques pourraient être évaluées et orientées » ? Ne revient-elle pas à définir « ce en quoi consiste être un authentique européen » ? Et ne se limite-t-elle pas, sur cette base, à « commander notre fidélité »[20] ?
C’est au regard de ces questions qu’apparaît la faiblesse pratico-normative de l’identification européenne. Trop complaisante envers le statu quo traditionnel, cette démarche se prive des potentialités autocritiques et innovatrices d’une raison certes descendue de son ciel transcendantal mais qui n’en conserve pas moins une vocation émancipatrice[21]. Potentialités qui se trouvent prises en charge, dans le domaine politique, par un processus de justification publique venant forcément déstabiliser la puissance légitimatrice trop rapidement octroyée aux cadres identitaires. Cela ne signifie pas que les sources ou les biens attachés à quelque « identité européenne » ne puissent avoir aucun rôle cognitif ou informatif : à l’évidence, ils alimentent la narration identitaire dès lors qu’il est question de savoir d’où l’on vient et quelles ressources sémantiques sont encore mobilisables. Reste que, d’un point de vue argumentatif, aucun critère de légitimité politique ne se laisse immédiatement déduire d’une logique ne parvenant pas à se hisser au-delà de la formulation, si ce n’est de la reproduction, d’un arrière-plan de sources ou de biens partagés – sauf à engager ladite « communauté européenne » sur la voie d’une « quasi-nation »[22]. Quant aux retombées pratiques de cette démarche, elles se jaugent à l’aune des usages politiques de l’Européanité, qui sont loin d’être dénués de tout risque d’essentialisation. À nouveau, cela n’implique pas de renoncer au nécessaire « travail d’historicisation de la construction et de l’intégration européennes » ; mais – comme l’explique Yves Déloye – l’inscription de « la question des origines » sur « l’agenda politique » de l’UE est porteuse d’ambiguïtés redoutables, révélant « les apories d’une politique de la citoyenneté européenne qui reste encore prisonnière des cadres imaginaires et muséographiques inventés à un âge des États-nations que l’UE a vocation à bousculer, voire à dépasser »[23].
Tel est, en effet, le cœur du problème : quand bien même on rétorquerait que les tentations d’un Euro-nationalisme et d’une « substantialisation rampante »[24] de l’intégration européenne sont purement fictives, force est d’admettre que ce n’est pas en « identifiant » l’Europe que l’UE peut espérer surmonter son déficit justificationnel.
Le pari de la légitimation publique
En raison de la « surcharge éthique »[25] qu’elle inflige à l’intégration européenne, la logique identificatrice rend l’UE peu crédible dans sa prétention à s’autoriser d’un projet politique en perpétuelle construction, éminemment inclusif, et non pas d’une quête – défensive ou offensive – d’Européanité. Pire, cette logique s’avère contreproductive. Elle l’est si l’on considère que l’une des causes de défiance à l’égard de l’UE demeure la crainte de voir les identités communautaires (en particulier, nationales) disparaître dans le grand ensemble européen. Toutefois, l’argument n’est pas ici d’ordre prudentiel. Même si l’UE parvenait à accommoder la pluralité de ses identités collectives internes dans ce qu’Amitai Etzioni envisage comme « une communauté de communautés »[26], c’est au plan principiel que l’identification de l’Europe se montre inappropriée. Non seulement elle ne fait que répliquer à l’échelle européenne une volonté de substantialisation du lien politique – se propageant aujourd’hui, dans nombre de nations européennes, au travers d’une rhétorique de « l’insécurité culturelle » –mais elle masque le caractère « politique » de l’intégration européenne, celui-là même qui permet de poser la question de la légitimation démocratique de l’UE.
Ce qui est en jeu dans cette question qui ne saurait être résolue par l’idée que justification et critique puisent elles-mêmes à une « tradition démocratique » dont l’Europe serait l’héritière, ce n’est pas l’identité européenne, c’est le projet politique de l’UE et sa mise en œuvre concrète. D’où la nécessité de disjoindre l’Europe et l’UE[27], et de « politiser » la réflexion. Par « politisation », on peut d’abord entendre un programme théorique, une ambition philosophique, consistant à étudier ce que l’intégration européenne fait aux concepts mêmes du politique, c’est-à-dire à des catégories de pensée aussi fondamentales que la démocratie, la souveraineté, l’État, etc. Investigation qu’inaugurent les penseurs de la « demoï-cratie », de la « souveraineté partagée », de la « co-souveraineté », voire d’une « post-souveraineté », ou encore d’une gouvernance « post-étatique »[28]. À présent, c’est une réflexion nettement plus pratique qu’engage la « politisation » précédemment évoquée : faut-il « politiser » le débat sur le sens du projet européen, sur ce que l’UE devrait faire, refaire ou défaire ?
« Politiser » ce débat, c’est tenir compte de ce que Jeremy Waldron nomme « les circonstances de la politique », à savoir : « le fait que nous vivons et agissons aux côtés de personnes avec qui nous ne partageons pas la même vision de la justice, des droits ou de la morale politique »[29]. Fait « indépassable » qui, selon Waldron, demande d’accepter que la politique consiste à répondre au besoin d’adopter un cadre commun, des décisions, des plans d’action, alors même que nous divergeons profondément sur ce qu’ils devraient être[30]. Ce postulat d’un désaccord sur les principes de base de l’ordre juridico-politique et d’un dissensus à propos de leur actualisation, une fois rapporté à l’UE et au problème de sa légitimation démocratique, met en lumière la pluralité conflictuelle des conceptions du projet européen, des attentes vis-à-vis des institutions européennes, des représentations d’un « nous » politique européen. Comment, dans une telle situation de « diversité profonde »[31], relever le défi de la légitimation ? Comment fonder un accord public et transnational, aussi minimal soit-il, compte tenu des désaccords sur les normes devant régir le processus d’intégration européenne et sur les orientations normatives devant guider les décisions et les mesures, notamment économiques, à mettre en œuvre au sein et au nom de l’UE ?
C’est là une question dont la complexité même concourt à son évitement, notamment par le recours à une logique identificatrice. Et pourtant, il s’agit d’un enjeu de fond que l’on ne saurait évacuer, a fortiori si l’on entend placer l’exigence de « politisation » au niveau de la justification publique et de ses ressorts pratiques. Surgit immédiatement une série de questions fort délicates. Dans ce cadre, qui est celui du débat politique, une multitude de visions d’Europe divergentes, et même mutuellement contradictoires, ne manqueront pas de s’exprimer, dont certaines feront reposer l’UE sur le respect de ses racines identitaires, en particulier religieuses, tandis que d’autres encore iront jusqu’à avancer des positions radicalement critiques ou même hostiles à l’égard d’une intégration politique de l’Europe. Procéder à cette ouverture pose, en premier lieu, un problème de traduction, non pas seulement d’une langue nationale à une autre mais d’un langage pour débattre de l’UE à un autre. Comment réaliser le passage d’un langage éthico-culturel, à un langage basé sur les droits, puis à un langage politique, dont la grande technicité, en matière d’affaires européennes, est loin d’être un simple alibi utilisé pour éluder le débat ? Se pose, en second lieu, le problème des limites de l’ouverture confrontationnelle ainsi préconisée : où placer les limites de l’hospitalité publique à des visions divergentes de l’UE ? En d’autres termes, quelles sont les limites du « publiquement raisonnable » en matière d’expression des désaccords au sujet du projet européen ? L’ensemble de ces questions donne au défi de la légitimation démocratique l’allure d’un pari tout à fait périlleux compte tenu du paysage politique actuel. En même temps, l’ampleur du « malaise européen » a également de quoi suggérer qu’on ne peut guère remettre à plus tard les efforts pour relever ce pari, à la condition toutefois de ne pas confondre Europe et UE, identité et légitimité.
[1] Jean-Marc FERRY, L’Europe crépusculaire, Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico, Paris, Éd. du Cerf, 2010, p. 13.
[2] Amitai ETZIONI, « The Community Deficit », Journal of Common Market Studies, vol. 45, n° 1, March 2007, p. 23-42.
[3] Définie par Jacques DEWITTE (« Comment parler de l’identité européenne ? », in Ch. Delsol et J.-F. Mattéi (dir.), L’identité de l’Europe, Paris, PUF, 2010, p. 141) comme « ce qui est spécifiquement, typiquement européen ».
[4] Sur la disjonction entre « intégration politique » et « intégration éthique », voir Jürgen HABERMAS, L’intégration républicaine [1996], trad. Rainer Rochlitz, Paris, Fayard, 1998, pp. 229-234.
[5] Amitai ETZIONI, « Affective Bonds and Moral Norms: A Communitarian Approach to the Emerging Global Society », International Politics and Society, n° 3, 2005, p. 132.
[6] Ibid., p. 127.
[7] Amitai ETZIONI, « The Community Deficit », art. cit., p. 24.
[8] Amitai ETZIONI, « Affective Bonds and Moral Norms », art. cit., p. 137.
[9] Amitai ETZIONI, « The Community Deficit », art. cit., pp. 32-34.
[10] Pour une démarche de ce type, voir Catherine GUISAN, A Political Theory of Identity in European Integration: Memory and Policies, Abingdon, Routledge, 2012.
[11] Chantal DELSOL, « L’affirmation de l’identité européenne », in Ch. Delsol et J.-F. Mattéi (dir.), op. cit., p. 1.
[12] Jean-François MATTÉI, « La négation de l’identité européenne », in Ch. Delsol et J.-F. Mattéi (dir.), op. cit., p. 156.
[13] Jacques DEWITTE, art. cit., p. 131.
[14] Jean-François MATTÉI, art. cit., p. 150-152.
[15] Ibid., p. 150.
[16] Façon dont Chantal DELSOL (art. cit., p. 7) résume le propos de Jean-François Mattéi dans le même ouvrage, la référence vague et convenue aux « élites » renvoyant chez ce dernier (p.150-151) à une constellation protéiforme d’auteurs incluant aussi bien Éric Hobsbawm que Jacques Derrida, Susan Sontag, Alain Badiou ou Marc Crépon.
[17] Jean-François MATTÉI, Le procès de l’Europe. Grandeur et misère de la culture européenne, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p. 18.
[18] Ibid., p. 18-25.
[19] Lynn DOBSON, « Normative theory and Europe », International Affairs, vol. 82, n° 3, 2006, p. 514.
[20] Ibid., p. 515.
[21] Sur ce point, je me permets de renvoyer à : Janie PÉLABAY, « Jürgen Habermas et Charles Taylor : jugement interculturel et critique de la tradition », Tracés, n° 12 “Faut-il avoir peur du relativisme ?”, 2007 /1, pp. 121-135.
[22] Cf. Jos de BEUS, « Quasi-National European Identity and European Democracy », Law and Philosophy, vol. 20, n° 3, 2001, pp. 283-311.
[23] Yves DÉLOYE, « Introduction : éléments pour une approche socio-historique de la construction européenne. Un premier état des lieux », Politique européenne, n° 18, 2006/1, p. 10-11.
[24] C’est en ces termes que Jürgen HABERMAS (« De la tolérance religieuse aux droits culturels », Cités, n° 13, 2003, p. 165) met en garde contre une fusion de la culture majoritaire et de la culture politique publique.
[25] L’expression est, là encore, de Jürgen HABERMAS, L’intégration républicaine, op. cit., p. 259.
[26] Amitai ETZIONI, « The Community Deficit », art. cit., p. 26.
[27] Sur les problèmes induits par un recoupement de l’Europe et de l’UE, cf. J. Peter Burgess, « What’s so European about the European Union. Legitimacy between Institution and Identity », European Journal of Social Theory, vol. 5, n° 4, pp. 467-481.
[28] Voir, entre autres : Richard BELLAMY, « ‘An Ever Closer Union Among the Peoples of Europe’ : Republican Intergovernmentalism and Demoicratic Representation within the EU », Journal of European Integration, vol. 35, n° 5, 2013, pp. 499-516 ; Samantha BESSON, « Europe as a demoi-cratic polity », Retfaerd Nordisk Juridisk Tidsskrift, 1/116, 2007, pp. 3-21 ; Francis CHENEVAL et Franck SCHIMMELFENNING, « The Case for Demoicracy in the European Union », Journal of Common Market Studies, vol. 51, n° 2, 2013, pp. 334-350 ; Jean-Marc FERRY, L’Europe crépusculaire, op. cit. ; Jürgen HABERMAS, La constitution de l’Europe, trad. Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 2012 ; Kalypso NICOLAÏDIS, « The New Constitution as European ‘Demoi-cracy’? », Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. 7, n° 1, Spring 2004, pp. 76-93, “The Idea of European Demoicracy”, in J. Dickson & P. Eleftheriadis (eds.), Philosophical Foundations of European Union Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 247-274, « European Demoicracy and its Crisis », Journal of Common Market Studies, vol. 51, n° 2, 2013, pp. 351-369.
[29] Jeremy WALDRON, Law and Disagreement, New York, Oxford University Press, 2004, p. 105.
[30] Ibid., p. 102.
[31] Pour une analyse du pluralisme de l’UE et de sa « diversité profonde », je me permets de renvoyer à : Janie PÉLABAY, Kalypso NICOLAÏDIS et Justine LACROIX, « Echoes and Polyphony: In Praise of Europe’s Narrative Diversity », in J. Lacroix and K. Nicolaïdis (eds.), European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 334-362, ainsi qu’à Janie PÉLABAY, « Vers une Union post-unanimiste ? Réflexions sur le sens de la devise européenne », in J.-M. Ferry (dir.), L’idée d’Europe. Prendre philosophiquement au sérieux le projet politique européen, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2013, pp. 55-92.