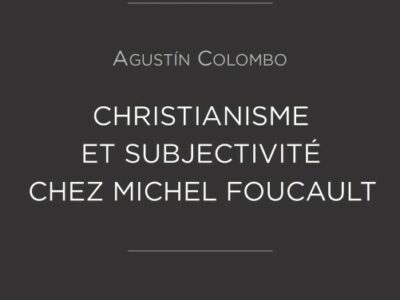De l’humanisme civique florentin au républicanisme européen
Recension : Maurizio Viroli, Républicanisme (1999), trad. Christopher Hamel, Paris, Bord de l’eau, 2011
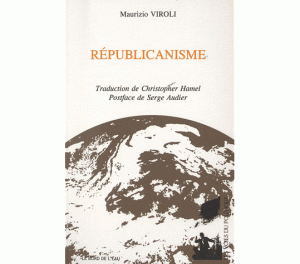
Paru en 1999 en Italie, le Républicanisme de Maurizio Viroli s’inscrit dans cette lignée d’ouvrages participant à ce que le philosophe Serge Audier, qui signe la postface de cette édition française, nomme le «renouveau républicain»[1]. Ces dernières décennies ont en effet été marquées par la redécouverte et la réappropriation d’une longue tradition de pensée politique républicaine grâce aux travaux de John Pocock, Quentin Skinner et Philip Pettit[2]. Dans cet ouvrage, Viroli se sert de sa double formation d’historien de la pensée politique et de théoricien politique pour à la fois retracer la genèse de la tradition républicaine et penser ses prolongations philosophico-politiques contemporaines. S’inscrivant foncièrement contre l’idée que le républicanisme ne serait qu’une critique archaïque de la modernité, le défi que se donne Viroli est de nous convaincre de l’actualité de la pensée politique républicaine. Le républicanisme est pour lui «une nouvelle utopie politique capable de réveiller les passions des citoyens libres que les idéaux politiques dominant la scène de cette fin de siècle — [il se] réfère ici au libéralisme et aux différentes formes de communautarisme — ne sont pas en mesure de maintenir vivantes et moins encore de faire naître» (p. 11).
Le républicanisme, une tradition de pensée d’origine italienne
Le républicanisme, tel que le définit Viroli, est une tradition de pensée politique caractérisée par deux idéaux, celui de la république comme communauté politique de citoyens fondée sur le droit et le bien commun (p. 7) ainsi que celui de la liberté comme absence de dépendance de la volonté arbitraire d’un ou de plusieurs hommes (p. 8). Il se caractérise aussi par son combat contre la corruption politique et la défense de la vertu civique des citoyens, qui s’avèrent nécessaires pour faire exister concrètement ces idéaux (p. 9).
Dans le premier chapitre du livre, Viroli veut mettre en lumière l’origine avant tout italienne du républicanisme moderne. Le républicanisme moderne serait né dans les républiques italiennes entre le XIVème et le début du XVème siècle et c’est seulement à partir de cette base que pourront se développer durant les siècles suivants des courants républicains aux Pays-Bas, en Angleterre, en France et aux États-Unis (p. 18). L’élément distinctif de ces républiques italiennes, par distinction avec d’autres formes de gouvernement de l’époque, est leur volonté que le maximum de citoyens puissent participer au pouvoir souverain (p. 20), par exemple grâce au principe de rotation des charges et au dispositif du tirage au sort. Nous pourrions voir ici la simple reprise du fonctionnement de la démocratie athénienne, mais ce qui différencie les républiques italiennes de celle-ci est qu’elles ne reposent pas sur l’esclavage (p. 23). C’est en cela que les historiens Sismonde de Sismondi et Carlo Cattaneo, auxquels se réfère Viroli, disent respectivement qu’elles furent l’une des expériences fondamentales de la liberté moderne.
Né dans les cités libres italiennes, le républicanisme semble ainsi constituer l’un des «fondements de la pensée politique moderne» tout en proposant une définition de «la liberté avant le libéralisme» pour reprendre les titres de deux ouvrages majeurs du chef de file de l’école de Cambridge qu’est Skinner[3]. Dans le quatrième chapitre du livre, consacré aux rapports qu’entretient le républicanisme avec le libéralisme d’une part et le communautarianisme d’autre part, Viroli rejoint en effet Skinner sur la question touchant à l’interprétation historique du républicanisme (pp. 58-61). Le républicanisme, pour ces deux auteurs, ne dérive pas d’une forme d’aristotélisme politique contrairement à ce que soutient le philosophe Jürgen Habermas[4] (p. 66). Ainsi Viroli paraît prendre implicitement ces distances vis-à-vis des républicains «communautariens» tels que John Pocock et Michael Sandel[5].
Viroli s’inscrit-il pour autant dans ce que John Rawls qualifie de «républicanisme classique», c’est-à-dire un républicanisme parfaitement compatible avec le libéralisme du fait de son détachement de l’«humanisme civique»[6] ? Dans le cinquième chapitre, Viroli se réclame explicitement des chanceliers de la République florentine, autrement dit des penseurs de l’humanisme civique comme Coluccio Salutati, Matteo Palmieri, Leonardo Bruni ou encore Nicolas Machiavel (pp. 72-77). L’originalité de Viroli est de désidentifier l’humanisme civique de l’aristotélisme en vue de réunifier l’humanisme civique et ce que Rawls nomme le républicanisme classique. Toutefois, cette originalité peut être jugée comme une faiblesse : l’homogénéisation du républicanisme à laquelle tend Viroli risque de nous faire négliger des divergences qui existent au sein même des penseurs qu’il ramène sous la bannière de l’humanisme civique. Par exemple, il est discutable de placer Machiavel sur le même plan que Bruni. Si tous deux ont été chanceliers de la république florentine, ils ont agi à des moments historiques différents et cela n’est pas sans impact sur leur conception respective de la communauté politique : alors que Bruni loue la république florentine du fait de son harmonie, Machiavel donne une place cardinale au conflit politique [7]. Quoiqu’il en soit, les penseurs politiques de l’humanisme civique se rejoignent au moins sur l’idée d’une vertu civique nécessaire au maintien en vie de la république. Mais en quoi cette défense de la vertu civique diffère-t-elle de celle de la vertu aristotélicienne qui considère que l’accomplissement de l’homme passe essentiellement par l’appartenance et la participation à la communauté politique ? L’homme tel que le concevait Aristote était la partie du tout que constituait la communauté politique[8], l’homme vertueux était donc uniquement conçu comme un citoyen et non comme un individu, notion encore inexistante chez les Anciens. La vertu civique souhaitée par les humanistes civiques implique-t-elle cette même conception de l’homme ? Viroli explique que cette vertu civique, c’est-à-dire le sens du bien commun, n’a jamais été conçue par les humanistes civiques comme un sacrifice de l’intérêt individuel contrairement à ce qu’a cru Montesquieu[9] (p. 72).
La valeur de la liberté républicaine, la liberté conçue comme absence de domination
Ce républicanisme distinct de l’aristotélisme peut-il encore se poser comme une alternative au libéralisme ou bien n’est-il plus qu’un simple correcteur de ce dernier contre ses propres dérives[10] ? D’une part, il convient de remarquer que cette manière de poser la question n’est pas neutre. En effet, en demandant au républicanisme de se positionner par rapport au libéralisme, elle considère le libéralisme comme courant principal de la pensée politique moderne et le républicanisme comme courant secondaire. D’une certaine manière, Viroli retourne la question en demandant au libéralisme de se positionner par rapport au républicanisme. Si Viroli a montré qu’historiquement le républicanisme apparaissait avant le libéralisme dans la pensée politique moderne, il montre aussi que théoriquement le libéralisme n’est qu’un républicanisme appauvri ou incohérent (p. 61).
En quoi le libéralisme constitue-t-il un appauvrissement du républicanisme voire même une manière de le rendre incohérent ? Dans les deux cas, la cause se trouve dans la définition de la liberté que donne libéralisme, à savoir la liberté dite négative[11], c’est-à-dire la liberté conçue comme absence d’interférences. Concevoir la liberté comme absence d’interférences comme le fait le libéralisme revient à considérer que la seule forme de contrainte de la liberté est la force ou la menace coercitive (pp. 44-45 et p. 62). Soutenir cela, c’est selon Skinner appauvrir la liberté républicaine (ou «néo-romaine»[12]), qui considère que la condition de dépendance représente tout autant une contrainte à la liberté que des interférences (p. 45). Si l’on suit cette conception de la liberté républicaine, il n’y aurait entre le républicanisme et le libéralisme qu’une différence de degré mais non de nature. Or si tel était le cas, le républicanisme ne pourrait pas prétendre constituer une troisième conception de la liberté, irréductible tant à la liberté positive démocratique qu’à la liberté négative libérale. Dès lors, Viroli s’éloigne de Skinner pour se tourner vers Pettit[13]. Pour Pettit, le républicanisme ne considère pas les interférences nécessairement comme des contraintes à la liberté. Ce qui constitue essentiellement une contrainte à la liberté, c’est pour lui la domination. La liberté républicaine est conçue comme absence de domination, c’est-à-dire comme absence de possibilité d’interférences arbitraires (p. 35). Pour le républicanisme, les interférences non-arbitraires telles que peuvent l’être les lois étatiques ne menacent pas la liberté. Au contraire, les lois étatiques sont nécessaires pour créer et garantir l’absence de domination (p. 54).
Retrouver la vertu civique grâce au patriotisme républicain
Si Viroli reprend très clairement le travail de Pettit du point de vue de la conception de la liberté républicaine, le républicanisme de Viroli n’est évidemment pas qu’une simple reprise du Républicanisme de Pettit. La relecture des penseurs de l’humanisme civique permet à Viroli de rester profondément attaché à la notion de vertu civique — ou «vertu républicaine» pour reprendre le titre du cinquième chapitre de son républicanisme (pp. 70-80) — lorsque Pettit préfère dans son Républicanisme la notion sans doute moins forte de «civilité»[14]. Réhabiliter sur le plan philosophique la notion de «vertu civique» est une chose, trouver comment la réhabiliter sur le plan pratique en est une autre autrement plus compliquée.
Pour répondre à cette dernière question, Viroli recourt à ses précédents travaux de recherche présentés dans Per amore della patria[15] et achève son livre par deux chapitres consacrés au patriotisme républicain, thème qu’il juge insuffisamment traité par les néo-républicains[16]. Le patriotisme républicain estime que le ressort de la vertu civique repose dans l’amour de la patrie. L’amour de la patrie, c’est l’amour charitable, ou la charité laïque, pour la république (p. 81). La charité laïque ne se confond pas à la simple justice contrairement à ce que soutient Bobbio dans le dialogue qu’il a eu avec Viroli[17]. Alors que la justice se veut rationnelle et universelle, la charité laïque est une passion pour une république particulière (p. 82). Il convient de préciser ici que si l’amour de la patrie passe par l’amour d’une république particulière, c’est parce que structurellement l’amour ne peut porter sur des concepts purement abstraits. Cela étant dit, Viroli se garde bien de confondre patriotisme et nationalisme : à travers leur défense d’une république particulière, les penseurs du patriotisme républicain visent principalement la défense d’un ensemble d’institutions politiques permettant le vivero libero tandis que les nationalistes visent essentiellement la sauvegarde d’une identité culturelle particulière (p. 89).
Comment faire renaître le patriotisme républicain ? Viroli trouve dans la célébration de l’histoire un bon moyen d’inciter les citoyens à reprendre eux-mêmes le flambeau de l’engagement civique (p. 97). Si la tradition républicaine est d’origine italienne, cela signifie que l’histoire italienne est riche d’expériences historiques d’engagement civique pour la liberté républicaine (p. 99). Dans l’histoire italienne, Viroli met notamment en lumière un type d’expérience républicaine : celle de la participation à l’autogouvernement communal (pp. 104-105). Loin du républicanisme jacobin et centralisateur à la française, le républicanisme italien est un républicanisme fédéraliste. Viroli plaide d’ailleurs ici en faveur d’une réforme fédérale qui redonnerait de l’importance aux communes (p. 106). Ainsi, alors que Jean-Fabien Spitz, commentant Pettit, dit que « la république n’est pas la démocratie participative »[18], nous pouvons dire que Viroli ouvre la voie à un dialogue entre les théoriciens du républicanisme et ceux de la démocratie participative.
Toutefois, si refaire des communes de véritables espaces politiques est un moyen qui peut permettre de renouer les citoyens à l’intérêt pour la chose publique en raison de leur proximité qu’ils ont avec celles-ci, Viroli pense que cela n’est qu’une étape et que le républicanisme est à même de susciter l’engagement politique pour des communautés plus grandes. Pour nous européens, ce qu’apporte Viroli au renouveau républicain est de penser un « républicanisme européen » pour reprendre le titre du chapitre qui clôt son ouvrage. Le patriotisme européen n’implique pas de nous abstraire de nos cultures locales et nationales en vue d’aimer de seuls principes universalistes comme le soutient Habermas avec son « patriotisme constitutionnel »[19]. Les cultures civiques particulières sont considérées par Viroli comme une ressource nécessaire à faire renaître chez les citoyens l’amour de la patrie (pp. 107-109). Aussi, il faut rajouter que le développement de ces cultures civiques particulières ne passe pas que par la participation des citoyens aux institutions étatiques. Viroli en appelle ainsi à une promotion d’une politique de la société civile (p. 109), en ce sens il s’éloigne encore d’un certain républicanisme à la française privilégiant l’État à la société civile[20]. Dans les deux cas, l’idée principale reste que la chose publique, qu’elle soit européenne ou non, nécessite toujours la présence chez les citoyens d’un ethos civique (p. 110) car s’il n’existe pas de république sans lois républicaines, il n’existe pas plus de république sans mœurs républicaines.
Amélie Pinset – Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
[1] Serge Audier, Les théories de la république, Paris, La Découverte, 2004, pp. 70-108
[2] John Pocock, Le moment machiavélien (1975), trad. Luc Borot, Paris, PUF, 1997 ; Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne (1978), trad. Jerome Grossman et Jean-Yves Pouilloux, Paris, Albin Michel, 2009 ; Philip Pettit, Républicanisme (1997), trad. Jean-Fabien Spitz et Patrick Savidan, Paris, Gallimard, 2004
[3] Quentin Skinner, Op. cit. et Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme (1998), trad. Muriel Zagha, Paris, Seuil, 2000
[4] Jürgen Habermas, Droit et démocratie : entre faits et normes (1992), trad. Rainer Rochlitz et Christian Boudchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, p. 485
[5] John Pocock, Op. cit. et Michael Sandel, Democracy’s Discontent, Cambridge, Harvard University Press, 1996
[6] John Rawls, Libéralisme politique (1993), «Leçon V», §7, 5., trad. Catherine Audard, Paris, PUF, 2006, pp. 250-252
[7] Pour plus de développement sur la place du conflit chez Machiavel, nous renvoyons à Serge Audier, Machiavel, conflit et liberté, Paris, Vrin, 2005.
[8] Aristote, Les politiques, I, 2, trad. Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, 2008, p. 13
[9] Montesquieu, «Patrie», in Encyclopédie, Volume XII, Neuchâtel, Bouloiseau, 1765, p. 179
[10] La position consistant à considérer le républicanisme classique comme un simple correcteur du libéralisme a été soutenu par exemple par le philosophe libéral Alain Renaut, voir «L’alternative républicaine», in Alain Renaut et Sylvie Mesure, Alter ego. Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, Flammarion, 2002, p. 185
[11] Isaiah Berlin, «Deux conceptions de la liberté» (1958), in Éloge de la liberté, trad. Jacqueline Carnaud et Jacqueline Lahana, Paris, Calmann-Lévy, 1988, pp. 171-179
[12] Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme, Op. cit.
[13] Philip Pettit, Op. cit., «La position de Skinner», pp. 400-404
[14] Philip Pettit, Op. cit., «Civiliser la république», p. 329
[15] Maurizio Viroli, Per amore della patria, Roma-Bari, Laterza, 1995
[16] Nous pouvons remarquer par exemple que Pettit n’y consacre qu’un seul paragraphe, voir Philip Pettit, Op. cit., pp. 348-349
[17] Norberto Bobbio et Maurizio Viroli, Dialogue autour de la république (2001), «Crainte de Dieu, amour de Dieu», trad. Guillaume Lagrée, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 61-62
[18] Jean-Fabien Spitz, Philip Pettit. Le républicanisme, Paris, Michalon, 2010, p. 51
[19] Pour plus de développement sur la critique de Habermas par Viroli, nous renvoyons à Maurizio Viroli, «Un patriotisme constitutionnel européen est-il possible ?», trad. Amélie Pinset, in Dikè, août 2011, consulté en ligne le 8 décembre 2011 : http://dike-philopol.fr/IMG/pdf/A-Pinset_-_Viroli_-_Un_patriotisme_constitutionnel_europeen.pdf
[20] Régis Debray, «République ou démocratie ?» (1989) in Contretemps. Éloge des idéaux perdus, Paris, Gallimard, 1992, p. 26