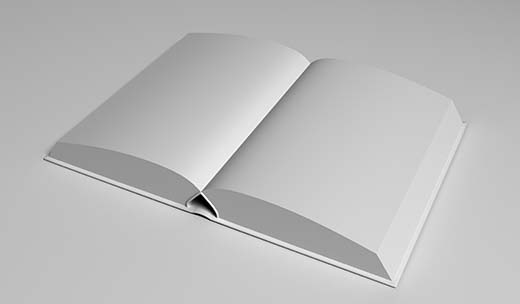De la mondanisation du Web
Florian Forestier – BNF/Paris IV
Du Web comme espace urbanisé
Le Web gagne peut-être à ne plus être considéré comme un domaine d’objets isolé, mais comme une part du monde. En tant que tel, il est pris dans un mouvement de mondanisation mais le transforme également. La pensée heideggérienne du monde permet de mieux appréhender la façon dont se spécifient et s’organisent des objets sur internet. Les objets ne sont objets que sur fond de certains rapports dans lesquels ils entrent, d’une contextualité spécifique, d’un système de finalités. Nous avons des objets, mais leur être objet ne se limite pas au fait que nous les avons. Les comprendre présuppose d’éclairer la logique d’investissement et de projection qui conduit à leur appréhension comme ces objets-là, que nous ne rencontrons pas seulement mais dont nous faisons quelque chose, à travers lesquels nous nous faisons aussi ; une spécification dont la matérialité même finit par porter la trace, car il ne s’agit pas seulement ici d’ouverture existentiale ou perceptive, mais d’engagement et de manipulation. Rétroactivement, il faut aussi s’intéresser aux mutations qu’impliquent ces nouveaux substrats de la mondanisation dans la façon même dont nous avons un monde.
Dans un deuxième temps, nous examinerons la possibilité de décrire la mondanisation comme une urbanisation. L’idée de monde conduit à insister sur une certaine forme de structuration du système des objets comme système d’ensemble, appréhendé dans son rapport à un projet qui s’y poursuit et s’y dépasse. La métaphore urbaine permet de nous décaler par rapport à la problématique ontologique-existentiale heideggérienne que porte la forme monde. La ville invite à considérer l’inscription d’un mouvement de spatialisation et de mise en sens au sein d’une structure matérielle elle-même concrétisée et spécifiée. De la thématique d’une étreinte du monde et de la Terre, elle nous conduit à celle de l’inscription d’un faire sens, de la co-constitution dialectique d’une impulsion spatialisante et de la nature de ses adjuvants et substrats. Considérer le Web comme espace urbanisé permet de comprendre plus concrètement la façon, dont s’instillant toujours plus dans toutes les régions de l’exister humain, celui-ci est amené à se faire non seulement espace et monde, mais espace habitable, structuré et agencé comme un espace habitable.
Le monde et le système des objets
Reprenons d’abord le fil de l’analyse heideggérienne de la question du monde[1]. Sans nous occuper de l’évolution du traitement que fait Heidegger de ce thème[2], rappelons que le monde est ce que Heidegger désigne comme l’étant en totalité. Le Dasein, pose Heidegger, est toujours déjà au monde, auquel il a affaire en tant que monde. Son expérience des étants se fait sur fond de l’horizon de totalité qu’est le monde. L’articulation des étants en cette totalité a lieu sur le mode du projet. Le Dasein s’abandonne au monde au sein duquel les étants se configurent comme objets en tant qu’ils constituent une chaine d’outils assemblés et dépassés dans le projet qu’est chaque fois le Dasein.
L’intéressant, pour notre perspective, est d’abord le rapport originaire que trace Heidegger entre exister et spatialiser. Exister sur le monde du Dasein, c’est spatialiser : einraumen. La spatialisation est ainsi une impulsion inhérente à l’homme (peu importe pour le moment qu’il reçoive son humanité de cette modalité ontologique qu’est le Dasein, ou que l’on interprète son mouvement spatialisant et configurant dans une perspective simplement anthropologique). Existant, l’humain donne à ce à quoi il a affaire une structure d’espace, que ce soit sur le plan perceptif ou conceptuel. L’humain existant situe et se situe. Il se rapporte à lui-même en spatialisant, dans un double mouvement de lier les objets et de se lier à eux.
Cette double transcendance articulée – du monde sur le Dasein, et du Dasein sur lui-même dans la dimension du projet, vise dans la perspective heideggérienne à rendre compte de la double énigme originelle de la phénoménologie : transcendance originaire et « dynamique », exposition à la mise en jeu de l’être même au sein des étants rencontrés sous l’horizon de leur étantité. La transcendance, pour Heidegger, n’est pas atteinte par détachement intentionnel, mais le geste du transcender, co-extensif de la structure de l’exister, configure la donation de l’étant et rend compte de ce que le rapport à l’étant s’établit sous l’horizon de cette question. Heidegger entend ainsi comprendre les modalités de la donation perceptive et signitive de l’objet à partir d’une structure plus profonde. Qu’est-ce qui, dans la forme de mon ouverture au monde, rend possible la rencontre de la forme de l’objet? Le détachement de l’objet comme objet signifié présuppose que, dans la structure de l’expérience en général, soit déjà inscrite la possibilité d’une telle mise à distance. La prise de l’étant dans la discursivité se conquiert toujours sur l’horizon du transcender, de sorte, aussi, que :
« Les catégories traditionnelles de la choséité que l’on définit en même temps pour des raisons déterminées comme les catégories de l’être (choséité, substance, accident, propriété, causalité) trouvent leur genèse phénoménale dans un mode déficient de la Bedeutsamkeit – « signifiance » ou « significabilité ». De telles catégories sont déjà tirées d’un mode d’accès (à l’étant) qui se situe dans le processus d’une démondanéisation caractéristique.[3]»
Le rapport du Dasein à l’étant n’est pas primairement perceptif, mais la prise en vue perceptive implique elle-même à la fois une significativité (Bedeutsamkeit) originelle qui l’individue et une affectivité qui l’y expose[4]. L’ouverture du Dasein à l’étant est toujours à la fois affectivité et significativité, les deux modalités se situant l’une par rapport à l’autre dans une relation de co-appartenance indissociable. Mais ces formes de l’ouverture doivent elles-mêmes être comprises au sein du mouvement de transcendance originelle selon lequel c’est bien l’étantité de l’étant qui est mise en jeu dans la configuration d’un monde. Ce recul est pour Heidegger indispensable si l’on veut comprendre ce qui ouvre la possibilité même de la science et de la philosophie, c’est-à-dire poser la question de l’essence, qui ne s’ouvre elle-même qu’au sein de la mise en jeu de la question de l’être.
Répétons que la thématisation de l’étant comme étant passe par la mise en jeu du monde comme totalité de l’étant (et non comme totalité des étants). Le monde se donne effectivement comme monde, se donne en mettant en jeu sa mondanité, de sorte qu’il s’ouvre toujours déjà comme question de lui-même, comme l’horizon sur le fond duquel l’étantité de tout étant peut être interrogée.
La mondanéisation des objets du Web
Cette analyse du lien originaire de la question du monde et de celle de l’objet peut être déplacée pour tenter d’appréhender le statut des objets du web. Dans une perspective ouverte par Alexandre Monnin, on peut considérer que la définition du nouveau champ d’objet qu’est le web a permis la réinterrogation et la redéfinition de la question de l’objectivité comme telle,. Des concepts comme l’identité ou l’appartenance, ont ainsi du recevoir une définition, laquelle a été progressive, négociée au sein d’un processus d’abord ingéniérique, et rapidement, pratique.
Les travaux d’Alexandre Monnin conduisent à considérer l’ingénierie du web comme une ontologie expérimentale, qui rapproche les deux sens du terme ontologie : le sens philosophique classique de théorie de l’être en tant qu’être dans la généralité de l’acception[5], et le sens informatique[A1] , selon lequel une ontologie est une collection d’objets définis selon un ensemble de critères et de règles. Or, la détermination des objets du web conduit précisément, en donnant une interprétation technique aux concepts traditionnels du même coup déplacés ; en d’autres termes, d’interroger et de rejouer le premier sens de l’ontologie. Le web induit ainsi un nouveau régime de l’objet, décrit selon des horizons d’individuation multiples. Ainsi, écrit Monnin, « On the Web, each concept of philosophy in its own way then gains a new existence as a technical artifact: objects turn into resources, proper names into URIs, ontology into Semantic Web ontologies.[6] » De cette façon, continue-t-il, « (…) the Web is a worldwide embodied technical artifact that therefore creates a whole new set of constraints. We suggest that they should be understood as a material a priori—in the Husserlian sense—grounded in history and technology.[7] »
La question se déplace cependant dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de la fixation technique de concepts, mais de la constitution d’entités auxquelles nous avons affaire, faisant partie d’un monde commun. Si le web a pu être assimilé à une grande bibliothèque (par exemple par J-M. Salaaun[8], ou par P. Bazin, qui a évoqué la « bibliothécarisation du monde »), c’est plutôt la façon dont des objets communs peuvent en émerger, se définir de manière toujours provisoire et négociée qui nous importe ici. Le Web est un espace qui s’ordonne, se spécialise, un espace d’interaction, habité, avec ses lieux, ses limites. Les objets ne s’y définissent plus seulement à partir de concepts ontologiques abstraits mais à partir des données fondamentales d’une ouverture au monde au sein de laquelle se spécifient le champ de l’objectivable et les relations qui s’y nouent.
Reste alors à déterminer quels liens ces nouveaux objets mondanisés nouent à la mondanisation elle-même. Le Web devient monde, mais de quel monde s’agit-il alors ? Dans quelle mesure notre façon d’être au monde peut-elle être affectée par les nouveaux objets de cette mondanisation ?
De la terre à la mutation du monde
Revenons donc à l’analytique heideggérienne, et examinons les prolongements que donne Heidegger à son analytique initiale de la structure monde. Rappelons que d’emblée, la transcendance extatico-horizontale s’avère indissociable d’un mouvement de détachement de l’étant auquel elle ouvre. C’est dans le frottement du transcender et de ce qui lui résiste que celui-ci est ouverture à la question de l’être. Autrement dit encore, le « rencontré » n’est pas seulement rencontré sous la forme structurée du Vorhanden ou du Zuhanden. Pour se manifester ainsi, il doit tout autant faire encontre, consister en résistance même au transcender qui s’y ouvre. L’étant ne s’objective que sur fond de sa choséité, et celle-ci implique une « contre-transcendance », une « distance » originelle au sein de la transcendance[9].
La thématique de la chose comme étreinte et combat du monde et de la terre, développée par Heidegger dans L’origine de l’œuvre d’art, élargit ce cadre. L’encontre n’est plus seulement l’effet d’un discord de la transcendance. Il est une dimension qui appartient intrinsèquement à la structure même de la parution de l’étant. Le Dasein ne s’ouvre en effet à un monde qu’en se confiant et en s’abandonnant à la terre, à sa solidité et sa fiabilité. La chose se manifeste comme telle en disparaissant dans sa propre solidité. La terre est d’une part ce sur quoi « repose » le monde, mais elle est aussi ce qui n’est rien du monde. Ce n’est pas un hasard si Heidegger prend comme exemples, dans ses descriptions, une motte de terre ou une pierre, c’est-à-dire des étants déterminés, mais déterminés comme irréductibles à leur détermination. La pierre n’est pas une pierre parce qu’elle est reconnue comme telle : comme pierre, elle résiste, ne participe pas de son concept et lui résiste. La terre radicalise le concept aristotélicien de nature. Celle-ci n’est plus seulement ce qui a « sa finalité en soi », mais « la perdominance perdurant dans un s’épanouir », ce qui croit et tient de et en soi-même et se garde celé[10].
La question ouverte en filigrane par cette étreinte est sa possible complication, laquelle laisse entrevoir la possibilité d’une mutation des coordonnées initiales de l’analytique. Le regard porté par la philosophie sur l’étant est transformé par la réorientation préalable vers l’être. La terre met spécifiquement l’accent sur l’insistance de sa compacité, sur la façon dont il est lui même appelé à porter la pesée de l’Être. Chez Heidegger cependant, la distinction de l’être et de l’étant, de l’ontologique et de l’ontique, rend difficile d’envisager tout choc en retour de la matière dont se tisse le monde sur le monde lui-même. Monde et terre ne passent pas l’un dans l’autre, l’être ne se diffuse pas dans l’étant ni ne se ressource en lui[11]. Certes, avec la Kehre, la spatialité s’affranchit toujours plus de sa fondation dans la temporalité pour venir à son tour l’écarter, la déranger ; mais plusieurs études ont montré comment les frottements au sein des analyses anté-Kehre de Heidegger laissaient envisager une autre forme de résolution de ce conflit, plus accueillante aux questions du corps, de la nature, de la matière[12].
Le concept de plasticité développé par Catherine Malabou pour penser l’intégration du temps à lui-même dans le système hégélien, est utile dans ce but. La plasticité désigne le processus par lequel l’esprit se muscle et se nervure en intériorisant les dynamiques par lesquelles se fait son histoire dont le contingent s’essentialise, ou plutôt pénètre l’essentiel en nouant avec lui un rapport qui demeure celui d’une formation, d’une rythmique, dont ce qui vient modifie ce qui l’accueille. Selon le paradigme de la plasticité, la logique de supplémentarité derridienne et la quasi-transcendantalité qu’elle convoque n’impliquent pas une accidentalisation définitive et irréductible du devenir mais une danse improvisant sa propre formalité. Retraduit dans l’analytique heideggérienne, la problématique de la plasticité invite à penser « (…) un échange entre l’être et l’étant qui n’est pas une incarcération mais une libération de la différence ontologique.[13] » Le concept de plasticité traduit en quelque sorte le rythme du quasi-transcendantal derridien, la prise de forme d’une idéalité toujours hantée par la facticité irréductible lui ayant permis de se phénoménaliser.
La clef de cette porosité de l’ontique et de l’ontologique, explique Catherine Malabou, est la sensibilité interne du Dasein : sans pouvoir ici nous attarder sur cette thématique complexe, par ailleurs traitée dans plusieurs études qui ont fait date[14], précisons que la trace de cette question est à chercher dans la problématique de la responsabilité poursuivie dans les §57, 58, 59 d’Être et Temps[15]. Il en va bien, avec la conscience morale, de la façon dont le Dasein est appelé à l’assomption de soi à travers les possibles dans lesquels il se projette, dont le Dasein est affecté par lui-même, en prise sur son rapport à sa propre possibilisation. La nature de cette prise – de cette décision d’être soi, comme la décrit aussi Heidegger – a fait l’objet de bien des controverses tant elle demeure difficile à appréhender hors du cadre traditionnel de la subjectivité et de la décision subjective.
Comment, en effet, le Dasein peut-il être en prise sur lui-même sans que cette prise signifie maîtrise, et sans, tout autant, que le « se laisser être soi-même » soit compris comme abandon et déposition ? Cette question, qui constitue par ailleurs tout l’enjeu du doctorat d’Etat de Jean-Luc Nancy[16], conduit donc Catherine Malabou à la question de cette sensibilité interne qu’elle interprète dans l’horizon de la plasticité : la sensibilité à soi du Dasein doit être comprise comme sensibilité à ses propres tensions et contractions, en d’autres termes le Dasein se sent en tant qu’il se transforme. Le Dasein, en tant qu’il est un mode d’être, est inséparable de la facticité ontique en laquelle il déchoit, à travers laquelle il se noue et s’articule à lui-même.
La thématique de la plasticité donne ainsi l’assise ontologique nécessaire pour penser une interpénétration de la mondanisation et du mondanisé dont l’analyse stieglerienne de la technique pourrait donner le volet « phénoménologique ». Cette approche conduit à ne plus penser le monde comme la structure originaire, mais, chez Bernard Stiegler, à penser la mondanisation comme auto-structuration d’un écart originel qui ne s’aménage en monde que par la collaboration de l’activité pulsionnelle et des artefacts techniques qui la transposent en présence[17]. La pensée heideggérienne de la technique est ainsi déplacée d’un cran : la technique n’est pas seulement le processus caché d’une forme d’appropriation à soi de l’Être monnayée par un coup d’envoi spécifique à la pensée occidentale, mais le processus d’autorévélation de l’Être même[18]. Ce n’est plus, par conséquent, à un en deçà hypothétique qu’il s’agit d’arracher la possibilité d’une nouvelle entente, mais à l’historicité spécifique de la technique : la technique est inséparable de toute pensée, et l’avenir de la pensée, donc, la possibilité générique d’un monde, ne peut être envisagée qu’en son sein. L’analytique stieglerienne ouvre ce faisant de nouvelles questions : que devient le monde chaque fois que ses substrats mutent ? Les nouvelles charnières de la mondanisation ouvrent-elles de nouvelles virtualités au sein de la forme monde ?
Pourquoi prendre le détour heideggérien alors qu’il n’est pas besoin de l’analytique du Dasein pour dire que le numérique modifie nos manières d’être et de penser ? Parce que l’analytique heideggérienne permet de considérer dans sa plus grande extension la question du « devenir objet » des artefacts du Web, d’insister en retour sur le fait que peut-être ce ne sont pas seulement des pratiques et modes de pensées qui évoluent avec eux, mais bien les cadres généraux selon lesquels nous nous rapportons au réel, l’appréhendons, nous comportons en lui. Renouant avec le fil de notre problématique, il s’agira bien alors de nous demander, non plus seulement comment les objets définis sur le web se mondanisent, mais quel choc en retour sur le monde ceux-ci exercent. Qu’est-ce qui dans la mondanisation des objets du web, retrouve les structures de monde que nous connaissions, et qu’est-ce qui au contraire, les ébranle ? Notre hypothèse sera ici la suivante : c’est en poursuivant la métaphore urbaine et le déplacement qu’elle fait subir au concept heideggérien de monde qu’on trouvera le meilleur langage pour appréhender à la fois la façon dont le web en vient à faire monde, et l’éventuelle mutation que celui-ci contribue à provoquer dans la façon dont nous avons un monde[19].
La mutation du monde comme urbanisation
Dans l’Origine de l’œuvre d’art, l’architecture éclaire le statut de l’œuvre d’art, mais l’édifice invoqué est le temple, massif et clos sur soi. Or, l’architecture n’est pas seulement un bâtir, elle n’est pas configuratrice d’un lieu, mais matrice de spatialisation, configuratrice de nombreux lieux qui s’enchâssent et se déboitent. La réflexion déployée dans Bâtir, Habiter, Penser, prenant de son côté le pont pour modèle, la façon dont il installe la localité en transposant les bords du fleuve en rive, est plus ouverte à cette dimension, mais le caractère spécifique et isolé de l’exemple, peine à en faire saisir toute la pertinence.
Sans doute vaut-il mieux, pour exhiber la pleine puissance de la pensée heideggérienne, abandonner le terrain de l’édifice isolé pour celui de la ville entière. En effet, il s’agit bien aussi, avec la question du bâtir, de concevoir une œuvre qui ne se présente plus comme substance isolée, massive, indépendante, mais qui malgré tout œuvre : bâtir n’est pas simplement œuvre, mais ouvrir à l’œuvre, installer l’horizon rendant possible la parution de l’œuvre.
Dans La dislocation, Benoit Goetz insiste sur la façon dont l’architecture ménage des espaces, ou même de la spatialisation : l’architecture, écrit-il dispose l’espace pour le sens. Elle est « (…) une condition de possibilité de la fiction, et, sans doute, du dire et du penser en général[20] », dans la mesure ou « (…) exister, c’est (se) disloquer[21] » Goetz développe pour cela le concept d’esplace, c’est-à-dire d’un espace qui emprunte à la place et à l’agora, le caractère commun, ouvert, mais qui est également articulé, différencié, habitable de diverses façons. Littéralement : un espace « qui laisse de la place[22] » On trouve, explique Goetz, une mise en œuvre exemplaire de l’esplace dans les édifices de Le Corbusier. La ville pénètre en quelque sorte dans le bâtiment même : l’édifice est déjà une ville, la ville a elle-même quelque chose d’un édifice.
L’architecture selon cette acception articule dans une même dynamique ce qui nous est le plus proche et ce qui nous dépasse. Elle est à la fois ce qui permet d’habiter et de ne pas habiter. La maison, indique Goetz[23], déplaçant par-là l’horizon de l’analytique heideggérienne, n’est précisément pas une demeure ni un édifice : elle est aussi l’agencement d’une étrangeté, une façon de jouer avec l’espace qui en transmute la sauvagerie… Elle capte les dynamiques de la terre et les module, en rythme les tensions… La maison est l’opposée de la chambre, de l’enfermement dans l’irréalité, la torpeur, et met en place des liens ombilicaux avec un dehors…
La maison selon Goetz matérialise une façon de se tenir dans une diversité préservée dans la dynamique de son éclatement et rythmiquement unifiée. Elle n’est pas un objet mais un schème, et en cela également un assez bon modèle de l’artefact web[24]. Parler d’urbanisation du web et des objets du web, c’est parler d’un mode spécifique de mondanisation : une mondanisation en quelque sorte fonctionnelle, articulant des maisons, c’est-à-dire des objets dynamiques et « esplaçant » plutôt que des objets ancrés dans la choséité que porte la terre. Le modèle de la ville permet d’envisager un monde dé-mondé, un monde qui ne repose plus sur la masse fermée de la terre, mais qui suscite sa propre terre dans sa mondanisation. Qu’est-ce alors qu’habiter une ville désancrée de sa terre ? Une ville machinique ? Est-ce fatalement être voué à la platitude, au nihilisme, à l’errance ? Cette errance elle-même permet-elle d’inventer de nouveaux modes de consistance au sein du sens ?
On pourra, pour commencer à aborder cette question, s’intéresser à l’analogie entre la patrimonialisation de l’espace matériel, et la patrimonialisation de l’espace virtuel. Institué en France en août 2006[25], l’archivage de du web prolonge en apparence l’élargissement successif des domaines concernés par le dépôt légal : livres, estampes, cartes et plans, partitions musicales, photographies, arts graphiques de toute nature, phonogrammes, affiches, vidéogrammes et documents multimédia, œuvres. Mais quel est cependant le sens précis de cette patrimonialisation ?
Nous tentons de montrer ailleurs[26] que le statut de l’archive Internet se comprend mieux dans l’horizon de l’archéologie que dans celui de l’archivage classique. L’écrit a en grande partie ici statut d’oral, de conversations enregistrées sur le vif (forums, blogs, tweets qu’il est également question d’archiver), d’annonces (enseignes), d’indications incompréhensibles si on les prive de leur contexte. Internet recèle par ailleurs autant de structures pérennes que d’informations transitoires : tout ne peut pas y être considéré comme publié au sens classique. Comme une ville, Internet présente différentes strates chronologiques que l’archivage exhume.
Peut-on pour autant considérer l’archivage de l’Internet comme un processus de patrimonialisation au sens classique ? La patrimonialisation implique un horizon symbolique, celui de la consistance, dont le passage du régime du musée, de l’édifice, du monument, à celui de l’Inventaire général n’a pas altéré les traits essentiels. Certes, contrairement au musée, l’Inventaire général ne consacre plus la massivité indivise d’une œuvre temple ; il ne prétend pas consacrer des chefs-d’œuvre, mais plus modestement préserver la possibilité de leur parution individuelle. Il s’agirait-là d’un déplacement sans déformation du régime de l’aura (selon le terme de Benjamin[27]) : l’inscription dans l’inventaire donne à l’objet la possibilité de recevoir une aura. Elle légitime symboliquement et administrativement la possibilité de cette pérennité, consacrant, au moins sous forme de trace, l’horizon du temps long – la solide fiabilité de la terre.
Peut-on envisager la reconstitution d’un semblable régime symbolique à partir de l’archive Internet ? Peut-on effectivement considérer l’archive de l’internet comme la prolongation de l’Inventaire général ? Il faut bien remarquer que l’archivage tel qu’il a été mis en place est calqué sur le modèle d’un web de documents – ou plus généralement peut-être, d’un web calqué sur le modèle d’un espace public et stable où chaque action et chaque interaction est aussitôt dupliquée et pétrifiée pour devenir document et archive. En d’autres termes, l’archivage présuppose un Internet mondanisé dans l’horizon du monde perceptif et commun ; un Internet constituant une région du monde, se spécifiant et s’organisant selon les structures de ce monde, présupposant un ciel, une terre, l’horizon de la pérennité autant que celui de la fugacité. Or, les objets définis par le web ne sont précisément plus des objets au sens classique mais des proto-objets, des amorces d’objets générés par la rencontre entre une requête individuelle et un système de balises. De tels objets ne sont plus les ombilics qui soutiennent et aménagent un monde ; en quelque sorte, ils ne sont plus soutenus par des choses et sont des objets sans terre. Ils ne se mondanisent plus seulement mais re-mondanisent le monde sur un mode en quelque sorte dé-mondé (pour prendre le terme de Jean-Luc Nancy[28]).
Quel statut donner alors à des espaces transitoires, co-construits, mouvants, à une ville qui ne serait plus un bâti au sens traditionnel, mais un enchâssement de pièces libres et coulissantes, à une machine infinie qui ne cesserait de se transformer ? Quel statut, sinon celui de la struction (pour prendre un autre terme de Jean-Luc Nancy[29]), de ce jeu de l’un se divisant et s’estompant, de cette techno-logie de la pluralité des mondes dans le monde ? De « (…) la simultanéité non coordonnée des choses ou des êtres, la contingence de leurs coappartenances, la dispersion des profusions d’aspects, d’espèces, de forces, de formes, de tensions et d’intensions (…)[30] » ?
[1] Dans les Idées 1, Husserl affirme que la conscience absolue peut être obtenue phénoménologiquement comme résidu de l’anéantissement du monde[1] ; le monde y est simplement défini comme « (…) la somme des objets d’une expérience possible et d’une connaissance possible par expérience, la somme des objets qui, sur le fondement de l’expérience actuelle, peuvent être connus dans le cadre d’une pensée théorique correcte.[1] » La spécificité phénoménologique du concept de monde se décante peu à peu dans l’œuvre husserlienne au cours des années 20. Husserl passe du concept de monde comme horizon total de tous les systèmes objectifs, mais corrélat de la conscience assujetti à ses opérations, au monde comme forme transcendantale que le sujet transcendantal toujours déjà engagée dans un processus de mondanéisation (ou plutôt d’auto-mondanéisation) est amené à développer. Fink interprète ce seuil en retournant l’analyse phénoménologique, qui n’opère plus en détachant l’ego transcendantal des différentes strates de ses opérations fonctionnelles, mais en le saisissant ensemble avec sa vie de conscience, comme une totalité relevant de lois spécifiques, d’un mode de discours propre. Heidegger retourne de son côté le monde contre la conscience, puis contre la méthode phénoménologique.
[2] Pour cela, A. Schnell, De l’existence ouverte au monde fini. Heidegger 1925-1930, Paris, Editions Joseph Vrin, 2005.
[3] Prolégomènes à l’histoire du concept de temps (p. 318-319), cité par Jean-François Courtine, dans La cause de la phénoménologie, « La problématique catégoriale chez Heidegger », Paris, Presses Universitaires de France, 2007, p. 166.
[4] Dans Être et Temps, Heidegger élève au rang d’existentiaux la disposition affective, le comprendre et le discours en insistant d’autre part sur la médiation qui les accorde originairement les uns aux autres au sein de l’être-à. Cf. Alexander Schnell, De l’existence ouverte au monde fini, Paris, Editions Joseph Vrin, 2005, p. 76 : « Le discours – un existential qui est co-originaire avec la disposition affective et le comprendre – articule la compréhensivité. Ce qui est articulable, c’est le sens ». Mais ajoutons-le, si on veut rester heideggérien, le sens n’est rien hors du transcender au sein duquel il opère.
[5] Nous ne rajouterons pas de precisions sur cette question extrêmement complexe qui a été l’objet de nombreux travaux devenus classiques, en particulier ceux de J-F. Courtine dans Suarez et le Système de la Métaphysique, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, ou Les categories de l’être, Paris, Editions Joseph Vrin, 2003.
[6] Monnin, H. Halpin, “Toward a philosophy of the web : foundations and open problems”, Metaphilosophy, Vol. 43, No. 4, July 2012, p. 363
[7] Monnin, H. Halpin, “Toward a philosophy of the web : foundations and open problems”, op.cit., p. 365.
[8] J-M. Salaaun, Vu, Lu, Su, Les architectes de l’information face à l’oligopole du web, Paris, La Découverte, 2011.
[9] A. Dewalque, Heidegger et la question de la chose. Esquisse d’une lecture interne, Paris, L’Harmattan, 2003.
[10] Il faut bien voir que monde et terre ne sont pas des instances séparées mais des dimensions. La distinction de leur « mouvement » réciproque n’a sens qu’à même leur rencontre, à même la chose à la fois ouverte et refermée en elle-même. C’est bien pour comprendre le lieu même du surgissement de la chose comme chose, qu’elles sont ainsi distinguées. Cette double dimension met en exergue la rencontre qu’est toujours la parution de la chose ; l’avènement de sa manifestation est toujours aussi ouverture d’un temps et d’un lieu qui se configurent en elle. La chose est toujours assignation à un « là », une singularité, la phrase en laquelle elle s’ouvre le domaine d’une présence.
[11] Précisons tout de suite que les lectures qui vont suivre, d’inspiration derridienne, et qui accentuent l’idée de porosité de l’être et de l’étant, constituent un infléchissement très fort, et à maints égards, contestable, de la pensée heideggérienne. En insistant sur la dimension de l’Être et de la vérité de l’Être indépendamment de celle de l’étant, Heidegger se met bien en quête d’un horizon de consistance de la pensée ; d’où, demande Heidegger, la pensée se reçoit-elle comme pensée ? D’où est-elle enchainée à l’horizon de la vérité ? Il y a assurément une ambiguïté ici, dans la mesure où la thématique du dernier dieu hésite sur la question de cette consistance ; que signifie la difficulté, voire l’impossibilité pour Heidegger de dénouer, en deçà de toute philosophie, la question de l’Être et l’horizon chrétien (cf. D. Franck, Heidegger et le christianisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2004). Le dernier dieu vient-il, au-delà de toute consistance du divin à jamais défaite par la chute du Dieu chrétien, comme multitude de dieux dansants ? Avère-t-il au contraire une impossibilité définitive à déprendre la question de la consistance de la vérité de celle du christianisme ? La seconde mort de Dieu accomplit et parachève-t-elle la première, ou n’en est-elle qu’une répétition abâtardie par avance défaite par la proclamation de la résurrection ? Si on se place vraiment dans l’horizon heideggérien, on ne peut pas faire abstraction de questions de ce type ; nous ne faisons pour notre part ici que détourner la conceptualité heideggérienne pour l’intelligibilité d’un sujet certes moins grandiose.
[12] Cf. en particulier Didier Franck, Heidegger et le problème de l’espace, Paris, Editions de Minuit, 1984, mais également dans un horizon plus proche de celui qui est le nôtre ici, Catherine Malabou, Le change Heidegger, Paris, Léo Scheer, 2004.
[13] C. Malabou, Le change Heidegger, op.cit., p. 202.
[14] Evoquons par exemple J. Benoist, Kant et les limites de la synthèse, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, qui décèle, au-delà de la thématique heideggérienne de l’auto-affection à même la transcendance, l’insistance d’une archi-sensibilité du sujet, qui ne relève certes d’aucune appropriation, qui agit comme la nervure de l’auto-affection, en tant qu’elle est en même temps hétéro-affection.
[15] C. Malabou, Le change Heidegger, op.cit., p. 302.
[16] Publié sous le titre de L’expérience de la liberté, Paris, Galilée, 1989.
[17] Nous nous permettons de renvoyer à notre recension de B. Stiegler, Ce qui fait que la vie est digne d’être vécue, Paris, Flammarion, 2010, http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article308
[18] C’est la thèse développée dans La puissance du rationnel, Paris, Gallimard, 1985.
[19] Cf. notre texte « Internet et la ville », à paraître dans Médium n°36, juillet 2013 : « La métaphore urbaine est une façon de penser sans la réduire la complexité des univers de l’information, mais également de comprendre que cette complexité se traduit par une structuration. Déjà le terme « architecture » est utilisé de manière courante en informatique pour désigner la structure générale d’un système d’information : on parle d’architecture logicielle, d’architecture des informations, d’architecture matérielle, etc. Dès lors que toute institution est désormais associée à un système d’information, l’évolution des institutions (regroupements et fusions, acquisitions, partenariats, réorganisation, externalisation), requiert une adaptation de leurs applications informatiques. Dans cette perspective, l’urbanisation des systèmes d’information consiste à faire évoluer leurs fonctions de concert, en favorisant leur évolution et leur « interopérabilité ». Le système d’information peut en ce sens être comparé au quartier d’une ville : si ce dernier est bien urbanisé, un bâtiment peut être remplacé par un autre sans fragiliser le tissu urbain. De la même façon, un système d’information sera bien urbanisé si une application peut en remplacer une autre sans nécessiter une refonte de tout le système ni déstabiliser son fonctionnement. »
[20] B. Goetz, La dislocation, Architecture et philosophie, Paris, Verdier, 2001, p. 21.
[21] B. Goetz, ibid., p. 36.
[22] B. Goetz, ibid., p. 61.
[23] B. Goetz, Théorie des maisons, Paris, Verdier, 2011.
[24] Il faut en effet, nous fait remarquer A. Monnin, ne pas penser l’objet du Web selon la définition quinienne de l’ontologie (l’être comme la valeur d’une variable), mais en termes fonctionnels : l’objet est fonction, ou mieux, fonctionne.
[25] http://www.bnf.fr/documents/bibliographie_dl_web.pdf
[26] F. Forestier, « Internet et la Ville », Médium n°36, juillet 2013 (à paraître).
[27] W. Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Allia, 2011.
[28] J-L. Nancy, Le sens du monde, Paris, Galilée, 1992.
[29] J-L. Nancy, A. Barrau, Dans quels mondes vivons-nous ?, Paris, Galilée, 2011.
[30] J-L. Nancy, ibid.