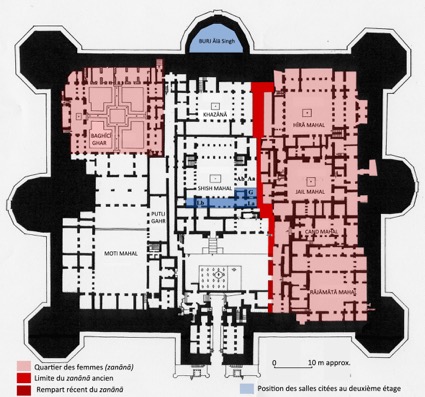De la dimension politique de l’art moderne et contemporain en Inde
Nicolas Nercam est Maître de conférences au Département des Arts, UFR Humanités de l’Université Bordeaux Montaigne. Il est membre de l’équipe de recherche du MICA (Art, Scénographie, Design : Figures de l’urbanité). Ses recherches portent sur l’étude des modernités artistiques extra-occidentales (en particulier indiennes), l’étude des apports des théories postcoloniales dans le discours sur l’art, l’étude du phénomène de la mondialisation artistique, l’étude des nouveaux rapports entre l’artistique, le politique et le social.
Depuis le début du XXIème siècle, l’art contemporain indien a trouvé sa place dans le concert international de la production artistique et de grandes expositions ont été les expressions manifestes, ces dix dernières années, de cet avènement[1]. Au sein de cette scène artistique mondialisée, nombre de critiques, d’esthéticiens, d’historiens, d’artistes et autres observateurs parlent « d’activisme artistique » comme d’une veine significative de la production contemporaine, exprimant à sa façon l’« obsession du réel[2] » propre à l’art actuel[3]. Cette appellation, aux contours flous, se propose de renouveler, dans le contexte de la mondialisation capitaliste, les relations entre engagement artistique et activisme social et politique, en développant des stratégies « qui repositionnent un des versants de l’art comme un levier de transgression, pour brouiller les cartes et mieux infiltrer les incohérences et les déviances du système[4] ». L’apparition de cet activisme artistique se manifeste sous le signe du paradoxe et de la confusion. De nos jours, dans nos sociétés mondialisées – en Inde comme ailleurs – la force de récupération du système capitaliste paraît considérable et les lois du marché constituent les cadres insidieux d’une nouvelle censure. Marc Jimenez l’affirme sans ambages en écrivant :
En un peu plus d’une décennie, le consensus culturel, c’est-à-dire la collusion attestée de l’art avec le système économique, politique et technicien qui « gère » la production industrielle des biens culturels, semble avoir mis définitivement un terme aux prétentions « subversives », « engagées », « impliquées » ou simplement « polémiques » de ceux que l’on persiste à nommer « artistes ». Le pouvoir de l’art (…) est devenu aujourd’hui le pouvoir de ceux qui administrent l’art et assurent sa promotion, sa diffusion et sa critique sur le plan économique et institutionnel.[5]
Néanmoins, malgré ce constat sévère parce que lucide sur l’art contemporain, nous continuons de penser que l’art actuel peut encore être rebelle au formatage culturel, médiatique et consumériste de la « société du spectacle »[6].
Dès la fin des années 1990, au sein des grandes manifestations artistiques qualifiées de « multiculturelles », une frange de la production contemporaine indienne s’inscrit dans la mouvance de « l’activisme ». Les réalisations de Shilpa Gupta, de Tejal Shah, de T. V. Santosh, de Vivan Sundaram ou des collectifs Raqs Media et Shamat sont souvent classées dans le cadre d’un « activisme artistique indien ».
Retrouve-t-on, au sein de la production artistique indienne et de sa diaspora, le même schéma d’un art engagé où la métaphore de la « résistance culturelle » supplante celle de « l’avant-garde artistique » ? Le constat que relève le sociologue Daniel Vender Gucht[7] selon lequel nos sociétés démocratiques exercent une sorte de « dictature soft » sur le registre de la « dictature de la majorité », s’applique-t-il à la société indienne, « la plus grande démocratie du monde » ?
Afin d’éclairer les démarches contemporaines de l’art indien dans son dialogue avec le politique et le social, il paraît tout d’abord nécessaire de l’inscrire dans une perspective historique, en analysant certains des aspects de l’histoire de la relation, toujours tumultueuse, entre art et politique, dans l’Inde du XXe siècle, depuis l’époque du combat anticolonial. En effet, cette relation – bien qu’elle ait pu paraître suspendue dans l’art contemporain occidental, au nom d’une autonomie moderniste de l’œuvre d’art – possède, dans le sous-continent indien, une histoire continue, dense et contrastée, et nombre d’artistes indiens de la scène contemporaine ne manquent pas d’y faire explicitement référence. L’approche du contexte politique de l’Inde fera donc, ici, l’objet d’une attention particulière, car ce sont bien les circonstances de la vie sociale qui déterminent, pour une bonne part, le caractère subversif ou non d’un art engagé. Ainsi, nous serons attentifs à souligner les tournants politiques et sociaux du sous-continent et à les articuler avec le domaine de la création artistique.
Prélude colonial
Depuis l’avènement du mouvement Swadeshi[8] en 1905 et jusqu’aux années 1940, la cause pour l’émancipation nationale n’avait cessé de gagner du terrain auprès de l’élite indienne anglicisée qui s’engagea résolument dans le combat anticolonial.
Les écrits de Partha Mitter[9] et de Tapati Ghua-Thakurta[10] ont mis l’accent sur les relations complexes entre modernité artistique indienne et combat anticolonial. Ils démontrent que l’avènement d’un art moderne indien, de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXème siècle, fut très étroitement lié à l’engagement idéologique pour la construction d’une nation indienne libérée du colonialisme britannique et que les aspirations libératrices exprimées par les artistes modernes indiens entrèrent en correspondance avec les espoirs suscités par la construction d’une Inde indépendante. Le mouvement nationaliste de l’époque n’avait, au niveau politique, rien de monolithique et la définition d’une nation indienne ne manqua pas d’occasionner de puissants tiraillements. Les inflexions esthétiques et artistiques des avant-gardes de cette période suivirent, en partie, les évolutions de la définition politique et sociale de la nation indienne, au sein du mouvement pour la libération nationale.
Ainsi, la peinture académique de Raja Ravi Varma (1848-1906) – qui hissa la mythologie et les grandes épopées hindoues au rang de « peinture d’histoire » – fut considérée, à la fin du XIXème siècle, comme l’expression du « génie national » par la bourgeoisie anglicisée indienne des métropoles coloniales[11]. Mais, dès les premières années du XXème siècle, la facture occidentale de la peinture de Ravi Varma fut considérée, par cette même bourgeoisie indienne, comme viscéralement incompatible avec l’expression d’une « authentique » indianité artistique. Ce fut l’art du mouvement dit de l’École du Bengale (Bengal School) qui délogea la peinture de Ravi Varma de son statut « d’art national ». L’École du Bengale, avec à sa tête le peintre Abanindranath Tagore (1871-1951), proposait une alternative artistique à « l’art colonial » en s’ouvrant à la peinture des miniatures des cours princières du nord de l’Inde des XVIIe et XVIIIe siècles. La production picturale des membres de l’École du Bengale se présentait comme indienne tant de facture que de contenu et reçut l’étiquette de « nouveau style indien ». Enfin, aux alentours des années 1920, l’avènement d’un « primitivisme politique », nourri en particulier par l’idéologie du Mahatma Gandhi, redistribua les données de l’indianité. L’élite nationaliste de cette époque glorifia le monde rural en édifiant alors une image mythique du « paysan indien », naïf porteur de la « pureté » des valeurs de la nation. A l’unisson de cette glorification, un primitivisme artistique vit le jour et les réalisations peintes d’Amrita Sher-Gil (1913-1941), de Jamini Roy (1887-1972) ou de Nandalal Bose (1882-1966), ainsi que les sculptures de Ramkinker Baij (1906-1980) puisèrent leurs thèmes et leurs forces plastiques aux productions rurales et tribales des campagnes indiennes. Dès lors, la facture aristocratique de l’École du Bengale, sa miniaturisation, sa préciosité, ses thèmes littéraires et son goût pour l’historicisme n’incarnait plus les nouvelles valeurs accordées à l’indianité.
L’époque du combat anticolonial constitua donc à l’évidence un moment de convergence particulièrement net entre art et politique. L’investissement politique des avant-gardes artistiques indiennes, dans l’orbite du mouvement pour l’indépendance, se solda par une remarquable réussite : la proclamation de l’indépendance, le 15 août 1947. Ainsi, la relation art et politique, durant la première moitié du XXème siècle, a pu être perçue comme particulièrement effective et la figure de l’artiste comme « agent subjectif et subversif[12] » a pu faire montre de son efficacité et de sa puissance à changer la société. D’aucun pouvait croire à une forme d’adéquation entre révolution artistique et révolution politique.
La production artistique de l’immédiate postindépendance, tout en développant les principes esthétiques construits à l’époque coloniale, héritera de la dynamique et de l’aura relativement positive de l’adéquation entre art et politique.
L’art engagé indien : du « tiers-mondisme » au « relativisme »
Deux dates, a priori plus politiques qu’artistiques, peuvent nous servir de jalons dans la présentation d’un panorama d’un art engagé en Inde des années 1940 jusqu’aux années 2000 :
– 1947 marque la fin du combat pour la libération nationale avec l’avènement de l’indépendance et les fondations de l’Union Indienne. C’est à cette même date qu’a lieu la terrible partition du sous-continent, créant de part et d’autre de l’Union, un Pakistan occidental et oriental.
– 1992 marque le virage économique de l’Inde vers une économie de marché. C’est à cette même date qu’eut lieu la destruction de la mosquée d’Ayodhya par des fondamentalistes hindous.
Ces deux jalons historiques nous permettent d’identifier deux paradigmes qui se structurent historiquement autour de la notion d’« art engagé » : le premier « tiers-mondiste » et le second « relativiste ».
Le paradigme « tiers-mondiste », à l’époque de la dynastie Nehru/Gandhi marque politiquement l’ère de la toute-puissance du parti du Congrès, où l’adhésion aux valeurs fondamentales qui structurent la « voie indienne » (démocratie séculariste, interventionnisme de l’état et non-alignement) est quasi unanime, tant dans la sphère politique que dans celle de l’art et de la culture. Dans le domaine des arts plastiques, ce paradigme présente une double ouverture vers le global, avec « le style international » et vers le local, avec la reconnaissance et la mise en valeur d’un patrimoine artistique. Enfin, il est caractérisé par la construction d’une relative autonomie de l’art, ainsi que par la conception du rôle politique de l’artiste comme acteur de la transformation sociale vers une plus grande émancipation.
Le paradigme « relativiste » de la fin des années 1980 aux années 2000 marque politiquement l’ère de la contestation de la toute-puissance du Congrès et des valeurs qui ont construit socialement, politiquement et économiquement les fondations de l’Union Indienne depuis 1947. Les accessions au pouvoir du B.J.P.[13], en 1996, en 1998, puis en 2014 constituent l’expression politique la plus extrême de cette remise en cause. Une nouvelle conception du politique voit le jour, fondée sur l’idée que le pouvoir n’est pas uniquement logé au cœur des instances gouvernementales mais qu’il traverse le corps social et s’immisce dans les relations les plus intimes et les plus quotidiennes (rapports de pouvoir entre mari/femme, parents/enfants, jeunes/vieux, entre castes, entre classes sociales, entre communautés…). Dans le champ artistique, ce paradigme marque une forme de méfiance à l’égard de l’association entre projet artistique et pouvoir politique institutionnel. Le rôle social attribué à l’artiste évolue et l’artiste engagé adopte un rôle de médiateur et non plus de héraut délivrant une parole messianique. Il doit en outre adapter son travail aux impératifs d’un marché de l’art mondialisé en expansion en Inde.
Art engagé et mouvement progressiste
Les années 1940 furent particulièrement riches en événements d’importance[14] et le monde artistique de cette époque représenta et vécut dans sa chair les soubresauts de l’histoire. Durant ces « années de cendres »[15], le combat antifasciste devient, pour nombre d’intellectuels et de politiques indiens, un corollaire au combat anticolonial. Pendant cette période, sous l’impulsion de son secrétaire général P. C. Joshi, le parti communiste indien (C.P.I.) va définir une ligne d’action culturelle et utiliser abondamment les techniques populaires de communication afin de mobiliser un large public pour la cause antifasciste. Dans cette ligne, des associations, à l’image de celles des intellectuels progressistes occidentaux, regroupant écrivains et artistes se formèrent. Parmi les plus significatives : la All India Progressive Writer’s Association, (I.P.W.A.) créée en 1936 à Lucknow et l‘Indian People’s Theatre Association (I.P.T.A.) créée en 1941 à Bangalore. Ces deux associations devaient jouer un rôle majeur dans le débat intellectuel et dans l’action artistique et culturelle durant les années 1930-1940. L’unité idéologique au sein de l’I.P.W.A. reposait, comme le précise Sudhi Pradhan[16], sur la volonté de construire un front culturel uni pour la paix, contre le colonialisme, l’impérialisme et le fascisme. L’I.P.W.A. fut un véritable creuset et les divers comités de l’association réussirent à attirer des personnalités littéraires et artistiques pourtant réputées pour leur peu de sympathie à l’égard de l’idéologie marxiste.
D’après les principaux animateurs de l’I.P.W.A., S.S. Zaheer, Mulk Raj Anand, Hiren Mukherjee, ou Ahmad Ali[17], l’association voulait combattre certaines tendances artistiques et littéraires, qualifiées de « réactionnaires » ou de « non progressistes ». Dans le domaine des arts plastiques, l’esthétique « passéiste » de l’École du Bengale tout autant que celle « coloniale » de l’art académique occidental des écoles gouvernementales incarnaient cette déchéance artistique. La ligne esthétique et idéologique adoptée par l’I.P.W.A. demandait aux écrivains et aux artistes progressistes de jouer un rôle social actif. L’idée suivante était développée : l’art puise son essence dans la réalité sociale, il est l’une des expressions de la conscience politique la plus haute de la société. La finalité d’un art « révolutionnaire » ne réside pas dans le résultat proprement artistique, mais dans sa capacité à déclencher des actions d’ordre politique dans la société. La production artistique devait concourir au développement d’une conscience politique pour le créateur autant que pour son public. Les réalisations artistiques devaient bénéficier d’une large diffusion (réseaux du C.P.I. et des syndicats d’obédience marxiste) auprès d’un public populaire (classe moyenne urbaine, paysans, ouvriers). Ainsi l’activité artistique devait-elle être conçue comme une remise en question constante, comme une autocritique permanente, tant de la pratique artistique que du système social.
Ce fut dans le domaine du théâtre, avec ce que l’écrivain Samik Bandopadhyay appelle l’aventure héroïque des compagnies de l’I.P.T.A.[18], que l’articulation art / politique semble avoir été la plus active[19]. La ligne esthétique et idéologique de l’I.P.T.A. ne diffère guère de celle de l’I.P.W.A. dont elle est une émanation. Cette association théâtrale militait pour une rencontre avec les publics populaires paysans et ouvriers. Cela conduisit les troupes affiliées à œuvrer hors des cadres esthétiques et logistiques des théâtres traditionnels urbains. Les manifestations dans les rues (pathnatika), dans les manufactures des banlieues ou au cœur des villages devinrent les formules nouvelles de productions théâtrales. Elles permettaient d’asseoir une propagande politique auprès des classes les plus démunies, suivant les principes de l’agitation propagande soviétique des années 1920 ou suivant l‘esthétique du théâtre traditionnel de la yâtrâ[20].
En ces années 1940, nombreux furent les photographes (Sunil Janah), les cinéastes (Ritwik Ghatak), les peintres, les graveurs et les sculpteurs qui s’engagèrent aux côtés du mouvement progressiste et ne cachèrent pas leur sympathie à l’égard du marxisme, voire leur militantisme au côté du parti communiste[21]. Le credo esthétique d’un ancrage de la production artistique au plus près de la réalité sociale poussa certains artistes à aller au cœur de l’action, au contact des manifestations populaires et des drames sociaux. Ainsi, lors de la terrible famine de 1943 au Bengale des artistes, parmi lesquels Atul Chandra Bose (1898-1977), Ramkinker Baij (1906-1980), Sudhir Ranjan Khastagir (1907-1974), Zainul Abedin (1914-1976), Chittaprosad Bhattacharya (1915-1978) décidèrent de représenter le constat cru et brutal des souffrances humaines et de la mort. Le peintre Zainul Abedin fut fortement ébranlé par l’arrivée des premiers paysans faméliques dans les rues de Calcutta. Il mènera alors un véritable travail de reporter-dessinateur[22]. L’artiste Chittaprosad Bhattacharya réalisa un remarquable reportage dans la campagne bengalie meurtrie par la famine, constitué d’articles et de dessins, intitulé Hungry Bengal[23]. Les représentations des désastres de la famine, sur tous les supports et suivant les techniques les plus variées, continueront à être très nombreuses même après 1950. Zainul Abedin et Chittaprosad Bhattacharya furent les premiers à se préoccuper de la diffusion de leurs témoignages artistiques auprès des couches les plus larges du pays, suivant en cela les orientations de l’I.P.W.A. Ils utilisèrent la presse quotidienne (People’s War, Janayuddha, the Statesman et the Hindustan Standard). Ceci impliquait une production susceptible d’être aisément reproduite, ils choisirent le dessin, la gravure, les encres. Cette production devait aussi être immédiatement lisible ; ils furent donc préoccupés par toutes les formes de figuration d’où leur intérêt manifeste pour la gravure expressionniste allemande aussi bien que pour celle des artistes révolutionnaires chinois[24]. Comme ces derniers, ils voulurent dénoncer à la pointe du crayon, de la plume ou de la gouge, les horreurs liées à la famine et à l’exploitation de la misère.
Les différents comités de la I.P.W.A. apportèrent leur soutien à la réunion d’un certain nombre de plasticiens, par delà la diversité de leurs positionnements artistiques : en particulier le Calcutta Group, en 1943 et le Progressive Artists’ Group (P.A.G.) en 1947. Ainsi les artistes du Groupe Progressiste de Bombay, et en premier lieu le théoricien du groupe Francis Newton Souza (1924-2002), cultivèrent une vison de l’artiste coïncidant avec la mythologie, voire avec la légende moderne, de la figure du génie baudelairien, du marginal, du « suicidé de la société » comme le dit Antonin Artaud. Par là même, les membres du P.A.G consacrèrent la liberté irréductible du créateur, propre au statut libéral de l’artiste, dorénavant membre d’un « universel moderne ». L’artiste du P.A.G. cultiva et entretint cette idée que le « scandale moderniste » (l’exposition inaugurale du Groupe, à Bombay en 1949, en témoigne), voire l’incompréhension du public étaient les signes de son élection et la marginalité, l’attribut de son statut d’artiste autonome, génial et authentique. Toutefois dans leurs manifestes, les artistes du P.A.G. tout comme leurs homologues du Groupe de Calcutta revendiquèrent clairement une dimension sociale et politique de leur travail artistique. Il s’agissait dans le même mouvement d’affirmer l’individualité de l’artiste face au poids des diverses formes d’exploitation sociale, religieuse, nationaliste, coloniale …
Ce fut tout au long du mouvement pour la libération nationale que se construisirent les principales caractéristiques du statut de « l’artiste engagé » qui servira de repère pour les créateurs jusqu’aux années 1980. Sous la dynastie Nehru/Gandhi, la République indienne considérait l’artiste comme « un représentant idéal de la communauté nationale[25] ». La communauté des artistes et des intellectuels se devait d’incarner les valeurs progressistes prônées par l’Etat central, en plaçant son investissement social et artistique au-delà des antagonismes communautaires, afin de contribuer à l’avènement d’une transition acceptable vers une gouvernance moderne, démocratique et « laïque ». Incarner ce que Geeta Kapur nomme la « Secular Identity » devenait le credo de la communauté artistique[26]. Cette dernière adhéra très largement à « l’idéologie émancipatrice » défendue par la voie indienne. Elle contribua à doter le gouvernement Congrès d’une aura positive, en le présentant comme le seul et unique recours, à la disposition du peuple indien, vers une émancipation politique, économique et culturelle. L’artiste Maqbool Fida Husain (1915-2011), membre fondateur du P.A.G., incarna cet « artiste national » de la postindépendance. Issu de la communauté musulmane sunnite du Mahârâshtra, M. F. Husain sut emprunter à différents registres iconographiques et plastiques (références à l’iconographie hindoue, aux motifs textiles, aux formalismes modernes occidentaux…) afin de construire un vocabulaire plastique à destination de la nation indienne.
Vers un « relativisme » de l’art engagé
Ce protocole politique entre monde artistique et pouvoir central, organisé autour de la défense des valeurs congressistes, commença à se fissurer suite à l’imposition, par Indira Gandhi, alors premier ministre, de l’Indian Emergency de 1975 à 1977. Le gouvernement Congrès, fortement ébranlé par une opposition politique déterminée et par une série de défaites électorales décida de suspendre le processus démocratique en imposant l’état d’urgence, afin de combattre, selon ses termes, une situation « d’anarchie nationale ». Nombre d’artistes décidèrent alors de braver ces interdictions et d’exposer leurs productions peintes ou sculptées, ou de présenter leurs spectacles de rue, occasionnant, le plus souvent, une réaction musclée de la police ou de l’armée. Ce fut à partir de cette période que la critique d’une « culture nationale » commença à s’imposer dans les milieux intellectuels et artistiques indiens et que la question d’une pluralité culturelle fut alors au cœur des débats.
L’exposition Place for People, organisée par Geeta Kapur à New Delhi en 1981, cristallisa les nouvelles aspirations d’un art engagé. Dans le catalogue[27], l’historienne de l’art affirmait que les polarités qui avaient structuré un art moderne indien (en particulier art indien / art occidental et art / identité nationale), étaient dorénavant dépassées. Les réalisations des artistes invités – Bhupen Khakhar (1934-2003), Gulam Mohammed Sheikh (1937), Jogen Chowdhury (1939), Vivan Sundaram (1943), Nalini Malini (1946), Sudhir Patwardhan (1949) – présentaient un large éventail de l’art figuratif, mêlant intimement des emprunts à l’art classique, à l’art populaire et urbain indien, au Pop’art américain et à la figuration libre européenne.
En 1989, dans le sillage idéologique de cette exposition, se crée l’Indian Radical Painters and Sculptors Association, composée de jeunes militants communistes de l’état du Kérala. Dans leur manifeste, les Radicals, s’appuyant sur les théories des historiens subalternistes, reprochaient à l’art moderne indien son manque d’indépendance ainsi que son caractère institutionnel. D’après eux, l’absence de singularité de la modernité artistique proviendrait d’un défaut (voire d’un refus) d’analyse de ses origines coloniales. Dénonçant la prédominance idéologique d’une « culture des élites », les Radicals prônaient un art à contenu politique contestataire, à destination des plus démunis, des sans voix de la vie politique et économique[28]. Malgré sa vie éphémère, cette association contribua à mettre en lumière les mensonges du discours de l’état démocratique à l’égard des minorités et joua un rôle conséquent au sein du renouvellement des relations entre activisme politique et pratique artistique.
A partir des années 1990, la contestation des valeurs fondatrices de la République indienne revêtit une nouvelle dimension politique avec l’instrumentalisation et l’exaspération des conflits communautaires. Les organisations du Vishva Hindu Parisad (V.H.P.) et du Rashtriya Swayamsevak Sangh (R.S.S.), clés de voûte de l’idéologie fondamentaliste hindoue furent les artisans de cette instrumentalisation et l’avènement de leur bras politique le B.J.P. comme alternative au parti du Congrès démontra l’ancrage électoral d’un nationalisme hindou en Inde. L’artiste, à l’aura internationale, Maqbool Fida Husain fut la cible de persécutions de la part des activistes du nationalisme hindou. Les origines musulmanes de l’artiste et sa libre interprétation de l’iconographie hindoue avaient déclenché la colère des associations fondamentalistes[29]. Dès la fin des années 1990, il fut harcelé et ses œuvres furent vandalisées. La menace était telle qu’il fut forcé à un quasi exil à Dubaï et mourut à Londres en 2011[30].
Instigués par des associations nationalistes hindoues, les heurts communautaires suite à la destruction d’une mosquée à Ayodhya le 6 décembre 1992[31] furent parmi les plus sanglants qu’ait connus l’Inde ces dernières années. Cet événement dramatique, qui se déroula face à une armée indienne impassible, voire complaisante, déclencha une vague d’émeutes entre musulmans et hindous à travers tout le Nord du pays, émeutes qui furent d’une extrême violence dans les faubourgs de Mumbai avec plus de 900 morts.
Cet événement bouleversa l’opinion publique et la crainte d’un embrasement général du pays fut réelle[32]. Pour l’artiste Vivan Sundaram, les événements d’Ayodhya eurent un impact décisif au sein de sa production artistique ; il abandonna la peinture sur toile, alors son médium de prédilection, pour s’adonner à l’installation, plus à même, d’après lui, de transmettre, avec pertinence plastique et idéologique, le message politique de ses réalisations artistiques. Dès 1993, l’artiste présente son installation, Memorial[33]. Il y met en scène la mort d’un inconnu lors des heurts communautaires. Cette installation devint l’image emblématique de la déchéance de la conception d’une Inde tolérante et secularist, garantissant la paix entre les communautés. L’œuvre se veut une véritable mise en garde des citoyens qui pourraient être abusés. Car selon Vivian Sundaram, le fondamentalisme religieux est instrumentalisé afin de détourner les communautés d’une analyse sérieuse des ressorts idéologiques de la mondialisation capitaliste dont les intérêts économiques sont, par principe, transcommunautaires.
Parmi les nombreuses réactions d’artistes face à la montée de l’Hindutva (concept politico-religieux revendiquant une Inde intrinsèquement hindoue), il est à relever l’investissement de l’association Sahmat (Safdar Hashmi Memorial Trust), forum d’artistes et d’intellectuels, créée en 1989. Au travers de son slogan « Artists Alert ! », Sahmat mobilise des universitaires, des artistes et des acteurs sociaux lors d’évènements où les droits démocratiques sont remis en cause. L’association est toujours très active sur le front des minorités afin de défendre leur droit, leur sécurité à l’intérieur de l’espace culturel national. Les événements d’Ayodhya ne manquèrent pas de mobiliser ses actions. Parallèlement à la réalisation et à la distribution de 200 000 affiches à travers le pays, dénonçant les actions du nationalisme hindou et la passivité du gouvernement, Shamat organisa, le 1er janvier 1993, Anhad Garje, un programme musical expérimental, syncrétique et itinérant où les traditions musicales populaires de la sufi-bhakti, métissage entre tradition musicales musulmanes et musique de dévotion hindoue, recevaient une coloration contemporaine.
Après les événements d’Ayodhya, les violentes émeutes du Gujarat de 2002 mobilisèrent une nouvelle fois les artistes indiens pour défendre le caractère interconfessionnel de l’Inde. En mars 2002, suite à une attaque de trains par des activistes musulmans, l’état du Gujarat s’embrase. La communauté musulmane fut la plus touchée, d’aucun parle de « génocide musulman » en évoquant ces événements[34].
En 2003, Shilpa Gupta décida d’exprimer sa colère et sa frustration face à l’extrême violence des heurts communautaires survenus en 2002, dans l’état du Gujarat. Elle réalisa une intervention baptisée Blame (2002-2003). Dans un train local de Mumbai, l’artiste proposait aux voyageurs d’acheter pour la somme de 10 roupies, un flacon baptisé Blame (Blâme), rempli d’un liquide rouge imitant la couleur du sang. Sur chaque flacon, on pouvait lire : « BLÂMER. Vous blâmer m’apporte tellement de bonheur. Alors, je vous rends responsable pour ce que vous ne pouvez contrôler. Pour votre religion. Pour votre nationalité. Je veux vous blâmer car cela m’apporte du bonheur. » Dans chaque compartiment du train, elle présentait son produit en déclarant, non sans esprit provocateur : « Si vous êtes hindou, vous pourrez blâmer un musulman. Si vous êtes musulman, vous pourrez blâmer un hindou. Acheter ce flacon Blame et mettez-le au-dessus de votre télévision à la maison[35]. » L’objectif de l’intervention Blame était, d’après les propos mêmes de l’artiste, de réveiller de leur passivité les personnes à qui elle s’adressait[36].
Les groupes d’intervention des organisations nationalistes hindoues continuent, de nos jours, d’intimider le monde artistique par des actions violentes au nom d’une condamnation du blasphème et d’une diffamation de la religion. Leurs cibles sont les artistes, les lieux de formations, les galeries, les centres d’exposition. L’un de leurs derniers coups de force marquant se déroula le 21 novembre 2015, lors du Jaipur Art Summit. Un groupe d’extrême droite hindoue protesta contre l’installation, dans un lieu public, de la production de l’artiste Siddhartha Kararwal, intitulée Divine Bovine. Il s’agissait « d’une vache volante » en polystyrène suspendue à un ballon. L’intention de l’artiste était d’attirer l’attention du public sur la consommation de matière plastique et de déchets par les vaches en milieu urbain. Pour les militants nationalistes, l’œuvre suspendue était provocatrice, car elle donnait une image dégradante et insultante de l’animal sacré. La police trancha en faveur des nationalistes et la vache de Kararwal ne resta en l’air qu’une trentaine de minutes[37].
Un état des lieux
Dans l’Inde actuelle, les principes de la Secular Identity se trouvent confrontés à ceux de l’Hindutva. La sphère artistique se trouve maintenant au cœur de ce combat idéologique. Le terme « combat » est ici à entendre au sens propre, tant les méthodes paramilitaires des organisations nationalistes hindoues sont d’une rare violence ; incendies de salle de cinéma ou de galeries d’art, intimidations physiques des spectateurs, destructions d’œuvres d’art, bastonnades et menaces de mort. Pour autant, il parait important de souligner que la posture politique pro-Secular Identity, (« libérale de gauche » et « anti-fondamentaliste »), ne fait pas l’unanimité au sein d’une certaine production artistique indienne. Ainsi, dans l’économie traditionnelle des marchés des villes indiennes (des bazars), se trouvent des magasins, vendant des images de dévotion hindoue, des almanachs illustrés, des calendriers, des portraits de leaders politiques, de mystiques ou de personnages historiques, directement affiliés à des organisations pro-hindoues, vantant les vertus et les mérites de l’Hindutva. Cet art de propagande se structura, en grande partie, suite aux heurts communautaires sanglants de 1992. Nombre de peintres et d’illustrateurs, à la formation artistique diverse (artisanale autant qu’universitaire) participent à l’élaboration de ces images. Au sein de cette vaste production, les réalisations peintes de Balraj et de Satyanarayan Maurya (surnommé Satya : « la vérité ») reçoivent un succès conséquent auprès d’un public populaire tant local que diasporique. Ces deux artistes sont parfaitement installés au sein de la propagande du Hindutva[38]. Leurs œuvres circulent au sein du net-work mis à disposition par le Sangh Parivar[39] et sont reproduites dans des revues pro-hindoues, comme Organiser. Balraj et Satya sont des artistes militants et se présentent, eux-mêmes comme des Hindu Activists[40]. Ils conçoivent leur travail artistique comme une forme de dévotion, à l’instar de l’attitude du dévot hindou pratiquant le Deshbhakti, vénération de la Terre-Mère.
Ainsi, dans le courant de la seconde moitié des années 1990, une peinture, réalisée par Balraj pour une carte de nouvel an, fut largement diffusée par les organisations pro-hindoues. Intitulée (en hindi) Bharat Mata appelant ses fils au combat, cette image représente Durga Mahishasura, la Déesse Durga combattant le démon Mahisha, appelant une foule réunie derrière elle à l’action et au combat. Dans cette production, les ennemis de la nation indienne, les « périls contemporains » vis-à-vis desquels l’Hindutva doit apporter une antithèse radicale, sont représentés sous les traits de trois serpents-dragons, à l’allure chinoise[41]. Les contenus historiques et mythologiques des œuvres de Balraj sont élaborés par des idéologues du R.S.S., autoproclamés historiens de la droite hindoue. L’histoire de l’Inde est ainsi présentée comme une succession de crises et de batailles. Cette perception de l’histoire accrédite le retour à un paradis pré-moghol (une sorte d’âge d’or hindou, Hindu Rashtra ou Bharatvarsha) suite à des périodes d’invasions humiliantes et meurtrières pour le peuple hindou (invasions musulmanes, puis britanniques). Enfin, l’histoire contemporaine du sous-continent, à partir de 1947, est marquée par les méfaits et les trahisons d’un gouvernement « secularist », conduit par « l’athée Nehru » qui s’est acharné à présenter une image dégradée et obscurantiste de la religion et de la communauté hindoue. Ainsi, le mythe d’un retour à une « pureté » originelle et l’aspiration à l’avènement d’un hindouisme « authentique » expurgée des pollutions étrangères constituent un crédo fondamental.
De nos jours, l’activisme artistique a pris un tour plus identitaire et des associations féministes, dalit (intouchable), adivasi (tribal), gay, ou transsexuelles travaillent en collaboration avec des artistes et montent des « événements » dans des institutions culturelles publiques et privées. Majoritairement, l’art engagé indien s’inscrit au sein de l’éventail idéologique d’une orientation politique « progressiste », défendant les droits des minorités et les positions d’une Secular Identity. Si ce type d’activisme artistique indien a souvent trouvé, dans les grandes manifestations internationales multiculturelles, une plateforme de présentation, un autre activisme artistique indien existe, bénéficiant d’autres canaux de diffusion, en marge des grandes expositions internationales. Il s’agit de l’art dit de l’Hindutva, défendant une conception « communaliste » de l’Inde. Par-delà les différences idéologiques évidentes entre ces deux veines de l’art engagé indien, c’est bien l’analyse de leur fondement esthétique qui va nous permettre de mettre en lumière les écarts les plus significatifs entre les deux mouvances artistiques contemporaines. Les artistes de la Secular Identity se sont attachés à produire des œuvres dans lesquelles la singularité du créateur de même que le renouvellement formel jouaient un rôle déterminant (parfois au détriment d’un message social ou politique). Comparativement, les artistes de l’Hindutva sont engagés dans un art de propagande, dans lequel le renouvellement formel, de même que la singularité du créateur paraissent comme exclus. Rien ne doit entraver la transmission du message idéologique. Chaque peinture est ainsi systématiquement accompagnée d’un texte, constituant un véritable corset, qui canalise la communication et limite l’éventail des interprétations. Comme s’il ne devait y avoir qu’une seule interprétation à une image, qu’une seule histoire à un peuple et qu’une seule destinée.
Ces deux veines de l’art engagé indien se rejoignent, paradoxalement, sur leur intérêt porté aux diverses dimensions de « l’art populaire » (artisanat rural et urbain, art tribal). D’un côté la veine de la Secular Identity instrumentalise cet art populaire afin de mettre l’accent sur les différences culturelles propres à la société indienne contemporaine et sur le nécessaire respect d’un « art des minorités », voire d’un « art des subalternes » face à un « art national institutionnel ». De l’autre côté, la veine de l’Hindutva instrumentalise l’art populaire comme garant d’une unité essentielle de la nation, fondé sur une culture « authentique » pré-musulmane, expression d’un « âge d’or védique », face à « l’art moderne cosmopolite de l’état central ».
[1]– Parmi ces événements qui présentèrent un éventail de la production artistique contemporaine indienne relevons, parmi les plus significatifs : 1999, Timeless Visions : Contemporary Art of India, Peabody Essex Museum, Salem – 2001, Century City : Art and Culture in the Modern Metropolis, Bombay/Mumbai 1991-2001, Tate Modern, Londres – 2001, Bollywood Has Arrived, Passenger Terminal, Amsterdam – 2002, Kapital & Karma ; Aktuelle Positionen Indischer Kunst, Kunsthalle, Vienne – 2003, Body-City : Neue Perspektwen aus Indien, in : SubTerrain : Artworks in the cityfold, Haus der Kulturen, Berlin – 2004, Zoom ! Arte na India contemparâneo, Sede da Caixa geral de Depôsitos, Lisbonne – 2005, iCon, India Contemporary, biennale de Venise – 2005, Edge of Desire: Recent Art in India, Art Gallery of Western Australia, Perth – 2006, Subcontingent : The Indian Subcontinent in Contemporary Art, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin – 2006, Hungry God : Indian Contemporary Art, Arario Gallery, Beijing – 2007, New Narratives : Contemporary Art from India, Chicago Cultural Center, Chicago – 2008, India Moderna, IVAM, Valence – 2008, Chalo India !, Mori Art Museum, Tokyo – 2009, Indian Highway, Astrup Fearneley Museet for Moderne Kunst, Oslo – 2009, India Xianzai, Museum of Contemporary Art, Shanghai – 2010, The Empire strikes back, Indian Art today, The Saatchi Gallery. Pour le cas de la France, cinq manifestations majeures sont à souligner : 2005, Indian Summer, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris – 2006, Bombay Maximum City, Tri Postal, Lille – 2010, Autres maîtres de l’Inde. Création contemporaine des adivasi, Musée du Quai Branly, Paris – 2011, Indian Higway, Musée d’Art Moderne, Lyon – 2011, Paris, Delhi, Bombay, Centre Georges Pompidou, Paris.
[2]– Jacques RANCIÈRE, Chroniques des temps consensuels, Seuil, Paris, 2005.
[3]– Au côté de l’activisme, « l’obsession du réel » de l’art contemporain peut revêtir différentes formes et différentes étiquettes : Observation-constat documentaire – Interpellation micro-politique – Parasitage – Action de proximité. Jean-Marc Lachaud, « De la dimension politique de l’art », dans Les formes contemporaines de l’art engagé, de l’art contextuel aux nouvelles pratiques documentaires, sous la direction d’Eric Van Essche, Bruxelles, La Lettre Volée, 2007, pp. 33-47.
[4]– Propos de Jérôme Sans, « Hardcore. Vers un nouvel activisme », dans Hardcorte, Vers un nouvel activisme, catalogue d’exposition, Paris, Palais de Tokyo / Cercle d’Art, 2003, p. 6.
[5]– Marc Jimenez, « Pouvoir de l’art ou responsabilité des artistes », dans Arts et pouvoir, Paris, Klincksieck, 2007, pp. 7-9.
[6]– C’est d’ailleurs la thèse que défend Marc Jimenez dans son ouvrage La querelle de l’art contemporain. Marc Jimenez, La querelle de l’art contemporain, Paris, Gallimard, 2005.
[7]– Cet autoritarisme, précise Daniel Vender Gucht, exerce un contrôle social fondé sur les lois de l’audimat ou de la rentabilité dont les principes sont présentés comme économiques et non idéologiques. Il s’agit de désamorcer la charge subversive de toutes postures non-conformistes et de ramener ainsi toute contestation à un pur signe dans le système de la mode, ou intégrer l’expression de la différence en argument de marketing dans une stratégie industrielle de diversification de l’offre culturelle. Vender Gucht Daniel, « Pour en finir avec la mythologie de l’artiste politique : de l’engagement à la responsabilité », dans Les formes contemporaines de l’art engagé, de l’art contextuel aux nouvelles pratiques documentaires, sous la direction d’Eric Van Essche, Bruxelles, La Lettre Volée, 2006, pp. 59-69.
[8]– Le mouvement Swadeshi (mouvement pour une autosuffisance) fut lancé par les nationalistes bengalis en 1905, à Calcutta (alors capitale du British Raj) afin de s’opposer à la partition du Bengale imposait par le Vice-roi de l’époque Lord Curzon. Ce mouvement fut constitué de manifestations de masse, de défilés, de réunions publiques et d’actions de boycott des produits manufacturés importés de Grande Bretagne, se multiplièrent alors à Calcutta et dans ses environs jusqu’en 1911. Le mouvement Swadeshi constitua une étape essentielle dans la radicalisation de l’engagement des élites indiennes vers l’avènement d’une indépendance politique.
[9]– Partha MIitter, Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922, Occidental orientations, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 – Partha Mitter, The Triumph of Modernism, India’s artists and the avant-garde 1922-1947, Londres, Reaktion Books, 2007.
[10]– Tapati Guha-ThakurtaThe making of a new « Indian » art. Artists, aesthetics and nationalism in Bengal, C. 1850-1920, Cambridge University Press, Cambridge, 1992 – Tapati Guha-Thakurta, Monuments, Objects, Histories. Institutions of art in colonial and postcolonial India, New York, Columbia University Press, 2004.
[11]– Raja Ravi Varma, new perspectives, catalogue d’exposition, National Museum, New Delhi, 1993.
[12]– Expression empruntée à D. achar et S. K. Panikkar, « Introduction », dans Articulating Resistance, Art and Activism, sous la direction de D. Achar et S. K. Panikkar, Delhi, Tulika Books, 2012, pp. XI-XXIX.
[13]– Le Bharaiya Janata Party (B.J.P.) est le bras politique du nationalisme hindou. En 1996, le président du B.J.P. Atal Bihari Vajpayee devient premier ministre, poste qu’il retrouvera en 1998 et qu’il conservera jusqu’en 2004. En 2014, les élections portent une nouvelle fois au pouvoir le B.J.P. avec Narendra Modi comme premier ministre. Nombre d’observateurs considèrent que l’obtention du pouvoir politique du pays sera dorénavant une question d’alternance entre Congrès et B.J.P.
[14]– L’entrée de l’Inde dans le second conflit mondial, la terrible famine de 1943, l’intensification du combat pour la libération nationale, les massacres communautaires de 1946 et l’indépendance de 1947 suivie de la partition furent autant de faits particulièrement marquants des années 1940 en Inde.
[15]– Expression empruntée à Jean-Luc Racine, dans Calcutta 1905-1971, au cœur des créations et des révoltes du siècle, sous la direction de Jean-Luc Racine, Paris, Autrement, collection Mémoire n°46, 1997.
[16]– Sudhi Pradhan, « Preface » de Marxist Cultural Movement in India, chronicles and documents, vol. II 1947-1958, édité par Navana, Calcutta, 1982, pp. 7-13. Lors de la première conférence de l’I.P.W.A. en 1936, furent précisés les statuts de l’association et un manifeste fut adopté. Ce manifeste appelait les créateurs à se pencher sur les problèmes fondamentaux d’actualité (malnutrition, pauvreté, sous-développement social, assujettissement politique). Il appelait, au nom de la création artistique et de la liberté d’expression à s’élever contre la guerre, contre le fascisme et le militarisme.
[17]– Ahmad Ali, « Progressive views of art », dans Marxist Cultural Movement in India, chronicles and documents, vol. I 1936-1947, édité par Pustak Bipani, Calcutta, 1979, p. 61.
[18]– Samik Bandyopadhyay « Theatrescapes » dans STQ, issue 16, décembre 1997, Calcutta, Seagull Books, 1997, pp. 138-154.
[19]– Nicolas Nercam « Théâtre politique dans l’Inde contemporaine : une approche de l’œuvre du théoricien, dramaturge et metteur en scène Utpal Dutta » dans Théâtre et politique, sous la direction de Ioana Galleron, P.U.R., Rennes, 2011, pp.149-161.
[20]– K. Raha, Bengali Theatre, New Delhi, 21e éd., National Book Trust, 1993.
[21]– Dans le domaine des arts plastiques, soulignons tout particulièrement le travail de Somnath Hore (qui partit en milieu rural afin de rendre compte, par une série de dessins, du mouvement social du tebhaga, en 1946), Atul Chandra Bose, Kamrul Hassan et Chittaprosad Bhattacharya dont les réalisations furent diffusées dans les colonnes du journal communiste People’s War.
[22]– Il sillonnera les rues et dessinera sur le vif, les scènes dramatiques des trottoirs de la ville. La rapidité de l’exécution est un reflet direct de la précarité des vies qu’il capte sur la surface de son papier.
[23]– Dans cet ouvrage, publié dès 1943, Chittaprosad Bhattacharya ne se limitait pas à dresser le constat du désastre humain de la famine, mais il dénonçait surtout les profiteurs du système et les bénéficiaires de la spéculation. Nombreux et féroces sont ses croquis d’exploiteurs ventripotents venus saisir jusqu’aux très humbles ustensiles que des paysans faméliques étaient acculés à vendre.
[24]– Les réflexions et les partis pris esthétiques de l’I.P.W.A. s’inscrivent dans un certain contexte artistique mondial des années trente quarante où, par la dimension internationale du mouvement antifasciste et par le caractère social et politique contestataire de l’action culturelle, la conception progressiste du travail artistique gagnait alors du terrain. Vers la fin des années trente, les écrits de Jdanov et de Gorki, pères du réalisme socialiste, furent disponibles en Inde dans leur traduction anglaise. Les principes du réalisme socialiste reçurent un écho favorable dans le domaine littéraire. Mais cette nouvelle esthétique ne fut pas pour autant acceptée par les plasticiens, membres du mouvement progressiste indien. Ces artistes ont très peu emprunté aux productions réalistes socialistes d’U.R.S.S. Certaines gravures de Chittaprosad Bhattacharya, ainsi que quelques peintures et sculptures de Debiprasad Roychowdhury sont les seules exceptions notoires. L’Association I.P.W.A. contribua, en outre, à faire connaître au milieu artistique indien les travaux des artistes chinois du Centre de Recherche Artistique de Shangaï – Shangaï Yba Ishe Yanjiv Su, fondé sous l’impulsion de l’artiste communiste Jiang Feng – (J. F. Aandrews, Painters and Politics in the People’s Republic of China, 1949-1979, University Press of California, 1995), ainsi que les œuvres expressionnistes allemands, Käthe Kollwitz, Ludwig Meidner ou Frans Masereel. Ces œuvres à fort contenu social, étaient, dans leur immense majorité, des tirages à partir de gravures sur bois. Cette technique de la gravure sur bois et sur linoléum fut adoptée par les plasticiens indiens comme moyen privilégié d’expression du message politique en art. En ces années quarante, la gravure sur bois devient, tout comme en Chine, une véritable arme politique (Éric Janicot, Le « mouvement de la gravure sur bois », dans 50 ans d’esthétique moderne chinoise, tradition et occidentalisme 1911-1949, Publications de la Sorbonne, Paris, 1997, pp. 54-58).
[25]– Geeta Kapur, « Secular Artist, Cityzen Artist » dans Articulating Resistance, Art and Activism, sous la direction de D. Achar et S. K. Panikkar, Delhi, Tulika Books, 2012, pp.26-52.
[26]– Geeta Kapur, When was Modernism, essays on Contemporary Cultural Practise in India, Delhi, Tulika Books, 2000.
[27]– Geeta Kapur, « Partisan views about the human figure », dans catalogue Place for People, Jehangir Art Gallery, 9-15 novembre 1981, Bombay, pp.1-9.
[28]– Gayatri Chakravarty Spivak Les subalternes peuvent-elles parler ?, traduction de J. Vidal, Paris, éditions Amsterdam, 2009.
[29]– Daniel Herwitz, « Maqbool Fida Husain : the Artist as India’s National Hero », dans Third Text, n°78, vol.20, Issue 1, janvier 2006, pp. 41-55.
[30]– Geeta Kapur, « Modernsit Myths and the Exile of Maqbool Fida Husain », dans Barefoot Across the Nation, Maqbool Fida Husain & the Idea of India, sous la direction de Sumathi Ramaswamy, New Delhi, YodaPress, 2011, pp.21-54.
[31]– Le 6 décembre 1992, un groupe de fondamentalistes hindous, encadré par des dirigeants du V.H.P., du R.S.S. et du B.J.P. détruisent intégralement une mosquée du XVIème siècle (Babri Masjid) d’Ayodhya, dans l’état de l’Uttar Pradesh. La ville d’Ayodhya est un lieu saint pour la communauté hindoue, car elle marque le lieu de naissance de Rama, incarnation du Dieu Vishnu. La principale raison de la démolition de la mosquée, proclamée haut et fort par les organisations fondamentalistes hindoues, était qu’elle avait été construite sur le site d’un temple qu’il fallait impérativement restaurer.
[32]– L’affaire d’Ayodhya et les émeutes qui s’en suivirent constituèrent la trame narrative de films à grand succès comme Bombay (1995) de Mani Ratnam, ou Naseem (Brise du matin) (1995) de Saeed Akhtar Mirza.
[33]– Le point de départ de la réalisation de Sundaram est un cliché paru dans The Times of India, et illustrant un article sur la violence des heurts communautaires de décembre 1992 à Bombay, entre hindous et musulmans. Cette photographie montrait le corps d’un inconnu, sans signe particulier d’appartenance religieuse, étendu sur l’asphalte, une victime de la violence intercommunautaire. Vivian Sundaram réalisa une version en plâtre de ce corps et l’exposa dans un cénotaphe de verre éclairé par des néons. Dans l’alignement du cénotaphe, une arche était érigée à l’aide de malles de fer empilées les unes sur les autres avec à leur sommet, l’inscription en lettres lumineuses : Fallen mortal (Le mortel déchu).
[34]– D’après les autorités de Delhi, les heurts interconfessionnels occasionnèrent 254 morts hindous et 790 musulmans. Suite à ces heurts, plus de 61 000 familles musulmanes quittèrent l’état du Gujarat. Le ministre en Chef du Gujarat de l’époque, Narendra Modi (aujourd’hui Premier ministre de l’Union indienne), semble avoir de lourdes responsabilités dans la mise en place de ces journées sanglantes.
[35]– Propos de Shilpa Gupta, repris dans le catalogue Bombay Maximum City, l’Album, exposition Tri Postal, 2006, Lille 3000, Lille, p.160.
[36]– Shilpa Gupta, Op. cit., p.160.
[37]– Deepanjana Pal, « It’s time for art to be political », dans The Hindu, 10 décembre 2015.
[38]– Christiane Brosius, « Hindutva intervisuality : Videos and the politics of représentation », dans Beyond Appearances ? Visual Practices and ideologies in Modern India, sous la direction de S. Ramaswamy, New Delhi, Sage Publications, 2003, pp.265-296.
[39]– Le Sangh Parivar est une sorte de conglomérat « d’associations familiales », constituant près de 20 organisations nationalistes pro-hindoues, chacune spécialisée dans diverses activités sociales comme l’éducation, la diffusion culturelle…
[40]– Christine Brosius, « I am a National Artist : Popular art in the Sphere of Hindutva », dans Picturing the Nation : Iconographies of Modern India, Hyderabad, Orient Longman, 2007, pp.171-206.
[41]– Depuis le conflit militaire sino-indien de 1962, la Chine (allié du Pakistan) reste, dans la psyché indienne, encore perçue comme un ennemi potentiel de l’Inde. Sur cette peinture de Balraj, le premier serpent, blanc marqué de croix, incarne le christianisme (la religion de l’étranger, importée par le colon britannique), le second bleu, marqué par le symbole du dollar, incarne l’impérialisme américain (la culture consumériste américaine étant présentée comme la valeur étalon du capitalisme mondial), le troisième, vert, couvert de motifs de croissants, incarne l’autre « religion de l’étranger », l’islam (les musulmans, considérés comme des citoyens de second rang, sont les ennemis de la nation).