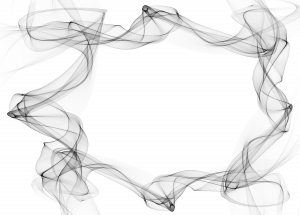Confiance et pluralisme engagés
Pour une épistémologie sociale pragmatiste et mélioriste
Benjamin Six
Centre de Philosophie du Droit (BioGov Unit) – UCLouvain (Belgique). Ce texte a été rédigé avec le soutien du F.R.S.-FNRS.
Introduction
Les débats sur le pluralisme devinrent monnaie courante durant ces dernières décennies marquées du sceau de la globalisation. Le pluralisme, défini de façon large comme la situation d’une hétérogénéité radicale de points de vue, est souvent perçu comme une difficulté à surmonter. Les théories délibératives ont alors été établies comme des méthodes rationnelles de résolution critique des confrontations d’altérité. Dans cette optique, la délibération publique devient le moyen de gérer le fait social pluraliste. Sans vouloir remettre fondamentalement en cause les théorisations démocratiques axées autour des concepts de tolérance, d’équité et d’autonomie, nous souhaitons proposer une relecture pragmatiste de leur enjeu institutionnaliste autour d’un concept de « confiance engagée ». L’objectif de cet article est de montrer en quoi la compréhension en des termes pragmatiques du phénomène confiant ouvre à une interprétation plus approfondie de son rapport à la normativité sociale, interprétation qui permet alors de concevoir le fait pluraliste non plus comme un problème pour la création de connaissance, mais bien comme sa solution.
La confiance est un phénomène délicat à définir, et souvent réduit à sa fonction. La littérature l’approche souvent par son versant de processus de réduction de la complexité[1], c’est-à-dire comme un dispositif offrant la résolution la moins gourmande en termes de ressources face aux dilemmes de l’action collectif. Nous utiliserons le concept de confiance en ce sens assez large durant les deux premières étapes de notre raisonnement, et nous tenterons seulement de comprendre sa mécanique particulière durant la troisième étape. Mais si la confiance est bel et bien un outil de réduction de l’incertitude, elle est avant tout un acte social dépassant largement le cadre de cette fonction, et qui, en s’appuyant sur des cadres institutionnels, permet des engagements en contexte pluraliste. Nous pensons en effet que l’enjeu de la confiance ne peut être compris, premièrement, qu’à la condition de ne pas la réduire à sa fonction, et deuxièmement, qu’en rapport aux référentiels d’assurance que sont les institutions.
Notre défense d’une épistémologie sociale dans les diverses sphères d’activité humaine passe alors par une remise en question d’une approche institutionnaliste que nous qualifions de « fonctionnaliste ». Souvent critiqué pour sa perspective holistique offrant peu considération aux enjeux conflictuels, le fonctionnalisme appréhende les institutions uniquement par le biais de leurs effets stabilisateurs du système social. Mais, comme pour la confiance, si les institutions ont en effet pour objectif de permettre une cohésion au niveau collectif, les comprendre uniquement en ces termes constitue un dangereux appauvrissement conceptuel. Nous pensons que cette perspective fonctionnaliste repose en fait sur un présupposé fondamentalement utilitariste et sceptique, où seul l’intérêt individuel justifie la présence des institutions et des actes de confiance, au sein d’un système social conçu comme une collection d’acteurs rationalisant leurs choix de façon globalement similaire.
En reconnectant le statut des cadres institutionnels à une socialité authentiquement pluraliste et complexe par le biais de l’enjeu de la confiance, nous resocialisons de façon radicale leur programme. En d’autres termes, la science, mais aussi le politique et l’économie, en tant que sphères institutionnelles opérant une normativité sur le social, ne constituent des autorités épistémiques que de par le fait que nous leur octroyons ce pouvoir sur nous afin d’assurer notre capacité à vivre ensemble. Leur fonction est vide de sens sans ce lien de confiance, et leur déconnexion avec une sphère sociale, conçue de façon pluraliste et complexe comme un ensemble d’évènements collectifs et de postures humaines d’abandon et de résistance, de cohésion et de contradiction, d’évolution et de révolution, doit être perçue comme un écueil à éviter et comme une dénaturalisation problématique de leur présence s’imposant à nous.
1. Les enjeux du fait pluraliste
Notre lecture de la question épistémologique contemporaine est axée autour de l’observation d’un fait majeur de notre époque, à savoir l’augmentation du potentiel de confrontation entre une multitude d’idées et de points de vue divergents. Ce fait, que nous qualifions de pluraliste, est le résultat des progrès économiques et technologiques qui eurent lieu durant le XXème siècle, et qui menèrent, par le biais de la facilitation des moyens de transport et surtout de communication, à la globalisation de nos sociétés. La naissance de l’Internet, sans aucun doute, modifia de façon radicale la façon dont l’humain acquiert de la connaissance, et ce d’une façon dont nous ne pouvons pas encore évaluer véritablement tous les impacts. Bien sûr, il serait erroné de croire que le pluralisme est une particularité de notre époque, mais si il existe de tout temps, depuis que l’homme communique, il revient par contre à la modernité d’avoir démultiplié la puissance de ce phénomène.
Pour le philosophe Adam Seligman, les relations sociales modernes, marquées par le passage de la « communauté » à la « société », sont caractérisées par une importante multiplication des rôles et des risques liés à leurs attentes, menant à un besoin social accru en termes de confiance[2]. Nous voyons donc apparaître ici un enjeu de la confiance en milieu pluraliste : la familiarité ne constituant plus la donne de base, il faut élaborer de nouveaux modes de coordination dans des contextes de plus en plus incertains. La confrontation à l’altérité étant bien plus importante qu’à l’époque pré-moderne, il en résulte un accroissement des risques lié à une divergence d’affiliation groupale, ainsi qu’à la mobilisation de référents incommensurables. La complexification du social et la différenciation accrue des rôles entraînèrent donc une augmentation du potentiel de dissonance et de conflit entre les comportements.
Pour utiliser un principe de temporalité volontairement flou, « avant », un individu pouvait vivre et mourir en ayant connu essentiellement un système majeur de normativité sociale (typiquement, celui de sa tribu ou de son village). « Aujourd’hui », avec l’augmentation de la connectivité communicationnelle et économique, la marge de manœuvre pour un individu désirant rester totalement hermétique aux implications produites par son comportement sur autrui, s’est réduite à une peau de chagrin – pour ne pas dire qu’elle est devenue une véritable chimère passéiste. Ce mouvement de complexification entraîna l’émergence de nouveaux enjeux éthiques de type transfrontalier et transgénérationnel (dont l’exemple le plus frappant constitue l’écologie), nécessitant de nouveaux modes aussi bien de compréhension que de développement de solutions. Dans ce cadre, la connaissance de ce qui se passe ailleurs et à autrui, devient plus que jamais un élément primordial de définition de ses propres conceptions de vie. Nos sociétés complexes, globalisées et multiculturelles, requièrent plus que jamais de tels actes épistémiques.
Or, il apparaît que nous avons tendance à élaborer une réponse essentiellement sceptique face à ce défi, mettant à mal la mise en capacité des postures de confiance que requiert la complexification des interactions. En mobilisant la célèbre distinction opérée par Niklas Luhmann entre une « confiance assurée », résultant de l’habitude et de la normalité, et une « confiance décidée », requérant un processus décisionnel et une évaluation du risque afférant à l’inconnu[3], nous pouvons obtenir une lecture intéressante de la modernisation et de son corollaire de rationalisation du monde. Alors que le potentiel du « faire confiance » n’a jamais été aussi élevé par le biais de l’accroissement de la connectivité, la nature des dispositifs normatifs que nous avons mis en place repose pourtant sur une logique de l’« avoir confiance ». Seligman décrit comme étant de nature post-moderne ce mouvement par lequel les sociétés réalisèrent une externalisation de la gestion des risques interactionnels, menant à une diminution de la capacité individuelle à mobiliser un agir social fondé sur le « faire confiance »[4]. Et cette extériorité (qui n’en est pas une en fait, mais qui est conçue comme telle) n’est autre que la sphère institutionnelle.
2. Le développement de l’institutionnalisme fonctionnaliste
Nous mobilisons ici le concept d’institution selon son acceptation la plus large, à savoir comme tout ce qui constitue une règle du jeu social[5]. Une norme peut être formelle ou informelle, et se présenter aussi bien sous la forme d’une organisation concrète que d’une convention sociale. Ce qui caractérise l’idée d’institution, c’est l’effet normatif qu’elle a sur les comportements. Mais un problème surgit lorsque nous réduisons notre rapport aux institutions strictement à cette fonction contraignante. La structuration et le traitement des défis socio-économiques par des systèmes légaux, techniques et économiques, perçus comme autonomes par rapport à la sphère sociale, opérèrent une sorte de démobilisation relationnelle dans le chef des acteurs. Les quelques exemples qui suivent servent à indiquer la multiplicité de registres de confiance que présentent ces défis.
L’accroissement de la légifération des interactions sociales, requérant pourtant une négociation continue des rôles, eut pour effet une déresponsabilisation civile à l’encontre de la question qualitative des liens sociaux. L’institution du contrat par exemple, comme outil privilégié de régulation économique des interactions, est souvent présentée comme la panacée dans ce cadre. Or, le contrat constitue un instantané normatif pouvant être rendu rigide à toute évolution des contextes, et pouvant être négocié dans des conditions flagrantes de déséquilibre. Nous ne souhaitons pas remettre en cause le principe du contrat, outil dont l’utilité et l’efficacité est évidente, mais bien, d’une part, son utilisation extensive et intensive dans tous les registres de la socialité, et d’autre part, l’oubli de son enjeu intrinsèque de pouvoir. Le contrat, une fois négocié, peut évacuer toute flexibilité des rapports sociaux en les contraignant en son cadre. Et c’est lorsque l’on perçoit l’institution contractuelle en des termes strictement coercitifs que l’on en vient à perdre de vue sa qualité conventionnelle, c’est-à-dire son symbolisme social[6].
Concernant la science, nous pouvons par exemple prendre le cas de la croyance en l’évolution technologique comme source de résolution des enjeux futurs de productivité et de sauvegarde de l’environnement. Pour les tenants de cette idée, il est inutile de négocier à l’heure actuelle des restrictions comportementales, dès lors que la science et la technique finiront par résoudre les problématiques en question. Dans ce cadre, c’est la nature même de la problématique environnementale qui est rendue comme caduque par la croyance en une prophétie technologiste auto-réalisatrice. Ici, nous voyons bien comment la confiance attribuée à l’institution scientifique évacue complètement des considérations liées à l’incertitude de l’impact de nos comportements. Une fois de plus, l’idée n’est pas de remettre en cause la fonction progressiste de la science et de la technique, mais bien d’indiquer qu’elle n’est pas neutre de valeurs sociales[7]. A cet effet, il convient de ne pas perdre de vue les conséquences que la technologie a sur nous, et son rôle dans l’émergence des problèmes identifiés.
Enfin, le marché constitue sans doute la figure institutionnelle la plus représentative dans notre démarche critique. Le marché a une fonction économique aussi claire que pertinente : il permet la libre rencontre d’intérêts par le biais de l’offre et de la demande. Le problème est, qu’aussi potentialisateur de rencontres et d’opportunités d’actes confiants soit le libre-échange, son principe est de type strictement utilitariste. A nouveau, ce n’est pas une mauvaise chose en soi, mais cela peut le devenir si l’on réduit l’ensemble du spectre de l’agir à un principe fondé sur l’évaluation d’un intérêt. Comme la technologie, le capital véhicule une valeur sociale et des enjeux de pouvoir qu’il convient d’être capable d’interroger à l’aune de considérations non économiques. Croire que la socialité peut se réduire au libre-échange revient à croire que toutes les interactions doivent être conçues comme des objets évaluables et capitalisables. Il existe pourtant tout un registre de l’agir anti-utilitariste (qui ne s’oppose pas mais qui échappe à l’utilitarisme, et dont la figure paradigmatique est le don) qui se soustrait totalement à la logique marchande[8].
Ainsi, le développement de l’institutionnalisation des interactions sociales par le biais de fonctionnalismes contractualiste, technologique et marchand, eut pour effet une déresponsabilisation à l’encontre de la gestion qualitative des liens sociaux. Il en résulte une importante déperdition du savoir « faire confiance » en faveur d’un « avoir confiance » sous modalité fonctionnaliste. En d’autres termes, le risque post-moderne est de voir la loi, la technologie et le marché, devenir les uniques récipiendaires de la confiance ! De ce déplacement résultent alors un appauvrissement du collectif, voire sa négation, ainsi que la mise en place de politiques de la déférence juridique, technique et consumériste, menant à un phénomène d’aseptisation interpersonnelle. Ce mouvement participe au développement de l’individualisation des hommes, aussi bien au niveau moral qu’économique, et favorise la mise en place et le succès des théorisations sociales individualistes fondées sur une suspicion : « je ne te fais pas directement confiance, mais j’ai confiance en la capacité de la loi, de la science et du marché, à te contraindre à agir dans le respect de mon intérêt. »
3. La réflexivité comme balance entre raison et routine
Il apparaît donc que le mouvement de potentialisation d’ouverture à l’altérité avance de concert avec le mouvement d’un institutionnalisme fonctionnaliste, pourtant antagoniste dans ses effets, et qui repose sur un repli sur soi et une déférence institutionnelle. Ce dernier mouvement a l’avantage de la facilité et de l’apaisement du questionnement, offrant une réponse stable, et sans doute perçue comme étant « éprouvée », face à la complexité des nouveaux enjeux. Si le fonctionnalisme ne nie pas forcément le fait pluraliste, il choisit d’en simplifier le défi, en l’abordant a priori comme un danger, et en cherchant à le réduire, que ce soit par des moyens purement utilitaristes, mais pouvant aussi faire appel à un pur saut dans la foi. Si l’utilité peut être le puissant instrument de réductionnismes de tout bord, cherchant à expliquer certains phénomènes au moyen de son principe aussi schématique que puissant, l’homme possède également la faculté de croire en des choses défiant toute preuve scientifique, aussi établie de longue date soit-elle, et de nier ce que tend pourtant à lui indiquer l’expérience sensible.
L’objectif de notre propos n’est bien entendu pas de remettre en cause l’office de l’utilité, ni même celui de la foi en fait, mais bien d’indiquer que la seule et unique voie pour s’affranchir des écueils extrémistes de ces deux registres repose précisément sur leur compréhension pluraliste, qui elle seule ouvre de façon adéquate à la réflexivité permettant leur contre-balancement. Nous comprenons ici le mécanisme de réflexivité d’une façon large, comme la capacité d’un individu ou d’un organisme à opérer un retour sur son mode de fonctionnement, à en tirer des conclusions, et à évoluer en fonction. Cette capacité réflexive est ce qui permet d’opérer un ajustement entre l’optimisation rationnelle et la routine, et donc entre l’évaluation des enjeux qui nous permet de temporiser, et l’engagement actantiel qui nous permet d’avancer. Et la confiance n’est autre que cet étrange et miraculeux phénomène à la base de toute socialité, reposant sur ce délicat mélange de raison, routine et réflexivité.
Le sociologue néo-institutionnaliste Guido Möllering décrit la confiance par le biais d’une heuristique de la « roue », dans laquelle le mécanisme de la « suspension du jugement » constitue l’élément central assurant l’équilibre entre raison, routine et réflexivité[9]. Cette « suspension » est un processus psychologique d’abandon qui permet aux acteurs de gérer de façon pratique l’incertitude ambiante et leur propre vulnérabilité. Pour Möllering, la « suspension » n’est rien de moins que l’essence de la confiance, en ce que cette dernière, en tant qu’état d’attente positive vis-à-vis des autres, ne peut être atteint que lorsque les éléments rationnels, routiniers et réflexifs sont combinés avec ce processus d’abandon[10].
Contre l’heuristique de la « roue », nous voyons pour notre part plus la confiance comme une « balance », dont l’effet résulte en ce délicat phénomène de « suspension du jugement », mais où la réflexivité joue un rôle bien plus important, à savoir celui de contrepoids assurant l’équilibre entre les bras de la raison et de la routine. Une confiance proprement réflexive, ni purement « rationaliste » – au sens des théorisations réduisant la rationalité à sa modalité instrumentale – ni purement routinière, est la seule capable d’assurer la création d’une socialité qui ne soit ni une pantomime individualiste ni une dictature démobilisatrice : dans le premier cas, la focalisation sur un calcul du risque transforme la confiance en un simple jugement de fiabilité de l’autre, et dans le second cas, l’acte quotidien d’attribution de sa confiance peut mener à un aveuglement ayant de lourdes conséquences. Ce qui est en jeu est donc une fois de plus le refus d’une optique réductionniste, s’appliquant dans ce cas-ci à l’ordre de la rationalité.
D’un côté, une approche « rationaliste » de la confiance, élaborée sur un principe de choix d’utilité et reposant sur des présupposés cognitifs articulés autour d’un enchâssement d’intérêts (« je te fais confiance car il est dans ton intérêt de respecter mon intérêt »[11]), réduit drastiquement le panel des modalités de la confiance à celles fondées sur une capacité de calcul prévisionnel. Prenons par exemple le cas d’une personne demandant son chemin à un inconnu dans la rue. Si pour avoir confiance envers les indications qui lui sont fournies, la personne doit découvrir chez l’autre un intérêt en soi dans le fait de bien la guider, il y a fort à parier que plus personne ne demanderait ni son chemin, ni l’heure, ni quoi que ce soit en fait. Personne ne se découvre un intérêt à perdre du temps pour répondre à un inconnu, mais cela se fait malgré tout, et les gens continuent à croire les autres. Pourquoi ? Sans doute parce que nous n’avons simplement pas non plus d’intérêt à leur mentir. Plutôt que de croire que l’autre est positivement bien disposé vis-à-vis de moi, nous acceptons le simple fait qu’il ne soit pas mal disposé à notre égard : nous suspendons un jugement qui risquerait de mener à un blocage interactionnel, et nous actons la proposition de l’inconnu, tout en jonglant avec des considérations d’ordre rationnel (« je dois trouver mon chemin »), routinier (« demander son chemin est monnaie courante ») et réflexif (« jusqu’à présent cela m’a permis de trouver mon chemin »).
D’un autre côté, réduire la confiance à son aspect routinier constitue également une réduction de la complexité du phénomène. Le principe d’une confiance routinière, que ce soit en quelqu’un ou en quelque chose, fut par exemple abordé par le biais du concept d’« assurance » par Luhmann. La confiance assurée est d’ordre systémique : elle repose sur un ensemble de vecteurs institutionnels et temporels qui permettent à l’individu de « résoudre la complexité » des contextes face à laquelle il est constamment confronté, et à vaincre l’incertitude afin de passer à l’acte. Comme nous l’avons vu, les institutions constituent dans ce cadre bel et bien des « dispositifs d’assurance »[12], mais il y a aussi tout simplement l’habitude et l’expérience, qui permettent de réaliser des choses apparaissant comme dangereuses pour des néophytes – escalader une montagne, ou même conduire une voiture. Le danger de la routine est alors qu’elle peut mener à une autre modalité de la confiance, à savoir son absolutisation et son détachement rationnel. Une confiance aveugle repose sur une dérive émotionnelle pouvant poser de nombreux problèmes dès lors qu’elle met à mal le déploiement d’un processus réflexif.
4. La confiance comme acte pratique d’engagement
Si le principe de la « suspension du jugement » constitue sans aucun doute une façon adéquate de décrire la phénoménalité particulière de la confiance, nous préférons mobiliser pour notre part l’idée d’« acte pratique d’engagement ». En effet, ce concept a l’avantage de ne plus faire référence aux pôles de la décision (le jugement) et de l’assurance (la suspension, et ce bien que ce concept décrive quelque chose de plus subtil que la routine en fait), et cette neutralité indique mieux à nos yeux toute la particularité processuelle de la mécanique confiante d’abandon. Comprendre la confiance au moyen de principes autres que ceux de l’évaluation cognitive de la fiabilité et de l’assurance institutionnelle ou absolue, ouvre alors à la question de son aspect pratique d’engagement relationnel.
Si la confiance repose sur un mélange complexe de raison, de routine et de réflexivité, il est impossible d’en saisir la nature profonde – et donc d’en prévoir et d’en gérer les modalités – sans la comprendre avant tout comme un acte pratique, c’est-à-dire comme un saut dans la socialité nourri par la croyance que « tout se passera bien ». L’idée est alors que pour accorder sa confiance, il suffit de croire en la volonté de l’autre de respecter l’engagement que nous lui proposons. C’est ce que décrit Philip Pettit en parlant de la « ruse de la confiance » : les relations de confiance s’établissent souvent sur la simple base de leur projection par l’une des parties, l’autre partie en venant à répondre presque « naturellement » à l’appel fidéiste[13]. Plutôt que de penser que l’autre est malintentionné à notre égard, nous mobilisons de façon incessante ce mécanisme optimiste qui repose sur un principe de socialité bienveillante. Cependant, nous insistons sur le fait qu’il n’existe en aucun cas un « devoir moral » de confiance : la raison et la réflexivité restent bel et bien des composantes essentielles à l’acte fidéiste, devant opérer un changement comportemental si l’expérience venait à mal tourner.
Comme le défend le sociologue Louis Quéré, « faire confiance » devient donc, sur la base d’un univers de référents d’assurance en construction, un engagement dans la relation, une mise de départ à travers laquelle se jette une force d’interaction[14]. Il importe de bien comprendre que la confiance ne se confond pas avec l’engagement, elle n’en est pas une forme, mais bien « une dimension constitutive » comme le souligne bien Quéré[15]. Pour ce sociologue influencé par le pragmatisme américain et la phénoménologie sociale, l’engagement requiert une implication active dans une situation comportant des éléments d’incertitude, d’investissement et de déférence. C’est au niveau de ce troisième élément de déférence qu’intervient le principe institutionnel, dont l’autorité que nous lui reconnaissons sur nous provient précisément du fait qu’il est généré par nous et pour nous. Quéré parle alors de « cadre fiduciaire » pour « désigner le référentiel normatif sans lequel la confiance ne peut pas exister »[16].
Nous créons constamment des institutions afin d’assurer l’établissement d’un « climat de confiance »[17] entre nous. En ce sens, elles sont le fruit de notre intelligence collective et du projet humain d’un vivre ensemble : les institutions sont des « connecteurs pragmatiques » qui permettent l’engagement et le passage à l’acte. Tout l’enjeu de la confiance institutionnelle repose alors sur la mise au diapason d’un processus de confiance envers l’institution, avec celui de la génération par l’institution d’un climat de confiance. Or, ce premier processus de la confiance institutionnelle est d’une nature strictement non fonctionnelle, car il repose sur des éléments de la socialité échappant à toute réduction instrumentale. Perdre cela de vue, comme le fait ce que nous appelons la proposition de l’« institutionnalisme fonctionnaliste » à la base de théorisations sociales fondées sur la suspicion, constitue une lacune à la source de notre mécompréhension des enjeux de confiance.
5. Relecture de l’enjeu de la confiance institutionnelle
Nous pensons donc que le véritable rôle des institutions est moins de contraindre les comportements individuels que d’assurer un encadrement favorable au déploiement d’un climat de confiance. Cet encadrement doit alors être attentif à ne pas opérer une programmation du social en termes strictement instrumentaux, c’est-à-dire en étant objectivement tendu à l’encontre de l’hypothèse opportuniste, sans quoi il risquerait de réduire son appui social à un jeu d’échanges intéressés et stratégiques en fonction d’un objectif bien défini à atteindre. Les institutions juridiques, techniques, marchandes, et bien sur démocratiques, ont toutes des fonctionnalités bien connues de justice, d’équité, de progrès, de reconnaissance, de liberté d’entreprendre et d’échanger, mais elles sont avant tout des créations complexes, fruits de l’histoire des hommes et de leur projet de vivre ensemble. En ce sens, elles sont constituées d’éléments que l’on ne peut réduire à leur finalité normative, et cette contingence inhérente des institutions participe au fait pluraliste.
Les conséquences de cet approfondissement conceptuel sont diverses. Dans le cadre d’une réflexion sur la confiance, cette relecture implique surtout une vision à la fois humble et faillibiliste quand à la « pertinence » d’une institution. Une institution est comme une présence qui résulte et s’impose à la fois à des contextes de vie particuliers, et il est dès lors très délicat de les évaluer les unes par rapport aux autres. En effet, le principe d’une évaluation de l’efficacité requiert la détermination de critères : quel dispositif légal offre l’encadrement le plus juste et le plus équitable, quelle technologie est-elle la plus évoluée, quelle gouvernance de marché permet la rencontre du plus grand nombre d’échanges, quel modèle démocratique engendre-t-il la reconnaissance du plus grand nombre, etc. ? Ces interrogations ne sont dénuées ni de fondement ni d’intérêt, mais les classifications auxquelles elles aboutissent réduisent la complexité de la confiance institutionnelle à leur fonction. Se pose alors, encore et toujours, la question de l’aspect radicalement contingent du choix du critère : en d’autres temps, d’autres lieux, quel aurait été ce choix ?
Dès lors, une autre conséquence, essentielle à nos yeux, n’est autre que la critique radicale de toutes les formes d’impérialisme et de colonialisme. En effet, l’importation et l’imposition d’un système institutionnel dans une culture différente peuvent éventuellement obtenir des résultats probants à l’aune de l’une de ces fonctions et de leur critère d’évaluation, mais il est par contre peu probable qu’elles n’opèrent pas une pernicieuse dénaturalisation du tissu social. Il résulte de tout acte impérialiste, qu’il soit géopolitique, économique ou culturel, un saut normatif vierge de toute épreuve de confiance sociale, pourtant nécessaire au soutien de la structure institutionnelle. Cette conséquence n’exclut cependant pas toute idée d’ingérence, mais elle lui impose des modalités particulières, fondées sur le respect des contextes de vie en présence, ainsi que sur un principe de partage des conceptions et des propositions normatives. Alors que le rationalisme occidental a tendance à s’imposer de par le monde par le biais de son programme économique capitaliste, il importe pourtant, maintenant plus que jamais, que les structures institutionnelles en place maintiennent activées leurs modalités de référence et de responsabilisation vis-à-vis de leur propre « socialité primaire », c’est-à-dire aux éléments de leur sphère sociale qui échappent au registre utilitariste[18].
C’est uniquement à travers l’interaction soutenue entre individus libres que peut se déployer la promesse d’un horizon commun. Les institutions sont les garantes de l’optimisme des peuples, non pas uniquement par le biais de leur gestion performante des enjeux socio-économiques (comme beaucoup le pensent), mais aussi et surtout de par leur capacité à suivre et à soutenir l’évolution de leur contexte social. Tel est donc le véritable enjeu de la confiance institutionnelle, qui, bien que pouvant sembler être fondé sur un argument quelque peu circulaire – la confiance que j’éprouve vis-à-vis d’une institution dépend du climat de confiance normatif qu’elle est capable de créer entre ses acteurs – constitue sans aucun doute la question essentielle à se poser face aux diverses observations de déclins de participation civile. Les institutions sont les lieux privilégiés de narrations dépassant les perspectives individuelles, et l’assurance de leur présence doit être le point de départ de la formulation de nouvelles perspectives d’avenir.
Suite à l’érosion pluraliste de la familiarité comme élément clef traditionnel de la formation d’attentes confiantes, tout l’enjeu moderne de la réflexivité institutionnelle repose alors sur la mise en place de processus démocratiques dédiés à l’interrogation de ce qui constitue la confiance envers les institutions. Dans ce nouveau cadre compréhensif, il n’existe plus une seule stratégie de gouvernance face aux déficits de confiance, mais bien deux : la première, de type bottom-up, est celle de la réactivation de la vie associative afin de ré-engranger au niveau civique les ressources morales nécessaires à un élargissement de la communauté d’appartenance, et la seconde consiste à jouer sur le design institutionnel afin de déployer, selon un mouvement top-down, la structure requise à la diffusion au sein de la population d’un sentiment généralisé d’équité, de solidarité et de justice. Une redéfinition des objectifs fonctionnalistes de la seconde stratégie ne peut faire l’impasse d’une interrogation de son lien proprement génétique à la première stratégie d’incitation des engagements. La confiance doit être avant tout travaillée par l’ensemble des acteurs au travers d’une ouverture mutuelle et d’une communication soutenue : en d’autres termes, au travers d’un « pluralisme engagé ».
6. Vers une épistémologie pragmatiste et mélioriste
Lors d’un discours adressé à l’American Philosophical Association en 1988, le philosophe Richard J. Bernstein évoque le concept de « pluralisme engagé » afin de décrire la posture que les philosophes contemporains doivent adopter selon lui, si ils souhaitent parvenir à percevoir avec acuité les défis de leur époque[19]. Identifiant l’enjeu posé par le fait pluraliste au sein de la recherche philosophique, Bernstein décrit la difficulté d’instaurer un dialogue entre les diverses écoles de pensée, fondées sur des paradigmes et des vocabulaires différents. Fidèle à la pensée pragmatique, il plaide alors pour la création d’une voie du milieu, pour l’affranchissement des extrêmes et pour le dialogue afin de combattre la violence barbare de l’imposition d’idéaux. Selon lui, aller à l’encontre de la fragmentation et rechercher le consensus et l’harmonie, ne constitue en rien un vœu pieu, mais bien la seule et unique façon de tendre vers une vérité pour laquelle les hommes continuent de se déchirer.
Proposant une épistémologie « faillibiliste » (principe pluraliste reposant sur une capacité de remise en question permanente de ses propres croyances et vérités) et « mélioriste » (principe progressiste, entre optimisme béat et défaitisme paralysant, selon lequel l’agir humain peut mener à une amélioration des conditions de vie), le concept de pluralisme engagé décrit un ethos faisant reposer sur chacun d’entre nous de nouvelles responsabilités en termes d’écoute et de respect de ce qui constitue la différence de l’autre[20]. Cette posture requiert une profonde humilité de la part des hommes quand à la nature de leur propre connaissance des choses, ainsi que des capacités d’attention et de remise en question, dès lors qu’est soutenue une relation de confiance. Cette conception pluraliste échappe à l’écueil d’un « relativisme inconséquent » (c’est-à-dire démobilisant toute forme d’engagement), en ce qu’elle repose sur l’effort nécessaire pour atteindre le point de contact permettant de s’engager de façon critique avec autrui. Et ce point de contact n’est autre que l’incessante remise au centre du débat de la question d’une probable unité[21], c’est-à-dire de ce lien social que ne cessent à la fois de révéler et de permettre les actes de confiance.
Il revient à William James, fondateur du pragmatisme le plus inspiré par la phénoménologie, d’avoir construit sa pensée à partir de cette idée que le monde est par essence pluraliste[22]. Tout dans l’expérience nous indique et nous projette de façon constante dans cette diversité radicale, dans ce flux d’évènements et de perceptions multiples. Pour James, il est essentiel que la philosophie soit capable de prendre en compte cette pluralité de points de vue, et ce sans la réduire au travers d’un schème de compréhension. Il faut que la pensée puisse prendre en considération toute la variété d’expériences humaines, aussi éloignées des diktats d’un rationalisme soient-elles, et qu’elle laisse une place au hasard, à la chance, et surtout au libre-arbitre. La foi possède une place importante dans le cœur des hommes, et doit pour cette raison trouver une position non dépréciée dans la logique de la connaissance. La « volonté de croire »[23] constitue pour James un acte créateur absolument essentiel, une des sources les plus puissantes de la socialité, et la preuve de notre intelligence collective. Croire, au-delà ou en-deçà de toute raison, c’est s’engager, et c’est choisir de « faire confiance » afin de parvenir à vivre et à expérimenter dans ce « flux de conscience »[24] qui nous porte.
Cette vision pluraliste, pour éviter l’inconséquence d’un relativisme qui défendrait l’idée selon laquelle n’importe quelle croyance est aussi bonne qu’une autre, implique alors un soubassement éthique de type mélioriste fondé sur le dialogue. Comme l’explique Bernstein, un univers pluraliste est un monde ouvert dans lequel les choix posés ont de réels impacts pouvant être négatifs, mais aussi, et surtout, positif[25]. Le méliorisme jamesien invite à considérer la source d’amélioration de la normativité dans l’effort fourni pour comprendre l’autre. L’altérité n’est que le résultat d’une appréciation différente de la même expérience. Comprendre que ce sont les points de vue sur une même réalité qui mènent à des divergences actantielles, ouvre alors à la question expérimentale : en quoi ma vision est-elle « meilleure » que celle de l’autre, et en quoi la compréhension de celle de l’autre me permet d’améliorer ou de renforcer la mienne ? La construction de la socialité dépend alors en première instance de ce mouvement confiant d’engagement envers l’autre et son irréductible différence, laquelle constitue la promesse d’un enrichissement mutuel. La « bonne » conception est alors celle qui parvient à intégrer et à prendre en considération le plus grand nombre de points de vue. Et dans ce magma de conceptions, ce sont rarement les plus extrêmes, à savoir celles se détachant le plus du socle expérientiel, qui obtiendront l’adhésion du plus grand nombre.
Conclusion
En guise de conclusion, nous souhaitons brièvement présenter les travaux du philosophe américain Philip Kitcher. En effet, et bien que notre démarche ne soit absolument pas la même, il existe deux liens conséquents entre les idées présentées dans cet article et celles défendues avec beaucoup de brio par ce philosophe des sciences. Premièrement, la conception défendue ici des institutions fait écho à la description par Kitcher du « projet éthique » que mène l’espèce humaine depuis son apparition décrit[26]. Selon une perspective naturaliste cohérente et articulée, il décrit comment l’évolution de notre espèce repose sur le développement d’une capacité de guidance normative. Si la fonction originelle de l’éthique est de remédier aux échecs de l’altruisme, les solutions institutionnelles que nous créons à cette fin sont le résultat de processus sociaux complexes, entrelaçant les opportunités offertes par les contextes de vie avec les ressources interactionnelles en présence. L’idée même d’une expertise éthique est un non-sens pour Kitcher : seule l’autorité du dialogue peut mener à la solution du devoir, et le rôle de la philosophie est de faciliter cette conversation.
Deuxièmement, Kitcher en est venu à faire référence au pragmatisme afin de trouver des solutions conceptuelles aux problèmes pratiques posés par le fait pluraliste. De William James, Kitcher garde une conception fondamentalement pluraliste de la vérité, et de John Dewey, il mobilise les réflexions liées à l’enjeu éducatif dans l’optique d’une démocratie à la fois radicale et créative[27]. Cette quête proprement pragmatique d’une voie du milieu entre un « relativisme inconséquent » et un « fondationnalisme infaillible », Kitcher la développe par exemple de façon claire en parvenant à articuler son combat contre le créationnisme avec celui qu’il mène contre le scientisme[28]. En effet, la science n’est pas neutre de valeurs, et, tout comme nous l’avons laissé entrevoir au travers notre réflexion institutionnelle, c’est pour cette raison qu’une démocratisation de son enceinte est primordiale. Mais cette démocratisation ne doit pour autant pas se faire au détriment de l’argumentation rationnelle, et elle ne doit en aucun cas se solder par l’imposition de croyances intégristes. Ce qui est fondamentalement en jeu pour Kitcher, c’est la mise en place d’une solution théorique cohérente, entrelaçant totalement les concepts d’épistémique et de pratique, dans des considérations éthiques, sociales et politiques[29].
A notre humble niveau, c’est aussi l’optique d’un entre-deux que nous avons essayé d’identifier, avec le mécanisme réflexif d’une confiance entre jugement et assurance. Une « confiance engagée » promeut et permet l’investissement, non seulement dans la relation, mais aussi et surtout dans l’évaluation et la modification des cadres fiduciaires qui l’assurent. Une telle confiance repose alors sur un ensemble de croyances évolutionnistes et mélioristes, selon lesquelles la confrontation à l’altérité constitue la source d’une normativité sociale affranchie de tout extrémisme. Quitter la logique d’un institutionnalisme fonctionnaliste, qui conçoit les règles du jeu collectif comme des instruments coercitifs, et les comprendre avant tout comme des connecteurs pragmatiques de confiance, permet alors de mieux saisir l’enjeu de leur autorité épistémique.
Autant de preuves du génie interactionnel des acteurs, cette conceptualisation des institutions oblige à les appréhender selon une perspective radicalement dynamique et idiosyncrasique… En d’autres termes : pluraliste. Ce fait pluraliste, loin d’inviter à un défaitisme lié aux affres d’un « relativisme inconséquent », requiert au contraire de le percevoir comme la source de toute créativité sociale, et comme la seule et unique voie face aux simplifications épistémiques produites par la logique fonctionnaliste. Contrecarrer les tendances réductionnistes de ce mouvement repose alors sur une démocratisation des enceintes aussi bien politiques que scientifiques, et impose le développement de processus transdisciplinaires, c’est-à-dire de collaboration confiante entre experts et profanes, dans la production de la connaissance.
[1] Luhmann, N., Trust and Power, Chichester, John Wiley & Sons, 1979.
[2] Seligman, A., The Problem of Trust, Princeton, Princeton University Press, 1997.
[3] Luhmann, N., « Confiance et Familiarité : Problèmes et Alternatives », in Quéré, L. (ed.), La Confiance, Réseaux, 108, Paris, Hermès Science Publications, 2001.
[4] Seligman, A., op. cit., 1997.
[5] North, D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
[6] Orléan, A., « Introduction : Vers un Modèle Général de la Coordination Economique par les Conventions », in Orléan, A. (ed.), Analyse Economique des Conventions, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.
[7] Feenberg, A., Questioning Technology, Oxford, Routledge, 1999.
[8] Caillé, A., Théorie Anti-utilitariste de l’Action : Fragments d’une Sociologie Générale, Paris, Editions la Découverte/M.A.U.S.S., 2009.
[9] Möllering, G., Trust : Reason, Routine, Reflexivity, Oxford, Elsevier, 2006.
[10] Ibid., p. 110.
[11] Hardin, R., Trust and Trustworthiness, in Russel Sage Foundation Series on Trust, 4, New York, Russel Sage Foundation, 2002.
[12] Karpik, L., « Dispositifs de Confiance et Engagements Crédibles », in Sociologie du Travail, vol. 38, n°4, Paris, 1996, pp. 527-550.
[13] Pettit, P., « The Cunning of Trust », in Philosophy of Public Affairs, vol. 24(3), 1995, pp. 202-225.
[14] Quéré, L., « Les Rationalités de la Confiance », in Lobet-Maris, C. et al. (eds.), Variations sur la confiance : Concepts et Enjeux au Sein des Théories de la Gouvernance, coll. Philosophie et Politique, 18, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2009, pp. 37-56.
[15] Quéré, L., « Confiance et Engagement », in Ogien, A. et Quéré, L. (eds.), Les Moments de la Confiance : Connaissance, Affects et Engagements, Paris, Economica, 2006, pp. 117-142.
[16] Ibid., p. 139.
[17] Hartmann, M., Die Praxis des Vertrauens, Berlin, Suhrkamp Verlag, 2011.
[18] Caillé, A., Théorie Anti-utilitariste de l’Action : Fragments d’une Sociologie Générale, Paris, Editions la Découverte/M.A.U.S.S., 2009.
[19] Bernstein, R. J., « Pragmatism, Pluralism and the Healing of Wounds », in Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, vol. 63, n° 3, 1989, pp. 5-18.
[20] Bernstein, R. J., The New Constellation : The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity, Cambridge, Polity Press, 1991.
[21] Bernstein, R. J., The Pragmatic Turn, Cambridge, Polity Press, 2010, p. 59.
[22] James, W., A Pluralistic Universe, in McDermott, J. J. (ed.), The Writings of William James : A Comprehensive Edition, Chicago, The University of Chicago Press, 1977.
[23] James, W., « The Will to Believe », in McDermott, J. J. (ed.), The Writings of William James : A Comprehensive Edition, Chicago, The University of Chicago Press, 1977.
[24] James, W., « The Stream of Thought », in McDermott, J. J. (ed.), The Writings of William James : A Comprehensive Edition, Chicago, The University of Chicago Press, 1977.
[25] Bernstein, R. J., The Pragmatic Turn, Cambridge, Polity Press, 2010, pp. 61-63.
[26] Kitcher, P., The Ethical Project, Cambridge, Harvard University Press, 2011.
[27] Dewey, J., « Creative Democracy : The Task Before Us », in Hickman, L. A. et Alexander, T. M. (eds.), The Essential Dewey, Volume 1, Pragmatism, Education, Democracy, Bloomington, Indiana University Press, 1998.
[28] Kitcher, P., Science in a Democratic Society, New York, Prometheus Books, 2011.
[29] Kitcher, P., Science, Truth and Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2001.