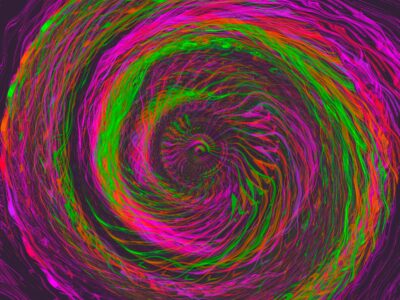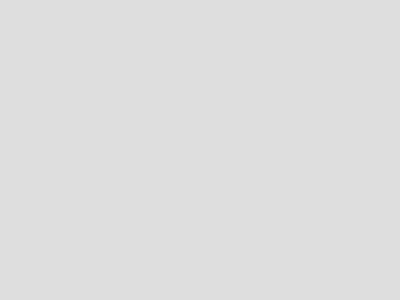Conception tragique du monde
Par Thibaud Zuppinger.
Tant que l’homme est absorbé par ses préoccupations quotidiennes, il ne songe pas particulièrement à réfléchir sur le sens de la vie et sur l’éventuelle absurdité de celle-ci, à « se replier sur tous ces néants qui ont fait un jour »[1] notait mélancoliquement Barbey d’Aurevilly. Le fait de vaquer à ses occupations constitue un excellent dérivatif aux interrogations que l’homme peut avoir sur sa place dans le monde.
Cela étant, lorsque la subsistance n’est plus le souci majeur il y a un espace qui peut surgir pour la réflexion sur le sens de notre place dans le monde. Les besoins naturels et nécessaires étant satisfaits, l’homme est alors en mesure d’accéder à un questionnement qui englobe son existence et le milieu qui l’entoure par un vaste « pourquoi » auquel les valeurs de la praxis quotidienne ne peuvent plus suffire.
Lorsqu’on relève la tête du monde des affaires des hommes, les valeurs propres à la société, caractérisées par une vue à court terme du rapport moyen/fin sans interroger cette dernière, prennent alors une coloration particulière, un aspect arbitraire et contingent car elles ne structurent pas la vie humaine de part en part. Cette interrogation peut être rapprochée de l’accidie, ce moment particulier de doute qui ôte tout sens à l’activité quotidienne, où le monde est alors débarrassé de la grille d’utilité qui structure notre regard. Ce moment psychologique est l’impulsion initiale qui amène l’individu à interroger le réel pour y chercher une réponse au sens de sa vie, de son activité.
Le réel ne nous dit pas ce que l’homme doit faire. Il reste désespérément muet devant les questions que l’homme se pose. Certes il possède des structures qui lui sont propres, des régularités que la science transforme en lois, une dynamique qui parcourt la nature. Cependant rien n’indique que cela nous concerne. Il pourrait parfaitement en être autrement, ou pire encore, il en irait sans doute de même si l’on n’était pas là à l’observer. Le réel n’a pas besoin de nous dans sa structure. L’observation la plus objective du monde nous renvoie irrémédiablement à un sentiment de contingence quant à notre existence. C’est ce moment que possède en commun les courants dits existentialistes : l’angoisse originelle.
Kierkegaard souligne qu’il est essentiel de reconnaître que l’on n’éprouve pas seulement de la peur face à certains objets spécifiques mais que l’on peut également ressentir un sentiment général d’appréhension. C’est ce même sentiment que Sartre décrit sous le terme de « nausée » ou encore que Heidegger développe au paragraphe 40 de Être et Temps[2]. L’angoisse se définit par trois caractéristiques fondamentales : c’est le monde dans son ensemble qui en est la cause, l’origine du malaise est dans l’absence de sens, et, enfin, cette prise de conscience manifeste un arrachement à la quotidienneté donc à l’utilité.
Le rapport que l’on entretient avec le monde sur le mode de l’angoisse diffère du mode de la quotidienneté qui l’examine sur le mode de l’utilité. Dans l’angoisse, le monde apparaît « en lui-même », c’est-à-dire sans interprétation préalable sur le mode de l’utile. Cet accès nouveau au réel est particulièrement difficile à supporter, et c’est pourquoi Nietzsche souligne que « l’ingéniosité de tous les hommes supérieurs de ce siècle consiste à triompher de ce terrible sentiment de vide[3]« .
L’acceptation du réel, pour que l’on puisse continuer à agir en son sein, suppose donc une conscience qui serait capable à la fois de connaître le pire et de pouvoir continuer à vivre sans être ravagée par cette connaissance de l’absence de sens. Il se dessine ainsi une tâche éthique pour l’homme qui consiste à s’accommoder du réel, à trouver sa satisfaction dans un monde périssable.
Dans le principe de cruauté[4], C. Rosset s’est attaché à en esquisser les principes éthiques. Cette éthique de la cruauté renvoie à ce moment de réduction du réel à son unique réalité, qui est inassimilable, indigeste (sens étymologique de cruor). Cette posture éthique repose sur deux principes qui sont le principe de réalité suffisante et le principe d’incertitude, ce dernier refusant l’existence de certitudes sur le réel ce qui permet une plus grande écoute des interprétations nouvelles en évitant le dogmatisme. Le principe de réalité suffisante est plus intéressant pour notre propos car il postule qu’il n’y a rien dans le réel qui puisse contribuer à sa propre intelligibilité, d’où bien souvent le recours à un principe extérieur chargé de l’expliquer et de le justifier. Or la réalité ne pouvant s’expliquer elle-même, elle nous est donc à jamais inintelligible. Le réel nous échappe, non en raison de son inépuisable richesse, mais en raison de sa pauvreté en sens. Nos attentes spontanées face au réel dépassent ce qu’il peut nous donner. De ce constat tragique il n’est pas possible de concevoir l’émergence d’une éthique qui puisse répondre aux aspirations humaines.
Le constat que nous venons de dresser sur la pauvreté en sens du réel a pour attitude éthique cohérente le nihilisme. Si le réel est axiologiquement neutre, alors rien ne vaut, et l’attitude la plus cohérente est le nihilisme, cette posture pour laquelle il n’y a pas de vérité morale, pas de hiérarchie des valeurs. Survient alors deux possibilités : agir ou se résigner. Le nihilisme reste au stade du désespoir résigné. En revanche, si l’on refuse l’abandon au flux chaotique du monde, ne tend-on pas alors, de façon générale, vers l’humanisme tragique ?
[1] BARBEY D’AUREVILLY Jules, Œuvres romanesques complètes, Tome II, textes établis par J. Petit, édition de la Pléiade, Paris, 1966, p. 740.
[2] HEIDEGGER Martin, Être et Temps (1927), trad. fr. de F. Vezin, Paris, Gallimard, coll. « nrf », 1986, pp. 235-236.: « le devant-quoi de l’angoisse est l’être-au-monde en tant que tel… Le devant quoi de l’angoisse n’est pas un étant intérieur au monde… Le monde a pour caractère l’absence complète de significativité… » ; « Le parler quotidien n’a d’autre but qu’une préoccupation et un débat où c’est l’utilisable qui est en cause. Ce devant quoi l’angoisse s’angoisse n’a rien d’un utilisable intérieur au monde »
[3] NIETZSCHE Friedrich, La volonté de puissance t.II, édition établie par F. Würzbach, trad. fr. de G. Bianquis, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1995, livre III, aphorisme 116.
[4] ROSSET Clément, Le principe de cruauté, Paris, éditions de Minuit, coll. « critique », 1988.
Pour citer cet article :
ZUPPINGER, Thibaud. Culture et progrès. Implications Philosophiques [en ligne]. 2009. Disponible sur : (consulté le ).