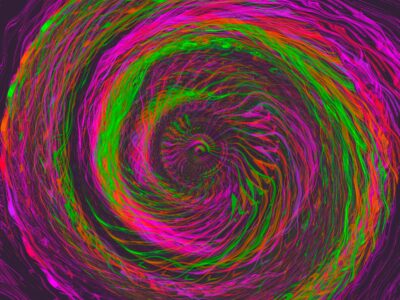Compte-rendu critique – Vers une nouvelle phénoménologie de l’institution. Avec et au-delà de Merleau-Ponty
Jérôme Watin-Augouard est professeur certifié de philosophie, ATER en philosophie allemande à l’Université Grenoble Alpes (UGA) et doctorant à l’Institut de Philosophie de Grenoble (IPhiG). Ses recherches portent sur les notions de symbolique et d’institution en phénoménologie, depuis Ernst Cassirer jusqu’à Marc Richir, en passant par Maurice Merleau-Ponty.
Mariana Larison, Vers une nouvelle phénoménologie de l’institution. Avec et au-delà de Merleau-Ponty, Bucarest, Zeta Books, 2023, 222p.
L’ouvrage est disponible ici.
Résumé
Vers une nouvelle phénoménologie de l’institution de Mariana Larison propose une approche originale des cours donnés par Maurice Merleau-Ponty en 1954/1955, d’une part en les réinscrivant dans les problématiques génétiques et génératives de la pensée husserlienne et, d’autre part, en déployant un dialogue avec la tradition sociologique et juridique française. L’ambition de l’ouvrage est ainsi d’esquisser le programme d’une phénoménologie de l’institution, notamment à partir d’une innovation conceptuelle de ces cours, à savoir la notion de transtemporalité.
Mots-clefs : Merleau-Ponty, Phénoménologie, Institution, Générativité, Temps.
Abstract
Vers une nouvelle phénoménologie de l’institution by Mariana Larison offers an original approach of the lectures given by Maurice Merleau-Ponty in 1954/1955, on the one hand reinscribing them in the genetic and generative problematics of Husserlian thought and, on the other, deploying a dialogue with the French sociological and juridical tradition. The ambition of the book is thus to outline the program of a phenomenology of the institution, based in particular on a conceptual innovation of these courses, namely the notion of transtemporality.
Keywords: Merleau-Ponty, Phenomenology, Institution, Generativity, Time.
Introduction
L’ouvrage de Mariana Larison se propose de relancer le projet d’une phénoménologie de l’institution, amorcé par M. Merleau-Ponty dans un cours donné au Collège de France en 1954/1955, dont les notes ont été publiées en 2003[1]. Si ce cours a donné lieu, depuis, à de nombreux commentaires – parmi lesquels on peut mentionner les articles de R. Terzi[2] et l’important ouvrage d’A. Gléonec[3] – l’originalité de l’ouvrage de M. Larison est d’en appeler à une « nouvelle phénoménologie de l’institution, avec et au-delà de Merleau-Ponty ». Il s’agit donc d’un « programme de recherche » (p. 19) visant à « ouvrir une phénoménologie de l’institution de matrice merleau-pontienne » (Ibid.). Au vu de la grande diversité des champs parcourus par l’autrice au fil des chapitres qui sont autant d’études thématiques – champs qui sont ceux-là-même que traverse Merleau-Ponty dans son cours, à savoir le vivant, l’animalité, la politique, la culture, l’histoire, etc. – nous centrerons ce compte-rendu autour de quelques questions générales à même d’éclairer la lecture de l’ouvrage.
Pourquoi un tel programme aujourd’hui ? Comment la phénoménologie, notamment dans cette inspiration merleau-pontienne, peut-elle contribuer à la réflexion actuelle sur l’institution ? En quelle mesure une telle phénoménologie est-elle nouvelle, et pourquoi, si elle chemine avec Merleau-Ponty, doit-elle également aller au-delà ? Vers quels champs cet « au-delà » fait-il signe ? Nous tenterons de formuler quelques réponses en nous appuyant sur les pistes ouvertes par l’autrice qui nous paraissent les plus décisives, à savoir, en premier lieu, la relance d’un dialogue entre phénoménologie et sciences positives sur la base de cette notion d’institution et de l’articulation qu’elle permet entre la phénoménologie et la tradition sociologique et juridique française. Deuxièmement, nous interrogerons la possibilité d’une troisième voie entre genèse et générativité, sur la base d’une innovation conceptuelle du cours de 1954/1955, trop peu connue encore, et sur laquelle M. Larison insiste avec raison, à savoir celle d’une transtemporalité originaire constitutive de l’institution. Néanmoins, si ce concept, que l’autrice traduit comme étant celui d’un « temps du commun » (p. 167), est bien au centre d’une phénoménologie de l’institution « de matrice merleau-pontienne », cette dernière semble receler des difficultés importantes, déjà relevées par plusieurs commentaires que nous exposerons au fil de cette deuxième partie. En un mot, disons que l’institution merleau-pontienne a certes le mérite d’expliciter la dimension commune de nos expériences – le commun pensé comme vie et comme temps – mais elle ne le fait qu’en présupposant constamment le statut originaire de cette communauté et de la continuité foncière qui la caractérise, au détriment des phénomènes de discontinuité et de rupture.
I. Relancer le projet merleau-pontien : phénoménologie et sciences positives.
1. Sciences et phénoménologie : quel dialogue ?
C’est par la question des rapports entre sciences positives et philosophie phénoménologique que M. Larison a judicieusement choisi d’introduire sa réflexion (pp. 11-21). Elle présente ainsi la position de Merleau-Ponty comme un « néo-socratisme » (p. 14) : prenant acte du constat husserlien d’une crise des sciences et de la rationalité, sans pour autant endosser l’ambition, également husserlienne, d’une fondation épistémologique des sciences sur la phénoménologie, Merleau-Ponty déploie sa philosophie comme une « interrogation constante et infatigable de l’expérience du vivant humain dans toutes ses manifestations » (p.14). Il s’agit donc de refuser autant la prétention philosophique d’ériger un savoir absolu que la naïveté réaliste des sciences positives, en exposant « la question du vivant humain en tant que problème » (p.15), non pas seulement épistémique ou historique, mais avant tout ontologique.
 Le travail de M. Larison consiste à montrer en quoi la notion d’institution confère à cette question un « nouveau principe d’intelligibilité » (p. 18). Par conséquent, le projet d’une nouvelle phénoménologie de l’institution implique de rouvrir ou de poursuivre aujourd’hui le dialogue avec les sciences, telles que la biologie, l’éthologie, les sciences du comportement et la psychanalyse d’une part, la sociologie et la théorie du droit, l’ethnologie et l’anthropologie d’autre part. Remarquons d’ailleurs que l’ouvrage de M. Larison a été publié à peu près au même moment que la somme du sociologue Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines[4], qui entend reconsidérer la sociologie comme une science, au même titre que la physique ou que la biologie, en dégageant des lois et des structures invariantes. Dans ce contexte, il est particulièrement important de faire valoir la perspective phénoménologique, laquelle s’est, dès son origine, érigée face à un « modèle positiviste des sciences » (p. 11). Si ce modèle n’est bien sûr plus le même qu’à la fin du XIXe siècle, l’objectivisme, le réalisme et le déterminisme portés par l’idéal de scientificité demeurent aujourd’hui tout aussi prégnants. Dès lors, « comment sortir d’une philosophie du sujet sans tomber ni dans un objectivisme ni dans un réalisme ingénu ? » (p. 20) Tel est l’enjeu d’une phénoménologie de l’institution, qui est aussi l’enjeu de sa discussion avec les sciences.
Le travail de M. Larison consiste à montrer en quoi la notion d’institution confère à cette question un « nouveau principe d’intelligibilité » (p. 18). Par conséquent, le projet d’une nouvelle phénoménologie de l’institution implique de rouvrir ou de poursuivre aujourd’hui le dialogue avec les sciences, telles que la biologie, l’éthologie, les sciences du comportement et la psychanalyse d’une part, la sociologie et la théorie du droit, l’ethnologie et l’anthropologie d’autre part. Remarquons d’ailleurs que l’ouvrage de M. Larison a été publié à peu près au même moment que la somme du sociologue Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines[4], qui entend reconsidérer la sociologie comme une science, au même titre que la physique ou que la biologie, en dégageant des lois et des structures invariantes. Dans ce contexte, il est particulièrement important de faire valoir la perspective phénoménologique, laquelle s’est, dès son origine, érigée face à un « modèle positiviste des sciences » (p. 11). Si ce modèle n’est bien sûr plus le même qu’à la fin du XIXe siècle, l’objectivisme, le réalisme et le déterminisme portés par l’idéal de scientificité demeurent aujourd’hui tout aussi prégnants. Dès lors, « comment sortir d’une philosophie du sujet sans tomber ni dans un objectivisme ni dans un réalisme ingénu ? » (p. 20) Tel est l’enjeu d’une phénoménologie de l’institution, qui est aussi l’enjeu de sa discussion avec les sciences.
Le premier mérite de l’ouvrage de M. Larison consiste à lever certains préjugés tenaces parmi le public philosophique ou intellectuel quant à ce qu’est la phénoménologie, et qu’il n’aurait pas été inutile d’expliciter ou de systématiser davantage, à titre de prérequis du dialogue avec les sciences. Nous pouvons en identifier trois principaux, qui peuvent, a priori, rendre dissonante l’expression de « phénoménologie de l’institution ». 1) La phénoménologie – particulièrement dans sa version transcendantale – serait avant tout une philosophie de la conscience, d’orientation subjectiviste, incapable donc de penser l’objectivité des structures ou des faits sociaux ; 2) son outil méthodologique principal, l’épochè, ne serait rien d’autre qu’un moyen de s’abstraire de la réalité sociale et politique, ou d’y être indifférent ; 3) et si la phénoménologie entendait malgré tout s’engager sur le terrain des phénomènes sociaux, politiques ou culturels, elle ne pourrait le faire qu’en s’opposant à son fondateur, Husserl, dont la pensée demeurerait avant tout une philosophie de la conscience.
1) La phénoménologie est avant tout plurielle, et si sa version la plus connue, exposée dans les ouvrages publiés du vivant de Husserl, témoigne bien d’une orientation subjective, l’ensemble de l’œuvre husserlienne ne peut y être réduite. Par ses analyses dites génétiques et génératives, qui concernent, en première approche, l’historicité du sens et les modalités de sa transmission intergénérationnelle, la phénoménologie husserlienne s’engage en effet sur un terrain qui n’est plus celui d’une stricte philosophie de la conscience, mais celui des phénomènes qui la dépassent, principalement sous l’angle de la temporalité.
2) L’épochè mobilisée par cette phénoménologie n’ouvre donc pas au seul domaine de la subjectivité, et des vécus constitutifs – donateurs de sens – de la conscience, mais bien, avant tout, à celui des « phénomènes eux-mêmes, dégagés des préjugés disciplinaires » (p. 208). L’épochè est ainsi un outil critique, qui permet de se prémunir de toute vue naïve qui consisterait à adopter d’emblée les méthodes et les exigences des sciences au seul prétexte de leur scientificité – ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ce soit l’occasion de congédier sans discussion les résultats de ces sciences, a fortiori quand l’objet en question est l’institution ou le vivant.
3) Cette phénoménologie de l’institution ne revient donc pas à jouer la carte merleau-pontienne contre Husserl, mais à approfondir, voire à « radicaliser » (p. 191) le sillon ouvert par le fondateur. Ce geste est certes contre-intuitif de prime abord, puisque Merleau-Ponty, dans son cours, entend prendre ses distances avec la philosophie de la conscience comme pensée de la constitution, à laquelle s’oppose justement une pensée de l’institution. Mais cela ne veut pas dire prendre ses distances avec la pensée husserlienne, puisque cette dernière n’est justement pas réductible à sa version « canonique » subjectiviste. La phénoménologie de l’institution n’est pas à déployer contre la pensée husserlienne, mais avec elle et depuis ses creux.
La démarche de l’autrice, en cela fidèle autant à l’esprit qu’à la lettre de la pensée merleau-pontienne, consiste ainsi à s’inscrire dans l’historicité propre à l’institution philosophique de la phénoménologie afin d’ouvrir « une nouvelle phénoménologie de l’institution » : le sens « déposé » dans les œuvres de Husserl et de Merleau-Ponty ne l’est pas, pour reprendre les mots de ce dernier, « comme un objet au vestiaire », mais « comme à continuer, à achever sans que cette suite soit déterminée »[5]. Ainsi, l’« au-delà de Merleau-Ponty », annoncé dans le titre de l’ouvrage, semble bien renvoyer, par une temporalité qui, nous le verrons, est le propre de l’institution merleau-pontienne, à Husserl lui-même et à une réinterprétation de sa phénoménologie, au croisement des perspectives génétique et générative. Ainsi que le résume l’autrice :
Le terme institution nous situe donc, d’emblée, en dehors du champ de la conscience individuelle, en dehors de la sphère de ce qu’on appelle, avec Husserl, la constitution. Et pourtant, comme nous voudrions le montrer ici, cela n’empêche nullement la phénoménologie de l’institution, telle que suggérée par Merleau-Ponty, d’être lue, avant tout, comme une ré-appropriation radicale du projet husserlien. Bien plus, elle présuppose d’après nous l’incorporation de la perspective générative au problème général de l’historicité du sens des analyses génétiques, précisément grâce à l’abandon, comme point de départ, de la perspective de la constitution. (p. 203)
L’institution merleau-pontienne semble ainsi engager une certaine réinterprétation des rapports entre les dimensions génétiques et génératives de la phénoménologie husserlienne, et même une « troisième possibilité […] qui n’exclut pas mais réincorpore les deux perspectives » (p. 192). Cette hypothèse remet en cause un présupposé qu’il eût fallu néanmoins davantage expliciter, à savoir « l’idée d’une alternative excluante entre générativité et genèse » (p. 193).
2. Quelle phénoménologie ? Perspectives génétiques et génératives.
En effet, la dimension génétique est présentée comme « la problématique de la genèse et de la transmission de sens dans la sphère personnelle comme dans la sphère interpersonnelle, engageant une réflexion sur l’historicité du sens et l’horizon de tradition qu’elle implique » (p. 62) et dont le concept majeur est celui de Stiftung, qui désigne initialement un type d’acte de la conscience consistant en une formation, une création ou une fondation d’un sens, soit de manière originaire (Urstiftung) soit comme réinstitution (Nachstiftung). Un concept que Husserl mobilise notamment pour traiter le champ des formations culturelles, notamment celui de la géométrie, dans l’Appendice III de La crise des sciences européennes. La dimension générative est présentée quant à elle, sur la base des travaux de R. Walton, comme « une dimension antérieure de l’historicité du sens » et un « mode primordial d’intersubjectivité » qui est celui de la « production, transmission et adoption du sens à travers des liens génératifs, voire instinctifs, au sein d’une communauté primordiale, formant de cette manière une proto-historicité subjective ainsi qu’un monde déjà proto-historicisé dès le début de la vie subjective » (p. 198).
De la sorte, et sans que cela soit véritablement questionné, la perspective génétique apparaît, au fil du texte, comme celle de « l’histoire effective des formations culturelles au sein d’une tradition » (p. 208), reposant sur une « donation de sens » (p. 199), alors que la perspective générative serait le lieu d’une « adoption » ou d’une « prise en charge » d’un sens « pré-donné », comme « résultat des pratiques d’une communauté à travers différentes générations au sein d’une histoire commune » (p. 199-200). La perspective génétique semble ainsi réduite à la donation de sens au sein d’« une histoire effective [qui] peut se dérouler tant dans le domaine subjectif qu’intersubjectif » (p. 201), un geste qui interroge, dans la mesure où les analyses husserliennes dites « génétiques » ne concernent pas tant une donation effective qu’une prédonation passive, temporelle et affective – et de ce point de vue, la frontière avec la générativité n’apparaît plus aussi tranchée. On s’en étonne d’autant plus que l’autrice prend justement ses distances, en notes de bas de page, vis-à-vis de la thèse d’A. Steinbock, à savoir celle d’une « alternative apparemment exclusive entre la phénoménologie générative et la phénoménologie génétique » (p. 192, n.2), et penche davantage pour la position de R. Walton « considérant les deux perspectives comme les différentes couches d’un même problème : celui de l’historicité de l’expérience. » (p. 192, n.3). Tout se passe comme si les rapports entre génétique et génératif étaient un peu trop vite considérés depuis une dichotomie que l’autrice appelle à dépasser avec Merleau-Ponty, mais sans que l’on comprenne quel sens ce dernier aurait donné à cette dichotomie. Par ailleurs, on ne comprend pas très bien comment s’articulent les deux aspects de la générativité comme transmission traditionnelle et communautaire du sens, et comme « dimension organique et affective primordiale » (p. 193).
On peut ainsi regretter que cette problématique n’ait pas été davantage développée sur la base d’un panorama plus important des recherches husserliennes, intégrant, outre R. Walton et A. Steinbock, d’une part les travaux de C. Serban[6] ou L. Perreau[7], qui mettent au jour la dimension corporelle et anthropologique ou la normativité sociale de la générativité et, d’autre part, ceux d’A. Schnell[8] qui insistent au contraire sur son statut rigoureusement transcendantal en-deçà de toute description phénoménologique. Ceci aurait permis de mieux comprendre et situer l’hypothèse, défendue par l’autrice, d’une « troisième possibilité » (p. 192) entre génétique et génératif, en quoi consisterait in fine la nouvelle phénoménologie de l’institution qu’elle entend ouvrir, mais dont l’exposé nécessiterait de distinguer plus rigoureusement, d’une part, la générativité dans l’œuvre husserlienne et les différents sens qui lui sont donnés par les commentaires dans ses rapports avec le génétique, et, d’autre part et par contraste, l’originalité du cadre merleau-pontien que M. Larison entend exposer dans son caractère matriciel.
Quoiqu’il en soit, l’ouvrage réussit à mettre en évidence que l’institution n’est pas un objet extérieur qui viendrait ex nihilo s’ajouter au programme de la phénoménologie en l’obligeant à renier ses orientations initiales, de même, inversement, que la perspective phénoménologique n’est pas totalement étrangère à ce que Marcel Mauss, dans le cadre de la sociologie, et Maurice Hauriou, dans le celui de la théorie du droit, avaient dégagés comme étant le propre de l’institution.
3. L’institution, au carrefour de la phénoménologie husserlienne et de la tradition sociologique et juridique française.
L’un des intérêts majeurs de la pensée merleau-pontienne de l’institution est bien de faire se recroiser la double origine de cette notion, à la fois philosophique et sociologique, et c’est également l’un des mérites de l’ouvrage de M. Larison que d’expliciter ce geste dans deux chapitres importants intitulés « Stiftung et pensée du social : quelle institution ? » (pp. 133-154) et « L’institution entre temps » (pp. 155-167). Ces chapitres permettent de réinscrire la pensée merleau-pontienne de l’institution dans le contexte de la tradition sociologique et juridique française, depuis E. Durkheim et M. Mauss, en passant par les juristes L. Duguit et M. Hauriou, tradition dont G. Gurvitch s’est fait le passeur auprès de Merleau-Ponty, et dont la prise en compte est tout aussi essentielle que la phénoménologie husserlienne pour comprendre la notion proprement merleau-pontienne d’institution.
La traduction que choisit de donner Merleau-Ponty à la notion husserlienne de Stiftung fait en effet échos à la notion que Mauss et Fauconnet introduisent pour qualifier ces « faits spéciaux » que sont « toutes les manières d’agir et de penser que les individus trouvent devant eux et qui s’imposent plus ou moins à eux »[9]. Ainsi, comme le remarque M. Larison, le choix de traduire la notion allemande et husserlienne de Stiftung par le terme français et sociologique d’institution « n’a rien d’évident » (p. 133) puisqu’il mêle la problématique subjective de la genèse des sens idéaux à partir des actes de la conscience avec celle de l’analyse objective des dimensions de l’expérience sociale.
Néanmoins, ce choix s’éclaire si l’on tient compte, d’une part, du fait que les développements les plus notables du problème de la Stiftung concerne le champ des formations culturelles interpersonnelles, et donc que la Stiftung est certes un acte subjectif mais qui s’ouvre à un champ de validité objective et intersubjective que Husserl nomme « tradition » et « histoire » et, d’autre part, du fait inverse que l’institution, pour Mauss et Fauconnet, ne désigne pas une objectivité monolithique et purement coercitive qui s’imposerait à des individus foncièrement passifs, mais un processus vivant qui intègre les subjectivités et auquel ces dernières participent activement par « appropriation » et « réinstitution du sens » (p. 162). Il s’agit, pour eux, de dépasser les dualismes durkheimiens entre individu et collectif, chose et conscience, en se donnant pour tâche de « penser la vie de la société à travers ses institutions » (p. 161), lesquelles ne sont « véritables » que pour autant qu’elles sont « vivantes », c’est-à-dire « changent sans cesse » tout en demeurant « les mêmes »[10]. Et M. Larison de commenter :
« L’institution comme seconde nature, nature vivante, s’insère alors dans une notion, non pas de vie commune, mais du commun pensé comme vie : vie totale dont les diverses institutions seraient les moments » (p. 163).
La même ambition de dépassement du dualisme de l’objectif et du subjectif est portée, dans le champ de la théorie du droit, par M. Hauriou[11], qui « semble aller plus loin que Mauss en explicitant la dimension temporelle qui sous-tend l’idée même de vie. Si Mauss pensait la dimension du commun en se prévalant de la figure de la vie, Hauriou le fait à partir des figures temporelles qui caractérisent le vivant » (p. 165). Ce dernier, en effet, « intègre l’idée de la durée temporelle comme mode de cohésion immédiate du social » et dont témoigne l’institution « à la fois créatrice et durable » (p. 164).
En somme, la Stiftung semble autant ouverte vers la dimension objective que l’institution vers la dimension subjective. Dès lors, on peut tout aussi bien dire, avec l’autrice, que la traduction merleau-pontienne n’a rien d’évident et reconnaître néanmoins qu’elle n’a rien d’étonnant puisqu’elle fait se recroiser, en un seul terme, le subjectif et l’objectif, l’activité et la passivité, l’individuel et le collectif, dimensions qui s’entremêlaient déjà dans la notion phénoménologique de Stiftung et celle, sociologique et juridique, d’institution. Des recroisements qui correspondent ainsi pleinement au projet philosophique de Merleau-Ponty pendant ses années au Collège de France et qui avait pour objectif de dépasser ces dichotomies pour penser une « troisième dimension » ou un « milieu commun »[12]. Ce qui est remarquable, c’est que ce milieu apparaît, dans les cours de 1954-1955, « au-delà ou en-deçà du temps subjectif et du temps objectif » comme « un temps du commun et cela de façon originaire » (p. 167). Nous en arrivons ainsi à ce qui paraît comme le cœur de l’ouvrage, à savoir la notion de transtemporalité qui est, selon l’autrice, « peut-être l’une des plus intéressantes et des plus mystérieuses de la pensée merleau-pontienne » (p. 196) en ce qu’elle désigne la temporalité proprement générative de l’institution.
II. La transtemporalité originaire : l’institution comme temps et vie du commun.
Si c’est par l’intégration des notions de vie et de temps que l’institution réalise le dépassement des dichotomies classiques, force est de constater un net primat du temps, à tel point que ce dernier devient, dans les cours de 1954/55 « le modèle »[13] même de toute institution, sous la forme d’une temporalité spécifique, que nous exposerons d’abord dans ses grandes lignes avant d’expliciter sa dimension générative qui communique avec sa dimension commune ou communautaire.
1. Qu’est-ce que la transtemporalité ?
La notion de transtemporalité est introduite à partir de la conception du corps vécu dans la Phénoménologie de la perception – objet du premier chapitre – que M. Larison interprète comme « mouvement subjectif transpersonnel » (p. 25). S’appuyant sur la distinction faite par Merleau-Ponty entre corps actuel et corps habituel, l’autrice souligne l’« épaisseur temporelle qui l’habite [le corps] sous le mode de l’“inactuel” » (p. 39) voire de l’impersonnel (cf. p. 43) et en fait le champ dynamique d’une histoire, ensuite interprété, au-delà de la seule conscience, comme le champ de l’institution elle-même. Le chapitre montre ainsi en quelle mesure « l’expérience vécue de notre subjectivité se déroule dans le mouvement d’une temporalité plurielle et simultanée, que Merleau-Ponty nommera des années plus tard la “transtemporalité” » (p. 51), et qu’on peut comprendre comme un « mode non linéaire d’organisation des temporalités dans une unité de vie », un « mode créateur de registres simultanés de temporalité, superposés, réversibles » (p. 44). La transtemporalité désigne ainsi « une parenté latérale des maintenant » (p. 71) qui implique une modification spécifique des rapports avec le passé et l’avenir.
En effet, « la transtemporalité originaire n’est ni répétition du passé ni présence du futur » (Ibid.) mais l’ouverture du passé à son avenir autant ou en même temps qu’inscription de cet avenir dans son passé, une traversée – qu’indique le préfixe -trans –, un recroisement qui fait la « fécondité illimitée de chaque présent »[14], entre la passivité de ce qui a été et l’activité de ce qui a à être. Merleau-Ponty y voit ainsi le temps propre de l’institution, l’articulation en elle des moment institué et instituant. Surtout, l’originalité de sa pensée, sur laquelle l’autrice insiste tout particulièrement, est d’inscrire la transtemporalité de l’institution humaine dans l’historicité préalable ou primordiale du vivant et de l’animalité, à laquelle est consacré le chapitre IV. Merleau-Ponty tente en effet d’y déceler les linéaments de ce qui sera ensuite l’institution proprement humaine, ce qui l’amène à comprendre la différence anthropologique à partir de l’émergence de ce qu’il nomme « matrice symbolique » et qui est coextensive de la transtemporalité comme recroisements entre un « avenir par approfondissement du passé »[15] et un « passé qui crée une question »[16]. Nous nous contenterons dans le cadre de ce compte-rendu de souligner un aspect essentiel de cette transtemporalité, qui a trait au statut de la présence.
2. Un paradigme continuiste et ses conséquences sur l’institution.
Certes cette présence est celle des « présents en profondeur » (p. 46) ou d’une épaisseur constituée par de l’inactuel et de l’à-venir, mais cette dimension semble in fine culminer en une coïncidence ou en tout cas en un recouvrement (Deckung) temporel, comme en témoigne cette définition de l’institution humaine comme « intégration en chaîne, tourbillon où tout converge, auquel tout réussit ; Deckung d’une anticipation et d’une régression et instauration d’un vrai maintenant plein. »[17] En d’autres termes, la transtemporalité de l’institution a beau être pluridimensionnelle, c’est toujours dans le cadre d’une simultanéité ou d’une superposition de ces dimensions qui concourent à instaurer ce « vrai maintenant plein » auquel Merleau-Ponty reconduit toute institution. M. Larison remarque bien cette « nouvelle façon de penser le temps » comme s’écoulant « non seulement en succession mais aussi en simultanéité, et dont les conséquences restent à mesurer » (p. 206). On peut regretter toutefois que l’autrice n’aie pas déployé ces conséquences en y intégrant une distance critique, déjà formulée d’ailleurs par certains commentaires.
Nous rejoignons ainsi Roberto Terzi lorsqu’il pointe dans la pensée merleau-pontienne ce qu’il nomme « une présupposition du sens, qui est en même temps un présupposé continuiste »[18] présent tout particulièrement dans « cette conception de l’institution comme mouvement vivant et unitaire du sens, qui garantit communication, ouverture, appartenance commune, continuité dans l’écart »[19]. Plus précisément, s’il est vrai que « institution, communauté, ouverture sont pensées par Merleau-Ponty non pas en termes objectifs et positifs, mais comme écart », néanmoins, précise-t-il, « l’écart “fonctionne” en fait toujours comme conjonction » [20]. S’appuyant notamment sur une critique formulée par Derrida[21], R. Terzi insiste sur la présence d’une sorte de loi implicite selon laquelle, au sein de l’« entrelacs entre coïncidence et non-coïncidence » Merleau-Ponty « préfère » toujours en fait la coïncidence à la non-coïncidence et « interprète cet entrelacs dans sa fonction de continuité, unité, communauté dans l’écart, plutôt que comme interruption ou séparation irréductibles »[22].
Si l’on poursuit l’interrogation quant aux conséquences de ce paradigme continuiste, on peut remarquer, cette fois avec Jeanne-Marie Roux[23], « un pouvoir d’intégration infinie de l’institution » qui s’atteste à deux niveaux. Tout d’abord eu égard à la continuité foncière entre la dimension intérieure ou privée et la dimension extérieure ou publique et qui rend difficile, si ce n’est impossible, de penser « l’écart entre l’institution et les individus qui y ont affaire » et, par là, « la possibilité d’une véritable oppression des sujets par les institutions »[24]. Ensuite, en vertu de ce « pouvoir d’intégration infinie de l’institution, que rien ne semble pouvoir véritablement sortir de sa course », l’institution, relativisant d’emblée toute révolution, « ne semble jamais pouvoir être véritablement nouvelle »[25]. De la sorte, Merleau-Ponty aurait tendance à « minorer la différence entre conservatisme et révolution » puisque « l’élucidation de ce qui les distingue significativement, c’est-à-dire de ce qui permet que cette différence compte, n’est pas entreprise. »[26] En effet, la transtemporalité amène Merleau-Ponty à relativiser la révolution qui ne serait jamais que réinstitution, « comme continuité rétrospective, comme mouvement zigzagant de ré-appropriation du passé » (p. 100). Là est, selon l’autrice, la « nouveauté de la proposition merleau-pontienne » (Ibid.) dont il est nécessaire, toutefois, de mesurer toutes les conséquences depuis un certain regard critique. En effet, qu’il s’agisse de la rupture temporelle que constituerait la révolution, ou de la « coupure entre institution privée et publique »[27], force est de constater l’absence remarquable, dans les cours de 1954/55 de tous ces phénomènes témoignant de ce que tout ne « converge » pas ou de ce que tout ne « réussit » pas lorsqu’il s’agit des institutions. Nous proposons de comprendre cette absence comme une conséquence du statut originaire, c’est-à-dire génératif, accordé à cette transtemporalité et, avec elle, à toute institution comme dimension du commun.
3. L’institution comme dimension générative et authentique du commun.
La transtemporalité est ainsi présentée par M. Larison comme une « temporalité originaire et authentiquement commune » (p. 179) : si l’on peut comprendre qu’elle soit originaire car relevant de la dimension antérieure ou primordiale de la générativité, en quoi est-elle également authentique ou « authentiquement commune » ? L’expression est remarquable autant que problématique, puisque l’autrice y reprend, sans vraiment la mettre à distance, la thèse merleau-pontienne selon laquelle il y a « synonymie d’institution et vérité »[28] – une vérité à la mesure du recouvrement (Deckung) qui s’y opère entre les différentes temporalités ou les différentes histoires.
Merleau-Ponty proposerait ainsi, selon les mots conclusifs de M. Larison, « une perspective générative, non pas simplement centrée sur la dimension du soi et de l’autre et ses diverses déclinaisons, mais fondamentalement située dans la perspective de l’historicité comme praxis commune, toujours sur un terrain partagé à plusieurs » (p. 210). En d’autres termes, la générativité, et la transtemporalité qui la caractérise, désignerait un commun toujours déjà partagé, toujours déjà là dans les couches les plus primordiales de l’expérience, et c’est pourquoi, « avant toute partition, la temporalité ainsi comprise unifie dans son survenir l’histoire privée et la publique. Elle permet que toutes deux soient des histoires communes » (p. 71). La transtemporalité serait donc d’autant plus vraie ou authentique qu’elle unifie et rassemble, en-deçà de la partition ou de l’écart, au sein d’un « tourbillon où tout converge »[29], la diversité des sujets, des temps et des significations. Ce « tourbillon », propre à l’institution, est interprété par M. Larison comme la manière dont Merleau-Ponty comprend, en 1954/1955, le « champ de présence » qui lui avait servi pour décrire le champ temporel de la conscience et du corps vécu dans la Phénoménologie de la perception. Selon l’autrice, « tout semble indiquer qu’une décennie plus tard, la notion d’institution redéfinirait ce “champ de présence” compris comme champ de l’apparaître » (p. 186). La transtemporalité, d’abord entendue comme temps de l’institution, serait donc également « un temps du champ même de l’apparaître, là dehors, dans le monde, un temps transpersonnel et territorial, zigzagant, pluridimensionnel, fait de superpositions et de simultanéités » (Ibid.). Force est de constater ici une sorte d’inflation du concept d’institution, qui ne désigne plus seulement une modalité particulière de l’apparaître mais sa structure elle-même, à tel point que l’autrice suggère, de manière cohérente mais non moins problématique, de comprendre l’institution non pas seulement comme transtemporalité mais également, et en incluant la dimension spatiale, comme « transphénoménalité du champ de l’apparaître » (p. 188, n.6). En somme la perspective générative que l’autrice entend développer à partir de Merleau-Ponty implique premièrement de faire de toute institution, ou de toute institution vraie, un champ temporel et spatial au sein duquel du commun s’est toujours déjà fait, deuxièmement, d’identifier la structure de l’apparaître ou du phénomène lui-même avec ce champ du commun qui est aussi champ de présence, et, troisièmement, de faire de l’institution le phénomène lui-même.
Trois thèses fortes qui auraient demandé, au-delà de la forme programmatique, à être interrogées par de plus amples développements, tant elles ne vont pas de soi. Mettant de côté la question massive du phénomène ou de l’apparaître dans son lien avec la présence et la dimension du commun, nous interrogerons seulement le geste consistant à primordialiser ou à transcendantaliser l’institution, c’est-à-dire à en faire une structure non seulement originaire mais aussi « authentiquement commune ». Ce geste permet-il de mieux comprendre les institutions existantes ? Ces dernières constituent-elles vraiment ce « terrain » toujours déjà partagé à plusieurs, et dans ce cas, comment interpréter les institutions qui oppriment, divisent, excluent ? Il y a là une difficulté majeure, particulièrement visible lorsque Merleau-Ponty reprend la définition goethéenne du génie comme « productivité posthume » pour affirmer que « toute institution est en ce sens génie »[30]. Certes il prend soin de distinguer d’une part un « sens fort »[31] de l’institution, en quoi consiste son « esprit » et sa dimension universelle, et un sens « faible » ou secondaire d’autre part, qui correspond à sa « lettre », toujours particularisée. Mais cette distinction lui sert pour caractériser en bloc deux types de sociétés, les unes « vraies », les autres « fausses »[32], en tant que celles-ci « ne sont pas fidèles à l’a priori de l’institution ou à son esprit, et se crispent sur sa lettre »[33]. Outre le fait que cette caractérisation ne permet pas de discriminer et d’interroger précisément au sein d’une même société telle ou telle institution dont la lettre ne serait pas fidèle à l’esprit, on se demande également ce qui pourrait expliquer ces « infidélités » : serait-ce donc que ces sociétés existent en dehors du régime de l’institution, voire, si l’on suit M. Larison, de la phénoménalité elle-même, ou sont-elles instituées en un sens « faux », ou inauthentique ? En somme, toute l’attention de Merleau-Ponty est consacrée à exposer un « sens fort » de l’institution qui, comme « institution vraie »[34], tend à rendre presque incompréhensible tout écart par rapport à cet a priori, ou, autrement dit, par rapport à cette fonction générative de l’institution.
Conclusion
L’ouvrage de M. Larison, loin de n’être qu’une étude consacrée à l’institution dans la pensée merleau-pontienne, ambitionne de replacer cette notion au cœur de la phénoménologie, de manière à relancer ses interrogations les plus fondamentales sur le sens de l’humain, du temps, de la vie, de l’histoire. Ce faisant, elle permet de faire rayonner la pensée merleau-pontienne dans deux directions très fécondes : d’une part celle de la générativité husserlienne et de la question fondamentale d’un « temps du commun », d’autre part celle de la pensée sociologique et juridique et notamment celle, trop peu connue encore, de M. Hauriou, dont la pensée de l’institution et le « vitalisme social » méritent d’être redécouverts. On regrette néanmoins que cette ambition ne soit pas servie par des développements non seulement plus importants mais aussi et surtout plus critiques envers les thèses merleau-pontiennes. Les critiques que nous avons suggérées n’ont pas ainsi pour but d’invalider le projet « d’ouvrir une phénoménologie de l’institution de matrice merleau-pontienne » (p. 19) mais plutôt d’inviter à considérer cette matrice depuis un autre point de vue.
Dans sa lecture du Visible et de l’invisible, Marc Richir avait en effet suggéré que « l’être sauvage », à partir duquel Merleau-Ponty interprétait le « tout » de « l’être société » comme « tissu conjonctif »[35], relevait en fait d’« une “idée régulatrice”, [de] l’horizon symbolique d’une tâche infinie »[36] et non de la dimension proprement phénoménologique de l’apparaître. Cette « illusion » de la pensée merleau-pontienne nous semble aussi à l’œuvre dans les cours de 1954/1955, dont la véritable fécondité pourrait être dégagée à condition d’en inverser le geste, c’est-à-dire de ne pas placer le commun, en le présupposant, dans le « passé » de la dimension originaire et générative, mais au contraire de le projeter au « futur », dans l’horizon symbolique et historique des institutions. Une inversion qui pourrait permettre à cette « nouvelle phénoménologie de l’institution » de déployer pleinement son potentiel critique, « avec et au-delà de Merleau-Ponty ».
[1] M. Merleau-Ponty, L’institution, la passivité. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Préface de Claude Lefort, Paris, Belin, 2015 [2003].
[2] Roberto Terzi, « Événement, champ, trace : le concept phénoménologique d’institution », Philosophie 2016/4 (N° 131), pp. 52-68 ; et du même auteur, « Institution, événement et histoire chez Merleau-Ponty », Bulletin d’analyse phénoménologique XIII, 3, 2017.
[3] Anne Gléonec, Institution et passivité. Lectures de M. Merleau-Ponty, Grenoble, Jérôme Millon, coll. « Krisis », 2017.
[4] Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, Paris, La Découverte, coll. « Sciences sociales du vivant », 2023.
[5] M. Merleau-Ponty, L’institution, la passivité…, op.cit., p. 50, [6].
[6] C. Serban, « Déformaliser l’intersubjectivité », Dois Pontos, 20 (1), 2023, pp. 198-208. http://dx.doi.org/10.5380/dp.v20i1.86984
[7] L. Perreau, Le monde social selon Husserl, Dordrecht, Springer, 2013
[8] A. Schnell, La déhiscence du sens, Paris, Hermann, coll. « Le Bel Aujourd’hui », 2015.
[9] Marcel Mauss et Paul Fauconnet, « La Sociologie, objet et méthode » (1901), in Marcel Mauss, Œuvres, vol. III, Paris, Minuit, 1969, p. 150.
[10] Ibid., p. 150.
[11] Cf. Maurice Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », in Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris, Librairie Bloud&Gay, 1933, pp. 89-128.
[12] Maurice Merleau-Ponty, « Travaux et projet d’enseignement », in Parcours deux, Paris, Verdier, 2000, p. 13.
[13] M. Merleau-Ponty, L’institution, la passivité…, op.cit., p. 47, [4].
[14] M. Merleau-Ponty, Signes, Paris Gallimard, 1960, p. 73.
[15] M. Merleau-Ponty, L’institution, la passivité… op.cit., p. 76, [21]
[16] Ibid., p. 75, [21].
[17] Ibid., p. 76, [21].
[18] Roberto Terzi, « Événement, champ, trace : le concept phénoménologique d’institution », art.cit., p. 61.
[19] Ibid., p. 62.
[20] Ibid.
[21] J. Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2000, p. 238-239.
[22] R. Terzi, « Événement, champ, trace : le concept phénoménologique d’institution », art.cit., p. 64.
[23] Jeanne-Marie Roux, « L’institution ouverte de Merleau-Ponty », in Les équivoques de l’institution. Normes, individu et pouvoir. E. Djordjevic, S. Tortorella, M. Unger, Paris, Classiques Garnier, 2019, pp. 199-219
[24]Ibid.., p. 209.
[25] Ibid., p. 210.
[26] Ibid., p. 212.
[27] « Aucune coupure entre institution privée et publique » (Ibid., p. 61, [12]).
[28] Ibid., p. 77, [22].
[29] Ibid., p. 76, [21].
[30] Ibid., p.50, [6].
[31] Ibid., p. 58, [10].
[32] Cf. Ibid., pp. 154-155 [86].
[33] Ibid., p.159, [90].
[34] Ibid., p. 57, [9].
[35] M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 173.
[36] M. Richir, « Communauté, société et histoire chez le dernier Merleau-Ponty » in Merleau-Ponty : phénoménologie et expériences, M. Richir et E. Tassin (dir.), Grenoble, Jérôme Million, coll. Krisis, 1992 p. 20.