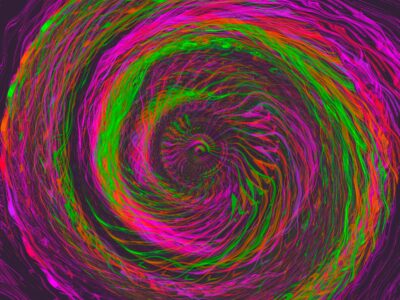Compte-rendu critique – Ravaisson et le problème de la métaphysique
Alexandre Couture-Mingheras, agrégé et docteur de philosophie, est rattaché au Laboratoire de métaphysique allemande et de philosophie pratique (MAPP) de l’Université de Poitiers. Ses travaux portent sur le monisme neutre et plus largement sur la métaphysique de la non-dualité.
Guillaume Lurson, Ravaisson et le problème de la métaphysique, Hermann, 2022.
L’ouvrage est disponible ici.
Résumé
Dans Ravaisson et le problème de la métaphysique, Guillaume Lurson introduit à l’œuvre d’une des figures fondatrices du spiritualisme français du XIXème siècle, aujourd’hui relativement méconnue, en examinant les modalités du renouveau de la métaphysique à l’ère positiviste et post-kantienne de son discrédit. Si la métaphysique veut pouvoir être de nouveau possible, c’est à condition en effet qu’elle surmonte le présupposé qui en structure l’auto-déploiement historique, à savoir le dualisme. La déconstruction de la métaphysique de la séparation, déployée en trois directions – métaphysique du sujet, de la finitude et de la substance – permet ainsi, à même sa neutralisation, de faire signe vers la non-dualité du principe, du monde et de soi.
Mots-clés : Ravaisson, spiritualisme, critique du dualisme, métaphysique, non-dualité
Abstract
In Ravaisson et le problème de la métaphysique, Guillaume Lurson introduces the work of one of the founding figures of the 19th century French spiritualism, today relatively unknown, by examining the modalities of the renewal of metaphysics, at the time of its rejection by positivism and post-Kantian philosophy. If metaphysics intends to be possible again, it must overcome the presupposition which structures its historical self-development, i.e. dualism. The deconstruction of the metaphysics of separation, spread out in three directions – metaphysics of the subject, of finitude and of substance – allows, by its neutralization, to point towards the non-duality of the principle, the world and oneself.
Keywords: Ravaisson, spiritualism, criticism of dualism, metaphysics, non-duality
« Le cœur fort veut l’Être »
Introduction. Le présupposé dualiste de la métaphysique
Le nom de Ravaisson évoque aujourd’hui tout au plus la préhistoire obscure et souterraine du spiritualisme bergsonien. Ce n’est pas le moindre des mérites de la belle étude que Guillaume Lurson lui consacre que de tirer de l’oubli cet acteur majeur de la scène philosophique française de la deuxième moitié du XIXème siècle et de l’affranchir du prisme déformant des penseurs de la postérité en le restituant à son histoire et, surtout, à son intuition centrale, à savoir le problème de la métaphysique. En effet, si la métaphysique à l’ère post-kantienne et positiviste de son discrédit veut être de nouveau possible, c’est à condition que, se réfléchissant en son historicité, elle surmonte ses propres présupposés, ceux-là même qui, en partage avec ses critiques, ont conduit à sa ruine.
Quel est donc l’impensé de la métaphysique historique ? Il s’agit du dualisme, que Ravaisson – qui en débusque le motif y compris dans les pensées de l’Un – nomme la « métaphysique de la séparation ». La refondation de la métaphysique promise par le spiritualisme porté par Ravaisson – cousin français de l’idéalisme allemand – passera dès lors par le dépassement du dualisme entre conscience et monde, entre l’esprit et la nature et entre « Dieu » et l’homme. Ainsi, sortant de l’oubli de l’Unité première, faudra-t-il repenser le statut du Principe, du Monde ou Nature et du Soi dans leur non-dualité, c’est-à-dire apprendre à voir selon l’Un, étant entendu que cette unité ne saurait plus s’opposer au multiple.
Toutefois, en réaction à la domination de la « théorie de la connaissance » (Erkenntnistheorie) qui procède de l’élision de l’ontologie au profit de l’interrogation sur les modalités et conditions de la représentation, le spiritualisme, qui fait figure de mouvement de reconquête de l’être dans la pensée, ne risque-t-il pas de retomber dans l’ornière des métaphysiques précritiques, c’est-à-dire dans le dogmatisme de la raison ? De là, dans l’auto-élaboration d’une perspective métaphysique non-duelle, la nécessité de déconstruire – rompant avec le dualisme de la « pensée d’entendement » – le critère épistémique de la clarté et, passant pour ainsi dire dans le dos de la raison, de la révéler à son impensé.
Encore faut-il préciser que la critique des « métaphysique de la séparation » est indissociable de la perspective qui cherche à se déployer. La pars construens n’est que d’apparence : si le dualisme constitue une forme de « cataracte spirituelle », la possibilité d’une vision nouvelle s’opère à même la neutralisation de la vision duelle. D’où la mise en dialogue constante de Ravaisson avec les auteurs de la tradition – d’Aristote à Maine de Biran en passant par la tradition néo-platonicienne – dans le but de dégager un espace, neutre, pour une métaphysique de la non-séparation, c’est-à-dire une pensée de l’Un (au) multiple, que Deleuze – cité par l’auteur – exprimera dans Différence et répétition en termes d’identité, supra-duelle, entre monisme et pluralisme. « L’essentiel de l’univocité n’est pas que l’Être se dise en un seul et même sens. C’est qu’il se dise, en un seul et même sens, de toutes ses différences individuantes ou modalités intrinsèques. L’Être est le même pour toute ces modalités, mais ces modalités ne sont pas toutes les mêmes »[1].
La métaphysique de la séparation et sa neutralisation
L’ouvrage se compose de trois grandes parties. La première porte sur le retour de la métaphysique au regard du contexte historico-philosophique de Ravaisson. En réaction à l’histoire génétique de l’esprit et à la théorie de la connaissance – où le savoir est orphelin de son être – l’auteur établit la psychologie, « connaissance de l’esprit réfléchissant en lui-même la totalité du réel » (p. 40), en voie d’accès à la métaphysique. La seconde partie explore la spiritualisation de la nature à l’œuvre dans le spiritualisme ravaissonien, c’est-à-dire dans le cadre d’une métaphysique qui cesse d’opposer la nature à ce qui la transcende et de tirer son sens de ce qu’elle prétend dépasser. Enfin, la troisième partie, consacrée à la nécessité des médiations, examine le statut de la religion, de l’esthétique et de la morale dans le cadre de la métaphysique renaissante.
Nous n’en suivrons toutefois pas la marche. C’est dans l’introduction que se trouve à notre sens le cœur spéculatif de l’ouvrage. En effet la caractérisation tripartite de la métaphysique de la séparation est d’autant plus capitale que la métaphysique ravaissonienne conquiert sa position par son propre auto-dépassement. Autrement dit la non-dualité se laisse saisir à même la neutralisation de tout dualisme. Le commencement est sa propre fin. Là s’offre la boussole, précieuse à qui empruntera l’itinéraire singulier de la pensée ravaissonienne.
I. La métaphysique du sujet
Il s’agit premièrement de la métaphysique du sujet, c’est-à-dire de l’appréhension du sujet en termes de subjectivité fondatrice du savoir et transparente à elle-même. Ravaisson y oppose, en une forme de « cartésianisme renversé » (p.19), un cogito dont la clarté est l’envers d’une obscurité, plus profonde, qui comme telle en constitue l’origine. Le cogito, une fois en effet rendu à sa négativité, à son insu constitutif, dont il forme pour ainsi dire la partie immergée et manifeste, l’idée même de sujet hypostasié et clos sur soi se trouve de la sorte écartée. Ni substrat, res cogitans, ni pure forme de l’aperception, le sujet se révèle porté par un « principe d’identité impersonnel ». Qu’est-ce à dire ?
 Loin qu’à l’occasion de son retour à soi la conscience se découvre un « moi » comme tel isolable, il faut bien plutôt dire, en une forme d’archéologie du sujet, que le « moi » procède – en l’oblitérant – d’une profondeur pré-subjective – et, on le comprend, puisque le sujet n’est tel que dans l’opposition (il est non pas chose mais « rapport ») pré-objective. Si bien que derrière l’intériorité psychologique se profile en réalité une intériorité plus originaire, « plus intense et plus vaste » (p. 52), « intériorité sans subjectivité »[2] ou, comme la nomme Ravaisson, « cosmique ». Car le moi est moins ce qui dans l’expérience se confirme que ce qui, s’esquivant en son profil, atteste de la présence en soi d’un « principe antérieur », d’un « absolu qui le rend possible dans son auto-position subjective ».
Loin qu’à l’occasion de son retour à soi la conscience se découvre un « moi » comme tel isolable, il faut bien plutôt dire, en une forme d’archéologie du sujet, que le « moi » procède – en l’oblitérant – d’une profondeur pré-subjective – et, on le comprend, puisque le sujet n’est tel que dans l’opposition (il est non pas chose mais « rapport ») pré-objective. Si bien que derrière l’intériorité psychologique se profile en réalité une intériorité plus originaire, « plus intense et plus vaste » (p. 52), « intériorité sans subjectivité »[2] ou, comme la nomme Ravaisson, « cosmique ». Car le moi est moins ce qui dans l’expérience se confirme que ce qui, s’esquivant en son profil, atteste de la présence en soi d’un « principe antérieur », d’un « absolu qui le rend possible dans son auto-position subjective ».
En régressant du moi au principe pré-égotique qui le fonde – la vérité du moi se tient dans le non-moi pourrait-on dire – Ravaisson, aussi bien à l’encontre du cartésianisme que de l’idéalisme transcendantal, rompt avec l’auto-appréhension pensante du sujet, c’est-à-dire avec la définition du sujet comme cogito. Le cogito n’est pas le tout du sujet : il en est pour ainsi dire une province. La relativisation du « moi » – à même l’élargissement du sujet à l’Impersonnel – s’accompagne en effet d’une relativisation noétique, c’est-à-dire d’une forme de désubjectivation du cogito qui se croyait sujet-maître, propriétaire, de la pensée. « Je » ne pense pas tant que « je » me constitue à même la trame des pensées que par suite je dirai « miennes ». Comme l’écrit Ravaisson, dans son Testament philosophique, « avant toute pensée particulière, on est obligé de supposer une pensée constante, sans commencement comme sans fin, qui est comme une chaîne sur laquelle se déploie la trame des pensées accidentelles »[3].
De sorte qu’en se plaçant désormais au point de vue de la praxis, l’idée d’autonomie comme assise de l’action morale se trouve relativisée. Une fois « l’hypothèse monadique », fondatrice de l’égoïsme pratique, secouée par la remontée au fond obscur duquel la pensée claire et l’idée de « moi » tirent leur « existence », il faut repenser l’agir – agir sans « moi ». L’agir qui provient de l’ego porte en soi le risque du désir appropriatif et de l’isolement. Conditionné, il est surtout un réagir. Mais l’agir qui sourd du « fond inépuisable », portant l’infinité de sa source, se donne comme la donation sans réserve de soi qu’est l’amour, « pro-catégorie de l’être » (p. 215). La « morale cosmique » (p. 262), trouve son principe dans la métaphysique : l’être commun – l’univocité de l’être – fondant la communauté morale.
La séparation, que le « moi » instaure dans sa différence avec le « non-moi » – le moi se pose en s’opposant – ne saurait plus être prise comme point de départ. Car c’est désormais, à même cette intériorité plus originaire, que l’on pourrait appeler la dimension d’intériorité de l’Être, le versant de la continuité ontologique entre tous les êtres, que se révèle le nouveau point de départ : celui-là même de l’Esprit, « fonds originaire, pure puissance du penser, qui irrigue de manière immanente tous les étants » (p. 22). Ravaisson, en remontant plus haut que le cogito, ne part pas ainsi de l’incomplétude du moi, liée à sa séparation d’avec le monde, mais de cette « plénitude » infinie en nous et « première » (p. 22). Infini dont on pourrait dire qu’il constitue l’origine et la finalité de l’existence de tout « je pense ».
Du reste l’habitude, « répétition différenciée, et non la différenciation répétée d’une existence sans essence » (p. 163) qu’explore la deuxième partie de l’ouvrage en la resituant en son lieu propre – la métaphysique par-delà le dualisme[4] – révèle l’ego à son propre mythe, simple « instance stabilisée dans un complexe de puissances qu’enveloppe l’existence de l’étant » (p. 165). Les étants, « manières d’exister à partir d’un principe universel et premier » (p. 163), « procédant d’un fond univoque », loin de jouir d’une existence indépendante, sont « la contraction même de l’esprit selon divers degrés » (p. 173). Si le moi procède d’un procès d’individuation, alors sa vérité se tient derrière lui, en ce qui en lui, à traverse la fêlure du cogito, s’annonce de pré-individuel, « champ impersonnel de potentialités ». Derrière le reflet du moi, le sans-visage. À même la psychogénèse, la cosmogénèse[5].
II. La métaphysique de la finitude
Il s’agit deuxièmement de la métaphysique de la finitude, laquelle exclut la possibilité d’un accès à l’absolu. Paradoxale en ce qu’elle conduit à sa propre annulation, elle se fonde sur la différence absolue entre l’infinité du principe et la finitude de l’étant. Cette différence n’a pu toutefois être absolutisée qu’au prix de l’hypostase dont « Dieu » pensé de façon oppositive à la « créature », extérieur à soi, est le symptôme, et, peut-on ajouter, de l’hypostase contraire du « moi ». En opposant la contingence et relativité de l’existence du fini à l’absoluité et la nécessité de l’infini, elle reporte toute la charge d’être sur un étant.
Corrélativement, si le savoir positif de Dieu a été au nombre des prétentions de la theologia rationalis, et que Kant en a condamné irrémédiablement l’accès, la métaphysique renaissante, on le comprend, devra remonter du modèle épistémique de la clarté objectivante du concept à un savoir obscur et non-objectivant, c’est-à-dire à cette pensée sans médiation dont le coeur chez Ravaisson est l’organe de saisie intuitive (et non-duelle) de l’être, capable qu’il est, de façon similaire au Hridayam vedantique ou au Fu’âd ou Lubb soufi, de se déprendre du régime de la représentation et de sa dualité constitutive. Alors que Kant pense l’expérience sous « les conditions de la finitude et de l’objectivité » (p. 260), le cœur figure le « non-savoir intuitif capable de pressentir l’existence du premier principe » (p. 258). La « vraie métaphysique » ne saurait être le « privilège des doctes »[6]. Elle est expérience du mystère de l’être, « obscure ou non-réflexive, qui consiste à descendre au cœur du soi, enveloppé dans le tout » (p. 168).
Ce pré-diagnostic de la structure « onto-théo-logique » de la métaphysique ne conduit toutefois pas comme ce sera le cas chez Heidegger à rompre avec la métaphysique, la déconstruction des présupposés dualistes de la métaphysique historique visant plutôt à la refonder, c’est-à-dire à lui assurer une nouvelle assise. Si la subordination de « l’être à l’essence », la chosification de l’existence, « sont des opérations eïdolâtriques qui sont le propre de l’entendement » (p. 26), à l’inverser, libérer l’être de l’essence, l’existence de l’instance en laquelle elle se recueille – la « chose », « Dieu » -, suppose de dépasser la rationalité inférieure de l’entendement dualiste. Il y va proprement d’une conversion de l’esprit qui rend possible la ressaisie de l’infini dans le fini pour être celle d’un esprit ayant su voir plus haut que sa finité, c’est-à-dire moins d’une réforme de l’entendement que d’une auto-transfiguration qu’initie le mouvement de remontée du sujet au-delà de sa dimension cogitante. Si est vu ce que nos yeux permettent de voir, alors un changement de vision s’impose : l’épreuve « (pré)subjective » de la non-séparation de soi et du principe.
Si bien qu’à l’encontre de la dimension tragique de la métaphysique de la finitude – angoisse, désolation et déréliction – Ravaisson, prenant pour point de départ la complétude découlant de la conscience acquise de sa non-séparation d’avec le principe, cherche à contempler l’harmonie et la beauté derrière la surface des antagonismes existentiels. L’unité, « condition transcendantale de la métaphysique authentiquement comprise » (p. 26), se trouve repensée à partir d’Aristote : chaque mode d’être exprime l’être sans pour autant que ce dernier constitue un « genre » à part. Autrement dit il ne s’agit pas de nier l’existence du fini et du multiple, mais, portant le regard plus haut et plus loin, de les intégrer dans le principe, à titre, précisément, de modalités expressives. Étant entendu que cette continuité d’être échappe au cadre oppositif du monisme et du pluralisme. Car si tout est « originairement lié et uni dans le réel » (p. 27), la multiplicité individuelle n’en a pas moins une réalité dès lors qu’elle est placée sous le régime de l’expression.
Notion centrale de la pensée de Ravaisson, qui s’inspire notamment de la tradition chrétienne et de la philosophie leibnizienne, l’analogie ressaisit l’un et le multiple en leur identité supra-duelle. Au contraire de l’homonymie et de la synonymie, incapables de rendre compte de la continuité de l’être, l’analogie permet de « dépasser la détermination régionale de l’être ; elle assure une connaissance transgénérique en tant qu’elle fait concevoir l’unité dans la multiplicité » (p. 156). Regard non-duel en ce qu’il saisit l’un dans le multiple et le multiple comme un : loin, donc, d’une philosophie de l’identité ou de la différence (ou différance) pure. Si tout est analogue dans le monde, rien n’est pareil.
L’ontologie de l’expression, ressaisie à même la lecture ravaissonienne de l’analogie, tient en effet chaque chose pour miroir du tout : il y va de la nature d’un reflet de renvoyer à la puissance de réflexion dont il provient. L’analogie, qui nous conduit à « retrouver la ‘’constitution intime’’ de notre être dans l’extériorité sans pour autant tenir celle-ci pour séparée » (p. 147), résorbe le dualisme même entre intériorité et extériorité. L’intériorité psychologique court pour ainsi dire à la surface du cogito et de ses cogitata : elle est un extérieur intériorisé. L’extériorité du monde, une intériorité extériorisée – exprimée. La réflexion – sous le régime de l’expressivité générale – désigne tant la réflexivité originaire, cosmique, que la réflexivité seconde pour ainsi dire qui se déploie en nos actes expressifs. Ainsi l’esthétique, « métaphysique figurée » (p. 231), en détruisant la « clôture de la représentation » (245) ouvre un espace pour ce qui se tient en-deçà de la dualité du représentant et du représenté : elle est ontophanie du principe.
Aussi la métaphysique de la finitude, qui procède de l’hypostase du fini, séparé de l’infini, est-elle moins annulée que surmontée (au sens de l’Aufhebung), car si on ne saurait nier le fini, c’est toutefois en manquer la vérité – pour ainsi dire « totale » – que de l’inscrire dans sa séparation d’avec ce dont il procède. Plus haut que la séparation, le rapport d’expression. Voir sans dualisme le fini et la partie, c’est donc les rapporter à leur propre statut expressif à l’égard de l’infini et du tout qui les constitue en leur être propre.
III. La métaphysique de la substance
Enfin, au « moi » et à la finitude succède l’exposition du troisième aspect de la séparation : la métaphysique de la substance. De la même façon que « Dieu » concentre toute la charge d’être et le cogito la teneur de Soi, l’être du monde se trouve replié sur la « substance ». Le premier résulte d’une réduction ontologique verticale, le second d’une réduction horizontale. Or, on le devine, la conception selon laquelle l’être ou le réel « demeure », de façon sous-jacente, sans réellement participer à l’être de ses attributs, résulte d’un processus de « réification de l’être par l’entendement » (p. 28). Autrement dit, le geste de chosification s’avère ici indissociable du geste de dédoublement de l’Un, la métaphysique de la substance de l’opposition entre sujet et objet. En effet, si l’être est pensé comme ce qui demeure inchangé sous l’édifice de la diversité phénoménale, c’est pour autant qu’il est pensé du côté de l’objet, réel mort que d’être insensible à la vie du monde.
La neutralisation de la logique dualiste d’entendement, de laquelle résulte l’appréhension substantialiste de l’être, prendra dès lors la forme d’un combat contre la « tendance de la pensée », définitoire du dualisme, « qui décompose et atomise la continuité du réel » (p. 28). Fluidifiant l’être – en une guise familière, pré-bergsonienne -, Ravaisson supplante l’être comme hypokeimenon au profit de l’être comme energeia – être dynamique.
Par le biais de la notion d’activité se trouve ainsi réuni ce qui avait été disjoint. Alors que l’ontologie cartésienne dédoublait l’être en deux substances, res extensa et res cogitans, l’ontologie ravaissonienne les reconduit à leur unité première. La matière et l’esprit constituent désormais deux pôles d’expression d’une « unique puissance d’être » (p. 28), ce qui signifie que l’être transcende ses modes de manifestation – il est unique, identité supra-duelle que viennent duellement exprimer ses pôles, « puissance » – et tout à la fois immanent à ce qui l’exprime. Comme l’écrit l’auteur, « l’univocité de la catégorie d’activité permet d’échapper au dualisme métaphysique, ainsi qu’au pluralisme existentiel » (p. 30).
En cela la métaphysique, surmontant son propre dualisme, définitoire – elle tire historiquement son sens de son opposition ou de son dépassement à l’égard de la physis -, ne désigne plus ce qui transcende l’expérience. Comme l’écrit l’auteur, « la métaphysique authentiquement comprise devra se délivrer de son assignation au ‘’suprasensible’’, en tant ‘’qu’au-delà’’ de la physis » (p. 27). Car c’est au fond de son propre mythe fondateur – sa dualité constitutive – dont la métaphysique cherche désormais à se libérer, à commencer par l’opposition entre immanence et transcendance. L’immanence, loin d’être l’autre de la transcendance, en constitue le mode d’auto-expression.
La métaphysique ravaissonienne, surpassant sa propre autodéfinition dualisante, prend ainsi la figure d’une ontologie non-duelle – neutre – qui renvoie dos-à-dos le repli intégral de l’être sur ce qu’il traverse et « l’ailleurs » en lequel l’être se déplie. À la faveur d’un chassé-croisé critique avec le schème hénologique de la tradition néo-platonicienne et le schème dynamique de la philosophie aristotélicienne, Ravaisson se fraie une troisième voie.
En effet, la pensée de l’Un est encore lestée de dualisme. Le principe, qui enveloppe l’idée d’un principié, d’un autre que soi, se trouve en un certain sens séparé par toute l’infinie distance du système d’émanation. Cette dualité, qui tient à l’absolue transcendance de l’Un – dont Ravaisson se méfie du sur-être, interprété comme néant – se trouve révélée par la structuration des réalités émanées autour de deux pôles, le principe d’un côté, qui donne ce qu’il n’a pas, et la matière de l’autre, point de coagulation et d’extinction de l’unité que Plotin qualifie d’altérité en soi. Le principe reste pris au piège de la contradiction entre sa transcendance absolue et sa relativité au principié – par quoi il se découvre lié à l’émané -, entre l’unité close sur soi et ce qui en dérive. En témoigne du reste le manichéisme – hésitant – entre le Bien comme principe, pourtant supra-catégorial, et le mal de la matière[7].
Il s’agira, à l’inverse, de libérer le principe de son unilatéralité par le passage du paradigme de l’émanation à celui de la manifestation, et, corrigeant pour ainsi dire la tradition néo-platonicienne par la tradition chrétienne (Jean Scot Érigène, Pascal) d’amender l’indétermination et transcendance du principe en faveur d’une dynamique de sortie de soi de l’Un et de relation d’amour à ce qui en procède. La « caractérisation du premier principe comme amour lui permet d’éviter la doctrine aristotélicienne de l’acte pur, mais aussi celle de la puissance indéterminée de l’Un » (p. 96).
Quant au Stagirite, Ravaisson retient l’appréhension dynamique de l’être et la continuité ontologique entre les étants, mais s’en écarte en raison du dualisme, lisible dans la disjonction entre supralunaire et sublunaire, et de la transcendance autotélique et fermée sur soi du premier moteur immobile. Si le dieu aristotélicien est cause finale des mouvements du monde sublunaire – par le désir qu’il inspire – il n’en reste pas moins « inactif » : il ne crée rien, identité à soi statique et stérile qui méconnait le don de soi. « Dieu, par son action ‘’magnétique’’, n’a aucun souci du monde, et n’en est pas le créateur » (p. 71). En fondant le schème hénologique dans l’ontologie de la dunamis et de l’energeia, Ravaisson réaffirme l’unité de l’être, et, partant, contre le réalisme naturaliste et la métaphysique de la substance, l’idée d’une activité unique. Cette activité renvoie à l’instance agissante, l’Esprit, semblable à la mélodie qui unit les notes qui la composent sans pour autant exister en dehors d’elles. « Il n’existe qu’un seul être qui soit tout en acte, qui soit une énergie absolue, energeia »[8]. Chaque étant manifeste cette auto-réflexion du principe, véritable noesis noeseos déployée dans l’élément du particulier. Se « penser, c’est penser le principe qui nous a engendrés, et dont nous saisissons l’image réfractée dans le multiple » (p. 79).
Aussi la nature se trouve-t-elle délestée de la dualité de son concept. Ni l’épicurisme qui anéantit la nature par manque en la réduisant à une matière atomisée et inerte – indissociable pour Ravaisson de son idéal autarcique – ni le néo-platonisme, qui la manque par excès en la pensant en sa nécessité, ne parviennent à lui rendre justice. Du reste « l’erreur des Grecs » tient-elle plus largement à ce qu’elle pense la nature comme inférieure, règne du mouvement et de l’éphémère, imperfection ontologique au regard de la substance. La destruction de la notion de substance ne peut qu’engager celle de son contre-terme spéculatif : la nature ne sera plus ce que le supra-sensible transcende mais la manifestation du supra, c’est-à-dire l’immanence de l’auto-déploiement expressif de la transcendance. « La nature, pourrait-on dire, est comme une réfraction ou dispersion de l’esprit »[9] : physis-meta, non « simple » nature, concept dualiste, mais surnature.
Conclusion. La non-dualité et la tentation du dualisme
Le « monisme », supra-logique et supra-duel, fonde on le voit le pluralisme existentiel, par-delà l’opposition entre monisme et pluralisme.
À la transcendance de l’Un et à l’indifférence du premier moteur non mû, Ravaisson substitue une forme de panpsychisme universel, déployé en deux directions. Horizontalement, la continuité entre les êtres – partant l’unification des différents niveaux de réalité – trouve son assise ontologique dans un « monisme » de l’être commun. Verticalement, la phénoménalité se trouve sous-tendue par une dynamique d’auto-manifestation du principe (ayant pris soin d’évider le concept de sa dualité avec le principié), à rebours du dualisme traditionnel entre l’être et l’image. Loin en effet d’une phénoménalité conçue – sous le signe de l’émanation ou de la création – comme dégradation ontologique, le spiritualisme insiste sur sa profusion d’être. Déchirant le voile des antagonismes – dépassant donc l’apparence de dualité – Ravaisson se laisse guider, derrière la surface des phénomènes, par le pressentiment de l’unité de tout ce qui est (on songera au Hen Kai Pan qui fédère parallèlement l’idéalisme et le romantisme Outre-Rhin).
C’est qu’à l’inverse du néo-platonisme et du gnosticisme – tels qu’il les interprète – Ravaisson refuse de concevoir le monde comme une prison, de finitude et de souillure, et, partant, la philosophie comme chemin de délivrance. Vouloir se libérer du monde, qu’est-ce sinon reconduire le monde à l’extra-mondanéité d’un être parfait ? Du reste la christologie, contre le primat de la transcendance propre au monothéisme judaïque, lui offre-t-elle les outils conceptuels afin d’établir la « continuité entre Dieu et le créé » (p. 219), c’est-à-dire afin de soutenir, par-delà le dualisme moral de l’esprit et de la chair, l’idée d’immanence du divin. Dieu, ni « clé » de résolution des contradictions ni « sommet de l’édifice métaphysique », n’est que « l’autre nom donné au monde dans ce qu’il a de plus contracté » (p. 285).
On comprend dès lors pourquoi Ravaisson condamne toute entreprise sotériologique, laquelle s’apparente à ses yeux à une escapade spirituelle. Le refus de la « voie mystique du néoplatonisme » (p. 74) – de l’extase comme sortie, fuite hors du monde – s’explique par sa méfiance déclarée envers l’appréhension méontologique du principe comme sur-être. On retrouvera cette même défiance à l’égard de la pensée orientale (Vedanta, taoïsme, bouddhisme principalement), de la même façon interprétée comme mystique de l’anéantissement. Comme l’écrit G. Lurson, « l’anéantissement est le retour de la pure identité à soi, le mouvement de l’esprit par lequel celui-ci s’abîme dans le refus de toute différence, en voulant maintenir la pureté d’une unité sans multiplicité » (p. 212). À l’instar de Hegel qui condamne au §5 des Principes de la philosophie du droit « le fanatisme religieux de la pure contemplation propre aux hindous » qui se réalise dans la « fureur de la destruction »[10], Ravaisson – selon une lecture déformante répandue au XIXème siècle – montre peu de sympathie pour le Brahman impersonnel ressaisi dans le vide de son intériorité, lequel lui paraît relever de l’identité tautologique et monotone d’un absolu méconnaissant la différence et la multiplicité.
Or, c’est précisément par son refus du vide et du non-manifesté que le spiritualisme ravaissonien paraît reconduire à son insu le dualisme critiqué. Certes, la dualité entre le principe et le monde se trouve résorbée au profit d’un rapport d’expression de sorte qu’il n’est plus de sens à opposer la nature à un « ailleurs », l’ici-bas à son au-delà. Mais si l’absolu fait l’objet d’une immanentisation radicale à la totalité de l’étant, il n’en va pas de même du côté du sujet, c’est-à-dire du côté d’une intériorisation subjective dont l’intégralité signifierait l’identité entre l’absolu transpersonnel et Soi – étant entendu que les termes de « Dieu » et de « moi » aient été affranchis de leur dualisme hypostasiant.
Autrement dit, et c’est là ce que Georges Vallin – philosophe contemporain, lui aussi tombé dans l’oubli, dont nous avons eu le bonheur de retrouver le nom sous la plume de G. Lurson – appelait une perspective métaphysique intégrale, alors que la métaphysique non-duelle fait signe vers l’identité supra-duelle entre le Principe, le Monde et Soi, Ravaisson, ne pose pas l’identité entre le premier et le troisième terme. C’est pourtant ce que la psychologie conçue comme réflexion de l’être, c’est-à-dire comme métaphysique, aurait pu laisser envisager dans sa remontée du cogito fêlé à son principe.
Tout se passe au fond comme si, à vouloir rendre hommage à un monde que la métaphysique historique a largement rejeté au nom d’une réalité plus fondamentale, Ravaisson reversait le principe tout entier au compte de la totalité mondaine : qu’il ne parvenait pas en somme à quitter le sol de l’être manifesté pour s’acheminer vers, précisément, la dimension non-manifestée, en retrait, de l’absolu. Prisonnier des coordonnées dualistes du problème, Ravaisson semble escamoter la transcendance pour ne pouvoir penser non-duellement l’immanence de l’absolu au monde et sa transcendance radicale, l’idée, en somme, que l’absolu est et n’est pas ce qui est.
Tentation du monde et tentation dualiste ne font qu’un. L’exclusion de l’absolu non-manifesté, ipséité sans objet et « vide » – c’est-à-dire la transcendance à l’égard du manifeste – consacre de façon unilatérale la manifestation du monde. À défaut de penser l’existence non-existante du monde des formes individuées, c’est-à-dire la relativité de l’expression à ce qu’elle exprime, Ravaisson paraît séparé du principe par toute l’épaisseur du monde.
Si la dynamique orientale d’intégration du principe dans l’immanence du monde – songeons à la tradition non-duelle du Shivaïsme du Cachemire – est capitale, elle se trouve toutefois précédée, de façon essentielle, par une dynamique de transcendance qui n’est autre que celle de la désidentification au « moi », personnage du monde, et en effet par l’anéantissement, si l’on veut, du monde même.
Mais c’est que cet anéantissement, qui révèle les phénomènes à leur vacuité, seul rend possible la réintégration subséquente dans l’immanence. Car voir le monde de façon non-duelle, c’est se voir dans ce qui paraît pour avoir anéanti l’illusion de séparation. Autrement dit, ce saut hors du monde, le mouvement de transcendance auquel Ravaisson paraît se refuser, est condition de celui d’immanentisation. En se rendant directement à la seconde étape, Ravaisson rend hommage au monde. Mais il semble par-là oublier le Soi universel dont la pensée indienne indiquait quant à elle le chemin (Aham Brahmasmi)[11].
La philosophia perennis, chemin de réminiscence de la nature véritable de ce qui est et par-là de notre propre nature, n’est possible que parce que l’oubli en lequel nous nous tenons – l’ignorance métaphysique – se détache sur fond de « souvenir intégral » (p. 112). Si la pensée ravaissonienne paraît réaliser en partie seulement le programme d’une métaphysique non-duelle, cette non-dualité, non intégrale, représente toutefois une singularité dans l’histoire de la métaphysique occidentale digne d’intérêt.
L’ouvrage de G. Lurson, incontournable pour qui s’intéresse à ce pan méconnu de l’histoire de la philosophie française et, plus largement, à la métaphysique, frappe par la richesse qu’il déploie dans l’analyse minutieuse des auteurs de la tradition, en dialogue avec lesquels la pensée ravaissonienne se forme. Plus important : il contribue – par une forme de coïncidence intuitive avec Ravaisson coulée dans la rigueur du concept – au rappel de cette souvenance intégrale, de cette mémoire en soi de Soi, en laquelle seule la philosophie trouve son commencement et sa finalité véritables.
[1] Deleuze, G., Différence et répétition, Paris, PUF, 1968, p. 53.
[2] Gouhier, H., Bergson et le Christ des évangiles, Paris, Vrin, 1987, p. 29.
[3] Ravaisson, Testament philosophique (1901), Paris, Boivin et Cie, 1933, p. 64.
[4] Janicaud, D., Ravaisson et la métaphysique. Une généalogie du spiritualisme français, Paris, Vrin, 1997. Plutôt que de lire Ravaisson par le biais de son disciple, on pourrait du rester relire Bergson, et partant le dualisme de sa métaphysique, par les yeux de son maître.
[5] On se réfèrera à l’étude magistrale de F. Chenet, Psychogenèse et Cosmogonie Selon le Yoga-Vasistha, Paris, Publications de l’Institut de Civilisation Indienne, 1998 pour le premier volume, 1999 pour le second.
[6] Ravaisson, Métaphysique et morale (1893), in De l’habitude. Métaphusique et morale, Paris, PUF, 1999, p. 186.
[7] « Car il y a deux principes, l’un des maux, l’autre des biens. Et tout ce qui est dans l’une des deux natures est contraire à l’autre, de sorte que les deux totalités s’opposent, et ce dans une plus grande mesure que dans les autres formes de contraires. » Plotin, Traité I, 8 (51), chapitre 6, in Traités 51-54, trad. sous la direction de L. Brisson et J.-F. Pradeau, Paris, GF, 2010, p. 47-48.
[8] Ravaisson, De la métaphysique d’Aristote (1933), in De la nature à l’esprit. Études sur la philosophie française du XIXème siècle, textes réunis par R. Belay et C. Marin, Paris, ENS Éditions, 2001, p. 201.
[9] Ravaisson, La philosophie en France au XIXème siècle (1868), in De l’habitude. La philosophie en France au XIXème siècle, Paris, Fayard, 1984, p. 310.
[10] Voir la note p. 212-213.
[11] Je suis Brahman, je suis l’absolu, selon le célèbre mahāvākya tiré de la Brihadāranyaka Upanishad (I.4.10). L’Advaita Vedanta – ou Vedanta non-duel – d’Adi Shankara insiste sur cette identité supra-duelle et intégrale. On relèvera cependant une certaine ambiguïté chez Ravaisson. D’un côté l’auteur exclut la sotériologie et la mystique de l’unio mystica. De l’autre, comme l’écrit G. Lurson, il y va d’une « union avec un soi qui, en son essence, coïncide avec la totalité du réel » (p. 225). Mais de quel soi s’agit-il ?