Compte-rendu critique – Le désir du réel dans la philosophie québécoise
Enseignant au Collège Montmorency (Laval, Québec), Guillaume St-Laurent soutenait en avril 2017 une thèse de doctorat à l’Université de Montréal intitulée Lumières et sécularité : Charles Taylor et les limites de la simple raison. Ses recherches postdoctorales (Université Brown, FRQSC 2017-2019 ; Université Laval, CRSH 2021-2023) se focalisent depuis sur l’éthique de la croyance, l’herméneutique post-heideggérienne, la philosophie de la religion et les débats métaphysiques contemporains autour du réalisme.
Pierre-Alexandre Fradet, Le désir du réel dans la philosophie québécoise, Montréal : Groupe Nota bene, coll. Territoires philosophiques, 2022, 244 pp.
Le livre est disponible ici.
Résumé :
Cette recension critique du dernier ouvrage de Pierre-Alexandre Fradet comporte trois moments principaux. Nous parcourons d’abord succinctement, au fil des chapitres de l’ouvrage, les principaux arguments développés par certains philosophes québécois– Charles De Koninck (1906-1965), Thomas De Koninck (1934-), Jacques Lavigne (1919-1999), Charles Taylor (1931-) et Jean Grondin (1955-) – afin d’établir la capacité humaine de connaître la réalité « en soi ». Nous faisons ensuite ressortir une tension importante qui traverse l’ouvrage, celui-ci étant tiraillé entre sa critique du réalisme naïf et, en solidarité avec le réalisme spéculatif contemporain, sa critique du corrélationisme. Enfin, nous concluons en indiquant que cette tension a également pour effet d’occulter certains aspects significatifs de la pensée des auteurs québécois étudiés.
Mots clefs : réalisme naïf, réalisme spéculatif, corrélationisme, ontologie, épistémologie
Abstract:
This critical review of Pierre-Alexandre Fradet’s latest work includes three main moments. We first briefly go through the main arguments developed by certain Quebec philosophers – Charles De Koninck (1906-1965), Thomas De Koninck (1934-), Jacques Lavigne (1919-1999), Charles Taylor (1931-) and Jean Grondin (1955-) – aiming to establish the human capacity to know reality “in itself”. We then highlight an important tension that runs throughout the book, it being torn between its critique of naive realism and, in solidarity with contemporary speculative realism, its critique of correlationism. Finally, we conclude by indicating that this tension also has the effect of obscuring certain significant aspects of the thought of the Quebec authors studied.
Key words: naive realism, speculative realism, correlationism, ontology, epistemology
I.
Le dernier ouvrage de Pierre-Alexandre Fradet cherche à faire état de l’originalité avec laquelle certains philosophes québécois – Charles De Koninck (1906-1965), Thomas De Koninck (1934-), Jacques Lavigne (1919-1999), Charles Taylor (1931-) et Jean Grondin (1955-) – traitent de la question du réalisme : est-il possible de connaître la « chose en soi », suivant la célèbre expression kantienne, c’est-à-dire la réalité telle qu’elle existe indépendamment de toute expérience possible, de toute conscience ? En ce sens, le « désir du réel » auquel fait allusion le titre du livre veut laisser entendre que les cinq philosophes étudiés apportent des réponses positives, quoique distinctes et nuancées, à cette question. Tous s’efforcent d’établir le droit de la pensée à prétendre pouvoir atteindre la réalité en soi, bien que tous soient également d’accord pour convenir que ce qui est dit de cette réalité doit demeurer « révisable, imparfait et faillible » (p. 189).
L’auteur fait en outre ressortir l’actualité et le « statut de devanciers » (p. 18) de ces philosophes québécois en comparant leurs thèses réalistes à celles élaborées par les principaux représentants du « réalisme spéculatif » contemporain, soit Quentin Meillassoux, Graham Harman, Iain Hamilton Grant et Ray Brassier, qui s’élèvent diversement contre un certain « corrélationisme », selon lequel la pensée serait irrémédiablement rivée à la corrélation sujet-objet, sans pouvoir la transcender en direction des choses en soi (p. 19). Ainsi, le livre se présente comme une étude comparative des penseurs québécois susmentionnés au regard de la philosophie spéculative contemporaine, tout en soulignant avec pertinence la manière dont leurs idées résonnent avec la pensée d’auteurs « (néo)vitalistes » comme Bergson (p. 31-41, 55-59, 97, 104, 118, 149), Whitehead (p. 27, 39) et Deleuze (p. 42, 102, 173)[1].
Pourquoi faire du réalisme spéculatif un tel point de référence central ? D’abord en raison de la prévalence du corrélationisme à l’encontre duquel il se définit : il s’agirait désormais de la figure dominante de l’antiréalisme, commune à la phénoménologie, l’herméneutique, le poststructuralisme, la philosophie sociale, au linguistic turn, au mind turn et aux philosophies de l’expérience ordinaire (p. 19)[2]. Ensuite parce que cette prévalence serait elle-même justifiée du fait de la supériorité du corrélationisme par rapport au « réalisme naïf », qui demeure celui du sens commun, dont l’auteur souligne volontiers le caractère « dogmatique » (p. 30, 44, 74, 81) de même que l’« ineptie » (p. 39) et la « cuistrerie » (p. 162). « Les réalistes dogmatiques et naïfs commettent l’erreur, écrit-il, de passer sous silence leur mode d’accès au réel : ils prennent position sur un objet qui transcende leur pouvoir de connaître » (p. 30). Le réalisme spéculatif serait ainsi parvenu à formuler clairement le défi que doivent aujourd’hui relever les tenants du réalisme, soit celui de se démarquer du réalisme précritique, auquel il ne serait plus possible de revenir, tout en dépassant le corrélationisme néo- et post-kantien, centré sur nos conditions d’accès au réel.
C’est dans le cadre circonscrit par cette double exigence que l’auteur inscrit la panoplie d’arguments réalistes développés par les penseurs québécois auxquels est consacré l’ouvrage. Ces arguments sont numérotés dans les analyses synthétiques qui suivent afin qu’ils puissent être nettement distingués les uns des autres tout en faisant ressortir les recoupements les plus significatifs entre les positions des auteurs étudiés.
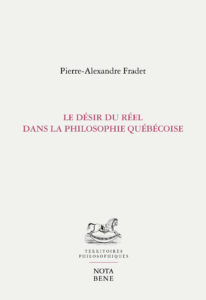 Charles De Koninck présenterait ainsi une variante nouvelle de 1/ l’argument hégélien selon lequel on ne peut nier la possibilité de connaître l’en-soi sans commettre une contradiction performative : il n’est possible de penser les limites de la connaissance, à commencer par la distinction entre l’en-soi et le pour-nous, qu’à la condition de les avoir déjà dépassées, c’est-à-dire de pouvoir comparer l’en-soi au pour-nous (p. 44-6) ; un 2/ argument aristotélicien indiquant que la différenciation des contraires – du bien et du mal, de la santé et de la maladie, du haut et du bas, du froid et du chaud – constitue un critère de démarcation net entre l’esprit et le monde, le pour-nous et l’en-soi, dans la mesure où ces dyades conceptuelles coexistent dans l’esprit humain, alors qu’il est impossible qu’elles se matérialisent simultanément chez un même être ou objet réel : « ce qui met en évidence l’existence d’une réalité irréductible aux propriétés de l’esprit » (p. 47-50) ; un 3/ argument eddingtonien (inspiré de l’épistémologie développée par Sir Eddington, astronome et physicien anglais, 1882-1944), faisant valoir la légitimité de la distinction de l’Âge classique entre « propriété premières », indépendantes du sujet connaissant, et « propriétés secondes », relatives au sujet connaissant, lorsqu’il s’agit de penser le statut des aspects de la réalité dévoilés par les sciences modernes de la nature (p. 50-1, 55-6, 59-60) ; un 4/ argument de sens commun, de nature plus phénoménologique, visant à faire ressortir la transparence ou l’ouverture non-problématique du « langage courant » sur le monde, chacun étant à même de se reconnaître en prise directe avec les choses dans ces usages de la langue que supposent les activités perceptives et pratiques de la vie quotidienne (p. 51-3) ; et, enfin, 5/ un argument thomiste (ou plus généralement déiste), d’après lequel l’ordonnancement intrinsèque des choses, y compris les processus d’évolution de la vie par sélection naturelle, témoignerait de l’action d’un Dieu créateur qui les ordonne à leurs fins (p. 57-9).
Charles De Koninck présenterait ainsi une variante nouvelle de 1/ l’argument hégélien selon lequel on ne peut nier la possibilité de connaître l’en-soi sans commettre une contradiction performative : il n’est possible de penser les limites de la connaissance, à commencer par la distinction entre l’en-soi et le pour-nous, qu’à la condition de les avoir déjà dépassées, c’est-à-dire de pouvoir comparer l’en-soi au pour-nous (p. 44-6) ; un 2/ argument aristotélicien indiquant que la différenciation des contraires – du bien et du mal, de la santé et de la maladie, du haut et du bas, du froid et du chaud – constitue un critère de démarcation net entre l’esprit et le monde, le pour-nous et l’en-soi, dans la mesure où ces dyades conceptuelles coexistent dans l’esprit humain, alors qu’il est impossible qu’elles se matérialisent simultanément chez un même être ou objet réel : « ce qui met en évidence l’existence d’une réalité irréductible aux propriétés de l’esprit » (p. 47-50) ; un 3/ argument eddingtonien (inspiré de l’épistémologie développée par Sir Eddington, astronome et physicien anglais, 1882-1944), faisant valoir la légitimité de la distinction de l’Âge classique entre « propriété premières », indépendantes du sujet connaissant, et « propriétés secondes », relatives au sujet connaissant, lorsqu’il s’agit de penser le statut des aspects de la réalité dévoilés par les sciences modernes de la nature (p. 50-1, 55-6, 59-60) ; un 4/ argument de sens commun, de nature plus phénoménologique, visant à faire ressortir la transparence ou l’ouverture non-problématique du « langage courant » sur le monde, chacun étant à même de se reconnaître en prise directe avec les choses dans ces usages de la langue que supposent les activités perceptives et pratiques de la vie quotidienne (p. 51-3) ; et, enfin, 5/ un argument thomiste (ou plus généralement déiste), d’après lequel l’ordonnancement intrinsèque des choses, y compris les processus d’évolution de la vie par sélection naturelle, témoignerait de l’action d’un Dieu créateur qui les ordonne à leurs fins (p. 57-9).
Fradet montre ensuite qu’on retrouve la plupart de ces leitmotivs, quoiqu’élaborés selon des modalités originales et toujours avec une pénétration historique et une sensibilité humaniste remarquables, chez l’éminent fils du premier, Thomas De Koninck, soit l’argument du sens commun (p. 71-6), l’argument hégélien (p. 79-81) et l’argument aristotélicien (p. 81-2), auxquels s’ajoutent un refus explicite de tous les « réductionnismes » (p. 75-6) ainsi qu’une approche nuancée de la question de Dieu et des rapports entre raison et foi (p. 83-7). Cette dernière mobilise dans leur complémentarité les voies extérieure et intérieure de la théologie chrétienne, soit le double héritage aristotélicien-thomiste et augustinien auquel faisait écho « le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi » évoqués par Kant[3].
L’analyse de la pensée de Jacques Lavigne fait état dans le troisième chapitre d’une œuvre méconnue et d’une très nette originalité. Cette dernière se développe d’abord sous la forme 6/ d’un vaste argument augustinien pour l’existence de Dieu, qui, à la différence de l’argument thomiste, passe moins par la reconnaissance de l’ordre intelligible du monde que par l’intériorité, soit la reconnaissance intime d’un désir de transcendance qui se manifesterait dans toutes les « stations » constitutives de l’expérience humaine – la sensation, le « régime signifiant » de la vie consciente, dont procèdent l’art, la science et la culture, les institutions sociales, la politique – , suivant ce que Lavigne dénomme la « méthode d’implication » (p. 91-100). Ce parcours spirituel, marqué au coin d’une volonté affirmée d’éviter tous les réductionnismes (p. 100), se prolonge en outre dans 7/ un argument empiriste faisant valoir l’expérimentation (ou l’appréhension du « concret », l’« excitation sensible ») comme seul critère effectif pour départager la fiction et le réel, ce qui appartient au domaine des productions subjectives (le pour-nous) et ce qui appartient en propre aux structures du monde (l’en-soi) ; cet effort pour se régler de manière créatrice « sur le réel mouvant, au lieu d’adhérer par “médiocrité” à l’illusoire stabilité des choses », serait ainsi le trait caractéristique d’un « moi sain », « authentique », c’est-à-dire d’une « configuration de la conscience » apte à discerner la nature essentielle des choses, ou, ce qui revient au même, à même de prétendre légitimement à l’objectivité (p. 101-6). On découvre ici une pensée proche de l’existentialisme chrétien du début du xxe siècle – fort semblable, en particulier, à celui de Jean Wahl[4] – et que Fradet confronte avec justesse à l’existentialisme sartrien (p. 106-112).
Les derniers chapitres traitent des arguments réalistes de Charles Taylor et de Jean Grondin, qui s’inscrivent tous deux dans la tradition herméneutique contemporaine. Comment concilier une prise en compte conséquente des médiations historiques et linguistiques de la pensée, d’une part, et la prétention de celle-ci à l’universalité selon les modalités distinctes de la science et de la philosophie, d’autre part ?
Après avoir fait état avec justesse des plus récents développements de la position de Taylor en ce qui a trait à la question du réalisme (notamment dans Retrieving Realism, coécrit avec Hubert Dreyfus en 2015), Fradet se focalise sur ce qu’il dénomme 8/ l’argument de l’« immersion comparative », qui ressort des réflexions antérieures menées par Taylor (p. 127-145)[5]. L’argument fait valoir qu’il est possible d’examiner d’un point de vue critique les divers cadres de références herméneutiques (ou « paradigmes ») sur la base de raisons de type ad hominem, c’est-à-dire de nature intrinsèquement comparative. Ce type de raisonnement permettrait d’établir que la transition d’une position à une autre, d’un cadre à un autre, marque à certains égards un « gain épistémique », et ce alors même que ces cadres paraissent incommensurables du point de vue du modèle apodictique de la raison, soit dans la perspective de l’exigence selon laquelle la raison devrait pouvoir trancher les désaccords entre personnes raisonnables sur la base de considérations explicites et plausibles pour tous (ce que Taylor dénomme des « critères »). Le pivot de l’argument est ici la notion de raison ad hominem, que Fradet analyse de manière convaincante et nuancée, en plus de relever comment celle-ci se manifeste dans la célèbre éthique de l’authenticité de Taylor (p. 145-151). La raison humaine disposerait d’importantes ressources herméneutiques par-delà la sphère limitée (et relative) de la raison apodictique. Il est toutefois un peu étonnant que le « réalisme scientifique » de Taylor ne soit que mentionné au détour d’une phrase (p. 127), alors que ce dernier reprend à son compte l’argument eddingtonien consistant à mettre de l’avant la capacité de la science moderne à produire des descriptions « absolues » de la réalité, suivant le mot de Bernard Williams, ou d’un « point de vue de nulle part », suivant cette fois Thomas Nagel, par opposition aux descriptions qui portent sur le sens que revêtent les choses pour nous, soit sur les propriétés secondes ou « anthropocentriques »[6]. Plus encore, un lecteur familier avec l’œuvre de Taylor pourrait regretter que son principal argument réaliste, soit le « principe de la meilleure explication <best-account principal> », ne soit pas discuté alors qu’il gouverne en profondeur son « réalisme de l’être-au-monde »[7].
L’ultime chapitre de l’ouvrage montre bien avec quelle originalité Jean Grondin développe l’argument hégélien en faveur du réalisme – que Fradet qualifie avec raison de « transcendantal, ad hominem ou élenctique » (p. 161, 171) –, soit l’idée selon laquelle il n’est pas possible de ne pas se prononcer sur la réalité en soi, suivant la conception traditionnelle de la vérité comme adéquation de la pensée à la nature essentielle des choses (veritas essendi, veritas rei) : le nier reviendrait à le faire malgré soi (p. 157-172). De fait, quoi qu’on fasse, la reconnaissance des limites de la connaissance est en même temps un savoir qui, au moins à titre de certitude négative, vaut absolument ; toute pensée « post-métaphysique » est, à son corps défendant, une « métaphysique en acte » ; tout « antiréalisme », soit-il idéaliste, constructiviste ou nominaliste, est un réalisme qui s’ignore. Qui plus est, Grondin montre bien, comme Taylor d’ailleurs[8], que s’obstiner à se maintenir dans la contradiction performative, en croyant pouvoir se refuser à penser le réel en soi, est forcément une posture aliénante, contre-productive. Fradet relève en outre que Grondin déploie une « certaine théologie » (p. 174) où se trouvent fusionnés les arguments thomiste et augustinien dans une tentative nouvelle et stimulante d’en expliciter la souche métaphysique commune : que la réflexion conduise à reconnaître l’existence de Dieu en partant de l’ordre intelligible du monde lui-même (stratégie thomiste) ou de l’aspiration au Bien, au mieux-être, qui transit intérieurement tous les êtres vivants (stratégie augustinienne, sur laquelle l’auteur insiste davantage : p. 173-180), il s’agit dans tous les cas de partir du « sens des choses » (qui peut lui-même être compris au sens directionnel, signifiant, sensitif ou réflexif[9]) pour remonter à sa source, sur le mode d’une « conjecture e sensu rerum », en admettant un premier principe qui en serait responsable, un souverain Bien transcendant.
L’ensemble des positions et arguments analysés dans l’ouvrage se trouvent ainsi mobilisés sur un double front : contre le « réalisme naïf », qui fait l’impasse sur les conditions de possibilité de la pensée, et, simultanément, contre les diverses figures contemporaines du « corrélationisme », qui enferment la pensée dans ses schèmes subjectifs, ses médiums constitutifs. Aucune ne céderait à la tentation de « croire que nous pouvons pénétrer à l’intérieur du réel en soi pour en attester l’existence et en connaître les propriétés sans détour », mais toutes auraient plutôt la prudence de se contenter de montrer comment « nous pouvons en parler à distance, à travers un schème subjectif qui se trouve sans cesse orienté vers l’extériorité » (p. 172). On pourrait donc « palper » (p. 81), « tâter, effleurer, voire explorer peu à peu » les choses en soi (p. 191), mais on ne devrait jamais prétendre les connaître ou les « intuitionner » (p. 32) dans leur nature intrinsèque, en « intelliger l’essence » (p. 118).
II.
Fradet fait œuvre utile. Il connaît intimement l’univers culturel québécois et permet habilement d’y entrer. La visée de l’ouvrage est certes généraliste, mais les analyses demeurent toujours stimulantes et le style adopté, limpide et agréable, illustre bien le mot de Vauvenargues : « La clarté est la bonne foi des philosophes ». Cela dit, il n’est pas certain que le fil conducteur du livre, soit la double critique du réalisme naïf et du corrélationisme, puisse être tenue jusqu’au bout, de manière cohérente. Il ressort au contraire à de nombreux moments que ce que l’auteur identifie comme le nerf même du corrélationisme moderne, soit l’argument du « cercle corrélationnel » (selon la formule de Quentin Meillassoux[10]), peut être aisément réfuté sur la base des intuitions centrales du réalisme naïf.
L’argument du cercle corrélationnel fait valoir « qu’on ne peut prétendre penser l’en-soi sans entrer aussitôt dans un cercle vicieux, sans se contredire aussitôt » (p. 29) ; il stipule que se prononcer ou « prendre position » sur la réalité en soi revient à « démentir l’existence d’incontournables médiations au sein de l’acte de connaissance » (p. 161-2). C’est un argument dont l’auteur souligne la force, faisant valoir qu’il s’agit de l’arrière-plan intellectuel à partir duquel on réfléchit en général depuis Kant et, surtout, qu’il lance un défi incontournable : plus personne n’ignorerait aujourd’hui cette « évidence philosophique » d’après laquelle toute vérité soi-disant objective serait au fond « médiatisée par un sujet » (p. 35), et il faudrait avoir de bonnes raisons à offrir pour pouvoir légitimement prétendre « quitter avec succès » ou « se libérer » du cercle corrélationnel. Comment pourrait-il être question, en effet, de « se sortir de soi-même, c’est-à-dire de s’absenter de sa propre subjectivité pour coïncider absolument avec le monde » (p. 39) ?
Pourtant, Fradet montre bien que l’argument pivot de Meillassoux lui-même contre le corrélationisme repose en dernière instance sur l’intuition de sens commun voulant que la distinction entre l’en-soi et le pour-nous « suppose comme un corollaire la possibilité d’accéder à l’en-soi », c’est-à-dire que l’« idéalisme subjectif » est absurde (p. 32) ; et, plus nettement encore, il repose sur l’intuition selon laquelle la mort laisse derrière elle un monde qui demeurera très largement ce qu’il était pour le défunt (le supposé « sujet constituant »)[11]. Il en va bien sûr de même avec l’argument phénoménologique visant à réhabiliter la portée ontologique que reconnait le sens commun à l’expérience et au langage ordinaires, qu’on trouve chez Charles et Thomas De Koninck, mais également, quoique de façon moins explicite, chez Taylor (pour qui les médiations de la pensée sont « en continuité ontologique avec le monde, donc pas forcément corruptrices » : p. 171) et Grondin (chez qui, comme chez Gadamer, le langage conceptuel courant est en prise directe sur les choses en soi, du fait de sa porosité et son extensibilité essentielles : p. 180-2). Fradet souligne en outre avec Anna Longo qu’il suffit de distinguer les propriétés communes – extramentales – auxquelles réfèrent les concepts par l’entremise desquels nous raisonnons et la saisie subjective de ces propriétés dans le concept (cum-capere), en tant que représentation mentale, pour sortir du cercle corrélationnel (p. 35-6). Or, ces arguments ne constituent rien d’autre qu’une réaffirmation du réalisme naïf contre l’évidence présumée du corrélationisme : autant dire, en effet, que les médiations de la pensée sont en règle générale des voies d’accès fiables au réel et que l’en-soi, dès lors, figure lui-même parmi les phénomènes – ce qui est l’énoncé exact du réalisme naïf[12].
Cette tension irrésolue, qui traverse l’entièreté de l’ouvrage, ne s’y trouve jamais expressément thématisée. Au contraire, quoique la position défendue par l’auteur se prête à deux interprétations distinctes en ce qui touche les rapports entre le réalisme naïf et le corrélationisme, chacune d’elles laisse, pour des raisons qui lui sont propres, le problème béant.
Premièrement, plusieurs passages du livre suggèrent qu’une saisie positive de l’en-soi devrait être certaine et totale pour qu’elle puisse être considérée effective, c’est-à-dire pour que le réalisme naïf soit avéré. En effet, d’une part, l’auteur insiste pour dire – suivant l’argument hégélien – qu’on ne peut pas ne pas présupposer qu’il est possible de saisir l’en-soi ; d’autre part, on ne pourrait pas non plus affirmer connaître positivement l’en-soi, car il ne saurait être question de capter celui-ci dans un savoir assuré et englobant : notre finitude – les médiations de la pensée – l’interdit. C’est une interprétation que suggère fortement un article antérieur de Fradet sur le cercle corrélationnel[13]. « Devant le constat moderne selon lequel l’humain est un être limité », écrit l’auteur, « au moins deux attitudes peuvent être adoptées : ou bien l’on se sent enfermé en soi en raison de sa constitution propre ; ou bien l’on observe que tout travail de délimitation rationnelle implique un regard oblique sur ce qui transcende les limites (im)posées » (p. 45). On ne pourrait qu’entrevoir obliquement ou « indirectement » (p. 46) l’en-soi, car on ne penserait jamais autre chose que du « pour-soi » (c’est le cercle corrélationnel), bien qu’on ne puisse pas non plus nier notre capacité d’auto-transcendance, c’est-à-dire notre capacité de saisir l’en-soi (c’est le réalisme réfléchi, émancipé de la naïveté du sens commun). Kant aurait ainsi bien vu la nécessité de suspendre notre jugement sur les propriétés de l’en-soi (p. 190) ; la connaissance de l’en-soi devrait demeurer une certitude négative, une docte ignorance socratique (p. 46-9, 75-6, 191).
Or, suivant les intuitions du réalisme naïf, largement partagées par les non-philosophes, je n’ai pas à être « indubitablement certain de ma prise complète sur l’en-soi », comme le suggère l’auteur (p. 191), pour pouvoir légitimement tenir mes croyances pour des descriptions du monde en soi. Cette exigence est outrancière. Lorsqu’on tient une croyance pour vraie, sans voir de raison valable d’en douter, on se positionne en général de manière tout à fait positive sur l’en-soi, sur le sens des choses elles-mêmes : « Ce poêle est chaud », « Il neige », « Elle a gagné ses élections », etc. Et le fait que certaines de ces croyances soient objets de désaccord raisonnable n’y change rien. Il n’y a aucune contradiction à prétendre se prononcer sur l’essence des choses, en refusant de contraster notre expérience de celles-ci avec une éventuelle perspective absolue ou divine (sub specie aeternitatis), tout en reconnaissant que nos croyances sont faillibles et peuvent se révéler fausses : « Même si l’erreur est toujours possible, notre ambition peut être de voir le monde tel que Dieu le verrait, dans ses structures essentielles.[14] »
Une deuxième interprétation de la position de Fradet touchant à la relation entre le corrélationisme et le réalisme naïf est toutefois possible. Celle-ci est plus « optimiste », pour reprendre les mots de l’auteur lui-même[15], en ce qu’elle ne consiste pas à soutenir que tout discours sur l’en-soi devrait demeurer négatif et indirect, « oblique », mais reconnaît au contraire la possibilité de sortir du cercle corrélationnel : la pensée humaine ne peut pas prétendre épuiser la connaissance de l’en-soi, soutient-il, mais peut néanmoins y accéder. Cela dit, l’auteur admet désavouer la confiance – qu’il juge trop naïve – du sens commun en la capacité de la perception et du langage ordinaires de nous mettre en contact avec le réel ; les médiations subjectives pourraient donner accès au réel en soi, mais seraient fréquemment source d’erreur et d’illusions, dénaturant alors le réel qu’il s’agit d’atteindre. L’enjeu est ici celui d’une certaine prudence ou « humilité » (thème socratique qui revient à plusieurs moments dans le livre : p. 46-7, 99, 183, 185, 190-2), car reconnaître le fait que les médiations subjectives de la connaissance sont en règle générale fiables s’avère incompatible selon l’auteur avec la reconnaissance simultanée de leur faillibilité. Le réalisme naïf est en ce sens rapproché du « dogmatisme » (p. 30, 33, 44, 74, 81, 136) dans la mesure où reconnaître humblement sa faillibilité est ce qui permettrait, au contraire du réalisme naïf, de rester ouvert aux objections et, donc, au dialogue.
Pourtant, la confiance naturelle que nous avons d’être en prise avec le réel se doit d’être rigoureusement distinguée du dogmatisme : celui-ci ne tient pas à la supposée naïveté du sens commun, soit à l’ignorance du fait que les médiations subjectives seraient généralement corruptrices (puisqu’elles ne le sont pas : c’est l’erreur du corrélationisme que de le croire), mais bien plutôt, en sus de divers facteurs psychologiques et sociopolitiques, à l’ignorance des raisons positives qui existent de douter de nos croyances. L’esprit critique, soit la remise en doute des préjugés et des idées reçues, malgré l’effort qu’il suppose[16], n’exige aucun rejet du réalisme naïf. De même, le corrélationisme n’est pas un rempart contre le dogmatisme, mais un scepticisme arbitraire : on ne peut croire que les médiations de la perception et de la pensée interdisent de saisir l’en-soi que si nous l’avons d’abord décrété dans un doute qui n’est pas lui-même épistémiquement justifié ; elles ne rendent inaccessible l’en-soi que si l’on présuppose qu’elles ne peuvent pas être des voies d’accès fiables ou transparentes, en les soumettant à un doute très justement qualifié d’hyperbolique[17].
C’est l’aporie centrale du présent ouvrage sur le réalisme dans la philosophie québécoise contemporaine : l’auteur exprime – suivant l’argument du cercle corrélationnel – un scepticisme considérable à l’endroit du réalisme naïf, alors qu’il indique par ailleurs très clairement et à de nombreuses occasions pourquoi cette autolimitation de la pensée est arbitraire, intenable. Cette aporie pourrait certes être partiellement levée en adoptant une autre définition du réalisme naïf, qui ne renverrait pas à la confiance native du sens commun en la fiabilité générale des médiations perceptives et langagières de la connaissance, conçues alors comme des ouvertures non-problématiques au monde, mais plutôt à une ignorance de ces médiations en tant que telles, comme si certains sujets humains affirmaient l’existence de diverses propriétés du réel sans savoir qu’ils sont eux-mêmes là, dans leur constitution propre, à affirmer ces propriétés. Or, pareille compréhension des rapports entre la pensée et le monde n’est pas naïve, mais simplement désincarnée : qui ignore vraiment qu’il appréhende le monde par l’entremise d’un corps spécifique et d’une culture particulière, au moins en tant que trait général de la condition humaine ? Si une pure et simple ignorance de nos conditions d’accès aux choses était la définition du réalisme naïf que décidait d’adopter l’auteur afin de dénouer la tension relevée ici – et certains passages le suggèrent en effet, lorsqu’il évoque la possibilité d’être totalement « inconscient » des médiations de la connaissance (p.72), ou encore de passer entièrement « sous silence » notre mode d’accès au réel » (p. 30) –, il s’agirait assurément d’un repoussoir qui, loin de correspondre à l’attitude naturelle, ferait signe vers une forme de conscience dont on pourrait dire qu’elle est ou bien affectée d’une grave pathologie, ou bien encore à ses tout premiers stades de développement.
III.
Qui plus est, du fait de cette tension irrésolue, la double exigence que tente de satisfaire Fradet – montrer que chaque auteur étudié se démarque du réalisme précritique tout en dépassant le corrélationisme – agit sur le plan exégétique comme un prisme déformant dans la mesure où la critique du réalisme naïf ne permet pas de reconnaître que les médiations perceptives et culturelles de la connaissance nous ouvrent de manière généralement fiable sur le réel (« en soi », tel qu’il est indépendamment de toute conscience ou subjectivité) d’après les philosophes québécois examinés ici, alors que c’est parfois le cas de manière très explicite. On le voit de façon spécialement nette chez Grondin, selon qui il est inévitable de se prononcer sur l’essence véritable des choses, la « vraie réalité » (p. 159), et de le faire de prime abord et le plus souvent, en mettant l’accent avec Gadamer sur « la révélation ontologique que prodigue le langage, sur l’automanifestation des choses en langage »[18]. Le réalisme naïf se trouve ainsi endossé par moment dans l’ouvrage, non sans ambiguïté, mais pour être ensuite immédiatement désavoué au nom de l’exigence d’après laquelle une saisie positive de l’en-soi devrait être certaine et totale, suivant la première interprétation de la position de Fradet, ou encore de l’idée selon laquelle les médiations peuvent être fiables, mais ne le sont généralement pas – ce qui conduit l’auteur à affirmer contradictoirement que certains des philosophes qu’il présente rejettent le réalisme naïf tout en y souscrivant.
Inversement, l’exigence de dépasser le corrélationisme ne permet pas de rendre compte de certains aspects importants des positions comparées. Par exemple, Taylor propose une définition de la réalité selon laquelle est « aussi réel que possible » ce qui existe indépendamment de nos jugements et attitudes : « What is real is what you have to deal with, what won’t go away just because it doesn’t fit with your prejudices. »[19] Cette définition générale lui permet de soutenir (notamment avec John McDowell[20]) que certaines « propriétés secondes » des choses, c’est-à-dire certaines propriétés qualitatives, sont aussi réelles que possibles même si elles dépendent quant à leur existence de la nôtre, soit du fait que « le monde soit habité par des êtres humains, dotés d’une certaine forme de vie, de modes de conscience et de certains types de soucis ».[21] Le « tribunal de l’expérience » comporterait jusqu’à preuve du contraire un ordre de significations « interstitielles », à commencer par les « évaluations fortes » (strong evaluations), ne se manifestant qu’à « l’interface du Dasein et du monde <in interface between Dasein and world> »[22]. La réalité est ce qui résiste à nos préjugés, à notre effort de compréhension, qu’il s’agisse du monde vécu tel qu’il se dévoile à un agent en situation ou du monde objectif que découvrent les sciences expérimentales. L’inspiration première de Taylor est ici Heidegger, à qui reviendrait le mérite d’avoir indiqué une via media crédible entre le réalisme naïf et le constructivisme moderne : la « clairière » (clearing, Lichtung) présuppose un agent sans que celle-ci ne soit contrôlée ou intégralement configurée par celui-ci – « Dasein-related but not Dasein-centered »[23]. Or, cette voie moyenne – qui est celle du « réalisme de l’être-au-monde »[24] – n’opère pas un dépassement du corrélationisme, mais s’y maintient au contraire de manière tout à fait assumée. Elle se distingue en cela du réalisme de Grondin, chez qui le « sens des choses » ne dépend pas quant à son existence et sa structuration intrinsèque de l’existence des agents qui y accèdent en vertu de leur(s) langue(s) et leur(s) histoire(s)[25].
En somme, la décision, structurante pour l’ensemble de l’ouvrage, d’adopter pour point de référence le réalisme spéculatif contemporain, ou plus exactement la manière dont celui-ci définit la question du réalisme, entraîne des conséquences systématiques et exégétiques qu’on pourrait estimer regrettables. Car si « le désir du réel dans la philosophie québécoise » se trouve restitué ici de façon riche, habile et féconde, dans l’intention plutôt modeste de faire ressortir, à partir de leurs nuances propres, la fécondité aussi bien que les limites de certains des apports de la philosophie québécoise aux débats contemporains sur le réalisme (p. 20), on peut avoir le sentiment que s’y trouve largement éludée la question de savoir si le sens qui s’exprime dans nos jugements et raisonnements aurait une réalité même dans un univers dépourvu d’agents conscients – ce qui demeure sans doute la pointe la plus radicale et polémique du réalisme.
[1] Fradet consacrait par ailleurs une belle étude à Bergson et Derrida en 2014, intitulée Derrida-Bergson. Sur l’immédiateté (Paris, Hermann, coll. « Hermann philosophie »).
[2] Voir à cet égard Lee BRAVER, A Thing of this World, A History of Continental Anti-Realism, (Northwestern University Press, 2007, 590 pp.), qui parle volontiers du « paradigme kantien » de la philosophie contemporaine tout en brossant un panorama instructif des courants antiréalistes de la philosophie continentale des deux derniers siècles (Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida).
[3] Emmanuel KANT, Critique de la raison pratique, Conclusion, trad. Luc Ferry et Heins Wismann, in Œuvres philosophiques II, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1985, p. 801-2. Cité par Thomas DE KONINCK, « La raison de l’amour », in Thomas de DE KONINCK & Louis ROY, La foi est-elle irrationnelle ?, Montréal, Groupe Fides, 2013, p. 20-1.
[4] Ces affinités sont particulièrement évidentes dans l’ouvrage collectif de langue anglaise édité par Alan D. SCHRIFT and Ian Alexander MOORE, Jean Wahl: Transcendence and the Concrete Selected Writings (New York: Fordham University Press, Perspectives in Continental Philosophy, 2017, 291 pp.).
[5] Fradet distingue également l’argument de la « condition humaine », mais il est clair, à la fois chez Taylor lui-même (« Explanation and Practical Reason » [1989], in Philosophical Arguments, Harvard University Press, 1995, p. 44-50) et dans le chapitre dont il est ici question (p. 127-136), que cet argument relève de celui de l’immersion comparative, à titre de figure ou d’instance particulière de ce dernier.
[6] Voir Bernard WILLIAMS, Descartes, Penguin Books, 1978 ; Thomas NAGEL, The View from Nowhere, Oxford University Press, 1986 ; Charles TAYLOR, « Understanding in Human Science », The Review of Metaphysics, vol. 34, no. 1, 1980, p. 31 ; Charles TAYLOR, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1989, p. 56.
[7] Charles TAYLOR, Sources of the Self…, p. 58-59. « How else to determine what is real or objective, or part of the furniture of things, than by seeing what properties or entities or features our best account of things has to invoke ? » (Id., p. 68).
[8] Voir Charles TAYLOR, Sources of the Self…, p. 88-90.
[9] Voir Jean GRONDIN, Du sens de la vie. Essai philosophique, Bellarmin, 2003, p. 27-34 ; Jean GRONDIN, Du sens des choses. L’idée de la métaphysique, PUF, 2013, p. 67-71.
[10] Quentin MEILLASSOUX, Après la finitude. Essai sur la contingence de la nécessité, Paris, Seuil, 2006, p. 19.
[11] Pierre-Alexandre FRADET, « Sortir du cercle corrélationnel : un examen critique de la tentative de Quentin Meillassoux », Hermann, « Cahiers critique de philosophie », 2018, vol.1 no. 19, p. 127-145. Voir spécialement Quentin MEILLASSOUX, Après la finitude…, p. 79-80.
[12] Le corrélationisme suppose en effet une mise en doute des moyens perceptifs et langagiers de la pensée qui est entièrement étrangère à la conscience naturelle, spontanée, de l’être humain. Ce doute à l’endroit des instruments de la connaissance s’est notamment cristallisé dans ce que Michael Huemer dénomme la doctrine du « voile de la perception », qui est en quelque sorte la forme la plus élémentaire et décisive du corrélationisme moderne, selon laquelle nous ne percevrions pas directement les choses elles-mêmes, telles qu’elles existent indépendamment de nous, mais seulement nos expériences ou représentations des choses : « Thus, our processes of perception are like a “veil” standing between us and the real world, preventing us from ever really perceiving (objective) reality » (Michael HUEMER, Skepticism and the Veil of Perception, Rowman & Littlefield Publishers, 2001, p. xix).
[13] L’auteur introduisait en effet dans « Sortir du cercle corrélationnel… » le concept de « possible référentiel » (p. 143-4) afin de souligner « que certains objets sont bel et bien pensables comme objets ne dépendant pas de la pensée pour être », mais dans l’intention de faire valoir qu’il ne saurait être question « de savoir avec certitude et exactitude la nature ou les propriétés de ces référents », soit de s’engager « à placer le contenu de pensée qu’on forge alors dans le monde lui-même, encore moins à en faire une vérité absolue ».
[14] Charles LARMORE, « Expérience et ouverture au monde : remarques sur la phénoménologie de Claude Romano », in Philippe CABESTAN (dir.), L’événement et la raison : autour de Claude Romano, Paris, Vrin, Le Cercle herméneutique, 2016, p. 166.
[15] Communication privée, 1 mars 2023.
[16] « Pour répéter, pour imiter, pour se fier, il suffit de se laisser aller ; c’est la critique qui exige un effort » (Henri BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion [1932], PUF, 2013, p. 143-4).
[17] À ce sujet, voir notamment, en plus de l’essai de Michael HUEMER (Skepticism and the Veil of Perception…, chap. 1 et 2, p. 7-49), les excellentes analyses de Roger POUIVET dans Le réalisme esthétique (PUF, 2006, chap. 1, p. 37-82)
[18] Jean GRONDIN, « L’art comme présentation chez Gadamer », in Gadamer. Art, poétique et ontologie, sous la direction de Jean-Claude Gens et Marc-Antoine Vallée, Éditions Mimésis, 2016, p. 60.
[19] Charles TAYLOR, Sources of the Self…, p. 59.
[20] Voir Charles TAYLOR, « Ethics and Ontology », The Journal of Philosophy, vol. 100, no. 6, 2003, p. 305-320.
[21] « Of course, it is clear that an essential condition of the existence of such properties is that there are human beings in the world, with a certain form of life, and kinds of awareness, and certain patterns of caring. But these properties are no less real features of the world which does contain humans than any “neutral” properties are » (Charles TAYLOR, Sources of the Self…, p. 68).
[22] « It re-establishes the non-arbitrary, non-projective character of certain demands on us, which are firmly anchored in our being-in-the-world. These demands do not just emanate from us, but at the same time, they are not inscribed in the universe (or the Universe and God) independently of us. They arise in our world » (Charles TAYLOR, « Recovering the Sacred », Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, vol. 54, no. 2, 2011, p. 117). « These significances arise out of a combination of spontaneity and receptivity, constraint and striving ; they are the ways the world must be taken in for a being defined by certain goals or needs to make sense of it » (Charles TAYLOR, « Merleau-Ponty and the Epistemological Picture », dans The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, T. Carman & M.B. Hansen (dir.), New York, Cambridge University Press, 2005, p. 46).
[23] Charles TAYLOR, « Heidegger, Language, and Ecology », in Philosophical Arguments…, p. 116. Cette question de la « transcendance dans l’immanence », qui constitue l’un des thèmes centraux de la tradition phénoménologique depuis Husserl, consiste ainsi à se demander « comment paradoxalement il y a pour nous de l’en-soi » (Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Éditions Gallimard, coll. Tel, 1945, p. 100).
[24] On trouve aussi une version robuste et sophistiquée de ce type de réalisme (« relationnel et holistique ») chez Claude ROMANO (Au cœur de la raison, la phénoménologie, Éditions Gallimard, 2010 (chap. XVI : « L’être-au-monde », p. 589-641), qui se réclame explicitement de la position de Taylor (p. 631-2, 769-770).
[25] Grondin n’hésite pas, en effet, à parler de la dimension « cosmique » du sens : « [l]a cellule qui se reproduit, la planète qui gravite autour d’un astre, le saumon migrateur qui remonte le cours d’un courant au moment du frai, l’abeille qui butine d’une fleur à l’autre n’ont-elles pas un sens ? » (Jean GRONDIN, Du sens de la vie…, p. 65).














