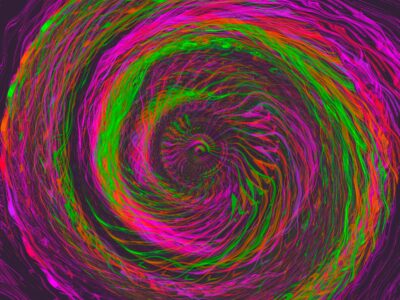Compte-rendu critique – La forme de la règle. Kant, l’éthique et la subjectivité
Circé Furtwängler est professeur agrégé de philosophie et ATER à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est rédactrice en chef de la revue Implications philosophiques.
David Zapero, La forme de la règle. Kant, l’éthique et la subjectivité, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, « La vie morale », 2021, 170p.
L’ouvrage est disponible ici.
Résumé :
Dans La forme de la règle, David Zapero examine la philosophie kantienne de l’autonomie en interrogeant sa normativité. A la profusion de normes qui constituent et régulent la vie sociale, il faut opposer une norme proprement éthique, dont le contenu se confond avec la subjectivité pratique elle-même, dès lors qu’elle se définit par la capacité à se concevoir comme soumise à une règle. Centré sur les Fondements de la métaphysique des mœurs, l’ouvrage propose une redéfinition de la subjectivité morale à partir du concept d’engagement, qui conclut une analyse précise de la fonction, des modalités et de la justification des règles.
Mots-clefs : Kant, Philosophie morale, Règle, Loi morale
Abstract :
In La forme de la règle, David Zapero examines the Kantian philosophy of autonomy by questioning its normativity. To the plethora of norms that constitute and regulate social life, we must oppose a specifically ethical norm, whose content merges with practical subjectivity itself, insofar as it is defined by the ability to conceive of oneself as subject to a rule. Centered on the Foundations of the Metaphysics of Morals, the book proposes a redefinition of moral subjectivity based on the concept of commitment, which concludes with a precise analysis of the function, modalities and justification of rules.
Keywords : Kant, Moral philosophy, Rule, Moral Law
Introduction
L’ouvrage de David Zapero part d’une interrogation méta-éthique (p. 6) : une conception généralement admise de l’éthique tend à séparer les normes éthiques des normes de la vie sociale, qui relèveraient davantage des usages, de la coutume ou des mœurs. On considère ainsi que les règles qui permettent d’évaluer la valeur morale d’une action sont dotées d’une nécessité qui les distingue, par exemple, des règles de la politesse, comme le vouvoiement, qui dépend des contextes sociaux dans lesquels le locuteur est amené à utiliser la seconde personne. L’auteur identifie dans la philosophie kantienne l’origine de cette conception des normes éthiques, qui les définit comme un type particulier de prescription, la « classe des prescriptions inconditionnelles » (p. 16). Ce type d’exigence éthique se signale tout d’abord par leur caractère prescriptif, et impératif sur nos actions (à la différence des normes sociales qu’on peut se contenter de décrire) ; mais aussi par leur indépendance à l’égard de tout contexte qui serait susceptible de les relativiser (à la différence de prescriptions conditionnelles comme les obligations qui impliquent un rôle social à l’image de celles de l’enseignant, de l’amphitryon ou du parent, p.5). En laissant leur étude aux sciences sociales pour se préoccuper uniquement du problème de la justification des normes, le philosophe adopte un présupposé que l’auteur présente comme un paradoxe : « Pourquoi la philosophie morale doit-elle commencer par faire abstraction de la prise qu’ont effectivement sur nous les normes régissant nos vies afin d’essayer ensuite de reconstruire cette prise et de la justifier ? » (p. 9) Cette opération d’abstraction se superpose à une distinction conceptuelle entre la forme et la matière de la règle : les normes de la vie sociale dépendent d’un contenu matériel, leur contexte, qui les dote d’une effectivité, là où les exigences proprement éthiques sont prescriptives indépendamment de tout contenu, et se définissent donc par leur forme. Le titre de l’ouvrage reproduit cette tension interne à la définition des normes éthiques : si c’est sa seule forme qui définit la règle dans le cas des normes éthiques, alors il nous faut identifier les règles – de second degré – qui permettent de nous assurer que la forme des règles morales que nous suivons est adéquate. Intituler un livre La forme de la règle pourrait en effet paraître à première vue redondant : qu’est-ce qu’une règle sinon une forme ? Par « règle » l’éthique désigne dans la philosophie morale depuis Kant la prescription qu’un agent a suivie pour l’appliquer à un cas particulier. Une règle dont on ne pourrait abstraire une signification formelle ne serait plus une règle du tout ce qui ne signifie pas pour autant qu’une règle doit être dépourvue de tout contenu matériel (ainsi de la règle monastique) : en limitant sa portée par la multiplication des exceptions, on la prive de sa forme et la règle ne devient alors plus qu’un vœu pieu. C’est cette tension entre l’abstraction nécessaire de la règle pour la rendre effective et la variété des cas pratiques que l’auteur entend interroger au cœur de la vie morale. La démarche de l’auteur repose sur une double décision : la première consiste à interroger la séparation entre les règles morales et les normes qui régulent la vie humaine en général, et la seconde à se confronter à l’histoire de la philosophie en proposant un commentaire de la philosophie de Kant, philosophe auquel la pensée de l’obligation morale mais aussi le reproche de formalisme restent les plus attachés.
L’ouvrage se développe à partir de cette interrogation sur le point de départ de l’éthique, et adopte pour méthode une interprétation de la philosophie pratique kantienne, tenue pour fondatrice de la conception de l’éthique comme autonome. Kant le premier rompt avec toute volonté de fonder l’éthique sur l’ontologie (p. 13), qu’il s’agisse du perfectionnisme des Anciens ou de la téléologie naturelle. Plutôt qu’une désillusion, la fondation d’une éthique sans ontologie permet de dégager la possibilité d’une objectivité pratique véritable. L’ouvrage procède selon trois moments : partant de l’impossibilité pour l’éthique de « saisir la volonté dans une perspective théorique, dans l’optique du spectateur » (p. 73) (« Engagement et contrainte », p. 21-73), l’auteur insiste sur la nécessité pour le sujet moral de « se concevoir comme soumis à une règle » (p. 124) pour qu’il se place dans un rapport où il lui est « possible [d’y] obéir ou de [l’]enfreindre » (Ibid.) (« L’Ananke stenai des Modernes ou le Faktum de la raison », p. 79-124). La troisième partie, aporétique, conclut à la nécessité pour le sujet moral de se penser engagé par une maxime qu’il n’est peut-être même pas en capacité de choisir, mais qu’il doit pourtant faire sienne, parce qu’il est exclu qu’il méconnaisse ses propres engagements, (« Liberté et ipséité », p. 127-164). Cette conception n’est pas sans poser des difficultés, comme le reconnaît l’auteur.
« Engagement et contrainte »
Le premier chapitre (« La lettre et l’esprit de la loi », p. 21-35) interroge la solution classique au problème de savoir ce qui constitue une norme éthique : l’usage de l’impératif catégorique comme un « étalon » (p. 21) ou un « moule qui se laisse appliquer à une maxime quelconque afin d’en déterminer la valeur morale » (Ibid.). Une telle interprétation de l’impératif catégorique demeure en-deçà du projet kantien : il ne s’agit pas d’identifier si certaines règles particulières a priori satisfont aux critères de définition d’une exigence éthique, mais de déterminer la forme a priori de toute norme éthique comme proposition inconditionnelle. En outre, le véritable problème semble ne pas tant se situer au niveau de la lettre de la maxime que de la modalité de son accomplissement selon son esprit. L’auteur s’appuie ici en particulier sur la distinction luthérienne entre la lettre et l’esprit de la loi, discutée par Kant dans la Critique de la raison pratique[1] ce qui lui fait écarter il est vrai, une interrogation sur l’aspect logique et linguistique de la formule de l’impératif catégorique[2]. Le fil directeur du développement est le problème de la « fausse obéissance », c’est-à-dire de la possibilité pour un agent d’agir conformément à une règle par accident, et à la nécessité pour les normes éthiques de se prémunir contre une obéissance fortuite (p. 31). Le chapitre II (« La volonté », p. 37-42) étudie alors le concept de vouloir, qui paraît déterminant dans la distinction entre un accomplissement authentique et une fausse obéissance. « C’est la là marque du vouloir : celui-ci ouvre un espace où il existe la possibilité d’une réussite et d’un échec. » (p. 39) Evaluer une action à partir d’un engagement pris par le sujet, c’est pouvoir éliminer la contingence qui accompagne les circonstances ou le résultat effectif de l’action. L’auteur peut relativiser alors la distinction kantienne entre impératif catégorique et impératif hypothétique (p. 40-41) puisque toute volonté bien déterminée doit vouloir les moyens en même temps que la fin. Plutôt qu’une causalité de la liberté, la volonté gagne selon l’auteur à être définie sous le registre du « comme si » : elle est « une capacité de nous concevoir comme agissant à l’aune de certaines règles que nous nous représentons. » (p. 42).
 Les chapitres III (« La raison instrumentale », p. 43-59) et IV (« L’engagement et la sincérité », p. 61-75) traitent du rapport entre la nécessité formelle des exigences éthiques et la raison instrumentale qui caractérise les contraintes pratiques matérielles. Le raisonnement instrumental ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les empiristes, se maintenir à un niveau descriptif : en exhibant les rapports causaux qui permettent d’accomplir une action précise, envisagée comme la fin d’un processus dont on identifie progressivement les moyens, la raison instrumentale formule bien des prescriptions. Contre Hume, il faut donc soutenir que le raisonnement instrumental est défini par un engagement implicite, qu’exprime l’impératif hypothétique : « Qui veut la fin, veut aussi les moyens. ». L’auteur montre ici avec beaucoup de finesse pourquoi les impératifs hypothétiques doivent être intégrés à l’ensemble des prescriptions éthiques : quand bien même ils sont conditionnels, ils ne reposent pas sur un principe empirique (comme le désir) mais sur un rapport formel et nécessaire entre la fin et les moyens. La contrepartie apparente d’une telle conception est la restriction de la moralité aux êtres rationnels, mais aussi la difficulté à penser une véritable infraction d’un impératif hypothétique, dès lors que le lien entre la fin et les moyens est défini comme analytique (p. 65 sqq.). Si l’engagement effectif constitue le seul critère de distinction, il n’est pas possible d’avoir de certitude quant à la sincérité d’une intention, celle-ci pouvant toujours se travestir dans les vêtements de l’amour-propre pour tromper jusqu’au sujet lui-même. L’auteur accuse une tension chez Kant entre « l’étude de la volonté comme s’il existait un certain étalon permettant d’identifier de façon indépendante les véritables mobiles d’un agent » (p. 74-75) et la « critique du sens intérieur » (p. 75) qui empêche à l’homme de se flatter de se connaître tel qu’il est lui-même.
Les chapitres III (« La raison instrumentale », p. 43-59) et IV (« L’engagement et la sincérité », p. 61-75) traitent du rapport entre la nécessité formelle des exigences éthiques et la raison instrumentale qui caractérise les contraintes pratiques matérielles. Le raisonnement instrumental ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les empiristes, se maintenir à un niveau descriptif : en exhibant les rapports causaux qui permettent d’accomplir une action précise, envisagée comme la fin d’un processus dont on identifie progressivement les moyens, la raison instrumentale formule bien des prescriptions. Contre Hume, il faut donc soutenir que le raisonnement instrumental est défini par un engagement implicite, qu’exprime l’impératif hypothétique : « Qui veut la fin, veut aussi les moyens. ». L’auteur montre ici avec beaucoup de finesse pourquoi les impératifs hypothétiques doivent être intégrés à l’ensemble des prescriptions éthiques : quand bien même ils sont conditionnels, ils ne reposent pas sur un principe empirique (comme le désir) mais sur un rapport formel et nécessaire entre la fin et les moyens. La contrepartie apparente d’une telle conception est la restriction de la moralité aux êtres rationnels, mais aussi la difficulté à penser une véritable infraction d’un impératif hypothétique, dès lors que le lien entre la fin et les moyens est défini comme analytique (p. 65 sqq.). Si l’engagement effectif constitue le seul critère de distinction, il n’est pas possible d’avoir de certitude quant à la sincérité d’une intention, celle-ci pouvant toujours se travestir dans les vêtements de l’amour-propre pour tromper jusqu’au sujet lui-même. L’auteur accuse une tension chez Kant entre « l’étude de la volonté comme s’il existait un certain étalon permettant d’identifier de façon indépendante les véritables mobiles d’un agent » (p. 74-75) et la « critique du sens intérieur » (p. 75) qui empêche à l’homme de se flatter de se connaître tel qu’il est lui-même.
« L’Ananke stenai des Modernes ou le Faktum de la raison »
Les chapitres V (« La découverte de l’autonomie », p. 79-85) et VI (« La forme de la loi, la réalité objective et le scepticisme », p. 87-99) placent l’originalité de la philosophie kantienne dans la « découverte » qu’« une loi morale, quelle qu’elle soit, ne peut pas nous être imposée de l’extérieur mais doit être adoptée par nous-mêmes » (p.79) avant de s’interroger sur la nature de « la contrainte caractéristique d’une loi morale » (Ibid.) dès lors qu’elle se définit par l’autonomie. La nouveauté radicale de la position kantienne tient à avoir refusé d’asseoir la moralité sur une définition du Souverain Bien, ou sur une compréhension descriptive du raisonnement instrumental, afin de tirer sa force du vouloir lui-même (p. 84), étant donné qu’« il n’existe de contrainte que là où on s’est contraint soi-même » (Ibid.) Certes, l’auteur admet une difficulté intrinsèque à l’expression « s’imposer sa loi à soi-même » (Ibid.), « comme s’il existait un état, avant elle, on n’était pas encore soumis à elle », une « antichambre du vouloir » (passim), mais il ne la traite pas pour elle-même ; si les prescriptions inconditionnelles sont consubstantielles au vouloir en général, on peine pourtant à comprendre la genèse de la moralité dans le sujet, le point de départ de la volonté se retirant toujours en amont d’elle-même. L’enjeu est plutôt pour l’auteur de faire valoir la nature de l’obligation qu’emporte le concept de loi morale : il s’agit d’une exigence éthique de second degré, nécessaire à l’adoption même d’une maxime (p. 85), car sans elle le vouloir est impossible. La loi morale est ainsi bien « différente de telle ou telle prescription particulière » (p. 88). Tout le problème se ramène à celui, plus général, de la possibilité de l’expérience, tel qu’il est formulé par la philosophie transcendantale : une norme est a priori dès lors qu’elle ne se confond pas avec une régularité empirique, mais constitue une condition de possibilité de l’expérience. L’auteur note ainsi que « le problème auquel la déduction transcendantale est censée apporter une solution est déjà soulevé, dans la philosophie pratique, au niveau de l’analyse du concept de volonté » (p. 93) parce qu’il est toujours possible que la conformité aux normes ne soit que conventionnelle et fortuite. « Or le point de vue caractéristique d’un acte de vouloir, consistant à se concevoir comme soumis à une règle, n’est rien d’autre, aux yeux de Kant, que le point de vue l’universalité. » (p. 94) Commentant le caractère abrupt de cette identification, l’auteur fait valoir que la notion de légalité (Gesetzmäßigkeit) désigne la possibilité pour le vouloir de se rendre « commensurable » à une maxime, et de ne plus concevoir sa situation comme unique, mais comme un cas particulier d’un ensemble de situations semblables, dans lesquelles on doit pouvoir avoir recours à des prescriptions qui valent pour plusieurs cas. Le résultat de cette analyse est que « la connaissance morale ordinaire […] mobilisée de façon implicite dans la vie quotidienne » (p.98) ne comporte aucun contenu, mais relève de la capacité du sujet pratique à s’abstraire de sa situation particulière, en « pren[ant] du recul [pour] distinguer entre un positionnement seulement relatif ou circonstanciel et un positionnement absolu. » (Ibid.)
Les chapitres VII (« Le problème de la justification de la loi », p. 101-116) et VIII (« Le Faktum de la raison », p. 117-124) exposent les raisons du refus kantien d’une déduction transcendantale de la loi morale, sans pourtant qu’il faille selon l’auteur considérer que cette impossibilité interdise toute démonstration rationnelle de la légitimité de la loi morale, rejetant par là l’interprétation classique du fait de la raison comme « corollaire » de l’échec de toute preuve de la loi morale, proposée par D. Heinrich[3]. La notion de fait de la raison n’est pas pour l’auteur un pis-aller à l’impossibilité de la justification de la loi morale. Certes, la légitimité de la loi morale ne peut pas être démontrée par la raison théorique, mais sa facticité renvoie plutôt au fait qu’elle est pour ainsi dire à elle-même sa propre justification. L’exposition de la loi morale s’identifie à la découverte d’une prescription autonome, qui n’a pas besoin de reposer sur une autorité extérieure – fût-ce une preuve de la raison théorique – dont elle tirerait sa légitimité. C’est pourquoi la justification de la loi morale ne peut être « analogue à la démonstration déductive d’une vérité. » (p. 112) C’est que la loi morale ouvre le registre de la contrainte pratique comme étant celui non pas de la justification d’une prescription pratique particulière, mais de la possibilité d’une prescription pratique quelconque. L’auteur souligne la proximité de cette argumentation avec la démarche de Kant lorsqu’il établit la déduction transcendantale des catégories : « l’enjeu décisif de la déduction n’est pas le statut de tel ou tel concept, mais la possibilité d’une contrainte à même l’expérience » (p. 115). Ces analyses très convaincantes, gagneraient à être développées, tant on sent que la mise au jour d’un type de nécessité rationnelle immanente est au cœur de la démarche d’un ouvrage dont la brièveté empêche une thématisation explicite de ce problème[4]. La seconde partie de l’ouvrage conclut à l’équivalence entre la prise d’un engagement, la capacité à penser son vouloir comme s’il était soumis à une loi et l’immédiateté de la conscience de soi. Le rapport entre la loi morale et la conscience de soi fait l’objet de la dernière partie, qui étudie le lien entre liberté et ipséité.
« Liberté et ipséité »
Les chapitres IX (« Fonction et place d’une déduction de la liberté », p. 127-135), X (« Liberté et conscience de soi », p. 137-147) et XI (« L’immanence de la loi et le problème de la subjectivité », p. 149-154) étudient le rapport entre la légalité universelle des prescriptions pratiques inconditionnelles et la conscience que le sujet pratique a de lui-même. C’est dans ce contexte que la notion de sincérité (p. 150) est introduite : tout engagement serait sincère dans la mesure où les exigences éthiques sont nécessairement autonomes, ce qui comporte le risque d’affaiblir la position kantienne, dans la mesure où « la loi [serait], en un certain sens, trop immanente à la volonté » (p. 150)
« Si, en tant que libres, nous appartenons au monde intelligible et si, en tant que membres de ce monde, nous obéissons inévitablement à la loi morale, nous pouvons seulement enfreindre la loi en tant que membres du monde sensible. Ce qui revient à dire : nous ne pouvons transgresser la loi que lorsque nous ne sommes pas libres. Cela signifie à son tour que cette infraction n’en est pas vraiment une parce qu’elle n’est pas le résultat d’un acte spontané. » (p. 151)
Pour l’auteur, il y a là un résidu de dualisme, qui s’exprime dans le recours à la notion de passion qui « ne nous engage à rien » (p. 152) pour expliquer la possibilité de ne pas s’engager sincèrement, mais qui ne rend pas compte de la possibilité de la transgression de l’engagement pris. Rappelant le texte des Fondements qui refuse tout recours à une conception dispositionnelle de l’éthique, laquelle identifie dans le caractère le critère d’une « conduite conforme à la loi », l’auteur écarte cette solution parce qu’elle demeure toujours un accomplissement externe et donc contingent. Cette interprétation conduit l’auteur à un paradoxe : il faudrait séparer les dispositions à la moralité de la bonne volonté, entendue comme la capacité à s’engager qui définit la subjectivité pratique ; autrement dit, il s’agirait d’« opérer une certaine distinction entre « nos dispositions » et « nous ». » (p. 153)[5] On peut regretter que l’auteur fasse ici l’impasse sur le concept de personnalité morale, qui aurait permis de préciser le rapport entre la rationalité pratique impersonnelle et l’imputabilité d’une action à un sujet pratique. C’est chez Kant le respect qui caractérise la personnalité, en tant qu’il est le sentiment de sa propre finitude à l’égard de l’absolu qu’est la liberté, constituant par là-même le seul sentiment moral (et non pathologique). S’il faut bien, comme l’auteur le souligne, situer le registre des prescriptions éthiques en dehors du caractère, cela ne signifie pas que la sensibilité soit absente de la moralité, en tant qu’elle nous y fournit un accès sous l’espèce du respect. Le concept kantien de personnalité ne dépend pas de la conscience de soi psychologique, ni même de la caractérisation de l’homme comme animal rationnel, mais de la seule liberté, entendue comme possibilité d’agir de manière autonome. Les caractéristiques de la personnalité renvoient ainsi à la loi morale elle-même et la conscience psychologique la présuppose plutôt qu’elle ne la permet[6]. Certes, entre les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) et La religion dans les limites de la simple raison (1793) le concept de personnalité connaît un approfondissement dont il faudrait retracer précisément les étapes pour l’intégrer au propos de l’ouvrage. Ainsi, la « spontanéité de la subjectivité » (p. 154) identifiée par l’auteur comme la justification de notre capacité à « entretenir un rapport particulier avec nos mobiles et nos desseins » (Ibid.) pourrait être resituée par rapport à sa source – la redéfinition proprement morale par la philosophie pratique du concept classique de personnalité juridique comme sujet d’imputation – et trouver une justification esthétique dans le sentiment du respect[7].
Le chapitre XII (« L’envers de la loi », p. 155-164) prend la forme d’une conclusion aporétique sur le problème de la possibilité de la transgression de la loi morale. Certes la restriction des normes éthiques aux prescriptions inconditionnelles écarte la possibilité de penser la régularité dans les actions comme simplement conventionnelle, et constitue la condition d’une conception autonome de la morale, sous la forme d’un engagement qui donne son sens et sa signification à l’agir du sujet pratique, mais la possibilité de l’infraction recule à mesure qu’on pose l’équivalence entre la volonté et la loi morale. Ayant écarté que les circonstances puissent expliquer l’infraction, celle-ci est condamnée à être simplement constatée dans son existence sans qu’on soit en mesure de fournir une justification de sa possibilité (p. 161). L’auteur souligne à raison que « cette impossibilité est le fruit d’un gouffre catégorial entre le point de vue théorique et le point de vue pratique : les actes de la volonté ne sont accessibles qu’au point de vue pratique et, à ce niveau, il ne peut pas être question de connaissance. » (p. 162) Si tant est que je dois concevoir mon agir comme soumis à une loi, et me tenir pour engagé par lui, je ne peux pourtant m’en considérer l’auteur qu’à condition d’avoir une conscience spontanée de ma liberté, laquelle interdit de penser la possibilité de l’infraction.
« Dans les difficultés que soulève la transgression de la loi se cristallisent les apories d’une perspective dans laquelle il est exclu, d’un point de vue pratique, que nous nous méconnaissions. » (p. 164)
C’est en définitive le concept d’engagement qui paraît résumer le mieux la philosophie morale kantienne pour l’auteur et lui permet de répondre à l’accusation classique de formalisme, qu’il reprenait à partir d’une perspective rawlsienne au début de l’ouvrage. Pour Rawls, Il fallait établir une distinction entre les impératifs catégoriques particuliers, issus des normes particulières de la vie morale exprimés sous la forme de maximes, et la formule de l’impératif catégorique, définie comme la « formule générale censée délimiter ces règles particulières et qui comporte une procédure pour le faire » (p. 21, note 2). Pour l’auteur la forme de l’impératif catégorique ne constitue une réponse à la question de savoir quelles sont les normes de la vie morale qu’à condition de la considérer non seulement d’un point de vue fonctionnaliste, mais en la resituant dans la subjectivation particulière qu’elle induit, celle d’une incorporation de la moralité sous la forme d’un engagement qui précède toujours mon agir, de la même manière que mon corps physique précède le sujet connaissant. La force de cette interprétation est de ne pas faire reposer, de manière fichtéenne, la moralité sur une contradiction entre le Moi et le non-Moi sous les traits d’une résistance du monde à mon agir mais de situer la moralité en amont même de tout agir possible, comme une donnée pratique inconditionnelle : l’engagement est alors l’autre nom de la liberté.
Conclusion
Loin de reproduire les interprétations classiques trop souvent répétées d’un kantisme scolaire, l’auteur s’engage dans une discussion précise des aspects les plus difficiles de la philosophie critique dès lors qu’elle se veut pratique. Définir les conditions de possibilité de l’éthique, c’est non pas s’interroger sur notre capacité à faire le bien, mais sur la possibilité de la morale en général. C’est depuis la définition de ce principe abstrait de la moralité que peut se poser ensuite le problème de sa justification et de son applicabilité. L’étude précise de ce mouvement qui consiste à s’interdire tout recours à l’empiricité pour en identifier les conditions a priori conduit à des analyses précieuses sur le rôle et le statut de l’impératif hypothétique, sur l’irréductibilité stricto sensu des prescriptions morales à des propositions logiques, sur la cohérence de la seconde Critique avec les Fondements dans la « déduction de la liberté » (p. 133 sqq.) ou encore sur la confrontation avec Hume et Locke.
On ne peut toutefois s’empêcher de sentir chez l’auteur une certaine ambiguïté à l’égard de la philosophie pratique kantienne, bien qu’il se défende de la « réhabiliter » (p. 9). Il est parfois difficile de situer son propos, dans la mesure où les critiques du kantisme sont toujours présentées dans le cadre d’une interprétation qui prend les Fondements pour point de départ et rayonne ensuite dans l’œuvre kantienne et donnent lieu à des concessions plutôt qu’à des réfutations. De manière implicite, on comprend que ce qui motive la démarche de l’ouvrage est de tirer toutes les conséquences d’une conception autonome de l’éthique, qui fasse table rase de toute donnée de l’expérience, pour identifier un type de nécessité rationnelle immanente ; mais cette entreprise se heurte à la question de l’accès à l’autonomie à partir d’une situation initiale hétéronome. Comment le sujet moral est-il effectivement capable de se rendre autonome ? Ce problème comporte un versant empirique et génétique, qui ne peut pas trouver de réponse satisfaisante dans la simple définition d’un fondement de la morale, et est traitée chez Kant à partir de sa philosophie de l’éducation, laquelle demeure absente de l’ouvrage. Une conclusion explicite aurait permis à l’auteur de se positionner plus clairement : s’agit-il en définitive de circonscrire chez Kant la persistance d’un dualisme dans le développement de la disposition à la moralité, indépendamment de l’interrogation transcendantale sur les conditions de possibilité d’une éthique autonome, ou bien de conserver la nécessité rationnelle envisagée comme le fil directeur de sa philosophie pratique pour montrer sa cohérence avec la nécessité rationnelle qui définit la philosophie de la connaissance, au-delà de l’entreprise kantienne ? Il semblerait que l’auteur fasse les deux choix en même temps. En dépit de cette interrogation qui reste en suspens, l’ouvrage se signale par sa grande rigueur dans la lecture des Fondements de la métaphysique des mœurs et dans la mise en perspective de débats autour de la philosophie pratique kantienne dans la philosophie analytique (G. E. M. Anscombe, B. Williams, J. McDowell, S. Cavell) et continentale (D. Heinrich, S. Rödl) ; il se rend par là incontournable à tout lecteur kantien qui s’intéresse au problème de la justification des exigences éthiques.
[1] KpV, Ak V, 72.
[2] R. Ehrsam, Le problème du langage chez Kant, Paris, Vrin 2016.
[3] D. Heinrich, « Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft », in D. Heinrich W. Schulz, K.-H. Volkmann-Schluck (eds.), Die Gegenwart der Griechen im neuderen Denken. Festschrift für Hans-Georg Gadamer zum 60. Geburstag, Tübingen, Mohr, 1960.
[4] Une telle interrogation n’est pas sans rappeler le commentaire classique de Bernard Carnois (La cohérence de la doctrine kantienne de la liberté, Paris, Seuil, 1973).
[5] C’est également la difficulté principale que soulignent MM. André Charrak et Jocelyn Benoist au cours d’une table-ronde autour de l’ouvrage de l’auteur, organisée par M. Pierre Fasula, qui s’est tenue le 22 avril 2022 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La vidéoconférence est disponible en ligne à l’adresse suivante youtube.com/watch?v=9tl6fjwPJGA (lien consulté le 02/01/2023).
[6] Pour une étude récente de la notion de personnalité morale chez Kant, on pourra se reporter à A. Grandjean, « Personnalité morale et rationalité selon Kant », Archives de Philosophie, vol. 79, no. 2, 2016, pp. 387-399.
[7] Une autre voie d’interprétation aurait pu consister à prendre acte de ce dualisme à partir de la différence entre monde sensible et monde intelligible, en s’intéressant au concept kantien de « règne des fins », en commentant l’analyse développée par Ch. Koorsgaard dans Creating the kingdom of ends (Cambridge University Press, Cambridge, 1996) qui aurait pu server de contrepoint à l’interprétation de J. Rawls évoquée par l’auteur dans le premier chapitre (p. 21).