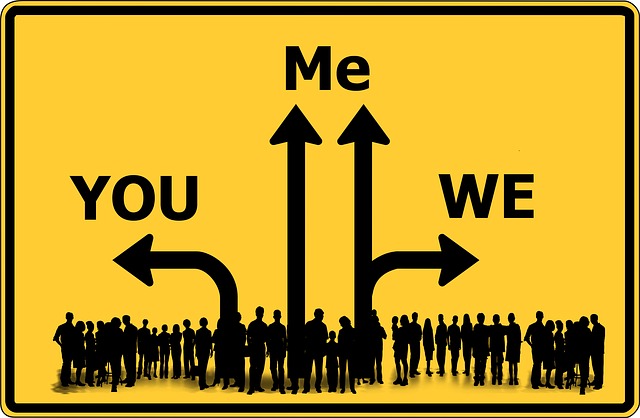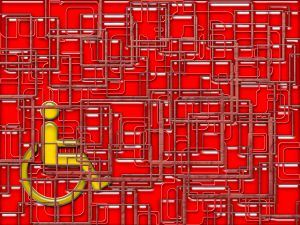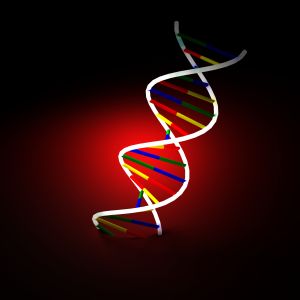Bioéthique, sciences, et philosophie
Textes réunis et présentés par Jennifer Merchant
Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II ; Membre du CERSA ; Membre de l’Institut universitaire de France
La bioéthique est débattue et institutionnalisée sous diverses formes dans presque tous les pays du monde depuis maintenant plus de quarante ans. Mais que signifie exactement le mot « bioéthique » ? Le terme a été prononcé pour la première fois en 1970 par Van Rensselaer Potter, oncologue à l’Université du Wisconsin, qui définissait la bioéthique de manière très générale comme « la science de la survie ».[1] Ce fut ensuite André Hellegers qui introduisit le terme « bioéthique » dans son usage contemporain. Pour Hellegers, il s’agissait de créer une éthique de la médecine et des sciences biologiques afin de construire un cadre d’action pouvant servir de guide aux praticiens.[2] Le premier article revendiquant la nature disciplinaire de la bioéthique fut publié en 1973 par Daniel Callahan, le fondateur du premier institut de bioéthique aux Etats-Unis, le Hastings Center, créé en 1969.[3]
Aucune autre discipline n’a connu un essor aussi rapide. D’abord aux Etats-Unis et ensuite dans certains États européens, la bioéthique est devenue une discipline universitaire à part entière, avec comme objectif d’analyser les retombées sociales et éthiques de l’innovation médicale et biologique. Puis en l’espace de quarante ans, la bioéthique est ensuite devenue la matière de d’institutions consultatives, administratives, et législatives locales, nationales et internationales. Les Etats-Unis furent le premier pays à créer un comité national d’éthique provisoire en 1977, mais c’est la France, s’appuyant fortement sur les avis de son Comité consultatif national permanent pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE, institué en 1983), qui fut le premier pays à se doter d’un cadre législatif touchant à l’ensemble des enjeux liés à l’application de la biogénétique (sauf l’euthanasie). Depuis, de comités en IRBs (Institutional Review Boards) en passant par nombre de lois et de traités internationaux, ce qui était à l’origine une discipline universitaire est devenue une « tour de Babel » institutionnalisée,[4] situation fâcheuse si l’on mesure la portée humaine et transnationale de l’ensemble des enjeux bioéthiques : recherches sur les sujets humains, recherches sur les embryons, procréation médicalement assistée, thérapie génique, suicide assisté, entre autres.
Pour comprendre cette évolution et mieux saisir le champ de la bioéthique, il nous faut des outils. L’analyse comparée entre les pays et leurs manières d’encadrer les retombées de la biogénétique pourrait en fournir, mais elle est encore balbutiante et parfois inexistante. Sans doute est-ce parce qu’elle nécessite une compréhension précise des traditions culturelle, politique, juridique, économique et sociale des pays étudiés. En outre, l’analyse comparée rencontre des obstacles spécifiques, notamment ceux qui sont liés aux choix méthodologiques.[5] C’est sans doute la raison pour laquelle ce type d’analyses se contente pour l’essentiel de souligner les différences entre les systèmes juridico/politiques. Or, le fait de décrire cette diversité ne suffit pas.
Au-delà de la simple juxtaposition des systèmes juridiques et politiques, un travail important reste à faire par l’ensemble des sciences sociales : philosophes, sociologues, anthropologues ont devant eux un terrain quasi-inexploré dans le domaine de la bioéthique comparée, et plus précisément en ce qui touche aux cheminements de son institutionnalisation. Une problématique parmi d’autres concerne l’analyse des concepts qui sous-tendent les rapports entre l’Etat et la société civile : pourquoi et comment, par exemple, la définition des droits individuels varie-t-elle d’un Etat à l’autre, oscillant entre la primauté du principe constitutionnel du « droit à la vie privée » aux Etats-Unis et le principe non moins prépondérant des droits de l’homme et du respect de l’intégrité physique et de la dignité humaine en France? De ces deux approches découlent des rapports totalement différents entre les individus et les pouvoirs publics qui décident dans le domaine de la bioéthique.
Ainsi, le fait de savoir qu’aux Etats-Unis le droit constitutionnel à la vie privée en matière de procréation protège la liberté des femmes à vendre leurs ovocytes ne nous apprend pas grand chose sur les réalités socio-économiques de ce type de commerce. Et alors que le choix a été fait en France d’inscrire le domaine de la bioéthique dans un encadrement national et centralisé, une approche qui évite certainement les disparités constatées aux Etats-Unis, les normes strictes qui sont imposées traduisent une certaine vision de ce que doit être la société française : accès limité à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels, imposition de l’anonymat en matière de don de gamètes, etc.
L’ambition de ce numéro de Implications philosophiques est de contribuer à ce vaste champ qu’est la bioéthique grâce aux contributions de sept chercheurs venant de disciplines diverses. Plusieurs sujets sont présentés et analysés : les notions de biopolitique et de biopouvoir (Judith Revel), la philosophie politique et le corps humain (Anne Brunon-Ernst), la bioéthique féministe (Donna Dickenson), les neurosciences et l’éthique (Hervé Chneiweiss), l’éthique clinique comme expérience de la démocratie (Véronique Fournier), ou encore la gestation pour autrui interrogée par la philosophie (un entretien croisé entre Delphine Lance et Bertrand Guillarme, les deux versions – audio et écrite – étant disponibles). Bien qu’abordant des enjeux divers, un thème central parcourt tous ces textes, celui du besoin d’un débat transversal, entre les disciplines et dans la sphère publique. C’est d’abord pour cette raison que les auteurs ont accepté de contribuer à ce numéro, et je les en remercie vivement.
[1] « L’objectif de la bioéthique… c’est d’aider l’humanité à atteindre une participation rationnelle mais précautionneuse dans le processus de l’évolution biologique et culturelle … Je choisis le terme de ‘bio’ pour signifier la connaissance biologique, la science des systèmes vivants, et je choisis ‘éthique’ pour signifier la connaissance des systèmes de valeurs humaines ». Van Rensselazer Potter, « Bioethics, The Science of Survival », Perspectives in Biological Medicine, vol. 14, 1970, p. 127-152.
[2] Hellegers fut également le fondateur du deuxième institut d’enseignement et de recherche en matière de bioéthique, le Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics à Georgetown University, désormais le Kennedy Institute. Voir Warren T. Reich, « The Word ‘Bioethics’ : Its Birth and the Legacies of Those Who Shaped Its Meaning, Kennedy Institute of Ethics Journal, vol. 5, 1995, p. 319-336 ; David Rothman, Strangers at the Bedside : A History of How Law and Bioethics Transformed Medical Decision Making, New York, Basic Books, 1991 ; Albert Jonsen, The Birth of Bioethics, New York, Oxford University Press, 1998.
[3] Daniel Callahan, « Bioethics as a Discipline », Hastings Center Studies, vol. 1, n. 1, 1973, p. 66-73.
[4] L’expression est de Hervé Chneiweiss (un des auteurs de ce numéro) et Jean-Yves Nau, Avis de tempête sur la bioéthique, Paris, Editions Alvik, novembre 2003.
[5] Parmi d’autres, voir Charles Ragin, The Comparative Model : Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies, Berkeley, University of California Press, 1987. Ruiping Fan, « Three Levels of Problems in Cross-Cultural Explorations of Bioethics: A Methodological Approach », dans Kazumasa Hoshino, ed., Japanese and Western Bioethics : Studies in Moral Diversity, Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 1997, p. 189-201.