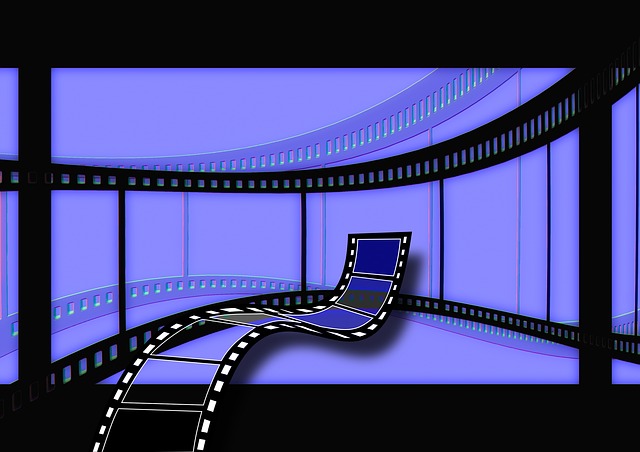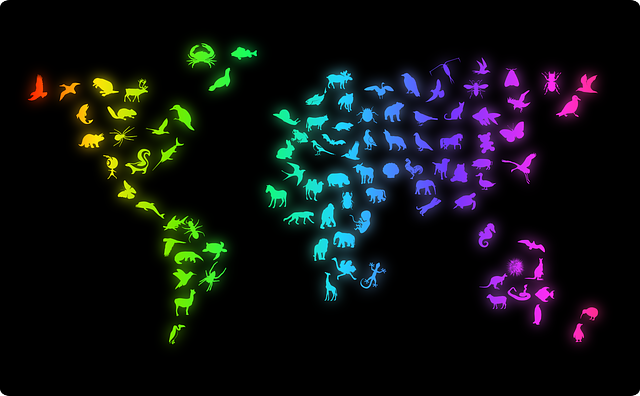Bergson et la causalité de l’exemple à la lumière des sciences sociales et biologiques : charisme, imitation, émotion (I)
Arnaud Bouaniche, Agrégé et docteur en philosophie, professeur en CPGE
Dans son dernier livre, Les Deux Sources de la morale et de la religion, qui paraît en 1932, Bergson fait dépendre la transformation morale de l’humanité de l’influence exercée dans l’histoire par certains individus exceptionnels (saints, sages, prophètes, etc.), à travers la seule vertu de leur exemple :
[…] pourquoi les grands hommes de bien ont-ils entraîné derrière eux des foules ? Ils ne demandent rien, et pourtant ils obtiennent. Ils n’ont pas besoin d’exhorter ; ils n’ont qu’à exister ; leur existence est un appel[1].
Mais quel statut faut-il accorder à cet « appel » ? Qu’en est-il de la nature de cette emprise des « grands hommes de bien » sur le reste de l’humanité ? L’enjeu d’une telle question est crucial. Il n’engage pas seulement la conception bergsonienne de la morale et de l’histoire. Nous voudrions montrer qu’il porte à l’état aigu, en quelque sorte, le problème des rapports entre science et métaphysique dans la pensée de Bergson.
On sait en effet que, dans toute son œuvre, ce dernier revendique de faire de la métaphysique une science empirique, capable d’aborder les grands problèmes de la philosophie sur le terrain des faits. C’est ainsi, par exemple, que le problème de l’union de l’âme et du corps est entièrement renouvelé dans Matière et mémoire (1896) à partir des données de la physiologie et de la psychopathologie de l’époque. À rebours de bien des contresens et des malentendus, l’intuition, véritable moteur de la démarche bergsonienne, n’a donc rien d’un contact inspiré et mystérieux avec les choses. Elle suppose une « longue camaraderie[2] » avec les faits, acquise à force d’observation et d’information scientifique, et Bergson considérait que « l’éclipse partielle de la métaphysique », qui sévissait selon lui depuis la moitié du XIXe siècle, et à laquelle il entendait riposter, trouvait son origine dans la difficulté éprouvée alors par la philosophie « à prendre contact avec une science devenue beaucoup plus éparpillée[3]. »
Or, une telle exigence de s’appuyer constamment sur la science, loin d’être abandonnée, est justement reconduite par Bergson dans Les Deux Sources, plus que jamais pourrait-on ajouter[4], à travers les sciences humaines et sociales, notamment la sociologie, l’ethnologie et l’histoire des religions, venues rejoindre la biologie qui était au cœur de son précédent livre, L’Évolution créatrice, parue en 1907, et ici constamment à l’arrière-plan des analyses. Mais à quelles données positives peut bien correspondre cet « appel » des grandes personnalités morales évoqué en commençant ? Dans un premier temps, ce sont bien le vague et l’obscurité qui paraissent l’emporter. Bergson distingue en effet, tel est l’objet du premier chapitre des Deux Sources, deux sortes de morales : l’une est appelée « close », qui consiste en un système d’habitudes prenant pour nous la forme de l’obligation, considérée comme l’équivalent, en l’homme, de l’instinct pour l’animal, et orientée vers la conservation de la société comme un organisme ; l’autre est qualifiée d’« ouverte », en ce sens qu’elle dépasse le cadre des devoirs imposés aux individus par chaque société, et s’adresse à toute l’humanité : dévouement, charité, générosité, respect, etc. Or, autant la première morale est, dans les analyses de Bergson, très largement éclairée par la sociologie et la biologie, autant les contours de la seconde restent plus flous, plus indéterminés, Bergson renvoyant le plus souvent à « quelque chose », à une certaine force d’attraction ou d’aspiration, qu’il qualifie de « plus ou moins irrésistible[5] ». S’agirait-il donc pour Bergson de renoncer, sur ce versant de l’analyse, à la « précision », exigence inventée par les sciences, et avec laquelle la philosophie se doit, selon lui, de renouer pour éviter de tomber dans l’arbitraire des constructions artificielles et des solutions verbales[6] ?
De fait, il semblerait que nous soyons conduits ici au-delà des données de la science, ainsi que le souligne de manière particulièrement explicite le passage d’une note rédigée par Bergson en marge de sa lecture d’un ouvrage d’Alfred Loisy, théologien catholique, très critique à l’égard des Deux Sources :
Cette obligation [celle qui prend la forme des devoirs imposés par la société] à mes yeux doit avoir sa racine dans la biologie. Elle a ensuite imprimé sa forme à quelque chose qui était plus que biologique et plus que sociologique[7].
Ce « quelque chose » se manifeste par ce que Bergson nomme, dans le passage cité en ouverture, un « appel ». Mais, dans le même temps où il « surgit » comme un écart ou une exception dans l’histoire, un miracle dans le cours de l’expérience, ce « quelque chose » se situerait, pour cette même raison, par-delà toute donnée ou explication, biologique ou sociologique.
Le but de cette étude sera de montrer qu’il n’en est rien, et que cette influence des grandes personnalités morales est au contraire envisagée par Bergson avec une grande précision, et qu’elle relève, au sens fort, d’une causalité, celle de l’exemple, susceptible d’être éclairée par des données positives, relevant aussi bien de la sociologie que de la biologie. Plus encore, en vertu de ce souci qu’elles manifestent d’enraciner constamment la métaphysique dans les faits, selon une logique fondamentalement ouverte, les thèses bergsoniennes pourraient bien trouver à s’articuler à des données scientifiques contemporaines, et retrouver par là une actualité. C’est ce que nous voudrions montrer brièvement sur un exemple précis, celui de la théorie dite des « neurones miroirs », découverte dans les années 1990, et qui, au croisement de la neurobiologie et des sciences sociales, trouverait dans Les Deux Sources, et par le biais de la question de l’imitation (que Bergson, comme nous le montrerons, partage en partie avec la sociologie de Gabriel Tarde), non pas des racines théoriques, mais un champ de questions qu’elle permettrait d’aborder sous une lumière nouvelle.
Du « prestige » au « charisme » : Bergson à la lumière de Max Weber
Le problème de ce que l’on pourrait nommer la « causalité exemplaire » dans l’histoire trouve son origine dans un étonnement de Bergson, celui-là même qui apparaît dans le passage que nous citions en commençant : « Pourquoi les grands hommes de bien ont-ils entraîné derrière eux des foules ? ». Dans cette question, le terme le plus important est peut-être le verbe « entraîner », qui revient de manière discrète, mais insistante, dans Les Deux Sources[8], ces hommes hors du commun y étant considérés à la lettre comme les « grands entraîneurs de l’humanité[9]. » Mais en quel sens faut-il entendre ce terme ?
A l’époque de Bergson, le verbe « entraîner » sert le plus souvent à désigner le processus par lequel un individu se trouve déterminé à agir en dehors de sa volonté consciente et réfléchie. Il est ainsi fréquemment utilisé dans la description des conduites passives, comme par exemple dans les recherches sur l’hypnose qui prolifèrent alors, notamment chez Binet, Bernheim ou Richet. C’est également dans cette perspective que Gustave Le Bon l’applique à l’histoire dans son essai sur la Psychologie des foules (1895) –à travers le mot « foules » Bergson y fait ici presque allusion – en attribuant aux ensembles collectifs un caractère de « suggestibilité », qui expliquerait selon lui la puissance et le prestige de ceux qu’il appelle des « meneurs » ou des « conducteurs » d’hommes.
Or, c’est un tout autre sens que Bergson confère à ce phénomène d’entraînement, sens qui ne peut être explicité qu’à la condition de se tourner vers L’Évolution créatrice, dont Les Deux sources constitue le prolongement direct. Le problème était alors justement celui de l’entraînement : il s’agissait de concevoir la vie sous les traits dynamiques d’une force envisagée sur le modèle psychologique de la volonté, « l’élan vital », s’efforçant de convertir l’inertie de la matière en mouvement, en un mot d’entraîner la matière. Mais, même si le troisième chapitre du livre clôturait, en une sorte de point d’orgue, sur cette « charge entraînante[10] » de l’espèce humaine qui représentait le mouvement le plus libre que la vie pouvait obtenir de la matière, il n’en demeurait pas moins qu’en créant l’humanité, la vie tendait à s’immobiliser, à se figer dans une « espèce » avant tout soucieuse de répéter des caractéristiques identiques. Les indications données par Bergson étaient alors nombreuses qui soulignaient l’impuissance et les limites de cet élan, son incapacité à se continuer, incapacité redoublée dans Les Deux Sources par la fragmentation de l’humanité en groupes ou « sociétés closes », repliées sur elles-mêmes, avant tout préoccupées à reconduire et reproduire un ordre le plus stable possible par la soumission de ses membres au fonctionnement du tout. Or, c’est cette tendance à l’inertie qui est vaincue par les grands hommes de bien :
la diversité des efforts [accomplis par ces grands hommes] se résumerait bien à quelque chose d’unique : un élan qui avait donné des sociétés closes parce qu’il ne pouvait plus entraîner la matière, mais que va ensuite chercher et reprendre, à défaut de l’espèce, telle ou telle individualité privilégiée. Cet élan se continue ainsi par l’intermédiaire de certains hommes […][11]
Le point essentiel est ici de saisir que ce retour de l’humanité au mouvement, autrement dit la possibilité même de l’histoire, prend sa source dans l’individu. Et précisément parce qu’ils revêtent un caractère exceptionnel, et qu’ils constituent un écart par rapport aux tendances naturelles qui définissent l’humanité, la présence et l’influence de ces grands hommes semblent relever, on le voit, d’un régime d’explication autre que celui des sciences. S’agit-il ici d’une perspective purement métaphysique, seulement cosmologique ou encore cosmopolitique, Bergson paraissant ici renverser purement et simplement les rapports entre individu et espèce tels qu’ils sont envisagés par Kant dans sa philosophie de l’histoire[12] ? Rien n’est moins sûr, comme l’attesterait un passage crucial pour notre propos, issu du quatrième chapitre des Deux Sources, dans lequel Bergson n’hésite pas à situer sa thèse sur le terrain de l’histoire, mais comprise cette fois comme science :
Nous ne croyons pas à l’inconscient en histoire : les grands courants souterrains de pensée, dont on a tant parlé, sont dus à ce que des masses d’hommes ont été entraînées par un ou plusieurs d’entre eux[13].
Le ton ne trompe pas : il s’agit bien pour Bergson de prendre ici position. Mais contre quoi, ou contre qui ? Replacée dans le contexte des sciences sociales de l’époque, l’expression « courants souterrains » renvoie sans doute à ce que l’on appelait alors les « forces profondes » ou « couches sous-jacentes » de l’histoire : tempéraments nationaux, mentalités collectives, traditions, etc., selon une perspective qui, sous l’impulsion de Lucien Febvre et de l’École des Annales, alors en plein essor, fut à l’origine d’un nouveau regard sur l’histoire, à distance de tout approche purement événementielle, et plus sensible aux structures ou infrastructures des grands ensembles collectifs : masses, sociétés, peuples, classes, etc. Mais à travers l’expression « l’inconscient en histoire », Bergson paraît renvoyer ici plus vraisemblablement à la vive polémique (ces courants souterrains « dont on a tant parlé ») qui opposa, une vingtaine d’années plus tôt, Émile Durkheim à Charles Seignobos, à l’occasion d’une discussion fameuse à la Société française de philosophie, le 28 mai 1908, autour de « l’inconnu et l’inconscient en histoire[14]. » Quel était alors l’objet de la polémique ? L’opposition entre Seignobos et Durkheim est radicale : le premier pose que les actes de la vie sociale proviennent d’individus pleinement conscients de leurs pensées et entièrement libres de leurs actes, tandis que, pour le second, la liberté n’est qu’une croyance, les individus étant, en dernière instance, conditionnés par des héritages matériels et mentaux pesant sur eux à leur insu. Il reste que Seignobos est lui aussi d’accord pour reconnaître une part d’inconscient dans la réalité sociale et historique, seulement il déclare cette part inconnaissable, l’intelligibilité historique maximale étant du côté des idées et des causes conscientes, raison pour laquelle ce que nous connaissons de l’histoire est finalement très peu de chose selon lui. Pour Durkheim, l’inconscient constitue un aspect considérable de la réalité sociale, mais loin d’être rejeté dans l’inconnaissable, il est l’objet même du sociologue. Or, Bergson ne nie pas ici l’existence de tels « courants souterrains », mais il soutient qu’ils ne constituent pas une réalité indépendante, ni ultime, ce qui leur donnerait une valeur de principe, mais qu’ils doivent eux-mêmes être expliqués. C’est un leitmotiv des Deux Sources qu’à l’origine de tout courant de pensée ou de sentiment, il y a (eu) un premier terme, autrement dit un individu, un créateur ou un initiateur, qui a été suivi[15], comme dans le cas du christianisme[16] ou dans celui de la justice des droits de l’homme[17].
Mais précisément, en invoquant ici l’individu contre la structure, Bergson ne donne-t-il pas congé à toute intelligibilité, à toute rationalité ? N’est-ce pas là céder à une vision romantique du grand homme, comparable à celle que l’on trouve dans l’ouvrage célère de Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (1841) ? Dans les mêmes années, et alors qu’il rapporte la création du peuple juif à la personne de Moïse, Freud formule, à l’endroit des grands hommes, une inquiétude qu’on pourrait opposer, dans les mêmes termes, à la démarche de Bergson :
Une telle hypothèse [selon laquelle « ce fut le seul homme Moïse qui a créé les Juifs »] ne constitue-t-elle pas une régression vers une manière de penser qui donna naissance aux mythes d’un créateur et à la vénération des héros, vers des temps où l’historiographie se réduisait aux actions et aux destinées de quelques individus, souverains et conquérants ? L’époque moderne tend au contraire à ramener les événements de l’histoire humaine à des facteurs plus cachés, généraux et impersonnels, à l’influence contraignante de conditions économiques, aux changements intervenus dans l’alimentation, aux progrès dans l’usage des matériaux et des outils, aux migrations dues à l’accroissement démographique et aux variations climatiques[18].
Valoriser le rôle de l’individu, ne serait-ce pas tourner le dos à la rigueur explicative, et sombrer dans une démarche qui relèverait bien plutôt de l’idéologie ou du mythe ? Pourtant, en rapportant ainsi cette puissance de transformation dans l’histoire à certains individus exceptionnels, de caractère sacré, de force héroïque et de valeur exemplaire, Bergson (sans le savoir !) retrouverait ici, sur le terrain même des sciences sociales, l’une des figures majeures de cette époque, Max Weber, et ce que celui-ci, presque au même moment, s’efforçait de théoriser, au croisement de la sociologie des religions et de la sociologie politique, sous le terme de « charisme[19]. » Par là, Weber entend un type d’autorité justement fondée sur la croyance dans les qualités extraordinaires d’une personne par là singularisée :
Nous appellerons charisme la qualité extraordinaire […] d’un personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessible au commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé de Dieu ou comme un exemple, et en conséquence comme un « chef.[20] »
Il y aurait bien sûr des divergences irréductibles entre ces deux perspectives dont la finalité, la méthode et les préoccupations sont absolument hétérogènes. Mais même dans la tâche qui les rassemble, d’expliquer l’origine de cette force d’attraction exercée par certains individus sur les autres, Weber et Bergson se distingueraient encore sur bien des points, à commencer par l’absence, chez ce dernier, de toute problématisation de cette influence en termes de « domination » ou d’« autorité », celles-ci étant rabattues par Bergson du côté de la « morale close » dont le régime ordinaire est celui de l’obéissance. En outre, si Bergson n’ignore pas l’influence du chef, si décisive chez Weber, celle-ci ne s’explique pas par une demande d’extra-quotidien, ou par une quelconque prédisposition à la vénération de l’« absolument nouveau », mais par une habitude d’obéir qui est, chez l’homme, l’équivalent de l’instinct chez l’animal. Cette habitude d’obéir coexiste d’ailleurs, selon Bergson, avec la tendance à commander, de sorte que, bien loin d’être rare ou exceptionnel comme chez Weber, le chef sommeille à l’état virtuel en chacun de nous, ainsi que l’atteste, d’après Bergson, le fait qu’« en temps de révolution », « des citoyens modestes, humbles et obéissants jusqu’alors se réveillent un matin avec la prétention d’être des conducteurs d’homme[21]. » Ce fait s’articule à un constat supplémentaire qui alimente un certain pessimisme bergsonien : comme il n’y a pas d’équilibre entre les deux tendances, et que nous sommes davantage faits pour obéir que pour commander, c’est le « chef manqué » qui advient plus souvent que le « grand homme d’action[22] »… Par cette mise à distance du chef et des grandes personnalités morales, on le voit, nous sommes bien loin chez Bergson de cette neutralité axiologique prônée par Weber, selon laquelle il s’agit de décrire sans juger, puisque l’appel du grand homme s’accompagne toujours chez lui d’un critère éthique, d’une normativité immanente, l’ouvert, qui fait des grands hommes nécessairement des grands hommes de bien.
Il reste pourtant que Bergson et Weber voient dans le prestige[23] dont sont porteurs certains individus (et par excellence ceux qui sont envoyés par Dieu !), une puissance novatrice ou rénovatrice, dont le point de départ est à chaque fois un « appel », capable de révolutionner les hommes de l’intérieur, selon un mode d’adhésion absolument irréductible à l’obligation impliquée dans l’obéissance impersonnelle à la tradition, aux institutions, aux lois ou aux règles. Comme Weber, Bergson souligne la rupture que constitue le surgissement de cet appel par rapport à l’attitude morale ordinaire. Il en présente cependant le contenu comme un élément ou un type « pur », qui tend par la suite à se résorber ou à se fondre dans des formes mixtes lorsqu’il s’actualise dans l’histoire. Bergson ne cesse d’insister sur le fait que la morale ouverte (celle qui donne à l’autre une valeur absolue) ne prend corps qu’en empruntant aux formes habituelles de l’ordre social. Ce point est remarquable dans le cadre d’un rapprochement avec Weber : Bergson souligne, tout autant que le sociologue, la nécessité d’une infiltration du prestige dans la forme permanente de la vie sociale, selon un processus de « quotidianisation » ou de « routinisation[24] », qui pallie le caractère intermittent de l’élément mystique ou charismatique, finalement très volatile, toujours menacé de s’épuiser ou de s’éteindre avec la disparition de son porteur. Bergson recourt à la métaphore de la retombée du feu en cendre, pour souligner combien l’appel des grands hommes possède une force d’attraction et de mobilisation, émotionnelle comme chez Weber, dont l’intensité est forcément vouée à décliner, puisqu’elle dépend de la présence en chair et en os de celui qui en est l’origine, ce à quoi les exigences sociales permettent de remédier en conférant à l’événement mystique ou charismatique, une durée, fondée sur le caractère immémorial de leur influence :
Justement parce que nous nous trouvons devant la cendre d’une émotion éteinte, et que la puissance propulsive de cette émotion venait du feu qu’elle portait en elle, les formules qui sont restées seraient généralement incapables d’ébranler notre volonté si les formules plus anciennes, exprimant des exigences fondamentales de la vie sociale, ne leur communiquaient par contagion quelque chose de leur caractère obligatoire[25].
Ce qui revient à dire que l’élément ou l’événement novateur, charismatique ou mystique, ne pourrait pas persister au-delà de son surgissement, se conserver, s’il ne rentrait dans le quotidien, par l’intermédiaire de la tradition ou de la loi. C’est une thèse plusieurs fois réaffirmée dans Les Deux Sources, mais qui n’en devient que plus saillante à la faveur de ce rapprochement avec l’œuvre de Weber, rapprochement grâce auquel on aperçoit toute la complexité et les nuances de la conception bergsonienne de la « morale ouverte », qui n’en reste donc pas à un vague pathos de l’appel capable de produire instantanément la conversion morale de l’humanité. Bien au contraire, Bergson se montre très sensible aux médiations qui rendent possible un processus d’infiltration de cet appel dans des formes institutionnelles, ou légales, en lui fournissant un canal de propagation, dont la généalogie révèle qu’il a finalement toujours sa source dans un individu d’exception.
[1] Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion [cité DS par la suite], éd. Frédéric Keck et Ghislain Waterlot, Paris, Puf, coll. « Quadrige », 2008, p. 30.
[2] Henri Bergson, « Introduction à la métaphysique », in La Pensée et le mouvant, Paris, Puf, coll. « Quadrige », 2009, p. 226.
[3] Ibid.
[4] Si vingt-cinq années séparent L’Évolution créatrice des Deux Sources, ce n’est pas seulement en raison des sollicitations extrêmement nombreuses (notamment diplomatiques lors de la Grande Guerre), dont Bergson fut l’objet dans le sillage de son chef-d’œuvre de 1907 et de la gloire qui s’ensuivit, mais aussi, et d’abord, en raison de l’étendue extraordinaire de la littérature que celui-ci a dû assimiler en sciences humaines pour aborder les questions de la morale et de la religion.
[5] DS, p. 98.
[6] Voir l’incipit célèbre de La Pensée et le mouvant : « Ce qui a le plus manqué à la philosophie, c’est la précision ».
[7] Voir « Une mise au point de Bergson sur Les Deux Sources de la morale et de la religion », présenté et commenté par Camille de Belloy, in Annales bergsoniennes I : Bergson dans le siècle, Paris, Puf, coll. « Epiméthée », 2002, note 2, p. 133-134, nous soulignons.
[8] On compte dans Les Deux Sources vingt-trois occurrences de ce verbe.
[9] DS, p. 55.
[10] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Paris, Puf, coll. « Quadrige », 2007, p. 271.
[11] DS, p. 285.
[12] Voir Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, prop. 1 et 2 (Ak. VIII, p. 18, Œuvres philosophiques II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliohèque de la Pléiade, 1980, p. 189), où Kant pose que seule l’espèce accomplit pleinement les fins naturelles et culturelles de l’humanité. L’idéal de l’espèce étant trop grand pour lui, l’individu, frappé d’une indépassable finitude, reste coupé de la destination de l’humanité. Or, tandis que Kant affirme que l’espèce peut ce que l’individu ne peut pas, chez Bergson, à l’inverse, c’est l’individu qui peut ce que l’espèce ne peut pas. De Kant à Bergson, tout se passe donc comme si la finitude et la négativité refluaient de l’individu vers l’espèce.
[13] DS, p. 328, nous soulignons.
[14] Voir Charles Seignobos, « L’inconnu et l’inconscient en histoire », in Bulletin de la Société française de philosophie (8), 1908, p. 217-247. On peut ajouter que Bergson prenait régulièrement part à ces discussions, qu’il lui arrivait d’ailleurs de présider, comme c’est le cas pour la séance du 25 novembre 1909, qui tournait elle-même autour de la notion d’inconscient, à l’occasion de la présentation de l’ouvrage de Georges Dwelshawers, L’inconscient dans la vie mentale.
[15] Quand Bergson affirme, dans le passage que nous citons, que les « masses » ont été entraînées par « un ou plusieurs » hommes, « plusieurs » doit être pris en un sens distributif : il désigne non pas un collectif, mais la succession d’initiatives, à chaque fois individuelles, qui explique un changement dans la société, ou dans l’humanité, en vertu du principe selon lequel « l’inertie de l’humanité n’a jamais cédé qu’à la poussée du génie » (DS, p. 179).
[16] Sur ce point, voir le célèbre passage du troisième chapitre : « Il faut pourtant bien qu’il y ait eu un commencement. Par le fait, à l’origine du christianisme il y a le Christ » (DS, p. 254).
[17] Sur l’origine de la « justice absolue » des droits de l’homme, voir DS, p. 76-77.
[18] Sigmund Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, trad. C. Heim, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1986, p. 204.
[19] Voir Max Weber, Économie et société, t. 1, « Les catégories de la sociologie », trad. Jacques Chavy et Éric de Dampierre (dir.), Paris, Pocket, 1995, notamment chap. III, section 4, §10 : « La domination charismatique ». Sur le charisme chez Max Weber, voir les « Leçons wébériennes sur la science et la propagande », d’Isabelle Kalinowski dans Max Weber, La Science, profession et vocation, Marseille, Agone, 2005, p. 117 et s.
[20] Max Weber, Économie et société, op. cit., p. 320.
[21] DS, p. 349.
[22] Ibid.
[23] Bergson utilise cette notion de « prestige » à propos de Socrate, voir DS, p. 61.
[24] Sur cette question, voir la très stimulante étude d’Étienne Balibar, « La ‘‘quotidianisation du charisme’’ selon Max Weber », consultable sur le site de Pierre Macherey « La philosophie au sens large », à l’adresse : http://stl.recherche.univlille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20042005/balibarcharismecadreprincipal.html
[25] DS, p. 47.