Avant-Propos – Echarpés au Titan

Il nous faudrait une bonne crise.
« « Ni fait, ni à faire » était l’exclamation traditionnelle des patronnes bourgeoises devant un travail insatisfaisant de leur bonne. « Fait et à faire » pourrait être le sous-titre de tout écrit philosophique digne de ce nom.« [1] La subversion commence d’un rien.
Il nous faudrait une bonne crise.
« Aujourd’hui ce qui domine, c’est la résignation; même chez les représentants du libéralisme. … Voilà ce qu’il y a derrière cet épuisement idéologique et on n’en sortira que si vraiment il y a une résurgence d’une critique puissante du système. Et une renaissance de l’activité des gens, d’une participation des gens.« [2] C’est à nous qu’il la faudrait, et pas à « eux », aux « jeunes », aux « vieux », aux « traders », aux « capitalistes », aux « gauchistes ». Critique radicale et activité politique: la subversion se paie de beaucoup.
Il nous faudrait une bonne crise.
« Il y a un lien intrinsèque entre cette espèce de nullité de la politique, ce devenir nul de la politique et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie ou dans la littérature. C’est cela l’esprit du temps. Tout conspire à étendre l’insignifiance.« [3] Et encore faudrait-il qu’elle soit bonne. Encore faudrait-il qu’elle soit critique. Et voici qu’à nous débattre nous craignons que l’entreprise de dévoration par la non pensée que l’on dira néo-libérale soit parvenue à un stade si avancé qu’il nous deviendrait impossible d’y encore rien faire contre. La subversion ne paie guère.
Mais la Crise – nous y sommes !
2011: Fukushima, le « printemps arabe », la dégradation de la note de crédit des Etats-Unis, le Président et ses affaires, le Parti Socialiste et ses primaires, le capitalisme qui partout boit la tasse – c’est la Crise! Et assurément, derrière tous ces renoncements cognitifs, ces incapacités ontologiques, ces ratages politiques, on renifle l’odeur aigrelette du même réel.
Que ce soit une crise pour les patronnes bourgeoises, cela va sans dire. Que ce soit un cataclysme pour des millions d’humains, et que ce vent pestilentiel ne donne pas l’impression de vouloir retomber, à l’évidence. Qu’au sens de la théorie des systèmes on assiste à une crise dite justement systémique de la machine capitaliste dans sa version de haut vol financier, qui pourrait en douter ? Mais rien n’est moins sûr, quant à nos sociétés. De krisis, guère : qui est le malade, comment en est mesurée la fièvre, quel est donc le pharmakon qui le sauvera ou bien l’achèvera ?
Une apocalypse, alors, peut-être, et c’est à craindre. Au sens étymologique et sartrien, apokalyptô : nous est révélé le système et, éberlués, ébahis, nous en contemplons les rouages, en dénombrons les fêlures, et ne faisons rien. Car nous ne faisons rien: voilà ce qui est à craindre – que l’insignifiance soit telle qu’alors même que la société crie qu’elle cherche à s’auto-instituer nous soyons devenus si peu autonomes que toute action ou réflexion instituante ait fui quelques encablées au-delà de nos capacités préhensives. Nous savons que la politique a été possible, nous voyons, si près, cette possibilité de la politique, pourtant la politique nous est impossible.
En un sens, rien de bien nouveau. Thucydide: « Il faut choisir: se reposer ou être libre. » Nous qui voulons choisir, et qui voulons choisir la liberté, nous tournons alors vers les survivants des heures glorieuses. L’insignifiance est si prégnante qu’il est impossible de la supporter, et, tant qu’à faire de recommencer à signifier, autant signifier (cor)rectement. Or, « la pensée critique d’hier est devenue l’alibi d’une pensée acritique ou plutôt anti-critique, la simple célébration du nouveau monde et du confort qu’il garantit à ses clercs.« [4] Alors, revenir aux textes? Mais est-ce seulement à les avoir trop lus déformés qu’il faut attribuer la défiance dont on fait preuve aujourd’hui envers eux? C’est qu’en compulsant Deleuze ou Foucault on n’entend pas seulement, au loin, la voix puissante de la critique: on les voit, bien plus proches, coller, toujours à une homologie prêt, au plus « cruel » de notre actualité.
Sourd une crainte chaque jour renouvelée: que le ver fût déjà dans le fruit. Et, à tout bien considérer, on se prend à douter: est-ce donc que mai 68 fut une brêche, ou bien un coin trop enfoncé dans la « décence ordinaire »? Ou bien les deux: motif de l’imaginaire second. Un « retour à Castoriadis » alors? Mais d’où reviendrions-nous? Du petit groupe d’hérétiques « d’ultra-gauche » qui ne devait connaître de gloire que posthume et ambivalente, alors qu’en était repris la critique anti-totalitaire et oublié tout le reste, y compris – et surtout – ce qui faisait le socle et l’effectivité de cette critique? Du philosophe accepté, jamais véritablement commenté[5], qui enseigna et peaufina quelque chose comme un système – terme passé de mode – ouvert – bien autre chose que cybernétique ou réticulaire –, dont les idées-mères, création, imaginaire, imagination, ne peuvent résoner qu’à travers des décennies d’utilisation fallacieuse, et qui prétendait, suprême outrage, avoir mis au jour quelque chose que deux mille cinq cents ans de philosophie s’étaient évertués à occulter?
Une assurance: nous venons du choix manqué entre socialisme et barbarie, et notre destination n’est pas différente de celle de nos prédécesseurs, d’abord de ceux qui durent cesser d’être marxistes, pour rester révolutionnaires. Socialisme ou barbarie. Nous ne saurions y échapper – en ce cas, autant faire valoir nos raisons auprès de ceux de nos contemporains et camarades qui dévoient vers le négrisme, les resucées spinozistes ou l’une quelconque des formes du born again again althussérisme, Althusser ayant eu le bon goût de former une génération de penseurs non seulement puissants, mais qui plus est vivants à la bonne heure (Badiou, Rancière, Balibar, Bidet…).
« On a raison de se révolter » contre ceux-là aussi: si « Nous pensons sérieusement que l’oeuvre de Castoriadis se tient au niveau de celles d’Aristote, de Hegel ou de Marx« [6], il nous faut aujourd’hui la faire nôtre. La triturer, la décomposer, l’ensidiser, en tirer des conclusions qui lui auraient déplu, pour lui faire honneur; nous engueuler, nous entre-déchirer, nous réconcilier à chaudes larmes, en incendier les temples et lui bâtir des chapelles, pour la faire vivre. Les Semaines Castoriadis d’Implications philosophiques n’ont pas d’autre objet, pas d’autre ambition: faîtes frémir vos colères et vos amours, étalez vos détestations et vos épiphanies. Profitons de ce que le cadre ne soit pas strictement universitaire pour oser. Soyons Brutus ou Erostrate – il ne nous plaît pas qu’on L’oublie! Et entonner peut-être, victoire à la Pyrrhus, « Il est mort, l’ami Castoriadis / Mais son nom reste vivant »[7].
Car Castoriadis est mort. Le monde qu’a connu Castoriadis se meurt – Castoriadis l’a certes connu mourant, mais la gangrène a fait d’encore beaux progrès. Nous ne pouvons nous contenter de susurrer à nos concitoyens, en malins génies qu’assurément alors nous serions, qu’il suffit de lire Castoriadis. D’abord, trop prosaïquement, la stratégie paraît intenable, considérant l’appareil qui nous enserre, politiquement, médiatiquement, universitairement – pour désagréable qu’est l’opération, il nous est commandé, aujourd’hui plus que jamais, de produire et d’être « efficaces ». Fallace, et fallace performative, mais qui se trouve aussi être ce dont nous manquons: il nous faut plus de lectures « castoriadiennes » ou « castoridiennes ». L’actualité éditoriale nous récompense enfin d’années de disette intellectuelle: Castoriadis est à l’honneur de plusieurs livres. Mais cet honneur reste ambigu: il faut encore tant le présenter, le découvrir et le faire découvrir, commencer à assurer les points en attente d’explication, que la critique ne dépasse jamais le moment du « négatif ». A nous, ici par exemple, de tracer les fronts, de mener les batailles, de préciser les intuitions, de réviser les impasses.
C’est qu’il y a beaucoup à dire, beaucoup que nous ne comprenons pas, et beaucoup sur quoi nous ne nous entendrons pas. Mais alors, pourquoi tergiversons-nous? Nous ne réservons pas tant d’égards à d’autres Grands, et nous révoltons contre eux, à tort ou à raison. A quoi tient cette sidération qui nous saisit devant Castoriadis? A l’étendue des domaines qu’il a conquis, et soumis, à la diversité des connaissances requises pour effleurer ses multiples jugements, dont il n’est pas évident qu’on puisse encore les acquérir « à jour », à la grandeur et à la hauteur de ses vues, dont l’on ne voit plus trop comment on pourrait les amender, sans se mettre en porte-à-faux avec ceci, sans enfreindre cela, à sa verve et à son verbe aussi[8]. Nous nous retirons de nos entreprises critiques, de peur d’être mis face à un dilemme auquel nous ne pourrions survivre: tout à fait pour, ou tout à fait contre Castoriadis.
L’oeuvre castoridienne est comme un diamant : par quelque facette qu’on l’aborde, tout s’y tient de manière cristalline ; d’où qu’on le regarde, les autres entrées s’aperçoivent; que l’on s’approche, et alors on ne sait plus trop : est-ce sa gangue qui gêne notre perception, et faut-il l’en dégainer au risque qu’il s’effrite définitivement, ou bien est-ce une inclusion, ou une faille en ses tréfonds, qui nous attire et nous abhorre, comme un trou noir? Et nous ne savons plus: est-ce l’anéantissement qui nous menace, ou bien la forte promesse de l’autonomie qui enfin dévoile son mollet? Un trou noir dont nous constituons le disque d’accrétion – une fenêtre sur le Chaos, mais à tout prendre « l’affect de la fin du désir » n’est pas nécessairement le plus productif en philosophie, et assurément le moins transmissible.
La belle épitaphe fournie par Edgar Morin, Castoriadis « Titan de la pensée« , s’avérerait par trop: Castoriadis dévorant ses enfants. Le risque est là. Mais il a toujours été – et c’est justement la marque de l’autonomie que de nous dessiller. Nous ne pouvons plus détourner le regard: la pierre est dans notre jardin. A nous de décider si nous tentons de l’enfouir sous des tombereaux de ronces, ou si nous réaménageons notre jardin à la mode zen pour qu’elle en soit le centre vital. Et sur cette pierre, peut-être…
« Nous ne philosophons pas – nous ne nous occupons pas d’ontologie – pour sauver la révolution, mais pour sauver notre pensée, et notre cohérence.« [9]
Face à cette maxime – à cet impératif! – nous n’avons d’autre choix que la fidélité absolue.
Yann Guillouche – Paris IV – Sorbonne
[1] Cornelius Castoriadis, Fait et à faire. Les carrefours du labyrinthe 5, Seuil, 1997, p.7
[2] C. Castoriadis, Post-scriptum sur l’insignifiance. Entretien avec Daniel Mermet, Editions de l’Aube, 1998; Voir en ligne http://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/CASTORIADIS/10826
[3] Id.
[4] Pascal Michon, Les rythmes du politique. Démocratie et capitalisme mondialisé, Les Prairies Ordinaires, 2007, p.9
[5] A au moins une exception qu’il convient de souligner: Vincent Descombes.
[6] Arnaud Tomès, Philippe Caumières, Cornelius Castoriadis. Réinventer la politique après Marx, PUF, « Fondements de la politique », 2011, p.268 n.3
[7] Paraphrase de « Fleur ceuillie… », qui pleure un autre éminent personnage: « Ah quel regret! (bis) / Le pays va vers les cîmes / Mais Lénine n’est plus là »
[8] Qui peut encore aborder Hayek avec sérieux, après avoir lu le compte-rendu que fit Castoriadis des thèses d’icelui: « Les licornes existent, donc l’univers est fait de gelée de coings« ?
[9] C. Castoriadis, Fait et à faire, op. cit., p.10








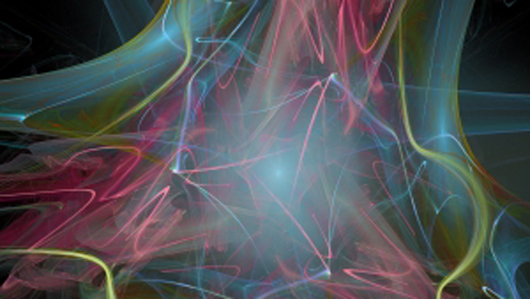




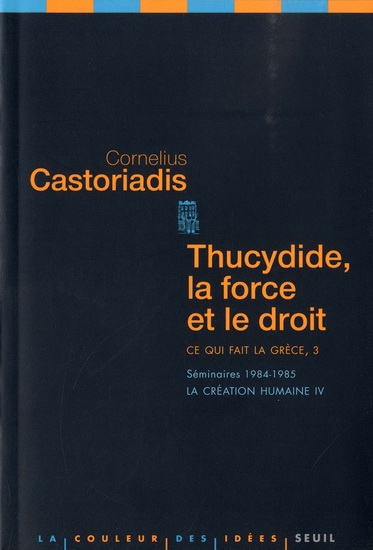

Merci pour ce magnifique texte, qui a pour caractéristique centrale – comme pour tous les textes de cet acabit – de formuler quelque chose que l’on ressent ou intuitionne, sans parvenir à l’expliciter convenablement. Dans l’esprit de cette fidélité, il faut rendre un immense hommage aux travaux faits par le groupe des Cahiers Castoriadis, autour de S. Klimis, L. Van Eynde et P. Caumières, qui depuis des années, malgré les difficultés, fait vivre cette pensée exigeante et salutaire. Puissent vos « semaines Castoriadis » participer de l’éclosion de ces germes.