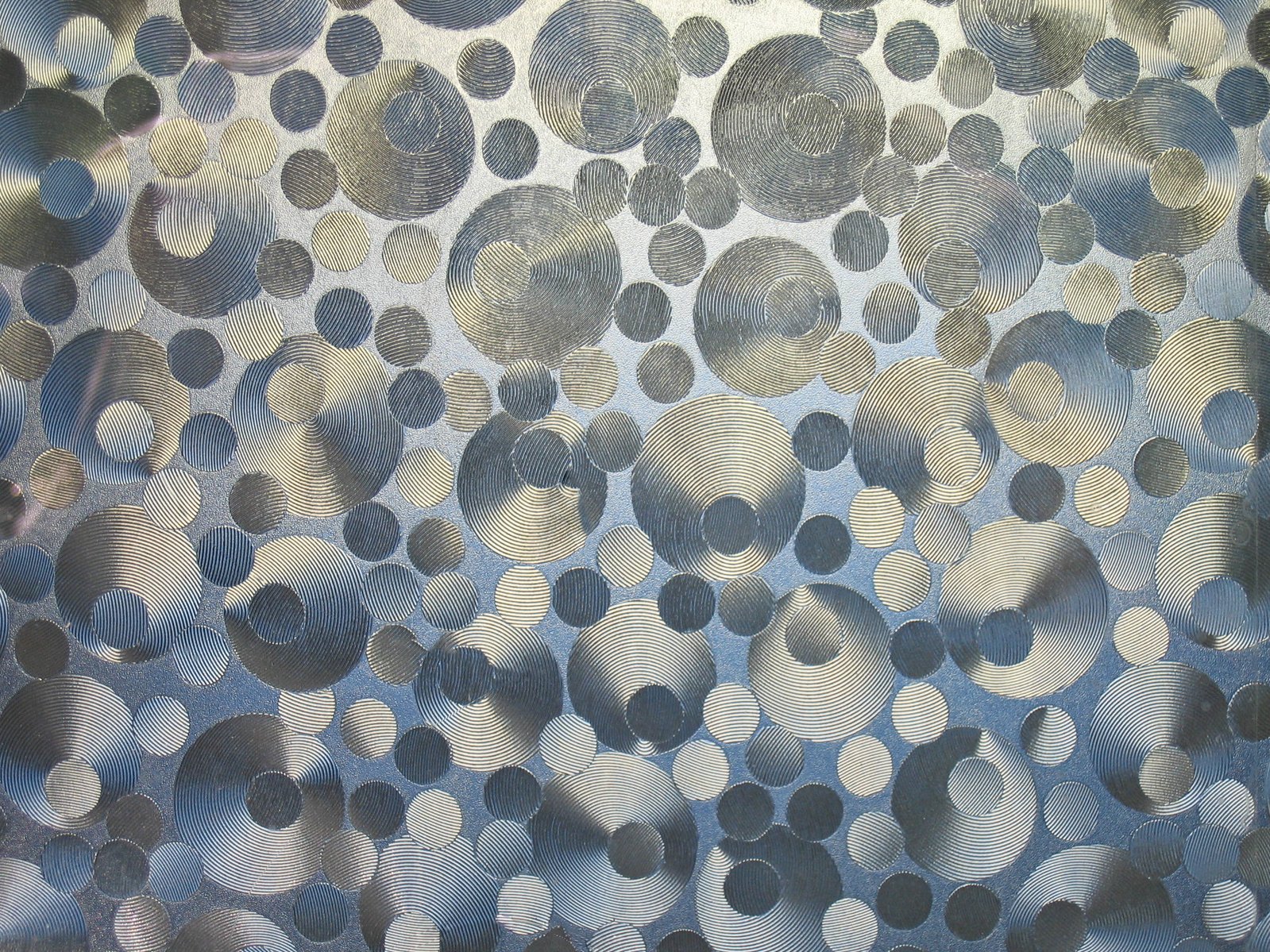Addiction et Séparation – Christine Leroy
Atelier : Addictions, Art et Écriture du corps
Christine Leroy – EsPAS – Paris 1
Introduction
Le terme d’addiction est mobilisé dans le registre médical, en particulier psychiatrique et psychanalytique, pour caractériser un certain type de pathologies autrefois répertoriées dans la catégorie des « dépendances ». En France, le terme d’addiction a été importé de l’anglais par Joyce McDougall[1] en 1978[2], afin de suppléer à un vide sémantique : on parlait jusqu’alors de toxicomanies. Or, il est possible de constater des dépendances sans substance, et c’est ce que fit la psychanalyste d’origine américaine : il s’avérait impératif de trouver un terme pour désigner des comportements, de type addiction sexuelle, anorexie/boulimie ou encore frénésie d’achat par exemple.
Joyce McDougall souligne que : « les objets addictifs échouent nécessairement dans le fait qu’ils sont des tentatives d’ordre somatique plutôt que psychologique pour faire face à l’absence ou la douleur mentale et ne fournissent qu’un soulagement temporaire à la souffrance psychique.[3] » Dans quelle mesure le geste artistique crée-t-il un corps psychique, et en est-il capable ?
Ma thèse sera ici que le geste artistique crée du corps visible ; il sépare de soi, il distancie. Ce faisant, la prise de recul vis-à-vis de sa production comme double de son corps propre permet à l’artiste de payer sa dette en faisant de son corps, visible par les spectateurs, une offrande poïétique. J’envisagerai donc ici l’hypothèse d’une création artistique comme palliatif à l’addiction, ce qui n’est qu’une manière de considérer le rapport de la création artistique à l’addiction. Mon point de vue sera alternatif à l’angle clinique, puisqu’il sera à la fois philosophique et esthétique.
Dans cet article en particulier, à titre de préfiguration d’un axe « Addiction et écriture du corps » au sein de la revue Implications Philosophiques, j’approfondirai la question de la séparation et notamment la problématique suivante : si l’addiction se révèle comme manque d’un corps suite à son aliénation consécutive à la dette, dans quelle mesure la création peut-elle pallier ce manque de corps et se substituer à l’addiction délétère en créant du corps-vécu et en comblant le vide de corps ?
Dans un premier temps, j’observerai, en m’appuyant sur la psychanalyse et la phénoménologie, la constitution progressive du corps psychique propre, de la fusion originaire (Melanie Klein) à la conscience du corps-vécu (Maurice Merleau-Ponty), en passant par les étapes transitionnelles décrites par Donald Woods Winnicott.
Dans un deuxième temps, j’étudierai le lien rompu et la sensation de manque de regard éprouvé et décrit par l’addict. J’associerai ce manque de définition spectrale du corps au manque de mots posés sur le corps, et commencerai à poser une équivalence entre le regard qui voit et le mot-concept qui définit. Je mobiliserai en particulier la notion de « nom/non du père » élaborée par Jacques Lacan, et poserai le mot/le nom donné à celui qui est vu comme outil de séparation et, dans le même temps, d’élaboration d’un corps autonome. J’émettrai alors l’hypothèse d’un manque d’oralité narcissique de la part de l’addict, tout en posant quelques réserves : peut-être le mot est-il un outil défaillant à définir le corps propre, dans la mesure où il relève du concept, du symbole, de l’à-côté là où l’addict recherche un surcroît affectif. En d’autres termes, le mot renvoie à la raison, or l’addict a plutôt besoin de nourritures inconscientes.
Dans un dernier temps, je poserai la pratique créatrice artistique comme oralité expressive suppléant au manque de regard délimitant et définissant le corps psychique propre. J’ajouterai que la spécificité de la pratique artistique réside dans son impulsion affective émotionnelle, pour ainsi dire « centripète », tandis que le raisonnement conceptuel est centrifuge. J’émettrai, à cet égard, la conviction d’une spécificité de l’écriture artistique, sensible et littéraire par rapport à l’écriture rationnelle et conceptuelle, laquelle échoue toujours à donner du corps à l’âme endettée.
Au préalable, il est nécessaire de considérer l’émergence et les définitions successives de l’addiction afin de mieux en saisir les enjeux éthiques, esthétiques et sociétaux.
I Définitions flottantes et problématiques émergentes : l’avenir d’une addiction.
1) L’addiction comme esclavage.
En anglais, le terme d’addiction est sous-tendu par son emploi, depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Age, pour désigner la « contrainte par corps » : était dit addictus celui ou celle qui, particulièrement endetté, n’avait plus d’autre option que de vendre son propre corps comme force de travail à un seigneur dont il devenait l’esclave. Ainsi, étymologiquement, le mot d’« addiction » désigne la « contrainte par corps », la dépendance vitale d’un maître qui a tout pouvoir sur l’individu, en particulier pouvoir de vie et de mort. Pendant longtemps, d’ailleurs, et toujours actuellement, le terme d’« addiction » a été alternativement employé avec celui de « dépendance » : ainsi, aujourd’hui, des groupes dits « de parole » rassemblent, par exemple, des « dépendants affectifs anonymes ». Mais la spécificité du terme d’addiction consiste dans le fait qu’il relève, aujourd’hui, du registre médical, quand celui de « dépendance » relève plutôt du registre anthropologique : nous naissons tous « dépendants », de nourritures physiologiques (air, aliments), affectives (parents) en premier lieu. Pour autant, quand bien même tout être humain est naturellement « dépendant », il serait excessif de considérer que chacun est « addict ». Il y a, de la dépendance à l’addiction, un changement d’échelle, une étape de franchie, du « normal » au « pathologique », du « vital » au « délétère ». Et c’est précisément ce qui vaut au terme de relever du champ médical, puisqu’il est associé à une forme de destruction identitaire : selon la plupart des thérapeutes, l’addict est tout entier dans l’objet de son addiction, au point que lorsque ce dernier lui « manque », il se ressentirait comme une béance totale, un contenant sans contenu.
2) Dépendance, addiction et enjeux éthiques.
Pourtant, le fait est qu’il existe des comportements et surtout des sentiments addictifs. Le DSM[4] V préfère d’ailleurs l’usage du terme d’addiction à celui de « dépendance », tout en opérant une distinction entre différentes catégories d’addictions : à une substance (toxicomanies, alcool, tabac, caféine…) ou bien à un comportement (jeu, internet, achats compulsifs, troubles du comportement alimentaire, addiction au sport ou « bigorexie », dépendances affectives, addiction sexuelle, dépendance au travail…). La nécessité de définir ces critères est associée au fait que ce type de pathologie est de plus en plus répandu et diversifié ; Aviel Goodman[5] les définit comme suit :
- Impossibilité de résister à l’impulsion de s’engager dans le comportement.
- Tension interne croissante avant d’engager le comportement.
- Plaisir ou soulagement au moment de l’action.
- Perte du contrôle.
- Autres critères de diagnostic :
– Préoccupations fréquentes pour le comportement.
– Engagement plus long ou plus intense que prévu.
– Efforts répétés pour réduire ou arrêter.
– Temps considérable passé à réaliser le comportement ou à se remettre de ses effets.
– Réduction et/ou dégradation des activités sociales, professionnelles, familiales, du fait du comportement.
– Perpétuation du comportement, bien que le sujet le sache délétère.
– Tolérance marquée et progressive, qui nécessite d’augmenter la fréquence du comportement ou les quantités absorbées.
6. Agitation ou irritabilité en cas d’impossibilité de s’adonner au comportement.
Ces critères décrivent adéquatement le phénomène addictif mais très vite, des questions d’ordre bioéthique surgissent, lesquelles dépassent de loin le champ descriptif. En particulier, la question du sentiment même de soi et de l’appartenance du corps. Même en cas de « contrainte par corps » et d’esclavage, le droit ne l’emporte pas sur le fait : l’esclave de l’Antiquité avait beau « appartenir » à son maître, lequel pouvait le battre si bon lui semblait, il n’en demeure pas moins que son corps propre ne pouvait, en dernière instance, se séparer de lui-même. Il y a une coïncidence du corps à l’identité, du moins pour ce qui relève du corps biologique naturel. Le sentiment d’aliénation ou de perte dans son objet, éprouvé par l’addict « en manque », son sentiment de plénitude lorsqu’il agit son comportement addictif, ne sont autres que des sentiments sans aucune réalité autre qu’éprouvée. Avec l’addiction, nous sommes dans le registre de la phénoménologie et du corps-vécu, bien plus que dans un registre positiviste. Nous sommes également dans le registre esthétique, puisqu’il s’agit de sensations, de bien-être ou de manque à être, c’est-à-dire d’affect. En cela, l’addiction relève bien plus de la psychanalyse que de la psychiatrie, puisqu’elle met en jeu l’affect et non pas, uniquement, la physiologie.
3) L’addiction : entre liberté et séparation.
Si l’addiction est bien, étymologiquement, la « contrainte par corps », au sens où le corps individuel devient possession d’autrui, alors il me semble que l’addiction peut s’opposer à la liberté, laquelle est définie dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme inaliénable. Il y a donc un paradoxe à supposer l’existence de l’addiction, comme le négatif de quelque chose qui n’admet aucun négatif.
Les termes auxquels l’addiction peut s’opposer sont donc certes, d’une part, celui de liberté puisque l’addiction renvoie à la servilité et la dépendance à l’égard d’un maître. Mais elle se distingue de la servilité en ceci qu’elle est une dépendance psychique plutôt que juridique ou physique : l’addiction est un sentiment avant tout, elle est dépendance d’un corps-vécu plutôt que dépendance d’un corps-chose. En cela, son étude sous l’angle phénoménologique m’apparaît comme essentielle pour sortir du champ clinique et de ses écueils – il est « reconnu » aujourd’hui que ni l’administration de psychotropes, ni la psychanalyse ne sont efficaces en termes de remédiation, faute peut-être de prendre en compte le corps-vécu. D’autre part, l’addiction s’oppose peut-être, davantage qu’à la liberté, à la « séparation ». À mes yeux, l’addiction est avant tout un lien-en-train-de-se-faire, elle se substitue à un lien à l’altérité ; en sorte que son contraire est l’absence de lien-se-faisant, il est rupture, séparation. Et en cela, tout particulièrement, l’addiction m’apparaît comme performance artistique : en effet, elle est un geste de création, celui d’un lien. L’addiction est création d’un corps comme lien, son effectuation donne au sujet un sentiment de complétude par le vide qu’elle remplit. C’est précisément en cela qu’il me semble capital d’établir une analogie entre addiction et geste créateur : par le comportement addictif, le sujet vise à créer un corps-vécu, en tant que ce dernier est lien au monde. Bien plus qu’une analogie, il me semble possible de voir une équivalence entre addiction et geste créateur : aussi délétère soit-elle, l’addiction est bien performance d’un corps-vécu, mode d’exister, d’ek-sistere – sortir du néant, se créer. Il me semble, en ce sens, possible de sortir du manichéisme qui vaut à l’addiction d’être incomprise, si l’on admet que les pratiques addictives n’ont pas pour fonction de détruire et ne répondent pas à une pulsion de mort, mais ont plutôt pour fonction de créer du soi, et répondent donc, quoique maladroitement, à une pulsion de vie.
Il importe de relever cette coïncidence entre addiction et corps-vécu d’une part, sous l’angle phénoménologique, et geste performatif artistique d’autre part, sous l’angle esthétique. L’enjeu majeur d’un tel questionnement me semble résider dans l’articulation entre addiction et séparation : le comportement addictif est l’agir d’un individu qui a besoin d’une entité extérieure à lui pour exister par soi, faire corps à titre individuel. Paradoxalement, donc, il se rend dépendant pour pouvoir être autonome, et la sensation de plénitude, quoiqu’éphémère, qu’il ressent, est celle d’être « enfin entier », existant par soi seul. En somme, il y a addiction par volonté et nécessité de séparation : l’addiction vise la séparation de corps, l’autonomie.
Le second enjeu est celui de l’articulation de l’addiction à la pratique artistique, et je m’appuierai essentiellement sur l’écriture comme geste esthétique : écrire, mettre des mots sur le vide, symboliser, a-t-il pour fonction de créer du corps manquant, et le geste d’écrire ou de se dire se substitue-t-il au comportement addictif ? Ou encore, au contraire, plutôt que de considérer le rapport de l’addiction à la création sous la forme de vases communicants, doit-on envisager un mouvement « de concert » entre pratique addictive et création, ce qui permet à certains écrivains de justifier leur alcoolisme, leur anorexie ou leur toxicomanie par le fait qu’ils leur sont nécessaires pour créer ?
Enfin, un dernier enjeu majeur nous renvoie à la problématique de la dette : si l’addiction est bien consécutive à une dette, et si donc le sentiment de « se manquer à soi-même » est associé à un devoir non rempli, ne peut-on penser que l’addiction échoue précisément parce qu’elle est impuissante à rembourser une dette qui se joue sur un autre terrain ? En ce cas, il est possible de voir dans l’acte créateur de l’artiste la production poïétique d’un corps qui tiendrait lieu de remboursement. En d’autres termes, le produit de la création artistique viendrait rembourser le corps. De très nombreuses questions en découlent : quelle est cette dette psychique ? Pourquoi et comment un corps-soma peut-il suppléer à une dette psychique, et cette absurdité ontologique n’est-elle pas à l’origine de l’échec nécessaire de l’addiction, dans sa tentative de compenser la dette psychique ? La création artistique n’est-elle pas, toujours, vouée à l’échec en tant que remboursement de la dette, autant que le corps addict, de sorte qu’il y aurait un basculement possible de l’artiste dans l’addiction à la pratique artistique elle-même ?
À travers ce foisonnement de questions surgit un champ de réflexion qui dépasse de très loin le registre médical et/ou psychanalytique. Il m’apparaît impératif de mobiliser le vocable et la méthodologie phénoménologique, ainsi qu’esthétique, afin de déployer la richesse d’une réflexion ouverte par le phénomène des addictions. À une époque où domine l’idéologie de la communication, laquelle prétend resserrer et démultiplier les « liens » sociaux, force est de constater au contraire la friabilité croissante de tels liens, laquelle va de pair avec une augmentation en flèche des fragilités narcissiques et du phénomène d’addiction. Étudier l’addiction, sous un angle phénoménologique et esthétique, permet de regarder sous un jour nouveau la notion de « lien » en posant la « séparation » et la distance comme conditions sine qua non de sa possibilité.
II. Avoir un corps, être un individu
Les travaux de Melanie Klein auprès de nourrissons ont permis à cette psychanalyste d’observer que le rapport à la mère – ou toute personne qui occupe la fonction maternelle – est constitutif du rapport ultérieur au monde et du vivre affectif sien. Je m’appuierai ici en particulier sur la façon dont Maurice Merleau-Ponty, phénoménologue du corps propre, a reçu et mobilisé les conclusions kleiniennes pour élaborer la phénoménologie de la « chair ». En outre, je puiserai chez M. Klein des outils théoriques qui élargiront la perspective merleau-pontienne.
1. Symbiose charnelle
D’après M. Klein, le destin du rapport entre l’individu et le monde qui l’environne se joue dans le rapport premier au sein maternel. Le nourrisson éprouve le sein comme une annexe de lui-même, tout comme la chair maternelle de laquelle il se nourrit. Cette symbiose sensitivo-affective avec le sein dont il se nourrit l’amène à éprouver comme « soi » tout ce qui l’affecte, et à l’introjecter comme tel. Cette relation symbiotique primitive modèle la façon dont l’individu conformera son rapport ultérieur au monde et à son propre corps. Le rapport premier à la mère modèle le « se rapporter » au monde et à soi-même.
« … les toutes premières relations de l’enfant, celles qui constituent son monde interne sont à l’origine de sa conception du monde comme formant un tout. Et cette conception à son tour détermine les relations sociales aussi bien que personnelles de l’âge adulte[6]. »
Ce que Melanie Klein désigne par « monde interne » renvoie donc au vivre de soi comme internalisation du lien au monde. Désirant – pulsion de vie – la nourriture maternelle, le nourrisson découvre progressivement que le sein-qui-nourrit ne répond pas systématiquement et immédiatement à ses vœux, constat qui le submerge et l’emplit de haine à l’égard d’une entité dont il est dépendant sur le plan vital. La pulsion par laquelle il tend vers le sein est donc tout autant pulsion de vie que de mort : il voudrait pouvoir détruire sa dépendance à l’égard de cette entité qui peut venir à manquer.
De cette permanente oscillation découle le désir qui est désir de fusion et qui perdure dans toute sexualité, autant que la mélancolie d’une dépendance : dans la fusion, ma subjectivité disparaît et c’est précisément la raison pour laquelle je dois fuir toute fusion, au risque d’être, par l’autre, « dévoré ». L’angoisse qui en résulte est comblée par le refoulement de la pulsion de mort ; d’après Melanie Klein, l’activité artistique n’est pas à proprement parler une « sublimation » du refoulé, mais plutôt l’expression du désir de réparation d’un lien par soi brisé, dans la pulsion de mort ; à cet égard, l’art lui apparaît « comme le reflet de nos relations avec autrui, avec la mère en premier lieu[7] ». Dans la pratique artistique, le sujet « fusionne » avec sa création, dans un espace-temps transitionnel ; ce faisant, il « répare » les déchirures jusqu’à éprouver une « complète union » et « l’effacement des frontières intérieures entre le Moi et l’objet [créé] incorporé[8] ».
2. Merleau-Ponty : le sein, le lien, la chair
L’interprétation merleau-pontienne de M. Klein en vient à poser le « se rapporter » à la mère comme « chair » : en d’autres termes la façon dont l’individu se vit comme corps ne fait pas que dépendre de la relation à la mère : il EST cette relation. Il y a bien, objectivement, deux corps ; mais en tant que sujet, le nourrisson construit sa conscience corporelle d’après la façon dont il se lie ou se sépare du monde qui l’environne, dans un lien qui est en même temps une séparation, un « entre » deux mondes. Le lien sépare, il circonscrit le corps qui progressivement se détache sur fond de monde. Merleau-Ponty reprend à Lacan l’image du ruban de Möbius pour élaborer une philosophie du chiasme : le corps, tel que le sujet le vit, épreuve charnelle, s’entrelace à l’épreuve du monde, sur le modèle de la symbiose avec le corps maternel décrite par Melanie Klein. Il y a une intersubjectivité charnelle, et la mère n’apparaît au nourrisson que comme un prolongement de lui-même. Cette relation chiasmatique apparaît dès la « fusion » intra-utérine : le vivre corporel de la mère s’entrelace à celui de l’enfant, par la médiation du placenta[9].
Le concept de « chair », employé par Merleau-Ponty, est sa traduction de l’allemand Leib : le corps vécu, employé par Husserl[10]. En latin, caro, carnis désigne ce qui se sépare, tout comme l’indique la racine indoeuropéenne –sker : l’usage du terme renvoie aux rituels sacrificiels, la chair étant ce qui se sépare des os. Par conséquent, la « chair » est aussi ce qui lie et fait la transition entre les os et l’enveloppe dermique. C’est un espace concrètement situé entre : entre le sujet et le monde. Par analogie, la chair est ce « liquide amniotique » qui environne le bébé avant la naissance, il est son cordon ombilical qui le relie au monde réel sensible ; espace transitionnel intersubjectif, la « chair » est un lieu situé « entre » deux mondes et permettant le passage d’un monde à l’autre ; espace qui permet de ressentir et de vivre, car c’est par mon incarnation que je peux entrer en contact avec le monde. En me séparant du monde, ma chair me relie au monde. Ma « chair » est un espace de « jeu » au sens propre du mot : espace de libre expérimentation du monde, espace sensible par définition.
De la subjectivité sensitive découle le caractère subjectif de la « chair ». C’est ce que j’ai de plus subjectif, puisque c’est en elle que je crée ma relation au monde, relation basée sur la perception que j’en ai ; ma « chair » détermine mes émotions, mes affects, mon ressenti propre du monde. Il ne s’agit pas là d’une métaphore, mais du sens concret du mot « chair » : la « viande » qui me constitue est la condition même de mon expérimentation du monde et de ma perception de celui-ci. C’est par ma chair que je m’individualise et, en quelque sorte, me « sépare » du monde ; c’est justement parce que ma « chair » est viande, c’est-à-dire intermédiaire entre ma subjectivité et le monde, que je peux entrer en contact avec le monde et le ressentir subjectivement.
Même si l’expression est peu usitée de nos jours, j’emploie de préférence le terme de « corps-vécu » pour désigner la « chair » au sens merleau-pontien. Selon moi, cette expression de « corps-vécu » est particulièrement adaptée pour caractériser la façon dont l’épreuve charnelle n’est pas objective, mais renvoie plutôt au « se rapporter au monde ». J’ajoute que cet emploi de l’expression « corps-vécu » permet de situer les failles et défaillances relationnelles primitives dans l’expérience du corps propre. Ainsi, le « manque de corps » de l’addict se localise à même la « chair » merleau-pontienne, en tant qu’elle condense le « se rapporter » premier au monde. Autrement dit, il est possible de considérer que les « pathologies du lien » ou addictions s’inscrivent à même la chair individuelle, qu’elles déterminent comme défaillante : comme « faisant défaut ».
3. Le paradoxe de l’addict : s’attacher pour se séparer
Nous avons vu jusqu’à présent que les pathologies du lien, ou addictions, sont caractérisées par un paradoxe : l’addict cherche son autonomie, en détruisant l’objet de sa pulsion par une consommation frénétique. Paradoxalement, donc, il devient dépendant pour devenir autonome.
Si l’on a coutume de définir les pratiques addictives comme « pathologies du lien », c’est en référence notamment aux travaux de Melanie Klein sur la dépendance du nourrisson à l’égard du sein maternel, de laquelle découle un amour-haine. De même, les addictions sont autant de passions caractérisées par un amour fusionnel autant qu’une haine à cause de la dépendance qu’entraîne cet amour, au point de générer une confusion identitaire : l’alcoolique est la bouteille, le toxicomane est la drogue, le cyberaddict est l’écran, le boulimique est la nourriture.
Force est donc de constater une coïncidence entre pathologies du lien ou « contraintes par corps » et corps vécu comme manquant, comme dépendant. L’erreur consiste finalement à vivre le corps comme manquant, quand la souffrance est psychique : un deuil ne peut pas se faire, une dette ne peut pas se panser et la plaie reste ouverte. L’addiction vient recouvrir la plaie d’un pansement, qu’elle retire aussitôt pour rouvrir la plaie et en arracher la croûte en train de se former. Maigre palliatif, l’addiction est surtout ce qui empêche le pansement de la souffrance en évacuant sa possible pensée : elle reste une réponse somatique à un manque psychique, pour ainsi dire un manque de corps-vécu psychique, précisément si l’on admet que le corps-vécu est lien au monde et non entité chosique.
Si l’on se réfère à Melanie Klein, on peut donc originer les addictions, lesquelles se manifestent de manière somatique et/ou comportementale, dans le rapport premier au sein maternel et, pour ainsi dire, à la matrice nutritive – ce corps qui a porté le nourrisson et duquel il s’est nourri.
Mais d’une part, on peut se demander si le sentiment de manque du corps est lié à une mauvaise séparation, une séparation d’avec le sein maternel qui fut brutale ou douloureuse, ou bien si au contraire on ne devrait pas imputer cette sensation psychique de manque de corps et de dépendance non à une rupture, mais plutôt une non rupture. Il aurait manqué un « non » qui sépare, un « nom » et un verbe, un mot qui se fût fait « chair » ; faute de quoi, l’individu s’éprouve comme manquant de chair.
D’autre part, je suis tentée de penser avec Joyce McDougall que l’addict échoue dans sa tentative de « se donner une chair » précisément parce qu’il apporte une réponse somatique à un manque psychique. Mais ce manque psychique, associé à une défaillance du lien et, pour ainsi dire, à un manque de lien, me semble découler non de l’absence de relation fusionnelle, non de l’absence d’amour ou de « sein maternel », mais au contraire du manque de séparation.
4. Séparation et espace transitionnel de symbolisation, d’après D. W. Winnicott
Pour qu’il y ait lien, il faut qu’il y ait un espace intermédiaire, un espace entre deux entités, un vide. En cela, je rejoins Donald Woods Winnicott[11] et son concept d’espace transitionnel : une « bonne » séparation a lieu lorsque l’enfant peut « jouer », dans une aire tierce, espace-temps situé entre réel et imaginaire. Cette aire transitionnelle lui permet d’être avec tout en se séparant : il est un espace « entre », un espace intermédiaire. Situé entre le monde et moi, il est le lieu-temps où je me constitue en tant qu’entité séparée.
L’espace transitionnel ne relève pas du monde réel tangible et objectif : il est création subjective englobant le monde alentour. Lorsqu’une fillette parle à sa poupée, elle parle à un objet du monde, qui est tangible ; mais le sens et la signification qu’elle accorde à la poupée relèvent de la pure fiction. La petite fille sait d’ailleurs très bien que la poupée ne lui répondra pas, qu’elle peut la laisser traîner parce que sa mère l’appelle subitement pour le repas. L’enfant n’est pas dupe du caractère seulement transitionnel et pour partie fictif de la scène qu’elle interprète ; pour autant, lorsqu’elle joue, elle ne fait qu’accorder une signification différente à des éléments du monde objectif. La nature intrinsèquement intermédiaire de l’espace transitionnel conditionne la trans-action : l’espace transitionnel est à la fois ce qui permet de faire la distinction – puisqu’il est entre, il sépare nécessairement – et ce qui relie – situé entre, l’espace transitionnel fait le lien. L’espace transitionnel est donc « entre » deux, intermédiaire, l’espace non de la fusion mais au contraire de la séparation : les consciences subjectives s’y co-constituent. Pour ce faire, l’espace transitionnel impose une distance intersubjective qui permet aux sujets de se constituer comme entités séparées mais aussi reliées par l’espace transitionnel. L’espace transitionnel est une aire de « jeu », au sens d’endroit u-topique où « il y a du jeu », c’est-à-dire de l’espace entre. Il est ce vide qui relie.
Si l’addict se sent « manquant de corps », s’il s’éprouve comme béance et vacance charnelle, c’est parce que le lien n’a pas pu se faire, faute d’espace entre. Françoise Dolto emploie l’expression de « castration symboligène[12] » pour désigner ces épisodes de la vie infantile au cours desquels les séparations sont l’occasion d’accéder au symbolique. Mon hypothèse est donc que l’addict manque d’un corps symbolique. Ma question est la suivante : le mot, en tant que symbole, peut-il suppléer au corps symbolique absent ? Peut-il créer un corps symbolique ? Et la graphie à même la peau du corps, l’écriture littéraire du corps vécu ou de l’addiction, l’écriture gestuelle qu’est la chorégraphie, sont-elles trois modes de performance d’un corps symbolique à même de suppléer la défaillance charnelle de l’addict ?
III. Imprimer son corps dans l’espace, écrire l’espace de son corps
Dominique Marinelli, dans son article « Addictions : à corps perdu » au sein de la revue numérique Le Portique[13] assimile toutes les addictions à des pathologies de l’oralité. Elles répondraient au sentiment de vide, de « trou béant » : « Les personnes ²dépendantes² ont un rapport particulier à leur corps. ²L’usage² qu’ils en font et la représentation qu’ils en ont, semblent marqués par un vide impossible à nommer. […] Dans ces affections de l’oralité, quelque chose est repérable d’emblée, quelque chose d’imparable. C’est le corps et l’usage, pourrait-on dire, qu’en fait celui ou celle qui est touché par cet affront atteint par cette plaie. Touché bien sûr, mais de façon violente, atteint de plein fouet, comme on l’est d’une balle percutant sa cible. Traversé, transpercé, comme si ce corps n’était pas à sa place, pas en place, tenant si mal debout, décalé. L’anorexique veut aplatir son corps le plus possible et y perdre sa ligne de vie. Le boulimique le remplit jusqu’à plus soif, il avale, il engouffre jusqu’à vouloir le faire éclater, peut-être. Le toxicomane le transperce, le pique, le troue…, pour y faire entrer la liqueur magnifique. […] Ces oralités, à la dérive, griffent le corps, afin de tenter d’en (re)trouver quelque trace. » En tant qu’elles sont des pathologies de l’oralité, les addictions s’articulent au manque de mots : « Des mots ne sont pas venus définir son corps, le délimiter » […] « Pas de mots médians, pas de paroles vraies, sécurisantes, médiatrices, rien que le vide. » Ce vide oral se retrouve dans l’image du vide à combler chez les addicts : anorexique, boulimique, toxicomane, alcoolique. « Si des paroles pouvant aider à différer ce besoin, sont absentes, elle devient trop forte, trop prégnante, elle ne laisse aucun espace au manque, à un effet de symbolisation, d’où la fermeture de ce circuit. Il n’y a aucune possibilité de jeu, de remplacement par autre chose. […] La réponse par l’incorporation de produits va tenter de faire la nique à cette angoisse, mais, c’est un leurre, de se faire croire qu’en planant le monde sera plus beau, plus supportable, qu’en buvant, le courage reviendra, qu’en se remplissant de nourriture, l’angoisse ira faire son trou ailleurs, que l’on pourra remplir le vide qui s’agrandit, qui prend toute la place, qui vrille le corps. La confrontation à ce vide est intolérable. L’angoisse les submergeant, la fébrilité les assaillant, le besoin se fait sentir de plus en plus de devoir colmater cette brèche à tout prix, de remettre en route le circuit, de plus de substances, plus de maîtrise, plus de jeûne, plus de traces pour sentir son corps être là, un peu. »
Aussi l’usage des mots pourrait-il permettre de suppléer à cette béance ressentie, pour créer du corps symbolique. L’exploration, de pistes issues d’exemples de la pratique artistique et littéraire peuvent constituer autant de chantiers ouverts à la réflexion et la discussion.
Mais au-delà de l’oralité et du verbe qui seul peut se faire chair, j’ajoute dès à présent l’hypothèse selon laquelle l’addiction s’associe au manque d’un regard. Peut-être ne suffit-il pas de poser soi-même des mots sur l’épreuve charnelle pour « se séparer », s’autonomiser et créer du corps symbolique : j’émets l’hypothèse de la nécessité d’un regard porté sur ce corps symbolique. En d’autres termes, il me semble que le mot a vocation à attirer le regard, lequel scinde l’individu en deux entités : sujet de l’action, objet visible. Le mot s’articule au désir, puisqu’il interpelle le regard sur ce dont il symbolise l’absence (Lacan[14]). Ce faisant, il devient un « corps symbolique » à ses propres yeux, une entité unie – c’est le sens premier du mot « corps » – qui se détache sur fond de monde. Le regard spectateur, que l’artiste interpelle sur son œuvre ou son corps réel par la médiation du verbe, crée un corps symbolique, une duplication objectale de lui-même, parce qu’il sépare et distancie le sujet de lui-même. C’est au sein même de son être que se fait la séparation, la duplication en sujet et objet. Il y a bien une séparation de soi à soi, d’où génération d’un espace entre subjectivité et objectivité : l’espace, étymologiquement, de la chair, laquelle sépare en reliant. C’est là, à mon sens, la vocation palliative de l’activité artistique.
IV. Contrainte par corps, dette et regard
1. Le regard qui sépare
Dans L’Être et le Néant[15], Jean-Paul Sartre affirme que l’on ne fait l’expérience de sa propre conscience qu’à travers le regard de l’autre. L’autre m’objectivise lorsqu’il pose sur moi un regard : de sujet tout puissant que j’étais, je deviens objet de son regard. Ce faisant, je me découvre objet possible de regard, non seulement pour autrui mais également pour moi. Cette étape de duplication de moi-même, comme objet en même temps que sujet, me perturbe car elle me fait descendre de mon piédestal ; néanmoins, elle est constitutive de ma conscience, et en cela elle est une expérience fondatrice. Je suis cela aussi, c’est-à-dire ce corps que, comme tel, autrui me voit être.
Que se passe-t-il lorsque, a contrario, le sujet n’est pas séparé de lui-même par un regard qui lui adresse une parole ? Il y a fort à croire que la conscience de soi, chez un individu sain, n’est pas totalement soumise à la présence concomitante du regard et d’une parole à un instant précis, et que l’être humain dispose de ressources spécifiques qui lui permettent d’accéder aux étapes psychiques naturelles du développement humain. En revanche, des constitutions lacunaires sont envisageables. En d’autres termes, la « séparation-duplication » peut ne pas avoir lieu, non par manque d’affection parentale, mais par excès de fusion et confusion des désirs. L’enfant est regardé, parlé, mais ce regard est défaillant puisqu’au lieu de séparer, il réfute la séparation : au lieu de devenir un « tu » aux yeux de l’autre, le « je » devient une annexe d’autrui, il reste un « je ».
À partir de Lacan[16], il est possible d’estimer que la présence d’un tiers vient dire l’espace entre les deux entités que sont la mère et l’enfant : ce « non » du père vient rompre et permettre au jeune enfant de se séparer. Il est ce regard qui, séparant, devient « ses parents » aux yeux de l’enfant et lui permet de faire la distinction entre autrui et lui-même, mais également entre le soi-sujet et le soi-objet. Au creux de l’espace entre soi-sujet et soi-objet se symbolise la « chair », précédemment désignée par le terme de « corps symbolique » ou « corps psychique ».
Et c’est là que le bât blesse : il peut manquer des mots, un regard, non d’amour, mais « séparant ». Loin d’être une recherche de fusion, l’addiction peut être recherche de ce qui sépare et crée du corps psychique, un corps qui manque. Bien sûr, l’individu sait qu’il nuit à son corps objectif, mais le manque se situe sur un autre plan. Et en satisfaisant le corps sur le plan physique, l’addict entérine le manque de lien du psychisme au physique, le manque de « chair » séparante – il manque d’autant plus sa cible qu’il vise à côté, sur un mode somatique. Or, comment trouver ce qui n’a jamais été donné, ce qui relève du passé et ne peut pas être changé ? Comment panser une brèche à jamais ouverte, un « non-lieu » ?
C’est ici que les pratiques artistiques du spectaculaire et de l’oralité me semble compenser le « manque de chair » en interpellant le regard de l’autre, « séparant », symboligène. Si l’expérience de l’addiction se vit « en cachette », dans la honte, c’est précisément parce qu’elle est incompatible avec le regard d’autrui, lequel introduit une distance entre soi et soi-même, espace de performance de soi. Ce regard conditionne la liberté de se créer, mais il génère une angoisse chez celui dont la duplication en corps-sujet et corps-objet a été, initialement, défaillante. Aussi l’addiction renforce-t-elle cette angoisse, en remettant toujours à plus tard la séparation.
2. L’exemple d’Amélie Nothomb : écrire pour se séparer et métaphoriser son corps désirant
Je m’appuierai pour finir sur un exemple mêlant littérature et mise en scène spectaculaire : le roman Robert des noms propres[17] d’Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb, auteure belge francophone, est connue à travers le monde comme étant une écrivaine prolifique. Elle a fait de son identité d’écrivain un véritable personnage, qu’elle met en scène de manière relativement spectaculaire : elle porte souvent un haut de forme noir, s’habille de longues robes noires et se pare de rouge à lèvre particulièrement vif, ce qui lui donne un style vestimentaire qualifiable de « gothique » et pour le moins « excentrique ». Dans ses romans et au fil de ses apparition médiatiques, Amélie Nothomb révèle et réitère la révélation de son anorexie-boulimie adolescente, ainsi que d’une potomanie (consommation excessive d’eau) et d’un alcoolisme infantile. Les allusions à une alimentation étonnante ou des comportements addictifs liés à l’oralité parcourent ses romans ; mais l’attitude d’écrivaine d’Amélie Nothomb elle-même reflète une forme d’addiction à l’écriture.
Levée tous les matins à 4h, l’auteure s’astreint à une écriture quotidienne de quatre heures. Après quoi, elle répond à la quantité, tout aussi abondante, de courriers qu’elle reçoit, au point d’entretenir de véritables correspondances avec certains de ses « fans ». La publication, chaque année, d’un nouveau roman, donne lieu à des séances de dédicaces qui durent des heures, à l’occasion desquelles ces mêmes fans se présentent et avec lesquels elle a des échanges relativement longs. Amélie Nothomb retient la date d’anniversaire de chacun d’entre eux, et bien entendu leurs prénom et nom. Ces séances sont aussi l’occasion pour eux de lui offrir maints présents, dont du champagne, et l’auteure s’astreint à en consommer une flûte à chaque offre de ses fans, ce qui lui vaut même parfois quelques malaises. Ce comportement de personnage-auteur est à mettre en rapport avec l’attitude d’écrivaine : si Amélie Nothomb publie un roman au mois de septembre de chaque année, elle en écrit, dit-elle, « environ trois » par an. Quant à l’écriture, elle semble n’avoir pas été son réflexe premier, ni même son projet de vie : il s’agirait d’une idée qu’elle aurait mise en œuvre à l’époque où elle était extrêmement affaiblie, physiquement, par l’anorexie, au point de frôler la mort. Après avoir lu la phrase de Nietszche extraite du Crépuscule des idoles : « Ce qui ne tue pas rend plus fort », elle aurait tenté d’écrire et c’est alors une transition, d’une addiction à une autre, que l’on peut observer.
Amélie Nothomb se dit toujours « abandonnique », terrorisée par la disparition de ses proches ou de ceux qu’elle aime. Elle n’a pas une estime surdimensionnée d’elle-même, affirmant qu’elle ne sait rien faire d’autre qu’écrire : dans le roman Le Voyage d’hiver[18], elle met en scène une auteure… débile mentale, aidée au quotidien par sa sœur, ce qui n’est pas sans rappeler son propre quotidien puisque sa vraie sœur Juliette Nothomb est toujours présente à ses côtés. Son rapport à l’alimentation n’est peut-être pas intégralement apaisé, l’auteure ne consommant qu’un repas par jour, mais il va de soi que l’écriture l’a aidée à surmonter ses propres fantômes. J’ajoute que les regards portés sur elle agissent telle une substance nutritive de l’ego : non seulement Amélie écrit car elle en ressent le besoin, mais en outre elle « publie », au sens premier du mot : elle s’ouvre au public à travers la mise en scène de son propre personnage. Elle infuse de son autobiographie dans l’intégralité de ses romans, ce qui en fait un « corps », une unité diversement déclinée. Il semble y avoir nécessité, chez elle, d’un tel regard constitutif de son identité. Que serait Amélie sans son personnage ? Plus étonnant encore, on retrouve cette quête identitaire chez les fans de l’écrivaine, lesquels ont tendance à adopter son code vestimentaire comme écriture spatiale d’un corps qui peine à se vivre.
L’attitude de l’écrivaine articule donc l’addiction au corps, à travers sa graphie : d’anorexique-boulimique-potomane-alcoolique qu’elle fut, l’écrivaine est devenue boulimique d’écriture et de regards bienveillants. Cette « boulimie » apparaît comme un remède, dans la mesure où elle reste une addiction mais où cette activité créative compense une souffrance psychique, sans que l’auteure n’en soit restée à une réponse somatique. L’écriture apparaît comme la réponse « somatique » à la souffrance psychique qui se joue dans l’addiction, au sens de « soma » ou « corps » symbolique. Le mot qui s’écrit, se dit et attire le regard, apparaît comme l’outil indolore d’une séparation, voire d’une duplication du soi en soi-sujet et soi-objet, pour une personne que la séparation effraie. Entre les deux, il est possible d’exister, de se créer comme corps symbolique, c’est-à-dire une « chair » qui émerge entre le soi-sujet regardant et le soi-objet regardé.
Je terminerai cette succincte illustration via l’exemple du roman Robert des noms propres d’Amélie Nothomb. Au sein de cette biographie romancée de la chanteuse RoBERT, amie d’Amélie Nothomb, l’écrivaine relate un rapport perverti entre désir de la mère de l’héroïne Plectrude, et désir de Plectrude elle-même. Cette enfant est promise à une carrière de danseuse classique de très haut niveau, mais cette carrière est brisée par l’anorexie de Plectrude et les conséquences somatiques de ce trouble du comportement alimentaire : l’héroïne doit cesser définitivement la danse à l’âge de quinze ans, après une grave fracture ostéoporotique. Or, l’épisode anorexique ne fait pas partie de la biographie réelle de la chanteuse RoBERT, de sorte que l’on peut voir là encore une immixtion de la personne d’Amélie Nothomb dans la biographie de la chanteuse. En vérité, l’auteur s’est saisie de cette confusion des désirs dans l’histoire vraie de son amie, pour introduire l’idée que le regard aimant, porté sur l’enfant, ne lui permet pas toujours de faire exister son propre désir lorsqu’il manque une séparation, un « entre deux ». L’enfant, ici Plectrude, reçoit de sa mère un regard fasciné et aimant, mais ce regard l’implore de devenir danseuse. Le désir de l’enfant est de plaire à sa mère, si bien qu’elle met tout en œuvre pour la satisfaire, sans se faire violence pour autant puisqu’elle aime danser. Mais à l’adolescence, lorsque l’enfant tombe amoureuse, elle se découvre incapable de dire son désir, car le regard qui aurait dû l’aider à se séparer n’a pas été présent. Le roman expose la renaissance de Plectrude lorsqu’enfin sa mère la « renie », puisqu’elle n’a pas été capable d’être danseuse et l’a déçue : ce reniement vaut séparation, ce qui est en même temps le vrai cadeau reçu par l’adolescente. Il lui permet de se créer et de supporter qui elle est, avec ses désirs propres.
Conclusion
Je conclurai mon propos en renouvelant mon hypothèse programmatique : si le comportement addictif est ancré chez l’individu, en tant que séquelle d’une séparation qui n’a pas pu et ne pourra plus jamais se faire, il n’en demeure pas moins que le geste créatif, notamment celui de l’écriture et de l’oralité spectaculaire, est peut-être une manière de créer du corps symbolique, seul à même de satisfaire la pulsion orale que la réponse somatique échoue à nourrir. La création artistique en effet interpelle le regard « castrateur » : celui du spectateur qui, regardant, introduit une distance interne chez l’individu, espace qui conditionne sa duplication en entités sujet et objet. Cette distanciation de soi à soi, permise par la spectacularité publique, est cette « chair » vivante qui se substitue au « vide » angoissant de l’addict. Dès lors, il n’y a plus opposition entre l’hypothèse selon laquelle l’addiction est « compensée » par le geste artistique, et le constat qu’elle lui est coextensive : de la névrose à l’art, il y a nécessité. L’art ne « guérit » pas un trouble qui s’origine dans une petite enfance à jamais révolue, mais il se pourrait qu’il panse en mots un corps symbolique qui fait défaut, et qu’il le recrée à titre palliatif. En ce sens, l’addict qui crée ne peut pas se passer de créer, faute de quoi il éprouve un manque viscéral qui l’amène à compenser de nouveau de manière somatique ; mais il est possible qu’il se pense incapable de créer s’il n’était pas de toute façon dans une dynamique addictive qui appelle le regard séparant.
[1] Psychanalyste britannique installée en France durant les années 1970.
[2] Voir Joyce McDougall, Plaidoyer pour une certaine anormalité, Éditions Gallimard, Paris, 1978. Étymologiquement, le terme latin addictus renvoie à la « contrainte par corps » d’un individu qui, endetté, en est réduit à vendre sa force de travail et pour ainsi dire son corps, afin de compenser sa dette. L’addiction est donc, en définitive, la réduction à l’état d’esclave. À ce sujet, voir l’article « Émergence de la notion d’addiction dans l’histoire de la psychanalyse » de Jacquet M.-M. et Rigaud A., in Anorexie, Addictions et Fragilités narcissiques, ouvrage collectif dirigé par Marinov V., Paris, Presses Universitaires de France, 2012.
Voir également Saïet M., Les Addictions, PUF, collection Que sais-je, Paris, 2011 :
« Réintroduit en France à la fin du XXe siècle à la fois par la psychanalyse et par le courant anglo-saxon, le terme « addiction » n’a pas été formé, comme on pourrait le supposer, à partir d’un anglicisme, mais provient d’un vieux vocable français tombé en désuétude, qui trouve son étymologie dans le terme latin addictus, littéralement « dit à », au sens d’attribuer, assigner quelque chose à quelqu’un.
Employé par le tribunal romain, addicere désignait plus précisément la condition d’« esclave pour dette », celui dont le corps était mis à disposition du plaignant par le juge, saisi en gage d’une dette impayée. Ainsi, l’esclave était addictus, « dit à », « affecté » à tel maître. Par la suite, le vieux français a prolongé cette terminologie, le terme addiction désignant la « contrainte par corps » exercée par l’autorité judiciaire sur le corps d’un individu débiteur pour l’astreindre à s’acquitter de sa dette. Simple prolongement sémantique, le terme juridique français a ainsi maintenu un lien très étroit avec le sens étymologique, devenu application concrète : le sujet victime d’addiction devait, par son corps, sous la contrainte, payer sa dette par une privation de liberté. »
[3] Joyce McDougall , « L’Économie psychique de l’addiction » in Anorexie, Addictions et Fragilités narcissiques, sous la direction de Marinov V., PUF, Paris, 2012.
[4] Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), le DSM est publié par la Société Américaine de Psychiatrie en vue de répertorier les différentes catégories de pathologies mentales. Cette classification se fait selon des critères symptomatiques de diagnostic, qui sont régulièrement révisés. Ainsi, le DSM I remonte à 1952, suite à la recension effectuée, au sein de l’Armée de Terre, par les psychiatres américains à l’issue de la la Seconde Guerre Mondiale. Le DSM IV a été diffusé en 1994, révisé en 2000, puis remplacé par le DSM V en mai 2013 lequel reste au stade de développement. C’est la raison pour laquelle de nombreux spécialistes en psychiatrie utilisent toujours le DSM IV.
[5] Aviel Goodman, « Addiction: Definition and Implications » in British Journal of Addiction n°85, 1990.
[6] Melanie Klein, Envie et Gratitude (1946-1963), trad. de l’anglais par Victor Smirnoff, Soula Aghion et Marguerite Derrida, Paris, Éditions Gallimard, 1992, p. 144 de l’édition de 1968. Nous soulignons.
[7] Janet Sayers, Les Mères de la psychanalyse (1991), trad. de l’anglais par Claude Rousseau-Davenet, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 250.
[8] Marion Milner, « Le rôle de l’illusion dans la formation du symbole » (1952), trad. de l’anglais par Mireille Fognini, Revue française de psychanalyse, tomes V-VI/1979, p. 857 ; voir également Marion Milner, La Folie refoulée des gens normaux : Quarante-quatre Années d’exploration psychanalytique, trad. de l’anglais par Danièle Faugeras, Paris, Éditions Érès, 2008, p. 129.
[9] Voir le travail d’Hélène Rouch, biologiste, évoqué par Luce Irigaray dans Je tu, nous – Pour une culture de la différence, Éditions Le Livre de Poche, Paris, 1992, p. 46 et suivantes. Lire également l’article de Francine Wynn, « The early relationship of mother and pre-infant: Merleau-Ponty and pregnancy », in Nursing Philosophy, Oxford, Blackwell Science Ltd, 2002.
[10] Voir notamment Edmund Husserl, Sur l’intersubjectivité, tome I, PUF, Paris, 2011.
[11] Voir Donald Woods Winnicott, Jeu et Réalité, l’Espace potentiel, Éditions Gallimard, Paris, 1975.
[12] Voir notamment François Dolto, L’image inconsciente du corps, Paris, Éditions du Seuil, 1984.
[13] Dominique Marinelli, « Addictions : à corps perdu », Le Portique [En ligne], 10 | 2002, mis en ligne le 02 juin 2005.
[14] Voir notamment « III. Les résonances de l’interprétation et le temps du sujet dans la technique psychanalytique » in « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » paru dans La psychanalyse, n° 1, 1956, Sur la parole et le langage. Extrait : « Ainsi le symbole se manifeste d’abord comme meurtre de la chose, et cette mort constitue dans le sujet l’éternisation de son désir. » (p. 163).
[16] Voir notamment Jacques Lacan, Écrits, Paris, Seuil, coll. « Le champ freudien », 1966, p. 578 et suivantes.
[17] Amélie Nothomb, Robert des noms propres, Éditions Albin Michel, Paris, 2002.
[18] Amélie Nothomb, Le Voyage d’hiver, Éditions Albin Michel, Paris, 2009.