Croyance et immanence dans la philosophie de Gilles Deleuze (2/2)
Croyance et immanence dans la philosophie de Gilles Deleuze (2/2)
Stéphane Lleres, Docteur en philosophie, agrégé de philosophie, chargé de cours à l’Université de Picardie Jules Verne. Ceci est la deuxième partie d’un article, dont la première partie, publiée le 10/12/18, peut être trouvée en cliquant ici. Résumé La philosophie de Deleuze trace une ligne de partage stricte entre la religion, qui renvoie à une transcendance, et la philosophie, qui s’installe dans l’immanence, semblant exclure par-là même la foi du champ philosophique. Pourtant, lorsqu’en 1985, Gilles Deleuze explique en quoi consiste le problème moderne, il réclame une croyance ou une foi. Cet article cherche à comprendre comment une philosophie de l’immanence, comme celle de Deleuze, peut réclamer une croyance ou une foi, et donc, comment il est possible de penser la foi en régime d’immanence. Abstract Deleuze’s philosophy draws a strict partition between religion, which refers to a transcendence, and philosophy, which develops in immanence, appearing to exclude faith from the philosophical field. However, when, in 1985, Gilles Deleuze explains the modern problem, he claims a belief or a faith. This paper tries to understand how a philosophy of immanence, such as Deleuze’s one, can claim a belief or a faith, and therefore, how it is possible to think faith in immanence plan. Mots-clés : Deleuze, croyance, foi, immanence, transcendance, image de la pensée, éthique, monde, corps. Keywords : Deleuze, belief, faith, immanence, transcendence, picture of thought, ethics, world, body. Si l’on cherche les facteurs historiques qui induisent cette situation, on pourra se tourner d’abord vers l’explication que donne Deleuze de la crise de l’image-action au cinéma. Les premiers théoriciens du cinéma, comme Eisenstein, concevaient celui-ci comme l’art des masses, et lui assignaient donc une tâche politique. Dans cette optique, l’image-action n’est pas seulement une image qui montre des actions, mais une image qui se prolonge en action dans les masses spectatrices, en vue de les faire accéder au statut de sujet politique et historique. Cela valait tout autant pour le cinéma américain, à ceci près que la prise de conscience du peuple y a lieu au plus profond de la crise économique, ou dans une lutte morale contre les préjugés, les profiteurs, etc. Or, après la Guerre, c’est précisément ce projet qui se trouve discrédité :
Si l’on cherche les facteurs historiques qui induisent cette situation, on pourra se tourner d’abord vers l’explication que donne Deleuze de la crise de l’image-action au cinéma. Les premiers théoriciens du cinéma, comme Eisenstein, concevaient celui-ci comme l’art des masses, et lui assignaient donc une tâche politique. Dans cette optique, l’image-action n’est pas seulement une image qui montre des actions, mais une image qui se prolonge en action dans les masses spectatrices, en vue de les faire accéder au statut de sujet politique et historique. Cela valait tout autant pour le cinéma américain, à ceci près que la prise de conscience du peuple y a lieu au plus profond de la crise économique, ou dans une lutte morale contre les préjugés, les profiteurs, etc. Or, après la Guerre, c’est précisément ce projet qui se trouve discrédité :
[…] l’art de masse, le traitement des masses, qui ne devait pas se séparer d’une accession des masses au titre de véritable sujet, est tombé dans la propagande et la manipulation d’Etat, dans une sorte de fascisme qui unissait Hitler à Hollywood, Hollywood à Hitler. […] Comme dit Serge Daney, ce qui a mis en question tout le cinéma de l’image-mouvement, ce sont « les grandes mises en scène politiques, les propagandes d’Etat devenues tableaux vivants, les premières manutentions humaines de masse », et leur arrière-fond, les camps.[1]L’image-action du cinéma d’avant-guerre devait se prolonger en action dans les masses, éveillant celles-ci au statut de sujet historique et politique, mais dans les faits, le cinéma n’a été qu’un instrument supplémentaire d’assujettissement des masses. On comprend alors que l’image-action entre en crise après la Guerre : c’est le cinéma autant que ses personnages qui ne peuvent plus agir, parce que l’action est paralysée par le soupçon de sa trahison. L’action peut toujours, dans les faits, se retourner et participer à ce qu’elle prétendait combattre. Il est alors clair que ce qui arrive au cinéma ne le concerne pas seulement, mais met en question, plus largement, la possibilité même de l’action révolutionnaire. Car la trahison du projet politique qui sous-tendait les cinémas américains et soviétiques n’a été possible que parce que les révolutions américaine et soviétiques ont elles-mêmes échoué. La Révolution américaine, d’après Deleuze, consistait non pas à « reconstituer un « vieux secret d’Etat », une nation, une famille, un héritage, un père »[2], mais à constituer une société de frères, à laquelle un homme n’appartiendrait pas en fonction d’une filiation ou d’un héritage, mais « en tant qu’Homme seulement »[3], une société d’hommes « sans particularités », et donc sans pères – c’est-à-dire une société débarrassée de la fonction paternelle. On voit comment ce projet rejoint, finalement, celui d’une Révolution communiste visant la constitution d’une société de camarades, puisque le prolétaire, comme l’avait déjà montré Marx, est l’homme indifférencié des masses ; le prolétariat est donc la classe universelle[4]. Un même objectif, mais seulement des moyens différents : là où la Révolution communiste procéderait par une « universelle prolétarisation », l’américaine se ferait par « universelle immigration »[5]. L’échec des deux révolutions est patent[6]. La Révolution américaine retrouve finalement l’Etat-Nation et restaure une fonction paternelle aussi bien que la Révolution soviétique qui sombre dans le Stalinisme et célèbre le « Petit Père des Peuples ». L’échec des deux grandes révolutions tient à ce qu’elles se sont retournées en ce qu’elles étaient justement censées combattre. Il est tentant de considérer que l’échec de l’action révolutionnaire est de droit plutôt que de fait. Elle semble en effet prise dans l’alternative suivante : soit épouser finalement la forme de l’Etat, celle-là même qu’il s’agissait pourtant de déjouer – c’est-à-dire se trahir, purement et simplement –, soit se dissoudre « dans les luttes locales partielles ou spontanées »[7] qui la condamnent à n’aboutir à rien. La révolution apparaît donc impossible et l’action caduque ; s’y engager ne peut relever au qu’au mieux d’une profonde naïveté, au pire que de duplicité. Telle est l’ambiance intellectuelle qui fait fond à la crise de l’image-action dans le cinéma d’après-guerre, mais c’est aussi celle qui règne au moment où Deleuze rédige les deux volumes sur le cinéma. Ceux qui se reconnaissent sous l’étiquette « Nouveaux philosophes » se font connaître à partir de la deuxième moitié des années soixante-dix, et proclament l’impossibilité de la révolution dans les médias et le monde éditorial durant les années quatre-vingt[8] ; corrélativement, les politiques ultra-libérales qui s’affirment à l’époque, sous l’impulsion de l’Amérique reaganienne et du Royaume Uni thatchérien, peuvent proclamer « there is no alternative » comme seule justification.[9] On comprend dès lors en quels termes doit se poser notre problème. La substitution d’une image de la pensée-croyance à l’image traditionnelle de la pensée-connaissance a entraîné une rupture du lien de l’homme et du monde : le lien sensori-moteur est brisé, et l’homme est devenu pur voyant. Dès lors, il ne peut plus s’agir de restaurer seulement ce lien, qui appartient à une image de la pensée que nous n’habitons plus. Lorsque Deleuze étudie le cinéma advenant après la Seconde Guerre Mondiale, il note que l’un de ses traits caractéristique est la prise de conscience des clichés[10].Or, un cliché, selon la définition qu’en donne Deleuze lui-même, c’est une image sensori-motrice[11] : c’est la perception dans la mesure où elle se prolonge en action, c’est l’image qui correspond à la nécessité d’agir ou de réagir[12]. Or ce qui apparaît comme cliché dans le cinéma d’après-guerre c’est tout ce qui faisait le cinéma d’avant-guerre, c’est-à-dire l’image-action ou l’image sensori-motrice. De la même manière que l’image-action est devenue un cliché pour le cinéma d’après-guerre, restaurer simplement le schème sensori-moteur c’est produire de simples clichés de pensée. Pour autant, il ne s’agit pas non plus d’en rester au simple constat de cette rupture entre l’homme et du monde. En rester là, voire jouir de ce constat, c’est ce qu’avec Rossellini, Deleuze considère comme de l’infantilisme[13]. Car cette rupture prive l’homme d’une action sur le monde. Or, sans pouvoir agir sur le monde, c’est-à-dire sans pouvoir tirer une satisfaction d’une action réelle, on en est réduit à jouir des images : cette jouissance purement imaginaire définissait précisément, pour Freud, le processus primaire, processus de satisfaction propre au jeune enfant, avant que s’élabore le processus secondaire par lequel l’action dans le monde est possible.[14] Jouir d’une position de pur voyeur : telle est la position infantile par excellence[15] – c’est précisément celle des « Nouveaux philosophes », qui proclament la révolution impossible et jouissent qu’elle soit impossible.[16] Ainsi se pose le problème : on ne peut pas simplement restaurer le lien sensori-moteur, on ne produirait que des clichés de pensée ; mais on ne peut pas non plus se contenter de prendre acte de la rupture de l’homme et du monde, et encore moins d’en jouir. La seule solution possible consiste à penser le lien de l’homme et du monde du point de vue de la nouvelle image de la pensée, c’est-à-dire du point de vue de la croyance. Penser, ainsi, le lien de l’homme et du monde, c’est le poser comme objet de foi : nous avons à croire à ce monde-ci, la foi constituant notre seul lien avec lui[17]. C’est en même temps que la pensée se fait croyance, et que son problème essentiel devient de croire en ce monde-ci. C’est du même mouvement que la pensée devient croyance et que la croyance se convertit à l’immanence. C’est ce dont témoignent les auteurs cités par Deleuze, y compris lorsque ceux-ci sont « encore pieux ». L’enjeu du pari de Pascal par exemple, c’est la vie du croyant ou du non-croyant, celle qu’il vit dans ce monde-ci[18]. De la même manière, chez Kant, si l’existence de Dieu ne peut faire l’objet que d’une foi et non d’une connaissance, cette foi est pratique : j’ai besoin de croire en l’existence d’un créateur moral du monde, car alors celui-ci n’est pas indifférent à mon action morale[19] : le lien de l’homme et du monde est donc l’enjeu véritable de la foi[20]. Retrouver le monde, non plus comme objet de connaissance, mais de croyance, tel est notre problème, le problème moderne. Or, ce problème se pose au croyant autant qu’à l’athée[21]. L’athéisme n’est pas le refus de la croyance ou la foi : ce que l’athée refuse, c’est le passage par une transcendance ; c’est cette démarche qui caractérise les penseurs que Deleuze considère comme « encore pieux » : c’est en passant par une transcendance qu’ils cherchent à retrouver le monde. Mais dans les deux cas, l’enjeu est le même : retrouver ce monde-ci, du seul point de vue possible, celui de la foi.
Foi et éthique
Retrouver ce monde-ci du point de vue de la foi relève, pour Deleuze, de l’éthique : avec Rossellini, il réclame en effet une éthique ou une foi[22]. Or, celle-ci passe par le corps. Croire au monde, en effet, c’est croire au corps :Ce qui est sûr, c’est que croire n’est plus croire en un autre monde, ni en un monde transformé. C’est seulement, c’est simplement, croire au corps. […] Notre croyance ne peut avoir d’autre objet que la « chair », nous avons besoin de raisons très spéciales qui nous fassent croire au corps […] Nous devons croire au corps, mais comme au germe de vie, à la graine qui fait éclater les pavés, qui s’est conservée, perpétuée dans le saint suaire ou les bandelettes de la momie, et qui témoigne pour la vie, dans ce monde-ci, tel qu’il est.[23]C’est ce que Deleuze trouve dans sa lecture de Pascal, qui conseille aux libertins qui veulent croire de faire « tout comme s’ils croyaient, en prenant l’eau bénite, en faisant dire des messes, etc. »[24] Croire commence donc avec une attitude du corps, et concerne donc en tout premier lieu le corps[25], au point que croire au monde, c’est d’abord croire au corps – ce qui ne signifie pas chercher à retrouver, à reconstituer le lien sensori-moteur, à reconstituer des schèmes sensori-moteurs : ceux-ci concernent une image de la pensée qui n’est plus la nôtre. D’autre part, nous ne manquons pas de schèmes sensori-moteurs, alors que nous n’avons plus le monde. Seulement, ceux-ci tournent « à vide », ils ne font plus notre lien avec le monde. Or, c’est parce qu’elle concerne le corps, que la croyance relève essentiellement de l’éthique. L’idée selon laquelle l’éthique concerne le corps, c’est ce que Deleuze tire de sa lecture de Spinoza : pour lui, la question centrale de l’Ethique est celle de savoir ce que peut un corps[26]. À tel point que c’est à partir de cette question que l’Ethique doit, selon lui, être abordée, plutôt que par le premier principe, qui n’a de sens que par rapport à cette question[27]. L’éthique, selon Deleuze, concerne donc la question de savoir ce que peut un corps. Elle diffère alors de toute morale, comprise comme un système du jugement. Le jugement consiste en effet toujours à rapporter ce qui est jugé à une norme ou un criterium qui se trouve, du même coup, transcendant par rapport à lui[28]. Le problème moral, c’est toujours de déterminer si une action est ou non conforme à une règle ou à un principe, qu’il s’agisse d’un impératif catégorique ou d’un principe de maximisation du bonheur : dans tous les cas, il s’agit toujours de rapporter l’action considérée à une règle ou à un principe extérieur, et donc transcendant. Le jugement est donc bien une évaluation, mais qui ne procède qu’en rapportant ce qu’elle évalue à une transcendance. La question éthique est très différente : l’évaluation éthique ne rapporte ce qu’elle évalue à rien d’extérieur ni de transcendant. Elle n’évalue un corps que du point de vue de ce qu’il peut, c’est-à-dire de sa propre puissance : l’éthique est une évaluation immanente[29]. C’est donc parce que la foi porte sur le corps, et que le corps est l’objet essentiel de l’éthique que Deleuze peut réclamer d’une même geste une éthique ou une foi. Mais si l’on veut comprendre ce que signifie exactement « croire au corps », il faut se tourner vers la manière dont Deleuze comprend ce qu’est un corps individuel. Sur ce point, Deleuze reprend la problématique de l’individuation telle qu’elle est formulée par Simondon[30]. Comprendre ce qu’est une chose individuelle demande de ne pas considérer l’individu comme un donné dont il faut partir, mais comme le résultat d’un processus d’individualisation. Partir de l’individu conduit en effet à un démarche circulaire, qui conduit à décalquer le fondement sur ce qu’il est supposé fonder, ou la condition sur ce qu’elle est censée conditionner : l’hylémorphisme conçoit en effet la chose individuelle comme le remplissement d’une forme par une matière, mais forme et matière sont dérivées par abstraction des choses individuelles qu’elles sont supposées expliquer – ce qui conduit à un cercle que Deleuze, dans Différence et répétition considère comme caractéristique du fondement[31] ou de toute démarche fondatrice. La seule manière d’éviter ce cercle, c’est de considérer que l’individu est le résultat d’un processus, qui ne ressemble pas à ce qu’il fonde. Ainsi, Deleuze considère avec Simondon que l’individu est la solution d’un problème, ou la résolution d’un champ problématique. Le problème, comme on l’a vu, se définissant comme la coexistence de dimensions hétérogènes, l’individu peut être vu comme une manière de tenir ensemble ces dimensions hétérogènes, de façon stable, c’est-à-dire qui peut être répétée. L’individuation est donc une prise de consistance dans le champ problématique, et il est, au sens strict, ce qui consiste. Deleuze, résume ainsi la démarche de Simondon :
Gilbert Simondon montrait récemment que l’individuation suppose d’abord sur un état métastable, c’est-à-dire l’existence d’une « disparation » comme au moins deux ordres de grandeur ou deux échelles de réalités hétérogènes, entre lesquelles des potentiels se répartissent. […] Apparaît ainsi un champ « problématique » objectif, déterminé par la distance entre ordres hétérogènes. L’individu surgit comme l’acte de solution d’un tel problème, ou, ce qui revient au même, comme l’actualisation du potentiel et la mise en communication des disparates. [32]La vision binoculaire, telle que la décrit Simondon, fournit un bon exemple de ce processus : les visions de chaque œil constituent des dimensions hétérogènes, qui se trouvent intégrées – tenues ensemble – dans une dimension supplémentaire qui est la profondeur. Mais il est de même d’une plante, qui peut être vue comme la solution d’un problème posé par la coexistence de l’air et la lumière d’une part, de la terre et de l’humidité de l’autre[33]. Mon corps est donc ce qui tient ensemble un flux de rayons lumineux (vue), un flux sonore (ouïe), un flux de nourriture et de matières fécales, (digestion), un flux d’air et de gaz carbonique (respiration), etc. C’est ce que Deleuze, dans Différence et répétition, décrit, avec Hume, comme habitude[34], et qu’il approfondit[35] avec Guattari, dans L’Anti-Œdipe, dans une perspective à la fois marxienne et bergsonienne, sous le terme de coupure-flux ou synthèse connective. Le flux, c’est ce que Deleuze et Guattari décrivent comme un mouvement infini, sans origine ni fin (il n’est même pas à lui-même sa propre fin)[36], et qu’il faut appeler processus[37]. Telle est la production vue par Marx : là où les économistes classiques distinguaient la production, la distribution, l’échange et la consommation[38], Marx montre que la production est toujours en même temps consommation, et que la consommation est toujours en même temps production (la production consomme des ressources et de l’énergie, et la consommation produit toujours au moins le corps ou la vie de l’homme qui consomme) ; de même, la distribution et l’échange ne se détachent pas de la production-consommation : ils sont la production sous d’autres aspects[39]. Dès lors, si l’on ne peut pas distinguer de moments ou de sphères indépendantes dans la production, alors la production est toujours production de production[40].La production ne produit qu’elle-même, et c’est en ce premier sens qu’elle est un processus : elle est une causalité immanente[41]. Et cette immanence entraîne l’univocité[42], qui fait le second sens du processus. Si la production ne produit que de la production, alors produire ne se dit qu’en un seul et même sens : il n’y a pas de différence entre la production naturelle et la production humaine[43]. Dès lors – et c’est le troisième sens du processus – la production est sans origine ni fin, c’est un mouvement infini qu’il faut donc comprendre comme flux. Mais justement parce que le flux est un mouvement infini, nous ne connaissons jamais de flux comme tel : nous ne connaissons de flux que coupé. Couper un flux, c’est en prélever quelque chose. Ici, c’est sur le premier chapitre de Matière et Mémoire que Deleuze et Guattari s’appuient. Car Bergson y décrit le plan de la matière comme un plan d’images-mouvement[44], c’est-à-dire un plan d’images traversées de mouvement, qui reçoivent du mouvement des images avoisinantes, et le restituent aux images avoisinantes[45]. Mais dans ce débordement d’images les unes sur les autres, il est en fait impossible d’en isoler une – puisque cette isolation suppose déjà la perception[46] – au point que le plan de matière se trouve être un plan de flux d’images-mouvements, que Bergson finit par traiter comme un plan de lumière[47]. Ce qui fait la différence entre la matière-image et la perception consciente, c’est alors seulement que la perception consciente s’opère, par sélection des images en fonction des actions dont on est capable. Percevoir, c’est donc toujours couper un flux, c’est-à-dire opérer un prélèvement sur un flux. Et non seulement percevoir, mais se nourrir, respirer, etc. Et cette coupure se fait en fonction de nos organes : nos yeux coupent un flux de lumière, nos oreilles coupent un flux de sons, mais pas de la même manière que les yeux d’une araignée ou que les oreilles d’une chauve-souris ; les yeux d’un mammifère ne coupent pas les flux de lumière comme l’herbe le fait, pour la photosynthèse. Un corps, c’est donc, de ce point de vue, ce qui connecte et tient ensemble plusieurs flux, en les coupant : l’herbe connecte un flux de sels minéraux et un flux de lumière, la tique connecte un flux de sang, un flux d’odeurs, un autre de perception spatiale de la verticalité. C’est en ce sens qu’un corps est coupure-flux ou synthèse connective. Mon corps est la synthèse connective d’un flux de nourriture, d’excréments, d’air, de lumière, d’odeurs, de sons, mais aussi de produits fabriqués, etc. Connexion de flux coupés, il n’y a pas de différence ontologique entre mon corps et les flux qu’il coupe – c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’univocité du processus – au point qu’un corps peut être, pour un autre, un flux sur lequel s’opérera un prélèvement : l’herbe opère un prélèvement sur un flux d’humidité, et un autre sur un flux de lumière ; mais l’antilope opère un prélèvement sur un flux d’herbe, et le loup prélève de la viande sur un flux d’antilopes. Mon corps connecte beaucoup de flux coupés, mais est lui-même objet de prélèvements, de force de travail, par exemple, mais un virus prélève aussi sur mon corps de quoi vivre, ou une tique, etc. Manière de dire que si Deleuze et Guattari appellent machine la synthèse connective de coupures-flux[48], alors toute machine est machine de machines[49]. On voit par-là que mon corps n’est pas autre chose que la synthèse connective de flux du monde, et c’est en ce sens d’abord que mon corps est mon lien avec le monde. Il n’est rien d’autre qu’un nœud, ou qu’un nœud de nœuds, consistant mais nécessairement provisoire, de flux qui constituent le monde lui-même, au point qu’on pourrait dire : mon corps est un nouage du monde. Il ne consiste en rien d’autre que cela. Mais le corps ne s’épuise pas dans ce en quoi il consiste. En effet, si « les machines désirantes nous font un organisme »[50], reste que « le corps souffre d’être ainsi organisé, de ne pas avoir une autre organisation, ou pas d’organisation du tout. »[51] La synthèse connective fait du corps quelque chose qui consiste, mais cette consistance tendrait à un durcissement, ou à une fixité si elle résumait le tout de l’individuation : l’individu ne pourrait plus devenir, il ne pourrait plus que demeurer ce qu’il est, où se briser. C’est ce qu’indique l’exemple paradigmatique, pour Simondon, du moulage de la brique d’argile : l’argile n’est pas une matière informe, pas plus que le moule n’est une forme immatérielle : l’argile est déjà individuée dans le marais où on la puise. Le moulage est donc un processus de désindividuation et de réindividuation de l’argile selon le moule : l’argile et le moule forment donc les deux dimensions hétérogènes d’un problème dont la brique est la résolution, qui les intègre et les tient ensemble. Ce n’est possible que dans la mesure où, dans cette rencontre l’argile retourne au problème qui la constitue et se résout à nouveau, mais cette fois selon le moule. Que l’individu garde une charge préindividuelle signifie qu’il peut devenir, ou qu’il porte, selon l’expression de Simondon une réserve de devenir. C’est ce qui permet l’apprentissage conçu lui-aussi comme un devenir[52]. Il faut donc que le problème ne disparaisse pas dans le corps individué qui en constitue la solution, mais qu’il y insiste. Cette réserve de devenirs qui insiste dans chaque corps individué, c’est ce que Deleuze et Guattari nomment, à partir de L’Anti-Œdipe, le Corps sans Organes. Celui-ci est produit par la synthèse connective elle-même : puisque la machine consiste, c’est-à-dire, puisque la coupure-flux prétend à son retour, il faut bien que d’une manière ou d’une autre, la coupure-flux soit enregistrée. Si, par exemple, l’appareil digestif infantile coupe un flux de lait maternel, cela n’arrive pas sans que la coupure s’enregistre, sans quoi elle ne pourrait prétendre à son retour, c’est-à-dire consister. La surface d’enregistrement ainsi produite apparaît comme un « énorme objet indifférencié »[53], recueillant toutes les connexions possibles ; mais du même coup, elle se place sous le règne de la synthèse disjonctive ou disjonction incluse : non pas une connexion ou une autre, l’une excluant nécessairement l’autre, mais soit une connexion, soit une autre, soit encore une autre, etc., sans aucune exclusion. Cette surface est un corps plein, sans organes, puisque l’organisme se comprend comme un nouage de coupure-flux, à l’exclusion des autres.[54] Si l’organisme est un nouage de coupure-flux, qui n’a de consistance qu’en tant qu’il prétend à son retour, alors « […] les organes de la vie sont la working machine »[55], et il est vrai qu’alors, en tant qu’il conteste cette consistance elle-même, le Corps sans Organes doit être compris comme instinct de mort[56]. Pour autant, sous cet aspect, le corps n’en est pas moins notre lien avec le monde. Car l’organisme que nous font les machines n’est qu’un agencement de coupure-flux, exclusif des autres ; il est donc insensible à tous les flux qu’il ne coupe pas, comme la tique est insensible à tout signal qui ne présente aucun intérêt pour son action. Contester cette organisation, c’est donc potentiellement ouvrir le corps à d’autres flux, et ces nouvelles coupures-flux nous font de nouveaux organes. Ainsi la musique, traversant nos corps, « nous met une oreille dans le ventre, dans les poumons, etc. »[57] C’est pourquoi il est très important de rappeler que, comme le notent Deleuze et Guattari, le Corps dans Organes (CsO) conteste l’organisme, mais pas les organes eux-mêmes :
Nous nous apercevons peu à peu que le CsO n’est nullement le contraire des organes. Ses ennemis ne sont pas les organes. L’ennemi, c’est l’organisme. Le CsO s’oppose, non pas aux organes, mais à cette organisation des organes qu’on appelle organisme.[58]Le Corps sans Organes est puissance de nouveaux organes, et c’est en cela qu’il est puissance de devenirs. C’est en cela qu’il est notre lien au monde : car il nous ouvre à d’autres flux que ceux qui font déjà notre corps, il rend sensible à ce qui était, jusque-là, insensible[59]. C’est dire que s’il est instinct de mort, c’est seulement de la mort de l’organisme. Car cet instinct de mort organique nous ouvre en même temps à une vie inorganique[60], qui est pure puissance de devenirs. Croire au corps, c’est donc en ce second sens, affirmer une ouverture au monde, une disponibilité à ce que nous ne pouvons encore sentir ou percevoir : c’est affirmer notre lien avec le monde, en tant que par-là s’affirme mon corps comme puissance de devenirs. Un corps individuel doit donc être compris sous deux aspects. D’une part, il consiste en l’agencement ou le nouage de flux hétérogènes, et peut donc être compris comme la résolution d’un champ problématique préindividuel ; d’autre part, dans la mesure où ce champ problématique ne disparaît pas mais insiste en lui, il est puissance de devenir. On aura remarqué que se retrouve là la double définition du corps individuel de Spinoza : comme individu, il se comprend comme rapport caractéristique de mouvement et de repos entre les parties qui le composent[61] ; comme charge préindividuelle insistant dans le corps individué, il se comprend un certain degré de puissance[62], d’agir ou de penser dont Deleuze rappelle constamment qu’il se double d’un pouvoir d’être affecté correspondant[63]. Ce que peut un corps, ce sont les devenirs dont il est capable. De là, on comprend mieux ce que signifie croire au corps, et en quoi se joue là notre lien au monde : croire au corps, c’est affirmer le corps comme disponible, vulnérable même, pour des rencontres par lesquelles il se désindividuera et se réindividuera autrement. Croire au corps, c’est affirmer le corps comme puissance de transformations, qui ne peuvent survenir qu’au contact d’une extériorité. On comprend ce que croire au monde a à voir avec le corps, et par conséquent, en quoi cette foi immanente relève ici de l’éthique. Cette éthique réclamée par Deleuze ne consiste pas, comme on l’a vu, à restaurer le schème sensori-moteur : il ne s’agit plus de trouver une voie par laquelle la perception se prolongerait en action. Mais dès lors que cette éthique assume la suspension du schème sensori-moteur, ne nous condamne-t-elle pas à une pure et simple passivité ? Cette critique, déjà, se trouve formulée par les marxistes à l’encontre du cinéma d’après-guerre :
Au Japon comme en Europe, la critique marxiste a dénoncé ces films et leur personnages, trop passifs et négatifs, tantôt bourgeois, tantôt névrosés ou marginaux, et qui remplacent l’action modificatrice par une vision « confuse ».[64]Ce n’est pourtant pas le cas. Car si retrouver le monde demande d’abord de croire au corps, c’est-à-dire d’affirmer le corps comme puissance de devenirs, il s’agit alors d’entrer dans une expérimentation indéfinie. Expérimenter, c’est connecter une chose avec une autre, et a priori n’importe quoi avec n’importe quoi, sans privilège particulier. Deleuze et Guattari rappellent la « satisfaction du bricoleur quand il branche quelque chose sur un conduit électrique, quand il détourne une conduite d’eau »[65], et que l’œuvre de Kafka « ne se propose en fait qu’à l’expérimentation »[66] :
On entrera par n’importe quel bout, aucun ne vaut mieux qu’un autre, aucune entrée n’a de privilège, même si c’est presque une impasse, un étroit boyau, un siphon, etc. On cherchera seulement avec quels autres points se connecte celui par lequel on entre, par quels carrefours et galeries on passe pour connecter deux points […][67]Croire au corps, c’est donc l’expérimenter : chercher des connexions avec d’autres choses, d’autres synthèses connectives ou d’autres coupures-flux que celles que nous sommes déjà. Ainsi, seulement, nous devenons. Il s’agit bel et bien d’une activité, mais d’une activité qui n’est pas sensori-motrice, une activité d’une nouvelle forme, qui ne s’épuise pas dans l’action, mais se réalise dans la création, pour autant que celle-ci procède justement par expérimentation.
Conclusions
Faire passer la croyance du côté de la philosophie n’est donc possible qu’à condition de convertir la croyance à l’immanence. Nous avons pu comprendre ce que cela signifiait : il s’agissait de passer d’une image de la pensée à une autre, d’une image selon laquelle penser c’est connaître, à une autre selon laquelle penser, c’est croire. Mais croire, ici, c’est affirmer : la pensée se fait croyance quand elle affirme l’élément problématique, hétérogène, qui la provoque à naître. Mais ce passage, nous l’avons vu, ne concerne pas seulement les philosophes ou les historiens de la philosophie. Il entraîne en effet une perte de monde que Deleuze diagnostique comme le « fait moderne ». C’est que l’image de la pensée comme connaissance dessinait une complicité, voire, parfois, une isomorphie, de l’homme et du monde, aussi bien sur le plan pratique que théorique. C’est cette complicité qui se trouve rompue dans le passage à l’image de la pensée comme croyance : les parties de la nature, dont l’homme lui-même, sont devenues indifférentes les unes aux autres. Et comme nous avons aussi pu le montrer, il ne peut être question de retrouver le monde du point de vue de la connaissance – car le pur et simple recyclage d’une image de la pensée déjà morte ne produit que des clichés de pensée – ni en rester à ce constat : nous n’avons pas d’autre chose à faire que de retrouver le monde du point de vue de la croyance. Ce problème – ce fut notre dernier point – est de plein droit un problème éthique, en ce qu’il concerne le corps. On n’affirmera pas un lien avec le monde sans affirmer le corps. Croire au monde, c’est d’abord croire au corps, c’est-à-dire affirmer le corps comme puissance de devenirs ; car si le corps individué n’est lui-même qu’un nœud de flux du monde, il est en même temps puissance de nouveaux nouages, de captation de nouveaux flux, jusque-là imperceptibles. Croire au monde, c’est donc affirmer le corps comme objet d’expérimentations. Tel est donc, d’après Deleuze, notre problème : nous avons perdu le monde, et nous n’avons pas d’autre choix que de le retrouver du point de vue de la foi. Manière de dire que la foi ainsi comprise n’a rien d’une décision ou d’une option individuelle : c’est – nous l’avons déjà noté – le problème du religieux autant que de l’athée. Ethique, la foi apparaît donc comme un problème tout aussi bien politique. Car expérimenter, ce n’est jamais, d’une part, sans défaire, même partiellement, l’agencement de coupures-flux que l’on est déjà, et d’autre part, sans défaire ou du moins contester la formation sociale au sein de laquelle on cherche à expérimenter. Car une formation sociale est elle aussi un corps[68] à une échelle plus grande, c’est-à-dire un certain nouage de coupures-flux en tant qu’il consiste, c’est-à-dire tend à perdurer, se conserver, et donc assurer sa reproduction d’une génération à l’autre. De ce point de vue, il devient clair qu’on « […] ne vous laissera pas expérimenter dans votre coin »[69], car se connecter avec n’importe quoi ou n’importe qui, n’importe comment, c’est toujours contester et mettre en péril la formation sociale existante[70]. Ainsi, Œdipe n’est pas ce désir incestueux qu’il serait nécessaire de refouler pour qu’une société puisse seulement s’établir[71], c’est l’instance par laquelle une formation sociale assure la reproduction de la structure familiale, et par là, la sienne propre : Œdipe, c’est ce qui garantit qu’on ne se connecte pas n’importe comment avec n’importe qui, ou n’importe quoi, mais seulement en tant que père ou père, avec une mère ou un père, même s’il ne s’agit que de père ou de mère potentiel. Œdipe, c’est donc la réduction drastique du champ de l’expérimentation aux seuls papa-maman. Toute expérimentation est donc politique en même temps que biologique, « appelant sur soi censure et répression. »[72] Si retrouver le monde par la foi passe par l’expérimentation, alors on comprend que notre problème n’est pas éthique, sans être en même temps de part en part politique[73]. Ainsi, contre les critiques niant la dimension politique du cinéma d’après-guerre, Deleuze affirme qu’il est « tout entier politique, mais d’une autre façon »[74]. La politique n’est plus, ici, l’action révolutionnaire, prise dans l’alternative de la trahison ou de la dissolution. Elle consiste ici à expérimenter. Ce n’est pas pour autant un renoncement à la révolution, déclarée impossible[75], car ces devenirs sont, on le comprend aisément, par eux-mêmes révolutionnaires. C’est de cette manière qu’il faut comprendre la fameuse opposition deleuzienne entre l’avenir de la révolution et le devenir révolutionnaire : lorsque Deleuze explique que la question de l’avenir de la révolution est une mauvaise question[76], et que la seule question est celle d’un devenir-révolutionnaire, il ne faut pas comprendre que Deleuze incite à fomenter des révolutions quelques en soient les conséquences. Il faut comprendre que l’expérimentation, qui induit un devenir-révolutionnaire échappe à l’alternative de la révolution trahie ou dissoute. L’expérimentation constitue par elle-même un nouveau type de révolution[77].[1] Cinéma 2, 7, p. 214. [2] Critique et Clinique, Paris, Editions de Minuit, 1993, p. 109. [3] Ibid. [4] Cf. K. Marx et F. Engels, Manifeste communiste, trad. Molitor, Paris, Alfred Costes éditeur, 1848, pp. 75-76 : « Le prolétaire est sans propriété ; ses relations avec sa femme et ses enfants n’ont rien de commun avec celles de la famille bourgeoise ; le travail industriel moderne, l’assujettissement moderne au capital, le même en Angleterre qu’en France, en Amérique qu’en Allemagne, l’ont dépouillé de tout caractère national. » [5] Critique et clinique, op. cit. p. 113. [6] Cf. Critique et clinique, p. 113 : « A cet égard, on ne peut séparer la faillite des deux révolutions, l’américaine et la soviétique. » [7] Cf. Dialogues, p. 174. [8] La Cuisinière et le Mangeur d’homme et Les Maîtres penseurs, d’A. Glucksmann, paraissent respectivement en 1975 (Seuil) et 1977 (Grasset). La Barbarie à Visage humain, de B.-H. Levy paraît en 1977 (Grasset). La même année, Deleuze fait paraître en supplément à la revue Minuit « A propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus général », texte distribué gratuitement dans les librairies. [9] Cf., sur ce point, F. Cusset, La Décennie, Paris, La découverte, 2008, F. Guattari, Les Années d’Hiver, Paris, Les Prairies ordinaires, 2009. Pour la décennie suivante, cf. J. Rancière, Chronique des Temps consensuels, Paris, Le Seuil, 2005. [10] Cf. Cinéma 1, 12, p. 283. [11] Cf. Cinéma 2, p. 32 : « Un cliché, c’est une image sensori-motrice de la chose » [12] Cf. Ibid., pp. 31-32 : « Les situations quotidiennes été même les situations-limites ne se signalent par rien de rare ou d’extraordinaire. […] Nous côtoyons tout cela, même la mort, même les accidents, dans notre vie courante ou en vacances. […] Et justement nous ne manquons pas de schèmes sensori-moteurs pour reconnaître de telles choses, les supporter ou les approuver, nous comporter en conséquence, compte-tenu de notre situation, de nos capacités, de nos goûts. Nous avons des schèmes pour nous détourner quand c’est trop déplaisant, nous inspirer la résignation quand c’est horrible, nous faire assimiler quand c’est trop beau. » [13] Dans le cours du 13 novembre 1984, Deleuze fait référence à un entretien de R. Rossellini avec Fereydoun, Hoveyda et E. Rohmer, paru dans les Cahiers du Cinéma n°145 (Juillet 1963) et reproduit dans R. Rossellini, Le Cinéma révélé, Paris, Flammarion, 1984, pp. 111-128 : « Je réagis à cela, parce que je crois fermement que la cruauté est toujours une manifestation d’infantilisme, toujours. Tout l’art d’aujourd’hui devient chaque jour plus infantile. […] Cet infantilisme, nous l’avons vu dans le nouveau roman. Nous le voyons sous une forme absolument incroyable en peinture. Nous en sommes arrivés à la vanité totale, au maladif. […] Aujourd’hui, l’art, c’est ou la plainte ou la cruauté. Il n’y a pas d’autre mesure : ou l’on se plaint, ou l’on fait un petit exercice absolument gratuit de petite cruauté. » La référence est reprise par Deleuze dans Pourparlers, Paris, Éd. de Minuit, 1990, p. 176. [14] Cf. Freud, L’interprétation des rêves, I, VII. [15] Rossellini définit justement la cruauté comme la position du pur voyeur : « La cruauté, c’est aller violer la personnalité de quelqu’un, c’est mettre quelqu’un en condition pour arriver à une confession totale et gratuite. Si c’était une confession en vue d’un but déterminé, je l’accepterais ; mais c’est l’exercice d’un voyeur, d’un vicieux. Disons-le : c’est cruel. », op. cit., p. 120. [16] Cf. Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1996, p. 174 : le « Nouveau Philosophe » est celui qui se place comme « […] le penseur soi-disant lucide d’une révolution impossible, dont on tire tant de plaisir qu’elle soit impossible. » [17] Cf. Cinéma 2, 7, p. 233 : « La réaction dont l’homme est dépossédé ne peut être remplacée que par la croyance. Seule la croyance au monde peut relier l’homme à ce qu’il voit et entend. » [18] Cf. Cours du 13 novembre 1984 : « Chez Pascal le pari c’est « redonnez-moi le monde, ce monde-ci ». Si bien qu’au même moment que la croyance se substitue au savoir, la croyance connaît une conversion, une conversion fondamentale […] la croyance […] cesse d’être croyance dans un autre monde pour devenir croyance dans ce monde-ci. » [19] Cf., par exemple, Critique de la Raison pratique, op. cit., Première partie, Livre Deuxième, chapitre V : « De l’existence de Dieu comme postulat de la raison pure pratique. » « Mais l’être raisonnable, qui agit dans le monde, n’est pas cependant cause du monde et de la nature elle-même. Donc, dans la loi morale, il n’y a pas le moindre principe pour une connexion nécessaire entre la moralité et le bonheur qui lui est proportionné […] Le souverain ben n’est donc possible dans le monde qu’en tant qu’on admet une cause suprême de la nature qui a une causalité conforme à l’intention morale. » [20] On retrouverait cette idée aussi chez W. James, par exemple dans La volonté de croire, trad. Loӱs Moulin, Paris, Flammarion, 1911, p. 76 : « […] nos facultés de croire ne nous ont pas été données pour créer des orthodoxies et des hérésies, mais pour nous permettre de vivre. Ajouter foi à nos aspirations religieuses, c’est donc avant tout vivre à la lumière de ces aspirations […] » [21] Cf. Cinéma 2, 7, p. 223 : « Chrétiens ou athées, dans notre universelle schizophrénie nous avons besoin de raisons de croire en ce monde. » [22] Ibid., p. 225. Cf. aussi R. Rossellini sur ce point, op. cit., pp. 121-122 : « Je me fiche de faire de l’art. Cela veut dire renoncer à beaucoup. C’est une position morale, que je peux dire même – si vous me permettez d’employer le mot – héroïque. Ce que tout homme cherche instinctivement, c’est à s’illustrer. Moi, je tâche de ne pas m’illustrer, mais de devenir utile. » [23] Cinéma 2, 7, p. 223. [24] Pascal, Pensées, n°233-418, texte établi par L. Brunschvicg, Paris, GF Flammarion, 1976, p. 116. [25] Cf. Cours du 13 novembre 1984 : « ça nous permettrait de comprendre d’une autre façon, et je crois plus exacte, le « abêtissez-vous » de Pascal. Lorsque Pascal dit « vous voulez croire ? » Croire c’est quoi ? Croire c’est prendre une posture. Alors on comprend généralement au sens de « prenez l’habitude de vous agenouiller et de faire votre prière », etc. Evidemment, il veut dire autre chose. La croyance s’écrit, à la lettre, se constitue : les postures sont l’élément génétique de la croyance. » [26] Cf. Deleuze et Parnet, Dialogues, op. cit., p. 74 : « D’où la force de la question de Spinoza : qu’est-ce que peut un corps ? de quels affects est-il capable ? » Cela renvoie à Spinoza, Ethique, III, prop. II, scolie : « Mais j’ai déjà montré, quant à moi, qu’ils ne savent pas ce que peut le Corps, ou ce qu’on peut déduire de la seule contemplation de la nature. » (Traduction B. Pautrat, Paris, 2010, Éditions du Seuil, p. 219) [27] Cf. Dialogues, pp. 74-76 : « Là aussi le prendre par le milieu, et non par le premier principe (substance unique pour tous les attributs). […] Le célèbre premier principe de Spinoza (une seule substance pour tous les attributs) dépend de cet agencement et non l’inverse. » [28] Cf., par exemple, la définition de la faculté de juger par Kant comme « […] le pouvoir de penser le particulier comme compris sous l’universel […] (la règle, le principe, la loi) », in Critique de la faculté de juger, trad. A. Renaut, Paris, GF Flammarion, 1995, introd., IV. [29] Comme on peut s’y attendre, la philosophie de Spinoza est exemplaire de ce type d’évaluation. L’essence d’une chose n’est en effet rien d’autre que sa puissance, qu’il s’agisse de Dieu (cf. Ethique, I, 34 : « La puissance de Dieu est son essence même. ») ou des créatures (cf. Ethique, III, 54, démonstration : « L’effort ou puissance de l’Esprit est l’essence même de cet Esprit »). Mais l’essence n’est pas ici à comprendre au sens, traditionnel, d’une idée générale : celle-ci n’est obtenue que par généralisation des données empiriques, et se trouve donc abstraite. « Dieu ne connaît pas les choses abstraitement, il ne forme pas d’elles des définitions générales et n’exige pas d’elles plus de réalité que l’entendement divin et la puissance divine ne leur en a réellement accordé » (Lettre à Blyenbergh, du 3 janvier 1665, trad. C. Appuhn). L’essence est donc toujours essence singulière, d’un étant individuel. La question éthique consiste donc à évaluer, pour chaque corps, ce qu’il peut, c’est-à-dire déterminer la puissance qui le définit ou, si l’on veut, son degré de perfection, « car essence ou perfection, c’est tout un » (Ibid.). [30] Deleuze écrit une recension de L’Individu et sa genèse physico-biologique, dans la Revue philosophique de la France et de l’étranger, vol. CLVI, n°1-3, janvier-mars 1966, pp. 115-118. L’article est repris dans L’Île déserte et autres textes, Paris, Éditions de Minuit, 2002, pp. 120-124. [31] Cf. Différence et Répétition, II, p. 119 : « C’est l’insuffisance du fondement, d’être relatif à ce qu’il fonde, d’emprunter les caractères de ce qu’il fonde, et de se prouver par eux. C’est même en ce sens qu’il fait cercle […] » [32] Deleuze, Différence et répétition, V, p. 317. [33] C’est ce que note Deleuze, reprenant S. Butler, Ibid., IV, p. 248 : « Il y a une contraction de la terre et de l’humanité qu’on appelle froment, et cette contraction est une contemplation et l’autosatisfaction de cette contemplation. Le lys des champs, par sa seule existence chante la gloire des cieux, des déesses et des dieux, c’est-à-dire des éléments qu’il contemple en contractant. Quel organisme n’est pas fait d’élément et de cas de répétition, d’eau, d’azote, de carbone, de chlorures, de sulfates contemplés et contractés, entrelaçant ainsi toutes les habitudes par lesquelles il se compose ? » [34] Avec Hume, Deleuze décrit l’habitude comme une synthèse – ou contraction – d’éléments hétérogènes qui tend à se répéter. Un corps individuel est donc une habitude au sens où il tient ensemble, de manière stable, les parties qui le composent, qui peuvent être considérées elles-mêmes comme des corps individuels de niveaux inférieurs, etc. Ce qui amène Deleuze à affirmer qu’il « […] faut attribuer une âme au cœur, aux muscles, aux nerfs, aux cellules, mais une âme […] dont tout le rôle est de contracter l’habitude. Il n’y a là nulle hypothèse barbare, ou mystique : l’habitude y manifeste au contraire la pleine générosité qui ne concerne pas seulement les habitudes sensori-motrices que nous avons (psychologiquement) mais d’abord les habitudes primaires que nous sommes, les milliers de synthèses passives qui nous composent organiquement. » (Ibid.) [35] Sur les raisons de ce changement de terminologie, cf. Stéphane Lleres, « De l’individuation à la stratification. Sur le « passage à la politique de Gilles Deleuze », http://www.implications.philosophiques.org. [36] Cf. Deleuze et Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, I, 2, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 40. [37] Cf. « Deleuze et Guattari s’expliquent », in L’Île déserte et autres textes, p. 305 : « Le processus, c’est ce que nous appelons le flux. » [38] Cf. Marx, Introduction générale à la Critique de l’Economie politique, (1857), II, trad. M. Rubel et L. Evrard, in Marx, Philosophie, Paris, Gallimard, 1965, pp. 453-454 : « La production crée des objets qui répondent aux besoins ; la distribution les répartit en fonction des lois sociales ; l’échange répartit de nouveau les objets répartis auparavant, compte-tenu des besoins individuels ; enfin dans la consommation, le produit abandonne ce mouvement social, il devient directement objet, se met au service du besoin individuel, et le satisfait dans l’acte de consommer. » [39] Les concepts de la distribution apparaissent comme l’envers des concepts de la production : Cf. Marx, Introduction générale…, II, b, p. 462 : « Par conséquent, les modes et les rapports de distribution apparaissent comme l’envers des agents de production. » Si la distribution considère la rente foncière, le salaire, l’intérêt et le profit, ce n’est que l’envers de la terre, le travail, le capital comme agents de production. L’échange, quant à lui, est toujours d’abord l’échange d’activités et d’aptitudes qui s’opèrent dans la production. L’échange des produits ne se distingue pas non plus de la production en tant qu’il a pour but la production elle-même (échange de métaux pour produire une voiture, etc.) Et même à son dernier stade, lorsque le produit s’échange pour être directement consommé, il suppose la division du travail, c’est-à-dire justement une organisation sociale de la production. [40] Cf. L’Anti-Œdipe, I, Paris, Éditions de Minuit, 1972, pp. 9-10 : « […] la production est immédiatement consommation et enregistrement, l’enregistrement et la consommation déterminent directement la production, mais la déterminent au sein de la production même. » [41] Ibid., p. 10 : « Tel est le premier sens de processus : porter l’enregistrement et la consommation dans la production même, en faire les productions d’un même procès. » La causalité immanente est décrite de manière détaillée par Deleuze dans Spinoza et la Problème de l’Expression, XI, Paris, Éditions de Minuit, 1968. [42] Cf. Spinoza et le Problème de l’Expression, XI. Dans le cas de la causalité immanente, la cause n’est pas au-delà de ce qu’elle produit. La distinction de la cause et des effets n’est pas pour autant supprimée, mais elle se formule par des formes communes, qui font l’essence de la cause et contiennent les essences des effets (les attributs de Spinoza, qui font l’essence de la Substance et contiennent les essences de modes). Dès lors, ces formes se disent en un seul sens de la cause et des effets, de la Substance et des modes. L’immanence implique donc l’univocité. Dès lors, si la production est cause immanente, produire se dit en un seul et même sens. [43] Cf. L’Anti-Œdipe, I, p. 10 : « En second lieu, il n’y a pas davantage de distinction homme-nature. […] C’est le second sens du processus ; homme et nature ne sont pas comme deux termes l’un en face d’autre, même pris dans un terme de causation, de compréhension ou d’expression, mais une seule et même réalité essentielle du producteur et du produit. » [44] Cf. Bergson, Matière et Mémoire, op. cit., avant-propos de la septième édition : « La matière, pour nous, est un ensemble d’« images ». » [45] Cf. Ibid., I, p. 33 : « Ce qui la distingue, elle image présente, elle réalité objective, d’une image représentée, c’est la nécessité où elle est d’agir par chacun de ses points sur tous les points des autres images, de transmettre la totalité de ce qu’elle reçoit, d’opposer à chaque action une réaction égale et contraire, de n’être enfin qu’un chemin sur lequel passent en tous sens les modifications qui se propagent dans l’immensité de l’univers. » [46] Ibid. : « Je la convertirais en représentation si je pouvais l’isoler, si surtout je pouvais en isoler l’enveloppe. » [47] Cf. Ibid., p. 39. [48] Cf. L’Île déserte et autres textes, p. 305 : « La définition d’une machine en général peut se réduire à […] [un] système de coupure de flux. » [49] Cf. L’Anti-Œdipe, I, p. 12 : « Mais toujours une connexion s’établit avec une autre machine, dans une transversale où la première coupe le flux de l’autre ou « voit » son flux coupé par l’autre. » [50] Ibid., I, p. 14. [51] Ibid. [52] Cf. Ibid. IV, p.248 : « Apprendre à nager, apprendre une langue étrangère, signifie composer les points singuliers de son propre corps ou de sa propre langue avec ceux d’une autre figure, d’un autre élément qui nous démembre, mais nous fait pénétrer dans un monde de problèmes jusqu’alors inouïs » [53] Ibid., p. 13. [54] En ce sens, le Corps sans Organes est le plan des flux. En tant que tel, la synthèse connective le présuppose ; mais il ne lui préexiste pas, puisqu’elle le produit : elle le présuppose sans qu’il lui préexiste jamais, elle ne le produit qu’en le présupposant et seulement dans la mesure où elle le présuppose. [55] Ibid., p. 14. [56] Cf. Ibid. : « Instinct de mort, tel est son nom, et la mort n’est pas sans modèle. Car le désir désire aussi cela, la mort, parce que le corps plein de la mort est son moteur immobile, comme il désire la vie, parce que les organes de la vie sont la working machine. » On se rappellera que Freud définissait justement la pulsion de mort comme celle qui tend au retour à un état anorganique. Cf. Freud, « Au-delà du principe de plaisir », ch. 6, trad. J. Laplanche et J.-B. Pontalis, in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981. [57] Deleuze, Francis Bacon. Logique de la Sensation, Paris, Seuil, 2002, ch. 7, p. 55. [58] Deleuze et Guattari, Mille Plateaux, 6, Paris, Éditions de Minuit, 1980, p. 196. [59] Notons que c’est précisément, pour Deleuze, l’effet de l’art. Cf. Francis Bacon. Logique de la Sensation, op. cit., ch. 8, p. 57 : « La tâche de la peinture est définie comme la tentative de rendre visibles des forces qui ne le sont pas. De même la musique s’efforce de rendre sonores des forces qui ne le sont pas. C’est une évidence. […] C’est ainsi que la musique doit rendre sonores des forces insonores, et la peinture, visibles, des forces invisibles. Parfois ce sont les mêmes : le Temps, qui est insonore et invisible, comment peindre ou faire entendre le temps ? Et des forces élémentaires comme la pression, l’inertie, la pesanteur, l’attraction, la gravitation, la germination ? » [60] Ibid., p. 48 : « Une puissante vie inorganique : c’est ainsi que Worringer définissait l’art gothique, la ligne gothique septentrionale. » [61] Cf. Ethique, II, 13, définition. [62] Ibid., I, 34, III, 7 ou III, 54, démonstration. [63] Cf. par exemple, Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Editions de Minuit, 1981-2003, p. 134 : « L’identité de la puissance et de l’acte s’explique par ceci : toute puissance est inséparable d’un pouvoir d’être affecté, et ce pouvoir d’être affecté se trouve constamment et nécessairement rempli par les affections qui l’effectuent. » [64] Deleuze, Cinéma 2, 1, p. 30. [65] L’Anti-Œdipe, I, p. 13. [66] Deleuze et Guattari, Kafka, Paris, Éditions de Minuit, 1975, I, p. 7. [67] Ibid. [68] C’est l’univocité de la production qui amène à affirmer qu’une formation sociale est produite au même sens qu’un corps individuel. [69] Mille Plateaux, 6, p. 186. [70] Deleuze et Guattari définissent en effet le désir comme « […] cet ensemble de synthèses passives qui machinent les objets partiels, les flux et les corps, et qui fonctionnent comme des unités de production. » (Anti-Œdipe, I, p. 34). C’est en ce sens que le désir est, par sa productivité même, dangereux pour toute formation sociale déjà établie : « Si le désir est refoulé, c’est parce que toute position de désir, si petite soit-elle, a de quoi mettre en question l’ordre établi d’une société : non que le désir soit a-social, au contraire. Mais il est bouleversant ; pas de machine désirante qui puisse être posée sans faire sauter des secteurs sociaux tout entiers. […] Il est donc d’une importance vitale pour une société de réprimer le désir […] » (Anti-Œdipe, II, p. 138). [71] « Si le désir est refoulé, ce n’est pas parce qu’il est désir de la mère, et de la mort du père ; au contraire, il ne devient cela que parce qu’il est refoulé, il ne prend ce masque-là que sous le refoulement qui le lui modèle et le lui plaque. » (Ibid.) [72] Mille Plateaux, p. 186. [73] Il est vrai que comme le remarque Alain Badiou dans « Existe-t-il quelque chose comme une politique deleuzienne ? », in Cités, n°40, Paris, P.U.F., 2009, la politique ne constitue jamais un domaine ou un type de pensée spécifique chez Deleuze. Mais si Alain Badiou considère l’expérimentation comme éthique, c’est aussitôt pour admettre que cette éthique a une portée politique : « Nous expérimentons, tous, la nécessité absolue de créer quelque chose qui ne soit pas le combat entre deux sortes de morts. Après tout, oui, c’est bien là une question éthique, mais aussi une question politique. » Cette difficulté à penser une politique qui serait indépendante de l’éthique tient selon nous à la manière univoque dont Deleuze, à la suite de Spinoza, comprend le corps. Le corps politique ou social est un corps au même sens que le corps biologique : comme mon corps consiste dans le nouage de flux hétérogènes, il en va de même du corps social ou politique : les flux qu’il noue sont ceux qui passent déjà par les corps biologiques individuels. En ce sens, l’expérimentation de mon propre corps et les devenirs qu’elle induit ont des effets sur le corps social, c’est-à-dire des effets politiques. Réciproquement, les expérimentation politiques ont nécessairement des effets sur mon corps, c’est-à-dire des effets éthiques. [74] Cinéma 2, 1, p. 31. [75] Cette position est défendue, par exemple, par Paola Marrati dans Gilles Deleuze. Cinéma et Philosophie, Paris, P.U.F., 2003, p. 107. [76] Cf. Dialogues, IV, p. 176 : « La question de l’avenir de la révolution est une mauvaise question, parce que tant qu’on la pose, il y a autant de gens qui ne deviennent pas révolutionnaires, et qu’elle est précisément faite pour cela, empêcher la question du devenir-révolutionnaire des gens, à tout niveau, à chaque endroit. » [77] Cf. Ibid. : « Au lieu de parier sur l’éternelle impossibilité de la révolution et sur le retour fasciste de la machine de guerre en général, pourquoi ne pas penser qu’un nouveau type de révolution est en train de devenir possible, et que toutes sortes de machines mutantes, vivantes, mènent des guerres, se conjuguent, et tracent un plan de consistance qui mine le plan d’organisation du Monde et des Etats ? »











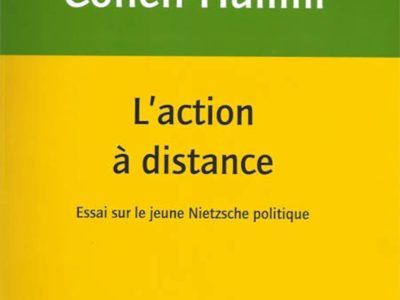



« Croyance et immanence dans la philosophie de Gilles Deleuze » (1 et 2) : textes intéressants et éclairants, même si le sujet est extrêmement complexe. Mais les nombreuses fautes d’orthographe compliquent encore une lecture déjà ardue par nature. Il serait souhaitable, avant de publier de tels articles, de les faire relire par un correcteur… au moins pour la forme, sinon pour le fond.